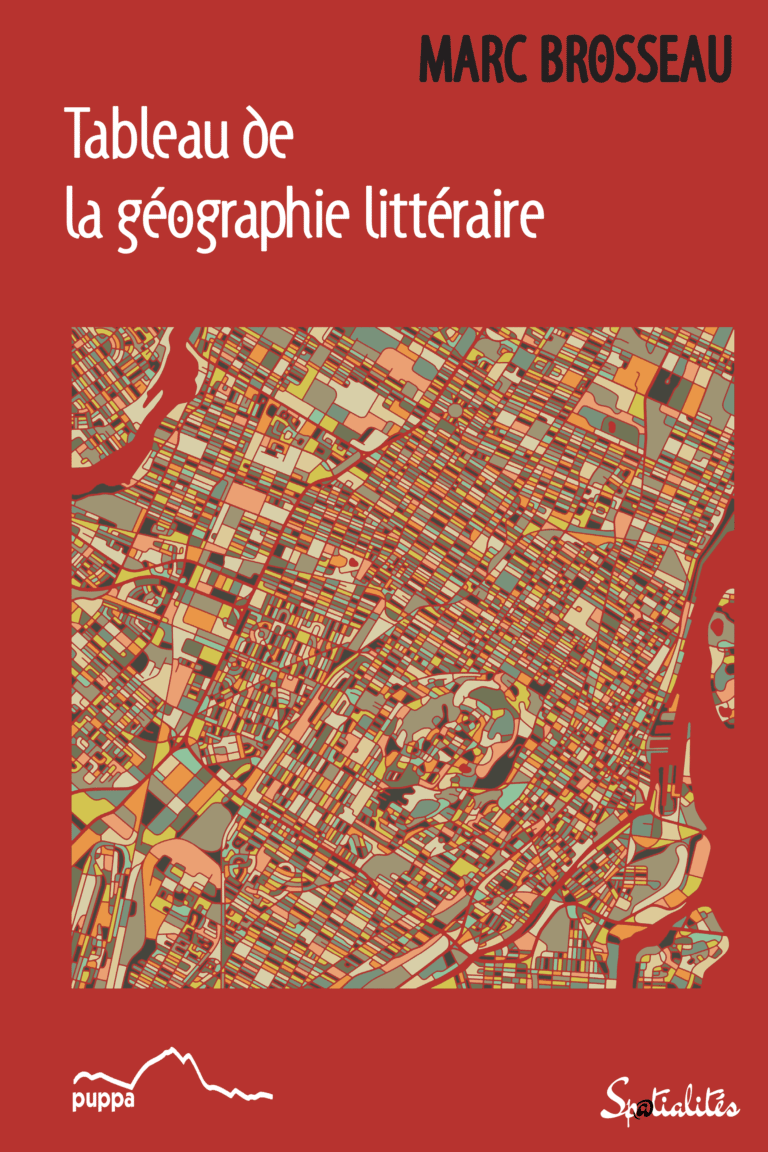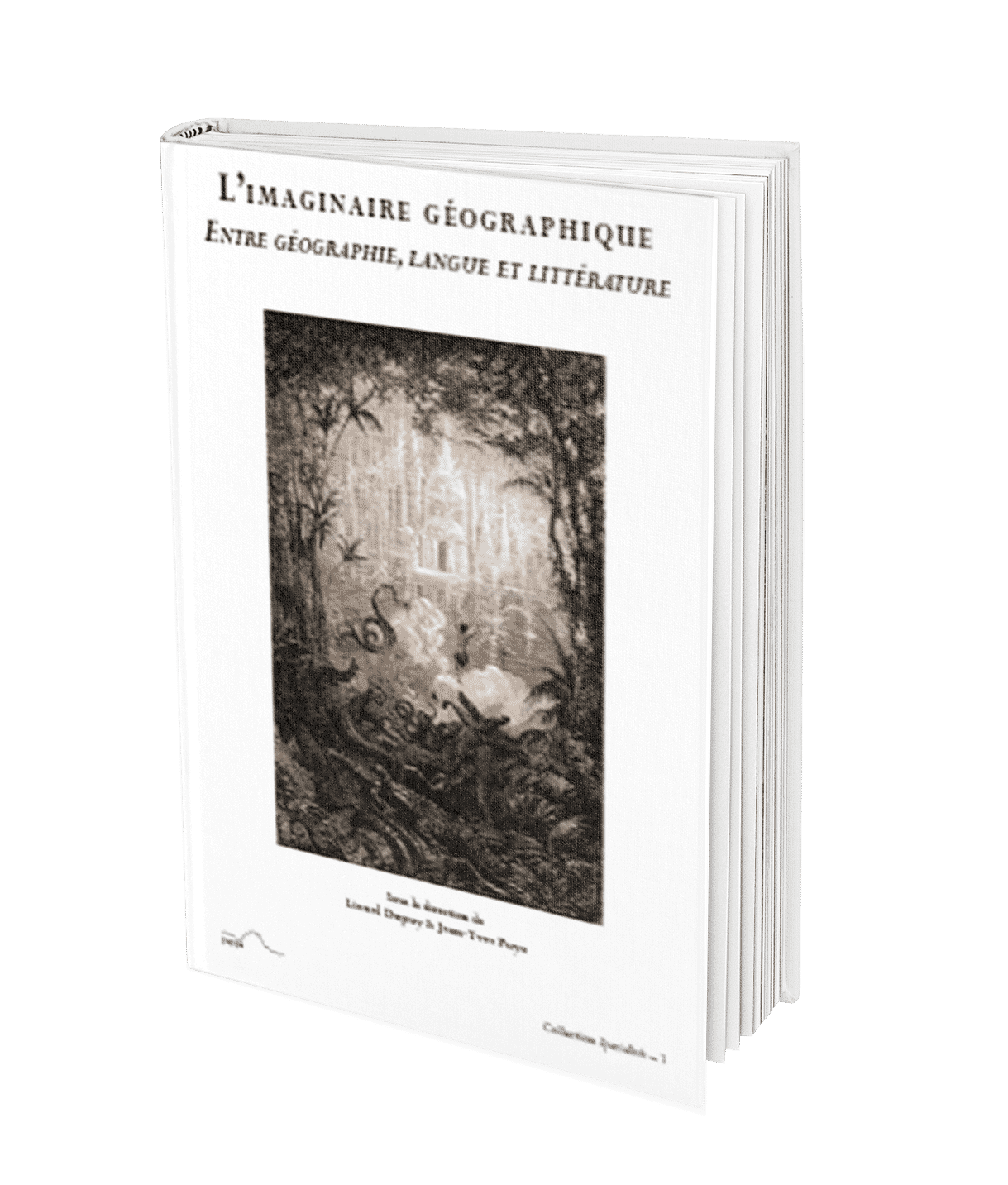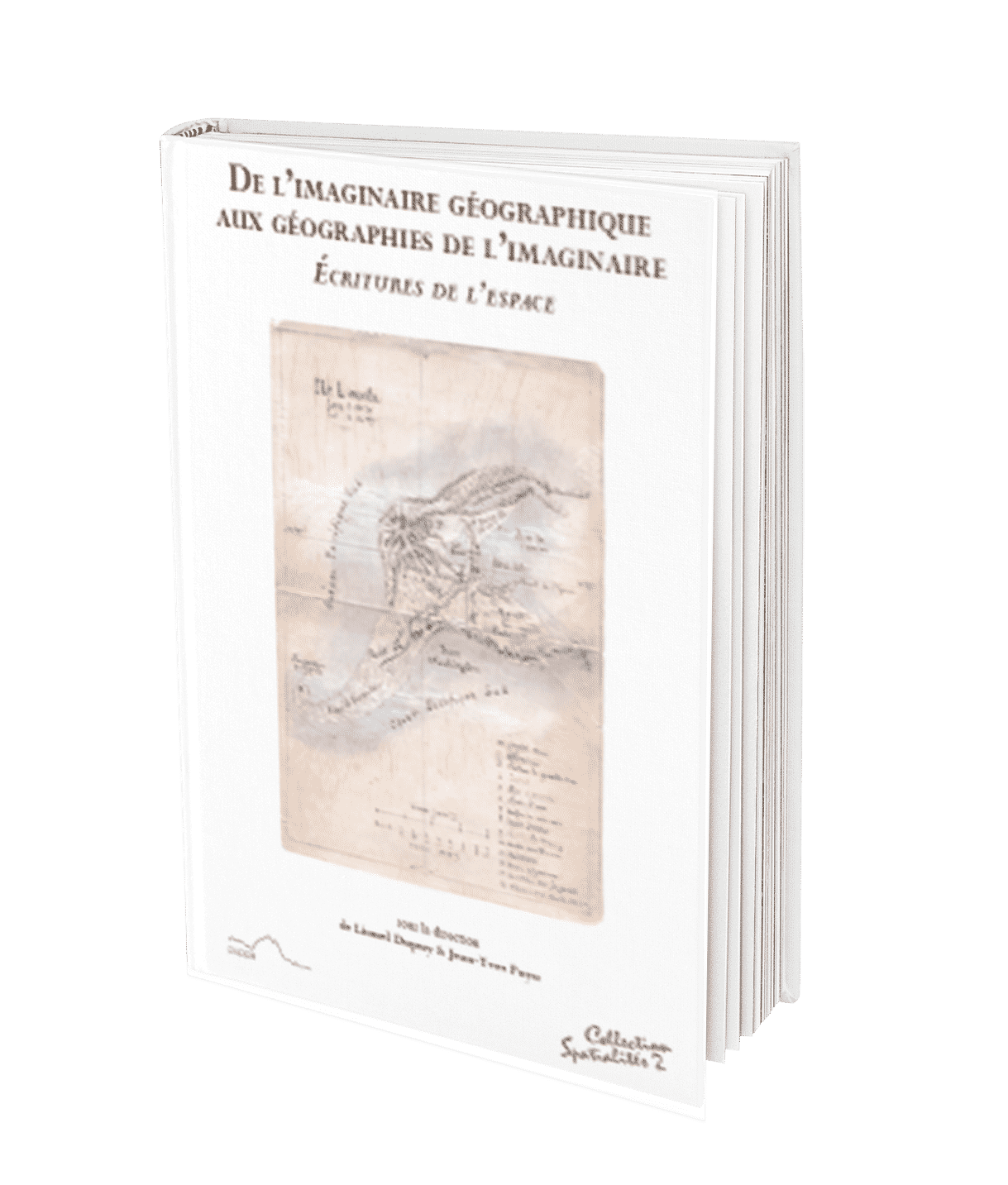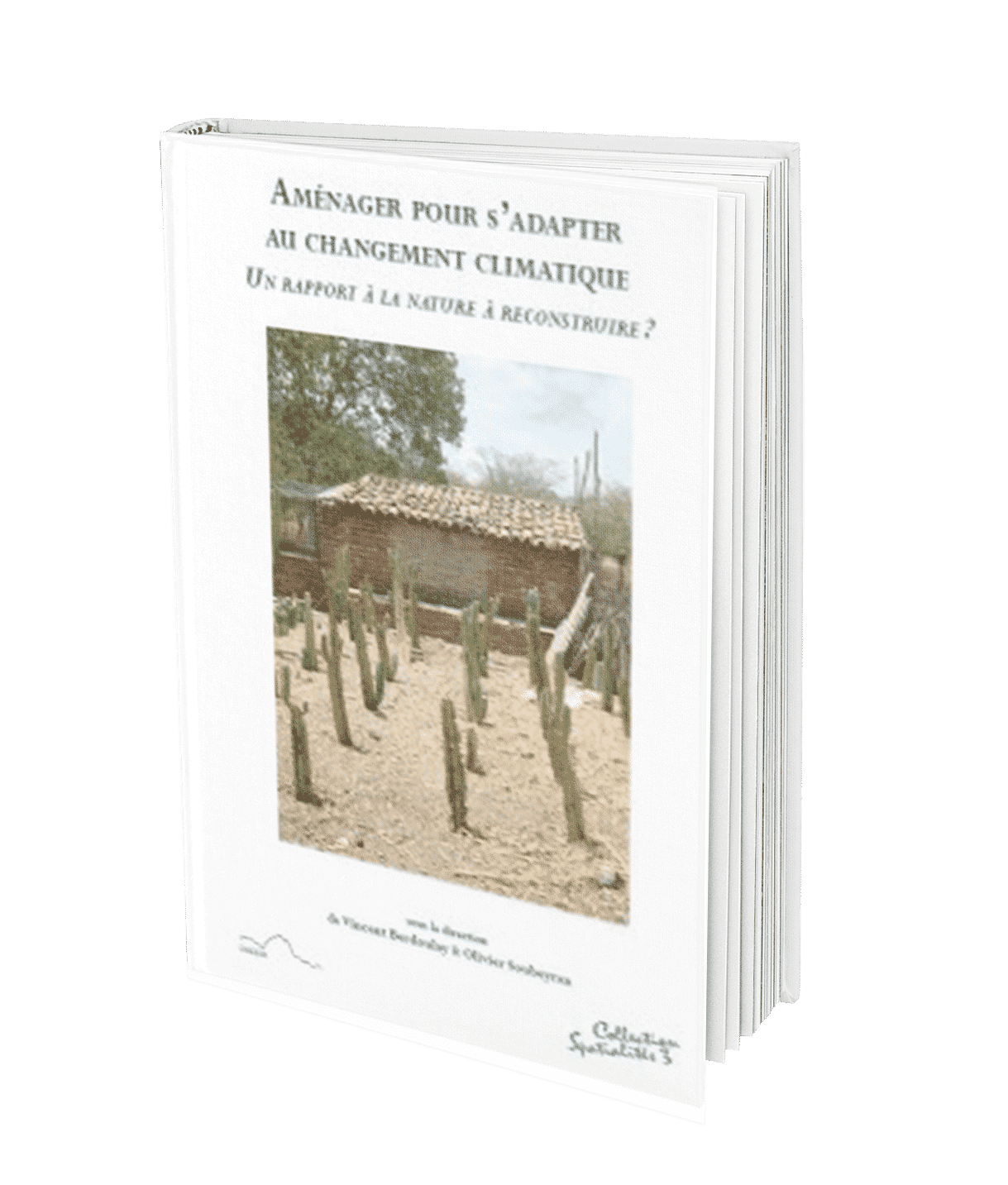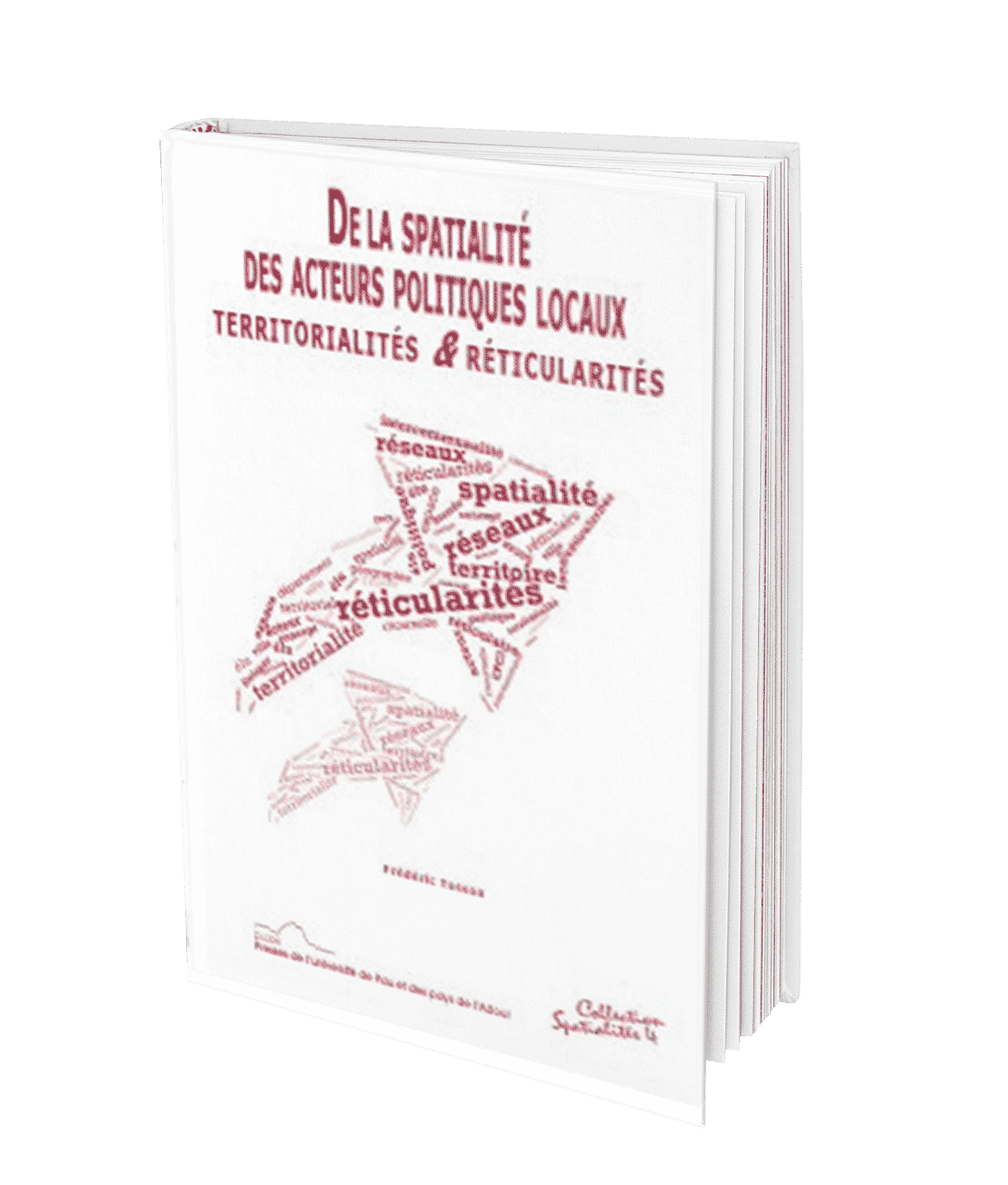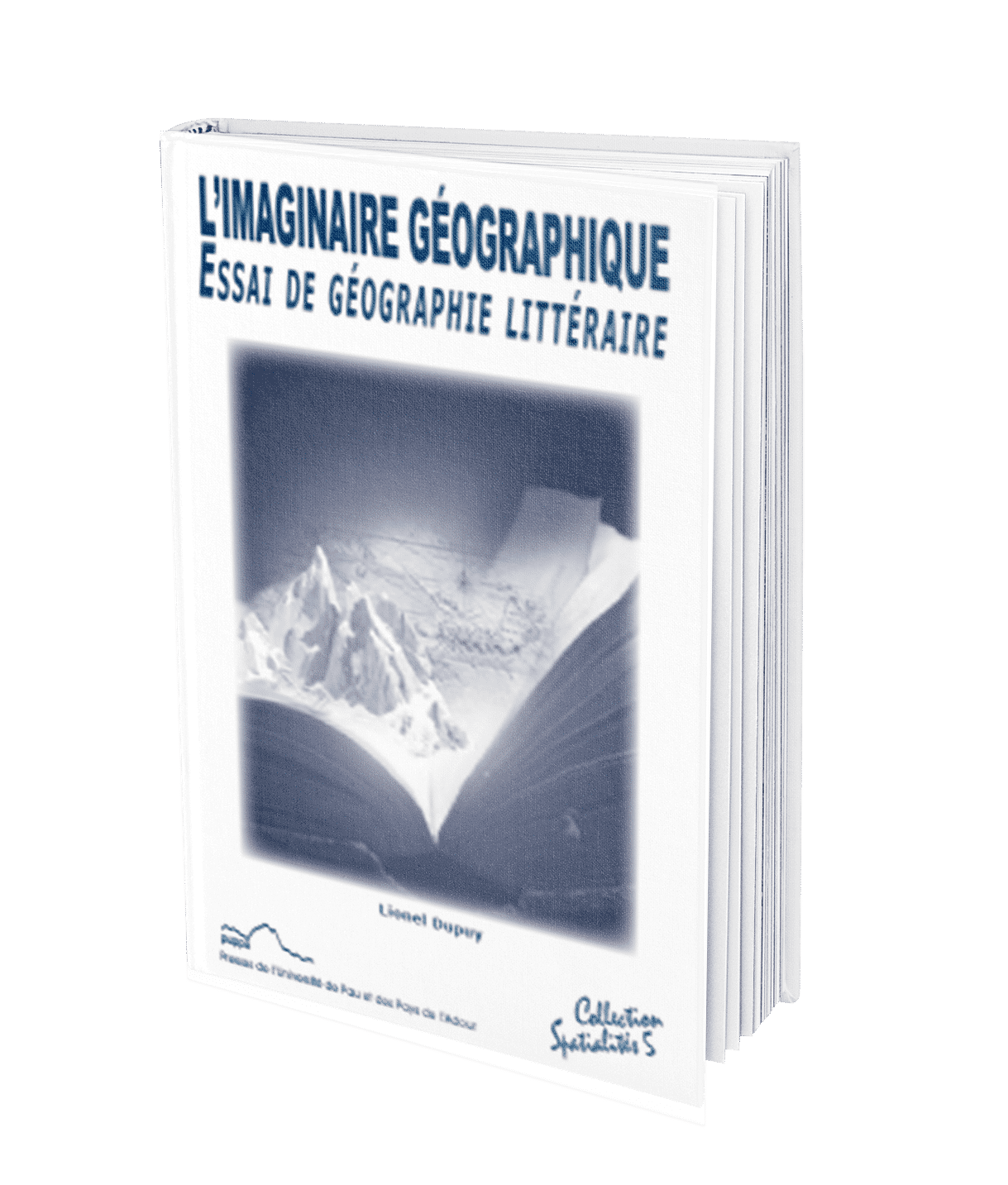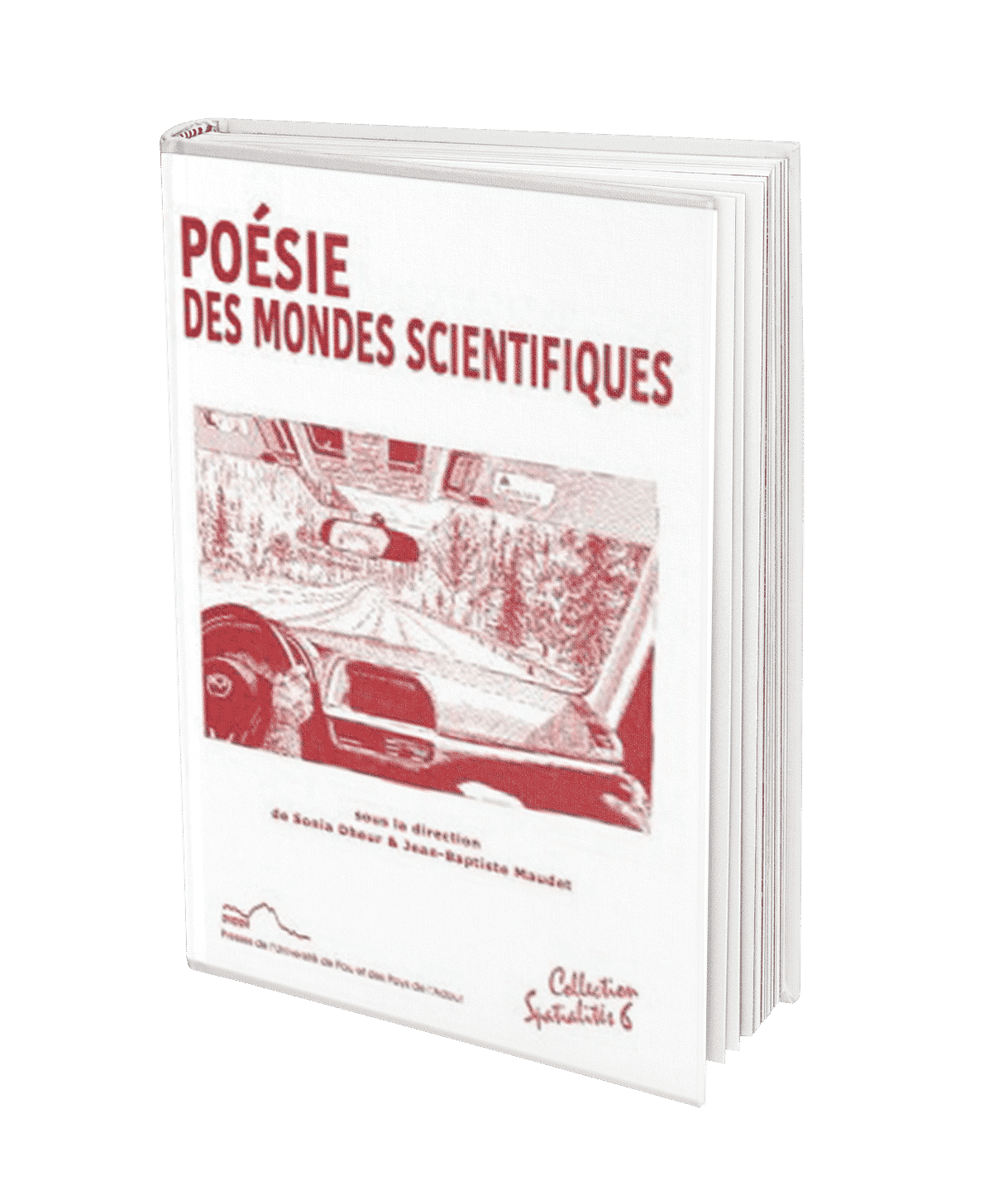Au sein des études géographiques, qu’elles recourent ou non aux œuvres littéraires, la thématique de l’imaginaire n’est pas nouvelle. Elle fait toutefois l’objet d’un intérêt renouvelé depuis une vingtaine d’années (Bailly, 1989 ; Sénécal, 1992 ; Debarbieux, 2003 ; 2015 ; Chivallon, 2008 ; Berdoulay, 2012 ; Bédard et al. 2012). Même à ses débuts, cette curiosité pour l’imaginaire est associée à une réflexion sur la littérature. Déjà, au milieu de XIXe siècle, Humboldt consacrait deux chapitres de son Cosmos à la littérature et à la peinture (Bunkse, 1981 ; Lévy, 2006). Dans la tradition anglo-américaine, J.K. Wright est sans doute le premier parmi les géographes à défendre l’idée selon laquelle la littérature constitue une source privilégiée pour stimuler l’imagination géographique (Wright, 1924 ; 1947). Lorsque la littérature est « finalement » devenue un peu plus qu’un objet de recherche périphérique avec l’avènement de la géographie humaniste dans les années 1970, elle fut encore une fois valorisée en tant que produit de l’imagination humaine. Dans la recherche contemporaine en géographie littéraire, la question de l’imaginaire demeure une préoccupation centrale.
Si l’on considère toutefois comment l’imaginaire y est conceptualisé, on constate une grande diversité d’approches qui recourent à des notions certes voisines mais qui s’appuient sur des positions épistémologiques différentes. En effet, lorsque les géographes traitent de géographies imaginaires, de géographies imaginatives (traduction littérale de la notion développée par Saïd) ou encore d’imaginaire géographique, ils ne parlent pas exactement de la même chose. Ils ne s’appuient pas sur la même conception de l’imagination (en tant que faculté) ni n’accordent préséance aux mêmes entités (à l’auteur, au contexte, au texte ou au lecteur). Les chaines causales dominantes qui relient ces éléments ne pointent pas dans la même direction selon que l’on privilégie une approche ou une autre. Lorsque c’est l’imagination créatrice de l’auteur qui est valorisée, je parlerai en termes d’imaginaire conquérant, capable de donner du sens au monde par l’entremise de géographies imaginaires. Lorsqu’il s’agit plutôt de comprendre l’ensemble de déterminations qui pèsent sur leur élaboration, je parlerai plutôt en termes d’imaginaires conquis qui peuvent tout de même, en tant que discours, participer à la diffusion et naturalisation d’images du monde. Ces géographies imaginatives ont donc aussi quelque chose de conquérant sur un plan sociologique ou politique. Enfin, lorsqu’il est envisagé comme une forme de médiation entre auteur et lieu par exemple, comme une interface entre culture populaire et culture savante ou encore comme une matrice de sens qui informe les pratiques individuelles en même temps qu’elle est travaillée par celles-ci, je parlerai plutôt d’imaginaire géographique. Les exemples dont il sera question dans ce chapitre devraient permettre d’illustrer ces différences et leurs implications pour la recherche.
Géographies imaginaires : culture et littérature sous le signe de l’imaginaire conquérant
Prenons comme point de départ le traitement réservé à l’imaginaire géographique en littérature par un géographe associé au courant humaniste. Je pense ici aux nombreux travaux de Luc Bureau, d’ailleurs trop peu souvent évoqués ou sollicités par la géographie littéraire. Dans sa belle Géographie de la nuit, par exemple, il sonde mythes et littérature (de la littérature gréco-romaine à Gracq, en passant par Rabelais, Shakespeare, Goethe, Rétif de la Bretonne et Baudelaire pour ne nommer que ceux-là) pour réfléchir comment l’homme a imaginé et, en quelque sorte, inventé la nuit (Bureau, 1997). Nous avons affaire ici à une conception unitaire ou idéaliste de l’âme humaine (fruit d’un sujet souverain doté d’un libre-arbitre autonome) et, avec elle, une version conquérante de l’imaginaire. Pour Bureau, c’est bel et bien l’homme qui donne sens au monde, qui l’ordonne à coup de mots et de paroles, d’idées (folles ou géniales), de symboles, de métaphores, et d’images multiples :
« Les hommes soumettent le monde à la servitude de leur imagination. L’illusion, le rêve, les fantasmes, les subjectivités, les erreurs d’appréciation sont au début, au milieu et à la fin de notre aventure sur terre » (Bureau, 2001, p. 46).
La réflexion ne porte ni sur une tentative de distinguer les faits de la fiction (nous sommes résolument dans le règne de l’imagination), ni sur les conditions matérielles de production (l’origine sociale de l’auteur n’ayant pas d’incidence ou de pertinence pour penser les rapports de la culture avec l’imaginaire de la nuit) ni, au demeurant, sur les dimensions formelles du discours qui les porte. D’ailleurs, plusieurs de ses autres ouvrages, pourtant largement élaborés dans un rapport chaleureux et érudit avec la littérature ne se lisent pas tant comme des exemples de géographie à proprement parler « littéraire » mais bien comme des essais de géographie culturelle (Bureau, 2001 et 2009).
La littérature constitue d’abord et avant tout pour lui une porte d’entrée dans l’univers de la culture, qui est sa préoccupation première. Bureau n’envisage pas la représentation littéraire de l’espace dans le flux complexe du récit dans lequel elle se déploie, ni ne mobilise les catégories de la critique littéraire pour l’interpréter. Non, il est fidèle en cela aux enseignements de Gaston Bachelard, selon lequel, c’est au « niveau des images détachées que nous pouvons ‟retentir” phénoménologiquement » (Bachelard, 1957, p. 197). Le sens circule librement des images aux idées dans la mesure où on se rend « disponible » à leur scintillement. Comme il l’écrit lui-même : « c’est devenu pour moi une loi : il faut sentir pour comprendre » (Bureau, 2009, p. 172). Plus proche de la démarche des comparatistes, son travail s’acharnera à trouver ou encore à tisser un jeu d’écho et de résonance entre toutes ces « images détachées ». Il s’inscrit ainsi dans la foulée de la critique de l’imaginaire (aussi appelée critique thématique) dont Bachelard serait un des précurseurs, type de critique d’ailleurs compatible avec les prérogatives philosophiques de la géographie humaniste. Voyons ici comment il sollicite les poètes et mêle ses idées aux leurs pour saisir les géographies imaginaires de la ville :
« Boris Vian aime le soleil mais n’aime pas les rues ensoleillées : ça manque trop de couleurs, de rires, de larmes et de mystères. Si bien qu’il ne consent à sortir de chez lui qu’à la brunante : ‟Et le soir il vient un moment / Où la rue devient autre chose / Et disparaît sous le plumage / De la nuit pleine de peut-être / Et des rêves de ceux qui sont morts /Alors je descends dans la rue / Elle s’étend là-bas jusqu’à l’aube”. (Boris Vian, cité dans Charpentrau, 1979, p. 83) […] Chez Baudelaire, dans la mesure où la ville nocturne se trouve transfigurée par l’imagination (‟L’imagination fait le paysage”), la substance de cette ville se transforme en havre de paix ou en antre de démons : ‟Sois sage ô ma Douleur, et tiens-toi plus tranquille. / Tu réclamais le Soir ; il descend ; le voici : / Une atmosphère obscure enveloppe la ville, / Aux uns portant la paix, aux autres le souci.” (Baudelaire, Les Fleurs du mal) […] Faisons enfin écho au témoignage d’un autre poète, Jean Tardieu, qui, aussi succinctement qu’on puisse le faire, porte la ville nocturne à son ultime point d’altérité : ‟la vraie ville est dans la nuit.” (cité dans Charpentrau, p. 124)
Et si pour vivre, il nous fallait ce dédoublement. Si la nocturnité dionysiaque nous était aussi nécessaire – individuellement et collectivement – que la diurnité apollinienne. La leçon serait claire. La ville où nous aurions totalement réussi à exorciser les ténèbres ne serait qu’une termitière totalitaire, un prodige d’inhumanité, un anti-rêvoir. Pourtant, nous y voilà presque dans cette ville incandescente, soûle de mégawatts, ennemie jurée de l’ombre : ‟[…] nous y voilà, dans l’extrême clarté, la lumière qui aveugle, aplatit les reliefs, gomme les recoins, dans cette toute puissance qui rêve même d’abolir la nuit”. (Nicole Czechowski, Autrement, n° 125, 1991) Saisis du regret des rendez-vous manqués, les géographes pourront alors s’exercer à l’inventaire des figures nocturnes résiduelles » (Bureau, 1997, p. 123-5).
Je prends l’œuvre de Bureau comme point de départ, surtout pas pour m’en servir comme repoussoir – elle constitue pour moi un des plus stimulants exemples d’une géographie culturelle humaniste ayant un recours privilégié aux œuvres littéraires – mais bien pour montrer comment plusieurs recherches illustrent l’intérêt d’associer la réflexion sur l’imaginaire littéraire géographique aux autres approches de la littérature (Brosseau, 2017). En fait, l’objet et l’intérêt des essais de Bureau se situent ailleurs, dans la substance des géographies imaginaires de la nuit. Il s’agit bien, de son point de vue, d’autant de géographies de l’esprit qui célèbrent la créativité des écrivains pour révéler le sens du monde et souvent même le lui donner.
Géographies imaginatives : imagination conquise et discours conquérant
Nous l’avons vu dans un chapitre précédent, plusieurs travaux de géographie s’inscrivant dans la mouvance humaniste, d’hier à aujourd’hui (Tuan, 1978 ; Pocock, 1981b ; Lévy, 1989 ; 2007 ; Desbois et Gervais-Lambony, 2017) ont justifié le recours à la littérature en affirmant qu’elle était en mesure de saisir le caractère évanescent, complexe, et subtile de l’expérience des lieux, qu’elle le faisait sans la médiation desséchante du discours scientifique et que, de ce fait, elle pouvait formuler des vérités universelles sur notre humaine condition. C’est précisément ce type d’affirmations qui a fait l’objet de critique de la part des géographes radicaux selon lesquels il s’agissait d’une conception naïvement apolitique de la littérature qui est complètement insensible aux rapports de pouvoir dont elle procède. Cette façon de voir la littérature sera ensuite critiquée, par d’autres, dans la mesure où elle s’appuie sur une conception transcendantale de la subjectivité humaine d’une part et sur une conception mimétique (strictement transitive) du langage de l’autre. La géographie radicale a peu produit d’études de cas et lorsqu’elle l’a fait, il s’agissait plutôt d’études portant sur des questions de justice sociale et spatiale. Or, d’un point de vue théorique, certains géographes critiques ont prêté à l’imaginaire à l’œuvre dans la littérature une fonction sociologique fort différente. Selon Olwig, l’imaginaire littéraire permet d’envisager « non pas ce que la réalité est, mais plutôt ce qu’elle devrait être » (Olwig, 1981, p. 48, ma traduction). Dans le même esprit, Silk affirme que la littérature peut « fournir les fondements pour intervenir dans le processus ‟d’appropriation mentale du monde” qui combat l’idéologie bourgeoise » (Silk, 1984, p. 151, ma traduction). Dans les deux cas, on insiste sur la fonction sociale de la littérature et on relie donc géographie « dans » la littérature » et géographie « de » la littérature. L’auteur n’y est plus un « créateur de génie » mais bien un producteur imbriqué dans la chaine sociologique de la production littéraire. Chemin faisant, l’agentivité n’est plus accordée à l’auteur comme tel, mais bien aux conditions sociales de production (déterminisme de classe) et au contenu idéologique de l’œuvre qui sert les intérêts de ceux qui le diffusent. Des géographies humanistes aux géographes radicaux on passe d’un imaginaire conquérant qui célèbre la capacité humaine de donner du sens au réel à un imaginaire conquis parce qu’émanant d’un producteur dont l’imagination est surdéterminée par les conditions socio-spatiales à l’intérieur desquels il évolue. Or, en tant que « produit » ces géographies imaginaires jouent un rôle actif dans le « processus d’appropriation mental du monde ». C’est dans cette perspective que peut se comprendre le type d’imaginaire que sous-entend la notion de géographie imaginative développée par Edward Saïd.
La dimension sociologique de la littérature sera reformulée avec une plus grande cohérence à la faveur de la « découverte » des travaux de Saïd sur l’orientalisme et, plus spécifiquement, le concept de « géographie imaginative », introduit en géographie par Gregory au milieu des années 1990 (Gregory, 1994, 1995)1. Il constitue depuis un des concepts importants de la géographie humaine, étant intégré aux dictionnaires et manuels d’introduction à la discipline. Dans la plus récente édition du Dictionnary of human geography, Gregory les définit ainsi : « des représentations d’autres lieux – de peuples et de paysages, de cultures et de ‟natures” – qui expriment les désirs, les fantasmes et les craintes de leurs auteurs et les rapports de pouvoir entre eux et leurs ‟autres” » ( « representations of other places – of people and landscapes, cultures and ‟natures” – that articulate the desires, fantasies and fears of their authors and the grids of power between them and their ‟Others” ») (Gregory, 2009, p. 369-70). La dimension relationnelle et asymétrique des représentations qui en découlent apparaît clairement dans les formulations de Saïd lui-même :
« la pratique universelle qui consiste à désigner dans son esprit un espace familier comme le ‟nôtre” et un espace qui ne l’est pas comme le ‟leur”, est une manière de faire des distinctions géographiques qui peuvent être totalement arbitraires. J’emploie le mot ‟arbitraires” parce que la géographie imaginaire du type ‟notre pays – le pays des barbares” ne demande pas que ces derniers reconnaissent la distinction » (Saïd, 1980, p. 110).
Ces géographies imaginatives, dont la littérature de fiction et les récits de voyages sont d’importants vecteurs, sont ainsi analysées, et souvent dénoncées d’ailleurs, comme autant de discours destinés à confirmer, naturaliser ou légitimer des visions binaires du monde, des idéologies spatiales asymétriques, avec des espaces nobles et des espaces sauvages, des territoires à imiter, d’autres à « civiliser », etc. Critique dans ses visées premières, et d’ailleurs très efficace en la matière, cette acception de la géographie imaginaire a toujours, ou presque, des accents politiques comme le veulent les études postcoloniales qui lui servent de cadre interprétatif. Si ces prérogatives critiques ont le mérite de mettre en lumière la pertinence sociologique et historique des représentations littéraires de l’espace et des territoires, elles canalisent en conséquence presque tous les regards dans une même direction et sont à ce titre sans cesse préoccupées par ce que l’on pourrait désigner comme les enjeux politico-culturels de la représentation.
Il s’agit donc encore, pour l’essentiel tout au moins, d’une forme d’imaginaire « conquis », déterminé par l’extériorité de l’auteur par rapport à l’objet de la représentation (ce que Saïd désigne comme sa localisation stratégique), laquelle se donne à lire et à interpréter en fonction du tissu complexe de rapports de pouvoir inégaux dont elle procède et qui lui procure une forme d’autorité.
« Pour cette étude de l’autorité, mes principaux outils méthodologiques sont ce qu’on peut appeler la localisation stratégique, qui est une manière de décrire la position de l’auteur d’un texte par rapport au matériau oriental sur lequel il écrit, et la formation stratégique, qui est une manière d’analyser la relation entre les textes et la façon dont les groupes de textes, de genres de textes même, acquièrent de la masse, de la densité et un pouvoir de référence » (Saïd, 1980, p. 58).
Or, on l’aura bien compris, ces géographies imaginatives ne sont pas que des « produits » : elles possèdent une puissante dimension « performative » (légitimation et naturalisation des représentations du monde). Il s’agit en quelque sorte d’une reformulation de ce que la géographie radicale désignait sous le terme de « processus d’appropriation mentale du monde ». Toutefois, les tenants et aboutissants de cette dimension performative seront mieux étoffés que dans les travaux s’inspirant de l’esthétique marxiste dont il vient d’être question. Les travaux de Phillips sur les romans d’aventures anglais à l’époque coloniale, nous l’avons vu au chapitre précédent, fournissent des exemples convaincants de la pertinence de telles approches dans la mesure où ils décrivent par exemple la « localisation stratégique » des auteurs et qu’ils « documentent » le type de services rendues par ces représentations à l’entreprise coloniale (Phillips, 1997). Ceux que Peter Hugill consacre à la littérature juvénile destinée aux garçons à l’époque edwardienne abondent dans le même sens (Hugill, 1999). Plus souvent mobilisé pour déconstruire les discours littéraires produits à l’époque coloniale, le concept de géographie imaginative s’avère aussi efficace pour mettre en lumière les représentations d’une forme d’altérité orientalisée dans les romans fantaisistes (Balfe, 2004) ou la littérature de voyages contemporaine (Tavares et Brosseau, 2006).
La littérature, nous l’avons vu avec l’exemple du roman de Salman Rushdie, peut aussi produire des « contre-géographies imaginatives » et incarner une forme d’agentivité culturelle ou de résistance à l’hégémonie. Les géographies imaginatives littéraires ainsi conçues sont à la fois un instrument idéologique de domination mais aussi un levier de résistance symbolique (McKittrick, 2000 ; Noxolo et Preziuso, 2011). Juha Ridanpää a montré que la résistance aux géographies imaginatives stéréotypées du nord de la Finlande (les territoires exotiques, sauvages et presque mythologiques de la Laponie) prend la forme d’une ironie métafictive qui met en abyme les artifices de sa propre construction dans les romans de Rosa Liksom (Ridanpää, 2007). La résistance symbolique demeure toutefois une affaire délicate. Bien qu’elle dispose de toutes les ressources du discours littéraire pour s’exprimer, elle n’échappe tout de même pas à ses pièges ou ses écueils. Angharad Stephens a bien illustré le problème dans son analyse des géographies imaginatives de ladite guerre au terrorisme ou « War on terror », comme le veut l’expression d’usage aux États-Unis (Stephens, 2011). Son interprétation du roman de Mosid Hamid, The reluctant fundamentalist, publié en 2007 (traduit en français la même année sous le titre L’intégriste malgré lui, puis rapidement porté à l’écran en 2012), suggère que des romans postcoloniaux comme celui de Hamid « fournissent un matériau pour déstabiliser les repères spatiaux et temporels des géographies imaginatives dominantes ». En revanche, en tant qu’intervention ou prise de position politique et culturelle, ces romans courent « le risque de reproduire l’argumentaire et les codes sur lesquels s’élaborent les géographies imaginatives de la War on terror qu’ils cherchent par ailleurs à combattre ». Ultimement, et sans doute pas intentionnellement, ils servent souvent à les « consolider et leur assurer une diffusion encore plus grande et un écho plus intense » (Stephens, 2011, p. 257 et 260, ma traduction libre).
L’analyse des géographies imaginatives commande ainsi une sensibilité aux stratégies discursives qui les produisent. Il convient alors de chercher les éléments du texte qui permettent de déconstruire les oppositions binaires asymétriques sur lesquelles elles se fondent, la rhétorique qui les porte, les formes narratives qui leur donnent vie. Chemin faisant, cela donne lieu à un nouveau déplacement de la préséance causale dans l’analyse et la compréhension des ressorts de l’imaginaire. Dans le premier cas, celui de la géographie humaniste, nous avons affaire à une forme conquérante d’imagination qui produit des géographies imaginaires qui donnent du sens au monde et qui sont porteuses de vérités universelles. C’est donc l’imagination humaine qui a préséance, qui est le maillon premier de la chaine causale : c’est là que se situe l’agentivité première. Dans le second, plus généralement matérialiste, les géographies imaginaires procèdent d’une forme d’imagination conquise parce que surdéterminée par les conditions sociales de leur production. Or, en tant que produits, ces géographies imaginaires sont dotées d’un pouvoir idéologique dans le « processus d’appropriation mentale du monde ». La « source » de leur agentivité n’en demeure pas moins « localisée » dans les conditions matérielles de production. Dans le dernier cas, celui des études postcoloniales, elles procèdent également d’une forme conquise de l’imagination, tout empêtrées qu’elles sont dans un réseau complexe de relations de pouvoir inégales (forme de déterminisme social encore une fois, mais démultiplié en fonction de facteurs sociaux, culturels ou identitaires plus nombreux). Or, la préséance causale se déplace encore un peu. Leur potentiel idéologique ne provient plus uniquement de ce réseau de relations de pouvoir qui alimenterait pour ainsi dire le potentiel « performatif » dont elles disposent. Celui-ci se situe surtout (mais non uniquement) dans les ressources du langage lui-même. La conception du discours à laquelle souscrit Saïd est foucaldienne à plusieurs égards – le discours est constitutif de l’objet qu’il décrit – et c’est en tant que discours que les géographies imaginatives sont dotées d’un pouvoir social effectif. Il ne suffit pas d’identifier le « contenu » idéologique de ces représentations et de savoir d’où elles proviennent. Il convient de mettre à jour la discursivité, la textualité en un mot, qui leur procure, justement, un tel pouvoir idéologique. Ainsi, la localisation première de l’agentivité, est-elle passée de l’auteur au contenu idéologique du discours, à sa textualité.
« Il faut considérer, insiste Saïd, le style, les figures du discours, le plan, les procédés narratif, les conditions historiques et sociales, et non l’exactitude de la représentation ni sa fidélité à quelque grand original » (Saïd, 1980, p. 60).
En portant une attention particulière à la textualité même des géographies imaginatives, l’interprétation postcoloniale combine donc, pour reprendre les termes de Collot, une géopoétique destinée à mettre en lumière sur les dimensions discursives qui les portent, une approche de type géocritique préoccupée par le sens et les significations qu’elles donnent aux lieux et aux territoires et une géographie de la littérature qui l’inscrit dans les conditions sociales et politiques de leur production.
Une part grandissante des recherches qui s’inscrivent dans le sillon des études postcoloniales tendent à envisager ses nombreux enjeux en termes davantage relationnels. Cela implique, selon Clive Barnett, « la nécessité d’abandonner l’accent mis sur le conflit manichéen irrémédiable entre colonisateur et colonisé au profit de concepts axés sur les processus de communication interculturelle » (« the need to shift away from a strong emphasis on irredeemable Manichean conflict between colonizer and colonized, towards concepts which focus upon processes of cross-cultural communication ») (Barnett, 2006, p. 152). Cela implique donc aussi de penser à ces rapports en termes de médiation. Les travaux subséquents de Saïd s’intéressent d’ailleurs plus spécifiquement aux interconnections et aux échanges bidirectionaux entre différentes sociétés et cultures (Saïd, 1993). La notion de « zone de contact » proposée par Pratt (1992), dont les travaux ont été abondamment discutés, incarne cette idée de médiation, aussi asymétrique soit-elle.
Imaginaire géographique : sous le signe de la médiation
Plusieurs géographes envisagent l’imaginaire géographique des œuvres littéraires dans une perspective plus large (c’est-à-dire moins résolument politique) et le conçoivent plutôt sous le signe de la médiation. Ils préconisent cette idée de médiation, ou encore d’interface, en recourant à des formes récursives de causalité entre sujets (individuel ou collectif), discours (ou représentations), contexte et réalités mondaines. Dans la géographie d’expression française, il existe une longue tradition de réflexion sur l’imaginaire géographique dont il serait difficile ici de retracer ici la complexe généalogie, laquelle passe notamment par Bachelard et la poétique de l’espace, Durand et les structures anthropologiques de l’imaginaire, Castoriadis et l’institution imaginaire de la société, Lacan et les trois plans imbriqués (réel, imaginaire et symbolique) de la psyché. Or, ce que la plupart de ces approches ont en communs, en dépit de leurs profondes différences sur le plan épistémologique, réside dans le fait que l’imaginaire y est souvent conceptualisé en termes de médiation, d’interface ou de relais ou encore en tant que matrice par l’entremise de laquelle le monde est ordonné, rendu intelligible, chargé de sens. Dans de nombreux travaux en français, l’imaginaire géographique est appréhendé dans cette perspectives (Bureau, 1984 ; Debarbieux, 1992 ; 2003 ; 2015 ; Sénécal, 1992 ; Soubeyran, 1997 ; Berdoulay, 2012 ; Bédard et al., 2012 ; Dupuy, 2019). Dans la géographie produite en anglais, même celle qui s’abreuve parfois aux mêmes sources, l’imaginaire géographique (ou geographical imaginary) continue d’être conceptualisé en termes essentiellement politiques, son étude s’inscrivant dans une perspective critique2.
Les exemples que nous verrons ici illustrent, chacun à leur façon et en combinant des perspectives différentes, le potentiel heuristique et épistémologique des conceptions de l’imaginaire qui en font un médiateur privilégié pour réfléchir aux rapports complexes entre un écrivain et ses lieux, entre culture et territoire, imaginaire urbain et littéraire, entre savoir géographique et connaissance littéraire. Le premier exemple, au sujet de l’imaginaire urbain de Charles Bukowski, sera plus explicite voire un peu plus didactique, dans sa confrontation des vertus respectives des conceptions conquises et conquérantes de l’imaginaire. Cela permettra de mettre définitivement de côté les vieux clivages théoriques entre humanistes et radicaux (entre volontarisme et détermination) pour inscrire son analyse sous le signe de la médiation.
Bukowski et l’imaginaire des bas-fonds
L’œuvre de Bukowski est née dans les bas-fonds et en traite abondamment. Elle est pour l’essentiel associée à Los Angeles où il est né et a passé la majeure partie de sa vie, exception faite de quelques années d’errance à travers les États-Unis au début des années 1940 (Sounes, 1998). Cette exploration littéraire a ceci de particulier qu’elle examine la vie dans les bas-fonds depuis les bas-fonds. La tradition littéraire de Los Angeles, jusqu’à une époque relativement récente, est plutôt le fait de migrants et d’exilés attirés par le mirage hollywoodien et la recherche d’une nouvelle vie, de la fortune, de la célébrité et de la possibilité typiquement états-unienne de se réinventer (Fine, 2000). Venus d’ailleurs pour exercer le métier de scénariste, les premiers romanciers de Los Angeles ont choisi de camper leurs fictions à Hollywood, les communautés balnéaires (Malibu, Venice West, etc.) et les quartiers cossus perchés sur les collines (Beverly Hills, Pacific Palissades, etc.). Les nombreux quartiers moins favorisés qui s’étendent sur la plaine autour du centre-ville officiel situé plus à l’est, ont été boudés, regardés de « haut » ou du moins ignorés par les écrivains jusque dans les années 1930. C’est alors que John Fante, bien que venu d’ailleurs lui aussi, descend dans les bas-fonds, les bars, les cafés et les pensions miteuses de Bunker Hill (Cooper, 1995). Avec Chester Himes, Oscar Zerta Acosta, Walter Mosley et Charles Bukowski, Fante inaugure une toute autre exploration littéraire de Los Angeles, d’un territoire autre de la ville ; les quartiers plus près du centre qui sont aujourd’hui habités par les populations noires, latinos et asiatiques, bref, non‑blanches (Skinner, 1995 ; Parades, 1995 ; Fine, 2000 ; Brosseau 2020).
Pour Bukowski, les bas-fonds urbains serviront à la fois de décors récurrents, de sources d’inspiration, de sites de résistance, de postes d’observation privilégiés pour considérer la société américaine et même de matériau de base pour constituer le mythe et la figure de l’auteur (Brosseau, 2002). Ils sont constitutifs d’un imaginaire particulier qui informera de proche en proche sa représentation des autres secteurs de la ville. Cet imaginaire des bas-fonds peut être envisagé à la fois comme le résultat de déterminations biographiques et sociologiques (ce qui en fait un imaginaire conquis, reproducteur ou réparateur selon les prérogatives théoriques à partir desquelles on l’aborde) et comme une « matrice » dynamique productive, « un principe organisateur et générateur », pour reprendre Jean-Jacques Wunenburger (2003, p. 42) – ce qui en fait aussi un imaginaire conquérant, créateur d’une vision originale qui s’étendra à la ville dans son ensemble.
Le Los Angeles imaginaire de Bukowski ne donne pas lieu aux débordements métaphoriques auxquels se prête pourtant si bien le paysage sud-californien, avec son assemblage complexe de montagnes, d’océan et de désert, ainsi que le risque constant de tremblements de terre qui obsède tant d’écrivains californiens (Davis, 1998). Non, le Los Angeles de Bukowski est écrit à hauteur d’homme, un homme de la rue et des bas-fonds. Il n’a rien d’exotique ou de déroutant. En fait, le texte semble prévoir un lecteur qui soit déjà en territoire familier, un lecteur pour lequel tout détail serait en quelque sorte superflu, comparativement au « lecteur idéal » de ses prédécesseurs qui semblaient écrire pour un lectorat du Nord-Est américain ne connaissant pas ou peu la Californie. Bref, l’image de la ville représentée dans son œuvre ne se constitue pas à partir d’un imaginaire géographique venu d’ailleurs.
Si Bukowski est parmi les premiers écrivains à écrire Los Angeles comme un territoire familier, donc de l’intérieur (en tant qu’insider), il le fait en même temps du point de vue d’un être profondément marginalisé socialement et donc spatialement : il est en quelque sorte un outsider en territoire familier. S’il possède le privilège de la perspective intime de l’initié, il est à la fois l’exclu qui contemple le monde dans lequel il vit et écrit depuis une position marginalisée. À l’instar de Bachelard, qui écrivait que l’imagination n’est pas tant la « faculté de former des images » mais « plutôt la faculté de déformer les images » et « surtout la faculté de nous libérer des images premières, de changer les images » (Bachelard, 1943, p. 7), on peut dire que Bukowski a contribué à changer les images exotiques de Los Angeles par des images banalement familières d’un quotidien très ordinaire, d’abord vécu dans les bas-fonds pour enfin coloniser les autres quartiers de la ville. Or, contrairement à l’approche bachelardienne, selon laquelle c’est « au niveau des images détachées que nous pouvons ‟retentir” phénoménologiquement » (Bachelard, 1957, p. 9), il convient d’identifier les constituants de son imaginaire à l’échelle de l’œuvre dans son ensemble.
Bien que variables et très plastiques, les définitions de l’imaginaire sont néanmoins fort convergentes. On le définit ainsi d’un point de vue littéraire comme « un ensemble d’images et de signes, d’objets de pensée, dont la portée, la cohérence et l’efficacité varient, dont les limites sont sans cesse à redéfinir, mais qui s’inscrit indéniablement au cœur de notre rapport au monde, de cette confrontation au réel » (Chassay et Gervais, 2002, p. 11). D’un point de vue philosophique, il est appréhendé comme un « ensemble de productions, mentales ou matérialisées dans des œuvres, à bases d’images visuelles (tableau, dessin photographie) et langagières (métaphore, symbole, récit), formant des ensembles cohérents et dynamiques » (Wunenburger, 2003, p. 10). En géographie, on l’envisage comme « ensemble d’images mentales en relation qui confèrent, pour un individu ou un groupe, une signification et une cohérence à la localisation, à la distribution, à l’interaction de phénomènes dans l’espace (qui) contribue à organiser les conceptions, les perceptions et les pratiques spatiales » (Debarbieux, 2003, p. 489). Il est possible de reconstituer la configuration de l’imaginaire bukowskien des bas-fonds en identifiant, ses constituants – « temps, espace, action, personnage, etc. » – ou ces « éléments typifiants qui donnent un style, un visage à l’ensemble des images » (Wunenburger, 2003, p. 11 et 41-2). Bien que cet ensemble soit quelque peu flexible, qu’il connaisse des transformations, des variations ou des permutations au cours de l’évolution de son œuvre, il n’en demeure pas moins relativement stable et étonnamment récurrent.
Du point de vue des lieux, la fiction est souvent campée dans le quartier des déshérités et des sans-abris (le skid row autour de la 5e rue) mais aussi les quartiers ouvriers de East L.A. ou East Hollywood. Plus souvent qu’autrement, il s’agit d’une série très limitée de lieux : chambres de pension miteuses (roominghouse, flophouse), avec leurs cages d’escalier, les ruelles sombres, des terrains vacants. S’en dégage une atmosphère un peu suffocante, dans laquelle planent des vapeurs d’alcool, de sueurs, de vieille crasse, de solitude, de petite misère et de mort. Le bar, rare espace de socialisation, et le magasin d’alcool ne sont jamais loin, reliés qu’ils sont par des segments de rues et de trottoir rarement décrits. Les milieux de travail, aussi divers qu’aliénants (de l’abattoir au centre de tri postal en passant par l’entrepôt ou la fabrique de biscuits), complètent le tableau. Pas de paysage, pas de vision panoramique de la ville. Un espace morcelé composé de lieux discrets coupés du reste de la ville, à tous le moins mal intégrés au tissu urbain dans son ensemble. Cela a pour résultat de créer une représentation des bas-fonds en tant qu’espace relativement autonome, un espace en soi qui n’a pas besoin d’être comparé aux autres lieux (plus favorisés) de la ville qui, par contraste, serviraient à le caractériser.
L’univers social dépeint par Bukowski demeurera longtemps inchangé. à côté de l’auteur/narrateur souvent présent, on retrouve un assemblage limité de personnages : hommes et femmes paumés et désabusés, des petits truands et criminels de fortune, prostituées de bas étage, à la marge et au bas de l’échelle sociale. Il y a aussi la « landlady » (dont l’équivalent français le plus rapproché serait la concierge) que l’on cherche à éviter dans ces mêmes cages d’escalier, faute d’avoir payé le loyer, le barman fier-à-bras avec qui le narrateur aura souvent maille à partir dans la ruelle, ou plus positivement la serveuse mexicaine de chez Pedro’s qui vous laisse siroter un café tranquille pendant des heures pour 5 sous (Bukowski, 1973 ; 1982b). Il y a enfin, le « p’tit boss », l’assistant-gérant, le foreman, le superviseur qui utilise tout le petit pouvoir dont il dispose pour casser les pieds à ses employés subalternes.
Le type d’action est aussi étonnement récurrent : alcool, beuveries, engueulades, bagarres, scènes de sexe manquées ou violentes, petits méfaits plus ou moins réussis, misère et violence conjugales, recherche d’emploi, abus de pouvoir dans les lieux de travail, etc.
Le temps, comme l’espace d’ailleurs, semble y être défini de manière absolue, sans profondeur ni perspective : peu de passé, peu de futur sinon immédiat, confiné à l’ici et au maintenant. Le temps est conjugué à l’éternel présent, laisse peu de place à la durée ou à l’espoir, sinon, au mieux, à une forme de résignation cynique que demain sera semblable à hier et aujourd’hui.
Chose certaine, Bukowski a développé une forme et un style singuliers pour exprimer cet imaginaire. Un style simple et sans fioriture – la quête de la phrase simple, épurée, sans ornementation – qui décrit un milieu dans une langue et dans une culture qui lui correspondent. Les descriptions sont rares, les dialogues nombreux (Brosseau, 2008a). Capturée dans de nombreuses (plus de 200) nouvelles très brèves, cette vie dans les bas-fonds est aussi représentée dans ses romans, composés eux-mêmes de très brefs chapitres (du type tranches de vie), plus intéressés à saisir le moment présent qu’à faire sentir l’épaisseur de la durée (Brosseau, 2008b). A fortiori, l’instant présent (même celui du passé) domine dans la poésie : « Now is the only living breathing reality » (Bukowski, 1995 : 115).
« L’exploration scientifique de l’imaginaire, écrit Christian Chelebourg, correspond, dans son ensemble, à une recherche des déterminations collectives et individuelles qui pèsent sur le choix et le regroupement des images » (Chelebourg, 2000, p. 5). Quiconque connaît la biographie de Bukowski, et les ouvrages biographiques qui le concernent sont d’ailleurs plus nombreux que les ouvrages critiques traitant de son œuvre (Cherkowski, 1997 ; Sounes, 1998 ; Malone, 2003 ; Baughan, 2004 ; Miles, 2005), trouvera un riche matériau pour comprendre le poids des déterminations qui pèsent sur les choix des éléments constituants de son imaginaire géographique. Rappelons que, fils unique d’une famille de classe moyenne inférieure, il a subi la pire trajectoire imaginable aux États-Unis c’est-à-dire le déclassement : son père ayant perdu son emploi pendant la crise, sa mère fut contrainte de faire des ménages pour subvenir aux besoins de la famille. Victime d’une violence paternelle répétée, marginalisé à l’école par une apparence physique peu flatteuse bientôt accompagnée d’une poussée virulente d’acné adolescente, Bukowski se réfugie dans sa chambre puis à la bibliothèque publique de Los Angeles pour lire. Malheureux à la maison et marginalisé à l’école, il n’en faudra pas beaucoup plus pour découvrir les vertus de l’alcool, quitter la maison, découvrir les bas-fonds de la ville, vagabonder à travers le pays…
Pour se tailler une place au sein du milieu littéraire sud-californien – occuper une certaine position au sein de ce champ littéraire dirait Pierre Bourdieu (1992) – il a d’abord ciblé les petites revues de poésie indépendantes, les journaux comme Open City, puis les revues pornographiques (qui payaient bien pour des histoires un peu salées…), adopté un style iconoclaste avec, selon certains, un maniérisme d’avant-garde (absence de ponctuation, de majuscule, langage grossier, etc.) telle que l’exigeaient l’intériorisation d’un habitus propre à un homme de sa classe. Un maniérisme qu’il a vite abandonné une fois sa position établie (Smith, 1985, Brewer, 1997).
Ainsi l’imaginaire urbain de Bukowski et le style qui l’exprime peuvent-ils paraître parfaitement surdéterminé par le destin socio-économique de sa famille et par les particularités de sa propre biographie. Son imaginaire ne serait ainsi que le résultat de facteurs structurants externes (ce qui en ferait un imaginaire conquis). Or, même du point de vue psychanalytique, il ne faut pas perdre de vue que l’élaboration du sujet de l’écriture qui est « chargé de réparer, par le langage, une blessure narcissique » (Chelebourg, p. 108) en substituant – « fonction réparatrice » – à une image douloureuse du moi une image plus satisfaisante, est aussi une stratégie et une réponse active du sujet par l’entremise de laquelle il devient tout au moins partiellement l’architecte de son propre destin. L’écriture permet à l’écrivain de dépasser sa condition, et, selon Bukowski lui-même, de survivre. Dans un poème, il écrit même que « Ces mots que j’écris me préservent de la folie complète » (« These words I write keep me from total madness »). Bref, l’écriture est aussi une conquête sur soi. Cette conquête a par ailleurs permis à Bukowski d’activement édifier son propre mythe – sa figure d’auteur –, un mythe hautement spatialisé autour des bas-fonds – son terrain d’apprentissage – et en particulier les petites chambres de pension miteuses évoquées plus tôt, objet d’écriture, refuge et poste d’observation à partir desquels sa vision de la vie urbaine se construit et se diffuse.
Cette stratégie est à ce point structurante que même lorsqu’il sortira lui-même progressivement des bas-fonds, son écriture conservera toujours les mêmes caractéristiques dominantes : « cette même phrase simple que j’ai apprise dans ces chambres miteuses » (« the same simple line, I learned in those cheap rooms ») (Bukowski, 1996, p. 361). De ce point de vue, son imaginaire des bas-fonds est pour lui un prisme au travers duquel la réalité sociale est appréhendée, une matrice générant les diverses circonstances qu’il se proposera de décrire et décrypter. Ainsi, lorsque sa prose s’aventurera dans les quartiers cossus de Los Angeles (plus à l’ouest), qu’elle explorera les milieux du sport (boxe, baseball, course de chevaux), de la littérature ou du cinéma (Bukowski, 1983c et 1989 par exemple), ce sont les mêmes thèmes – violence, exploitation, meurtres, sexe, crime et autres mesquineries grandes et petites – qui caractérisent ses personnages et leurs actions. Ceux-ci changent de statut mais pas d’attitude, ni de comportement, ni d’éthos. D’abord représentée dans les bas-fonds, la « folie ordinaire », selon le terme d’un de ses premiers recueils de nouvelles (Bukowski, 1972), a le don d’ubiquité. Né dans les bas-fonds, appréhendant la ville avec un regard cru et banalement familier, cet imaginaire a pour ainsi dire « colonisé » le reste de la ville. En ce sens, cet imaginaire est aussi conquérant, car il marque une forme de victoire individuelle et transcende les étroites bases géographiques qui ont façonné son développement. Je dis imaginaire conquérant, en référence à une autre réflexion de Bachelard qui, dans la Poétique de l’espace, écrivait que l’imagination a la capacité de s’imposer au réel – transformer les bruits de la ville en musique de bord de mer. L’imaginaire des bas-fonds de Bukowski s’est pour sa part imposé à la ville entière.
L’opposition entre les conceptions conquise ou conquérante de l’imaginaire résume les sempiternelles tensions épistémologiques entre volontarisme et déterminations. Il est plus fertile de chercher des formulations mitoyennes selon lesquelles l’imaginaire est à la fois produit d’une relation et producteur de cette même relation. Ainsi participe-t-il d’une forme de récursivité. Dynamique, l’imaginaire a en effet ceci de particulièrement intéressant pour la géographie qu’il s’interpose comme médiateur de premier plan dans la relation du sujet (et des sociétés au demeurant) et des lieux comme des espaces qui le façonnent et qu’il façonne à son tour. Vincent Berdoulay l’exprime bien. Pour lui, l’imaginaire
« doit plutôt être vu comme une médiation entre le sujet et son lieu, par laquelle le sujet recombine, de façon créative dans de nouveaux récits, des formes, des symboles, des signes et autres structures ou éléments chargés de sens. […]… Pour cela, il s’agit nécessairement d’un sujet actif qui réorganise les trames narratives donnant sens aux paysages, aux lieux et à sa relation au monde. La médiation de l’imaginaire dans ce processus de réajustement est essentielle, car c’est par son intermédiaire que des éléments de sens font l’objet d’une reprise et d’un travail de recomposition » (Berdoulay, 2012, p. 50-51).
La recherche de la « cause première » dans la constitution de l’imaginaire (vient-elle des conditions de production ou d’un sujet libre de toute contrainte ?) est sans doute un peu vaine sinon trop scolaire. Il est plus fécond de penser l’imaginaire comme participant d’une relation dialogique entre le sujet et le monde, relation à l’intérieur de laquelle il joue un rôle de médiation essentielle. Ainsi, l’imaginaire des bas-fonds, dont nous venons d’esquisser rapidement les contours au contact de l’œuvre de Bukowski, gagne-t-il à être envisagé en ces termes : un ensemble complexe d’images, de signes et de récits d’action qui est à la fois le fruit d’une expérience vécue (sans en être la simple transcription), l’objet d’une négociation labile avec le monde extérieur et le prisme au travers duquel monde et expérience sont appréhendés. Plus qu’un trait d’union entre le sujet et le lieu, il contribue à définir l’un et l’autre de même que leur relation.
Imaginaire littéraire et mémoire de la ville
L’étude de l’imaginaire en littérature s’inscrit aussi dans le cadre d’une réflexion plus large sur les dimensions géographiques de l’imaginaire social. C’est le type de travail auquel s’est livré Pierre-Mathieu Le Bel dans sa géographie romanesque de Montréal en s’évertuant à comprendre comment la littérature imagine la métropolisation de la grande ville québécoise, notamment en mettant en lumière sa fragmentation interne et ses interconnections à l’échelle globale (Le Bel, 2012). Bien conscient du fait qu’il est plus facile de suggérer que de démontrer l’existence d’un lien entre représentations littéraires de la ville et l’imaginaire social qui la concerne, il a constitué un corpus de romans contemporains susceptibles, c’est son pari méthodologique, de participer d’un imaginaire urbain montréalais. Pour être retenus, ces romans devaient avoir été recensés dans les quotidiens montréalais comme autant de récits ayant pour scène la ville de Montréal. Plus d’une cinquantaine au total, ces romans (publiés entre 2003 et 2006) sont étudiés non seulement parce qu’ils « parlent » de Montréal comme tel, mais parce que la critique en a parlés comme autant d’œuvres qui « disent » Montréal. C’est par ailleurs comme un « tout » que ce corpus est envisagé : « ne pas traiter de chaque arbre individuellement, mais considérer la forêt comme un paysage » (Le Bel, 2012, p. 15).
Au fil de la lecture et de la relecture de ce corpus, un thème s’est imposé à lui « parfois à travers un personnage, d’autres fois par l’entremise d’une action, d’autres fois encore grâce à un vocabulaire thématisé », celui de la mémoire et de la pratique de la mémoire. S’appuyant notamment sur les travaux de Ricœur, de Nora et de Méchoulan, Le Bel montre comment les personnages des romans de son corpus redéfinissent les limites molles, en fait plutôt les seuils un peu flous, qui distinguent malgré tout le territoire montréalais véritablement métropolisé du reste de la région. Ainsi, centre-ville, banlieue et campagne relèvent-ils pour eux de régimes mémoriels très différents. La ville centre est le théâtre d’une quête identitaire active, où l’on fouille le passé pour mieux se connaître soi-même. C’est le territoire de l’anamnèse, celui de la lutte contre l’oubli, où le travail de mémoire est délibéré, volontaire. Au gré de leur mobilité dans la ville, les personnages trouvent çà et là de multiples traces « faites d’un passé qui vibre dans le présent » et qui, tels autant de repères, font l’objet d’une appropriation individuelle au profit de leur propre formation identitaire :
« Ainsi la ville centre est le lieu de l’anamnèse. C’est le lieu où les personnages adoptent une attitude proactive face à la mémoire et une flexibilité vis-à-vis l’appropriation d’un passé qui puisse leur servir d’assise identitaire. On pige dans le passé canadien, québécois, mais aussi européen, sud-américain. On glane les éléments fondateurs dans le passé proche autant que dans le passé lointain. Ensuite on s’approprie la mémoire, on la refaçonne, on sculpte soi-même le socle de l’histoire qui nous sert de piédestal du haut duquel contempler la fuite du temps » (Le Bel, 2012, p. 56).
La banlieue, pour sa part, est plutôt imaginée dans ces romans comme l’espace de l’oubli, où l’on cherche à se réinventer en laissant son passé derrière soi, mais où les souvenirs refont surface en dépit de notre volonté. Si mémoire il y a, c’est une mémoire qui relève de l’habitude et non d’une forme d’agentivité assumée. La banlieue correspond ainsi, selon la terminologie de Ricœur, au territoire de la mnémée : elle diffère de l’anamnèse « en ce qu’elle ne suppose pas l’exercice d’une volonté appliquée dans l’acte de se souvenir » (Le Bel, 2012, p. 57). La banlieue y apparaît comme étant un peu coupée du reste de la ville et du monde, un espace aux formes paysagères standardisées un « topos sans chronie ». Le roman de Pierre Yergeau (2005), justement intitulé Banlieue,
« met en scène une dizaine de personnages qui portent des noms de marques déposées, qui habitent justement cette banlieue et qui ont adopté des formes culturelles de masse aux aspirations utopistes, où toutes traces du passé se perdent dans l’anonymat de l’uniformité. Même s’ils y travaillent parfois, ils sont métaphoriquement bien loin de la ville centre qui exerce sur eux la même fascination qu’une contrée lointaine » (Le Bel, 2012, p. 59).
La campagne, enfin, en périphérie immédiate de la ville, y apparaît surtout comme un espace de commémoration, là où le passé peut être accueilli, sinon célébré, comme ayant contribué à la constitution de notre identité. Mais il s’agit d’une « mémoire statufiée », les lieux de mémoire y étant représentés comme autant de « sépultures d’époques révolues, mais non moins fondatrices » (Le Bel, 2012, p. 67). Plus importante encore est la différence fondamentale entre ville et campagne sur le plan de la pratique de la mémoire. À la campagne, la mémoire a quelque chose de figé ou de consacré sur le plan social, elle peut servir de refuge, de ressourcement mais laisse peu de marge de manœuvre créative aux personnages, alors qu’en ville ceux-ci peuvent plus facilement transformer les nombreuses traces mémorielles en ressource pour se bricoler une identité.
« La visite à la campagne est un acte de commémoration qui ne peut que répéter. La ville offre en revanche une occasion unique puisque le processus qui transforme l’espace en lieu y est toujours accessible. Le lieu de mémoire rural est fixé par une force sociale inscrite dans l’histoire, alors que la ville, justement par sa pléthore de forces sociales contradictoires, rend flexible la pratique mémorielle en son sein » (Le Bel, 2012, p. 71).
Le roman montréalais contemporain propose ainsi une façon alternative, et en effet bien différente de celles que proposent géographes urbains et sociologues, d’imaginer les frontières qui rythment l’espace métropolitain.
Imaginaire cyberpunk et prospective urbaine
Rob Kitchin et James Kneale s’intéressent pour leur part à un sous-genre particulier de la science-fiction contemporaine – le « cyberpunk ». Leur analyse porte aussi sur un large corpus (trente-quatre romans et quatre recueils de nouvelles). Ce type de fictions projettent le lecteur dans un avenir rapproché au sein duquel les technologies de l’information, le cyberespace, la réalité virtuelle, l’intelligence artificielle, les relations homme-machine (cyborg par exemple), pour ne nommer que ces dimensions-là, jouent un rôle central dans le déroulement du récit. Ce sous-genre de la science-fiction explore les multiples façons dont les nouvelles technologies sont susceptibles de transformer nos modes de vie et le fonctionnement de nos futures sociétés post-industrielles et postmodernes. Il le fait, selon eux, de façon plutôt extrapolative en projetant le présent dans un futur prévisible tout en mobilisant, bien sûr, une bonne dose de spéculation. Ils pensent aussi que le cyberpunk a ceci de fascinant qu’il déstabilise les fondements modernistes sur lesquels repose la science-fiction des XIXe et XXe siècles : « self-other ; self-society ; nature-technology ; nature-civilization ; rational-irrational ; order-chaos » (Kitchin et Kneale, 2001, p. 22). En tant que corpus, ces œuvres sont appréhendées comme un espace cognitif (et discursif) à l’intérieur duquel les rapports futurs entre espace urbain, société et technologie sont imaginés et mis en forme sans les contraintes qui pèsent sur les discours académiques en matière de prospective. Elles constituent en quelque sorte une chambre d’écho récursif où s’entrechoquent les préoccupations des écrivains, bien sûr, mais aussi des universitaires (dans les sciences dures comme dans les humanités), ingénieurs, programmeurs, politiciens et bientôt divers groupes (« lifestyle communities ») sur les réseaux sociaux.
Leur analyse s’articule autour de quatre grands thèmes : urbanisme de demain, forme et structure urbaines, modes de régulation sociale et réappropriation de la ville future. Basé sur des romans écrits pour l’essentiel dans les années 1980 et 1990, le monde qui y est décrit témoigne des préoccupations pourtant bien contemporaines. Ils identifient sept grandes caractéristiques de ce monde imaginé par la science-fiction cyberpunk :
1) un monde ordonné par le capitalisme libertarien et le darwinisme social ;
2) un monde reconfiguré à toutes les échelles spatiales par la mondialisation ;
3) un monde dominé par un petit nombre d’énormes multinationales, au sein duquel les pays se sont fragmentés en de petits états-nations ;
4) un monde où la classe moyenne a disparu pour laisser place à une population clairement divisée entre pauvres et bien nantis ;
5) un monde de villes fracturées et fragmentées au sein d’un ordre global ;
6) un monde au sein duquel les riches vivent dans des espaces privés et sécurisés (l’espace public ayant entièrement disparu) et les pauvres sont laissés à eux-mêmes dans des espaces anarchiques, sans lois ni gouvernance ;
7) un monde doté d’un nouvel ordre sociospatial qui reflète tout de même notre présent (Kitchin et Kneale, 2001).
Ces productions culturelles sont d’intérêts pour les géographes dans la mesure où elles contribuent à forger les imaginaires géographiques des villes de demain :
« To us cyberfiction is a useful resource to geographers because it details the destabilization of the modern period, maps out possible future spatialities of the postmodern condition, and provides cognitive spaces which are being used by individuals and institutions in conceiving and making future society. Our analysis has shown that there are many facets of contemporary society, such as globalization and the rise of the dual economy, that indicate that these futures, or derivatives of them, may come to pass. Consequently, it is our belief that cyberfiction, and an analysis of how it is being appropriated, provides important insights into the possible geographies of the new millennium and, as such, they provide a resource in need of further analysis by geographers » (Kitchin et Kneale, 2001, p. 32)3.
Au centre de cet univers cyberpunk, une figure se démarque. Il s’agit de William Gibson dont l’œuvre a connu un fort retentissement, tant chez les amateurs de science-fiction, que chez les intellectuels. Henri Desbois a consacré aux romans de Gibson de nombreux articles dans « la perspective des études sur les imaginaires géographiques, et plus généralement des réflexions sur les rapports entre les formes de connaissances académiques et la façon dont les œuvres de fiction participent à la construction de nos conceptions du monde » (Desbois, 2017, p. 1). Sans avoir inventé le terme cyberespace, l’auteur de Neuromancien a grandement contribué à sa popularisation et a profondément marqué, selon Desbois, « les imaginaires techniques du numérique ». Avec le recul des années, il constate à quel point les grands motifs des romans cyberpunk de Gibson se sont imposés dans l’imaginaire du cyberespace contemporain : ubiquité de la technique, cités hallucinées, jungle urbaine, etc. Or, précise-t-il, « ce que nous appelons cyberespace n’a qu’un rapport lointain avec ce qui est décrit dans Neuromancien. Pourtant, notre regard sur la technique est empreint de cet imaginaire de science-fiction » (Desbois, 2017, p. 14)4.
Ces études de Le Bel et de Kitchin et Kneale se fondent sur l’analyse d’un corpus « géocentré » (pas un roman singulier ou l’œuvre d’un même auteur), dans une démarche comparative qui s’apparente à la géocritique telle que la définit Westphal (2007). Cette démarche permet par ailleurs d’éviter les apories d’une lecture obnubilée par la distinction nette entre réel et fiction, la distinction entre ville réelle et imaginaire étant délibérément suspendue, mais aussi d’une lecture symptomatique à l’affut de rapports de pouvoir inégaux qui, à coup sûr, les trouve. Ils s’intéressent donc aux échanges sémantiques et symboliques entre discours littéraire et imaginaire urbain, au brouillage référentiel qu’ils peuvent produire. La géographie « dans » la littérature devient un lieu de médiation pour penser les imaginaires populaires « de » la ville. Il s’agit là de préoccupations qui renouvellent la façon de concevoir la pertinence sociologique de la littérature.
De l’imaginaire géographique aux géographies de l’imaginaire
L’œuvre immense de Jules Verne a été envisagée dans la perspective de l’imaginaire géographique dans les nombreux travaux que Dupuy leur a consacrés. Grâce à ses recherches, il est possible de considérer l’imaginaire géographique vernien comme une forme de relais entre un savoir géographique patenté, reconnu, et un savoir plus populaire ou intuitif. Les rapports de Verne à la géographie savante, la Société Géographique de Paris ou encore ses nombreux « emprunts » à Élisée Reclus, aux frères Arago ou à Jean Chaffanjon sont désormais bien établis. L’importance et la nature de ses nombreux emprunts dans divers romans particuliers de Verne ont aussi été documentés (Dupuy, 2006b ; 2010 ; 2011a). Or, son œuvre constitue bien plus qu’une simple articulation de ces deux types de savoir. La perspective de l’imaginaire permet de mieux en comprendre l’originalité et de montrer à quel point la géographie est cœur de son processus créatif. Avec Verne, on assiste selon Dupuy en cette deuxième moitié du XIXe siècle à l’émergence du roman géographique qui « accompagne et succède au roman historique ». Plutôt que d’inscrire la narration dans un ici-autrefois comme le font Victor Hugo et Alexandre Dumas dans Notre-Dame de Paris et Les trois mousquetaires par exemple, Verne « déplace le curseur de l’ici vers l’ailleurs » pour composer, avec ses Voyages extraordinaires, de véritables fictions géographiques romanesques (Dupuy, 2013a, p. 10 ; Seillan, 2008). Or, pour bien comprendre les ressorts de ces récits (tant du point de vue de l’intrigue, de l’action que des univers dans lesquels ils se déploient), Dupuy croit utile de montrer comment ils mobilisent les ressources de l’imaginaire pour configurer ces ailleurs multiples.
L’imaginaire géographique remplit chez Verne une fonction pédagogique servant à transmettre un savoir géographique (Dupuy, 2013b) et ainsi installer un trait d’union entre savoir patenté et culture populaire, ce qui en fait une forme de médiateur ou de relais entre les deux. Mais l’imaginaire vernien est aussi et, peut-être avant tout, création. Dupuy, envisage donc aussi cet imaginaire géographique comme une reconstruction du réel, une création qui permet d’accéder à des faces cachées, ou encore inexplorées, de la réalité. L’imaginaire géographique lui sert à décrire et écrire les angles morts de la connaissance géographique de son époque, en faisant évoluer systématiquement ses héros dans des territoires alors inconnus. Que l’on pense à la découverte des présumées sources de l’Orénoque dans Le Superbe Orénoque (Dupuy, 2013c) ou encore la traversée au cœur de l’Afrique dans Cinq semaines en ballon. L’imaginaire géographique prend donc le relai du savoir géographique, mais s’en sert aussi comme tremplin pour extrapoler et poursuivre sur un autre terrain l’exploration du monde. Et lorsque que ce savoir s’avère trop lacunaire, Verne crée des espaces nouveaux, des mondes imaginaires, comme dans l’Île mystérieuse ou encore dans son Voyage au centre de la terre. Afin de demeurer dans le plausible, le vraisemblable, l’imaginaire qu’il développe s’appuie sur les connaissances scientifiques de son époque mais il les conjugue avec des éléments qui relèvent du mythe, de l’exotisme, du symbole, du poétique. C’est ce que Dupuy désigne en faisant référence au merveilleux géographique, type de récit qui permet à Verne de faire basculer le réel vers l’imaginaire. La créativité imaginaire de Verne, passe notamment par une inventivité littéraire qui s’exprime, linguistiquement et formellement, par un usage intense de la métaphore. Dupuy (2011b) examine comment la métaphore généralement et, plus spécifiquement, différents registres métaphoriques (terrestres, minéralogiques, géologiques ou encore écologiques), sont mis au service de l’imaginaire géographique dans Vingt mille lieues sous les Mers, ce récit emblématique des Voyages extraordinaires. L’imaginaire géographique est donc un processus qui aboutit à la mise en place de géographies imaginaires.
Qu’ils problématisent ou non la question de front, la plupart des travaux de géographie littéraire adoptent l’une ou l’autre de ces conceptions de l’imaginaire. Selon les points de vue théoriques, les postures épistémologiques ou les prérogatives critiques qui les motivent à recourir au matériau littéraire pour faire œuvre de géographes, qu’ils cherchent à mettre en valeur le pouvoir créateur des écrivains pour donner sens au monde, dénoncer le rôle politique que jouent certaines productions artistiques dans la diffusion et la normalisation de visions du monde asymétriques, ou à réfléchir aux médiations multiples entre le sujet et ses lieux, entre savoir géographique et connaissance populaire ou encore entre représentation littéraires et sociales, la question de l’imaginaire n’est jamais bien loin. En fait, elle y est presque toujours, ne serait-ce que de façon latente. Déjà, chez les premiers géographes qui cherchaient à séparer les faits géographiques de la fiction littéraire, l’imaginaire figurait comme une sorte de fantaisie dont il fallait contrôler les excès. Chez les premiers géographes humanistes, nous l’avons vu, l’imaginaire littéraire était célébré pour faire état de l’imagination créative des auteurs (et donc valoriser les pouvoirs de la subjectivité humaine) et pour montrer que nous ne vivons pas uniquement dans l’espace « réel » mais aussi dans un univers de représentations. Chez les géographes marxistes, l’imaginaire littéraire participait d’un processus d’appropriation mentale du monde et sa fonction sociale était donc plutôt idéologique, bien que l’origine de ce pouvoir loge dans les conditions matérielles de sa production. Avec la nouvelle géographie culturelle, et à la faveur de ses liens privilégiés avec les cultural studies britanniques et les études postcoloniales, ce sont des imaginaires hégémoniques que l’on dénonce dans les œuvres littéraires. Ce sont aussi des contre-imaginaires, car les textes s’imposent parfois comme autant des formes de résistance aux représentations dominantes. Dans ces perspectives, la question de la positionalité des auteurs (leur localisation stratégique) se conjugue à l’analyse des leviers discursifs des textes dans l’interprétation que l’on fait des géographies imaginatives littéraires. Enfin, les approches qui envisagent l’imaginaire géographique sous le signe de la médiation mettent un peu en suspens la question des chaines causales et de leur direction, pour penser les relations entre auteur, contexte, texte ou encore lecteur en termes de récursivité ou de co-construction.
En déplaçant le curseur de l’auteur au contexte, du contexte au texte, du texte au monde qu’il représente, ou encore du texte au lecteur, en accordant, à géométrie variable, plus ou moins d’importance à chacune de ces entités, la recherche sur l’imaginaire fait intervenir une géographie de la littérature et dans la littérature. Elle combine aussi, dans les meilleurs cas, l’analyse des représentations de l’espace dans le texte à une réflexion sur les façons dont elles sont mises en forme.
Notes
- Dans la version française de l’ouvrage de Saïd, on a traduit le concept de « imaginative geography » par « géographie imaginaire ». Or, Saïd n’utilise pas l’expression « imaginary geographies » mais bien « imaginative geographies », distinction que la traduction française ne capture pas. Bien que « géographie imaginaire » soit une expression plus heureuse sur le plan phonétique et plus généralemen
- À titre de concept, « geographical imaginary » a fait son entrée dans la cinquième édition du Dictionary of Human geography en 2009 (Gregory, 2009), longtemps après « Geographical imagination » en 1986, ou « Imaginative geographies » en 2000. En comparaison, il apparaît aussi tôt qu’en 1992 sous « imagination » (Debardieux, 1992) en français. En revanche, le concept de « géographie imaginative », dans le sens saïdien du terme, n’a toujours pas fait son entrée de façon « autonome » (et non comme élément à décrire sous les « études postcoloniales ») dans les dictionnaires français.
- « Pour nous, la cyberfiction est une ressource utile pour les géographes car elle détaille la déstabilisation de la période moderne, dessine les spatialités futures possibles de la condition postmoderne et fournit des espaces cognitifs auxquelles recourent individus et institutions pour concevoir la société de demain. Notre analyse a montré qu’il existe de nombreuses facettes de la société contemporaine, telles que la mondialisation et la montée de l’économie duale, qui indiquent que ces futurs, ou des dérivés de ceux-ci, peuvent se réaliser. Par conséquent, nous pensons que la cyberfiction, et l’analyse de la façon dont elle est appropriée, fournit des pistes importantes sur les géographies possibles du nouveau millénaire et, à ce titre, elle constitue une ressource qui doit être analysée davantage par les géographes » (Kitchin et Kneale, 2001, p. 32).
- Desbois s’est aussi intéressé aux romans plus récents de Gibson qui, abandonnant le genre cyberpunk au profit de « techno-thrillers », sont campés non plus dans un futur anticipé mais dans un présent plausible. Ces romans « se saisissent de la question des conséquences culturelles et sociales des évolutions techniques de façon plus frontale que les récits cyberpunks » (Desbois, 2017, p. 2). Voir aussi Desbois, 2007, 2010 et 2016.