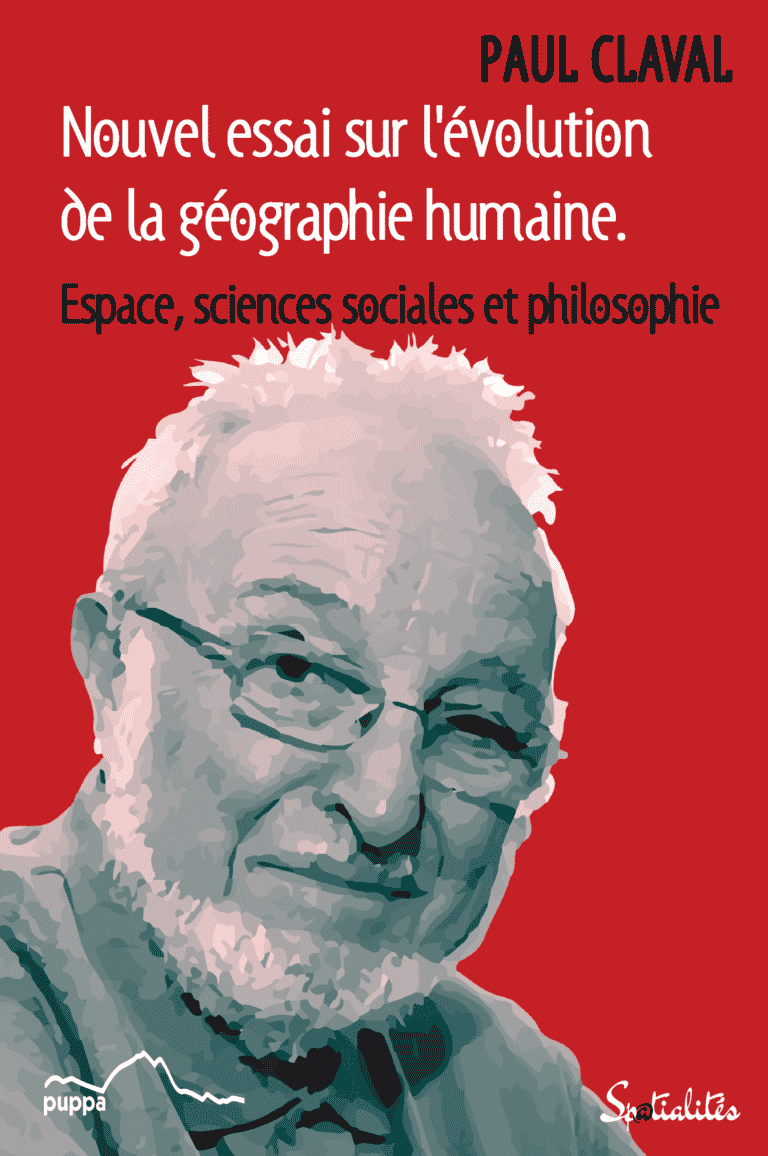Une rupture est en train de s’effectuer : les fondements mêmes des institutions et de la pensée occidentale sont remis en question par une nouvelle génération de philosophes. Le mouvement s’inspire de Nietzsche et reprend certains thèmes de la critique initiée entre les deux guerres par l’École de sociologie de Francfort. Michel Foucault, Jacques Derrida, Gilles Deleuze, François Lyotard ou Pierre Bourdieu illustrent en France ce mouvement, ce qui explique que lorsqu’il touche les États-Unis, aux alentours de 1980, il y soit connu sous le nom de French Theory (Cusset, 2003).
Ce qui est fondamentalement déconstruit, c’est l’idée de l’homme et celle de la science que s’était forgées l’Occident ; sous la forme qu’elles avaient prises à la fin du XVIIIe siècle, ces idées devaient beaucoup à Immanuel Kant.
Deux auteurs, Michel Foucault et Pierre Bourdieu, jouent un rôle essentiel dans la déconstruction poststructuraliste de la pensée sociale antérieure.
Foucault et le renversement de la métaphysique kantienne
L’entrée en scène de Foucault
Né en 1926 à Poitiers, où son père est chirurgien, Foucault y passe une jeunesse dont il parle peu. Proche de sa mère, il y vit assez seul. En un sens, il ne commence à exister que lorsqu’il part en 1945 préparer à Paris l’École Normale Supérieure au lycée Henri-IV, où les cours de philosophie d’Hyppolite l’enthousiasment. Il ne fraie guère avec ses camarades – pas plus qu’il ne le fait lorsqu’il intègre l’École, en 1946. Solitaire, il lit énormément. Il est psychologiquement instable, tente deux fois de se suicider et entre en relation avec le service psychiatrique de Sainte-Anne. Son homosexualité l’installe dans un monde à part.
Reçu à l’agrégation en 1951, il poursuit des études de psychopathologie, est psychologue stagiaire à Sainte-Anne, donne des cours de psychologie à l’ENS et traduit Le Rêve et l’existence du psychiatre suisse Ludwig Binswanger. C’est un philosophe qui aborde les sciences sociales par une de leurs portes latérales, psychiatrie et psychopathologie, et ne se familiarise qu’avec une de leurs méthodologies, celle de l’examen clinique que pratique la psychiatrie. C’est le domaine qu’il choisit pour sa thèse principale consacrée à Folie et déraison : histoire de la folie à l’âge classique (1961), cependant que son mémoire annexe est une introduction et une traduction de l’Anthropologie du point de vue pragmatique (1961) de Kant – indiquant que ses positions philosophiques s’inscrivent dans la postérité de celui-ci, même si c’est pour la subvertir.
L’Histoire de la folie s’appuie sur ce qu’a appris Foucault en s’initiant à la psychopathologie, mais son propos est historique et repose sur son immense érudition – un aspect fondamental de sa recherche. Il retrace l’évolution des attitudes à l’égard du dérèglement mental. Il part de l’analyse des textes et des tableaux relatifs à la Nef des Fous que multiplie la Renaissance. L’âge classique exclut les malades mentaux et les enferme comme il le fait de l’ensemble des déviants ; il enchaîne les plus violents. L’amélioration qu’apportent la création de l’asile et le traitement médical de l’aliénation est en trompe-l’œil dans la mesure où elle culpabilise les malades et leur fait supporter la responsabilité de leur anormalité. Le dernier chapitre de l’ouvrage relève de l’anthropologie philosophique : l’analyse clinique de la folie souligne ce par quoi celle-ci diffère de la normalité mais révèle aussi ses dimensions cachées et son arrière-fond.
C’est à un travail d’histoire des représentations et de leur signification philosophique plus qu’à une recherche empirique de science sociale que procède Foucault. En un sens, il ne fréquente celle-ci qu’à la marge, à travers sa pratique de l’analyse clinique des psychopathologies et à travers ce que les textes apprennent de leur évolution ; en un autre sens, il se situe en son cœur, puisqu’il s’interroge sur la validité des savoirs qui portent sur la folie. Il est ainsi conduit à caractériser les sciences de l’homme comme des disciplines qui s’occupent de la vie des hommes (et s’enracinent ainsi dans la biologie), de la manière dont ils produisent par leur travail ce qui leur est nécessaire (ce qui les ancre dans l’économie) et de leur capacité à communiquer (ce qui les lie à la linguistique).
Les « Mots et les choses » et l’étage moyen de la culture
Les curiosités de Foucault ne se limitent pas à l’histoire de la folie, comme le révèle Les Mots et les choses ; l’ouvrage, qu’il publie en 1966, le fait connaître du grand public cultivé. Le livre porte sur les sciences humaines qu’il analyse à partir des trois piliers qu’il vient de mettre en évidence : les sciences de la vie, l’économie et l’étude du langage. Il les saisit à l’avant-dernier stade de leur transformation en sciences et s’interroge sur le poids qu’exerce le milieu sur leur formulation : il aborde ainsi leur genèse d’un point de vue culturel à une époque où les dynamiques propres à la culture occidentale n’attirent encore guère l’attention. Il souligne le poids des manifestations élémentaires de celle-ci sur l’élaboration de ses formes supérieures – scientifiques en particulier :
« Les codes fondamentaux d’une culture – ceux qui régissent son langage, ses schémas perceptifs, ses échanges, ses techniques, ses valeurs, la hiérarchie de ses pratiques – fixent d’entrée de jeu pour chaque homme les ordres empiriques auxquels il aura affaire et dans lesquels il se retrouvera […], et à l’autre extrémité, la pensée, les théories scientifiques ou des interprétations de philosophes expliquent pourquoi il y a généralement un ordre, à quelle loi générale il obéit, quel principe peut en rendre compte, pour quelles raisons c’est plutôt cet ordre-ci qui est établi et non pas un autre » (Foucault, 1966, p. 11).
À la différence de ses prédécesseurs, Foucault souligne l’existence d’une région médiane entre les formes de base de la culture et ses expressions achevées :
« Mais entre ces deux régions si distantes, règne un domaine qui, pour avoir surtout un rôle intermédiaire, n’en est pas moins fondamental : il est plus confus, plus obscur, moins facile à analyser » (ibid., p. 12).
Pour Foucault, ce domaine joue un rôle déterminant parce que c’est à son niveau que s’ordonne le réel et qu’interviennent l’ordre et le pouvoir dont il est porteur :
« C’est là qu’une culture, se décalant insensiblement des ordres empiriques qui lui sont prescrits par ses codes primaires, instaure une première distance par rapport à eux. […] Ainsi entre le regard déjà codé et la connaissance réflexive, il y a une région médiane qui délivre l’ordre en son être même : c’est là que [celui-ci] apparaît, selon les cultures et selon les époques, continu et graduel ou morcelé et discontinu […]. Si bien que cette région ‘médiane’, dans la mesure où elle manifeste des modes d’être de l’ordre, peut se donner comme la plus fondamentale : antérieure aux mots, aux perceptions, aux gestes qui sont censés alors la traduire avec plus ou moins d’exactitude ou de bonheur […] ; plus solide, plus archaïque, moins douteuse, toujours plus ‘vraie’ que les théories qui essaient de leur donner une forme explicite, une application exhaustive ou un fondement philosophique. Ainsi dans toute culture entre l’usage de ce qu’on pourrait appeler les codes ordinateurs et les réflexions sur l’ordre, il y a l’expérience nue de l’ordre et de ses modes d’être » (ibid., p. 12-13) (c’est nous qui soulignons).
Pour comprendre la portée de ce passage, il faut avoir à l’esprit le fait que Foucault ne travaille pas comme un spécialiste de l’une ou l’autre des sciences sociales empiriques : il fait œuvre de philosophe. L’univers mental dont il traite a été structuré par Kant et sa théorie de la connaissance. James Miller résume ainsi la démarche de celui-ci :
« Dans sa tentative pour soustraire les bases du savoir aux attaques de la philosophie sceptique, [Kant] se sentit contraint d’établir une distinction rigoureuse entre la connaissance empirique issue de l’expérience et les idées transcendantales, qui sont le fait de la seule raison spéculative et s’étendent au-delà de toute expérience possible. La plus troublante de ces ‘Idées de Raison’ restait sans doute celle du libre arbitre. Tout énigmatique qu’il fût, impossible à prouver et, stricto sensu, à connaître, le libre-arbitre n’en ouvrait pas moins, aux yeux de Kant, la possibilité de mettre en pratique le transcendantal, faisant de certaines des idées les objets d’une expérience possible, avec pour conséquence apparente de combler l’abîme entre l’empirique et le transcendantal. Pour Kant, l’abîme qui pourrait s’étendre entre l’idée de raison et sa réalisation pratique reste insondable. Ce sont là, explique-t-il dans la Critique de la raison pure, des questions auxquelles on ne peut et on ne devrait pas répondre : elles trouvent en effet leur racine dans la liberté, or il entre dans le pouvoir de la liberté de transcender toute limite déterminée » (Miller, 1995, p. 170).
James Miller mentionne ensuite le second volet de la révolution copernicienne de Kant, à savoir « sa suggestion que les êtres humains ont à la fois la possibilité et l’obligation de se bâtir, au moyen des idées de la Raison, un monde moral et politique » (Miller, 1995, p. 170).
« Kant avait beau croire qu’une telle construction, opérée dans les limites de la raison, assurerait le triomphe des traditionnelles idées chrétiennes de Dieu, de la responsabilité morale et de l’immortalité de l’âme, sa critique ‘transcendantale’ offrait cette conséquence inéluctable d’ouvrir à l’esprit humain un domaine d’application d’une envergure insoupçonnée. Après la révolution critique de Kant, commente Foucault (Foucault, 1971, t. 1, p. 17), ‘le monde apparaît plutôt comme cité à bâtir que comme cosmos déjà donné’ » (Miller, 1995, p. 170).
L’homo philosophicus que construit le philosophe de Königsberg est complexe : c’est d’abord un être de chair ouvert sur l’extérieur par ses sens ; il est dans le même temps doté de catégories a priori, celles du temps, de l’espace, de la cause, de la substance, etc. ; elles jouent un rôle essentiel dans l’agencement de son expérience. L’esprit se caractérise par les propriétés transcendantales qui lui permettent de raisonner sur des entités abstraites qui échappent à l’empirie ; c’est d’elles qu’il tient son pouvoir de juger. L’homme possède ainsi à la fois une prise sur la réalité empirique et des capacités qui lui permettent d’échapper à celle-ci et qui fondent sa créativité. C’est le caractère absolu des choix éthiques dont l’homme est capable qui en fait un être moral, le caractère absolu de ses jugements esthétiques qui en fait un artiste. Sa dimension transcendantale le distingue ainsi du reste de la création. Quand Foucault parle de l’homme, c’est à cet homo philosophicus kantien qu’il se réfère.
C’est toute la construction de l’univers kantien que remet en cause la prise en compte de la « région médiane » de la culture, entre codes fondamentaux et connaissances scientifiques que propose Foucault : il navigue dans le « domaine d’une envergure exceptionnelle » qu’avait entrevu Kant.
L’étage moyen de la culture et la genèse des épistémès
Comme le souligne Foucault, la « région médiane » de la culture modèle en profondeur les mondes dans lesquels nous vivons :
« Dans l’étude que voici, c’est cette expérience [de l’ordre et de ses modes d’être] qu’on voudrait analyser. Il s’agit de montrer ce qu’elle a pu devenir, depuis le XVIe siècle, au milieu d’une culture comme la nôtre : de quelle manière, en remontant à contre-courant, le langage tel qu’il était parlé, les êtres naturels tels qu’ils étaient perçus et rassemblés, les échanges tels qu’ils étaient pratiqués, notre culture a manifesté qu’il y avait de l’ordre, et qu’aux modalités de cet ordre, les échanges devaient leurs lois, les êtres vivants leurs régularités, les mots leurs enchaînements et leur valeur représentative ; quelles modalités de l’ordre ont été reconnues, posées, nouées avec l’espace et le temps, pour former le socle positif des connaissances telles qu’elles se déploient dans la grammaire et dans la philologie, dans l’histoire naturelle et dans la biologie, dans l’étude des richesses et dans l’économie politique » (Foucault, 1966, p. 13).
Les sciences sociales telles que nous avons appris à les construire ne sont au fond que le déguisement d’une réalité plus profonde, celle qui se bâtit dans cette « région médiane » de la culture, où la quête de vérité compose avec les jeux de force et de pouvoir. Le but de Foucault n’est pas de mettre en évidence l’apport des sciences sociales, mais de préciser leurs limites – d’élaborer, si l’on veut, une Critique de la raison sociale, qui complèterait la Critique de la raison pure.
L’évolution réelle de la pensée n’est pas celle que l’histoire des idées prétend reconstituer à partir de l’analyse érudite des textes, mais celle des forces que recouvrent les mots dans les discours qui circulent à un niveau inférieur et y sont responsables d’effets innombrables de pouvoirs parfois minuscules, mais qui finissent par peser lourdement sur les hommes. Foucault résume ainsi son propos :
« Il ne sera donc pas question de connaissances décrites dans leur progrès vers l’objectivité dans laquelle notre science d’aujourd’hui pourrait enfin se reconnaître ; ce qu’on voudrait mettre au jour, c’est le champ épistémologique, l’épistémè où les connaissances envisagées hors de tout critère se référant à leur valeur rationnelle ou à leurs formes objectives, enfoncent leur positivité et manifestent ainsi une histoire qui n’est pas celle de leur perfection croissante, mais celle de leur possibilité […]. Plutôt que d’une histoire au sens traditionnel du mot, il s’agit d’une ‘archéologie’ » (ibid., p. 13).
La critique de l’idée kantienne de l’homme
La composition des ouvrages de Foucault est souvent déroutante. Les Mots et les choses ne comportent pas de conclusion ; elle est remplacée par deux chapitres consacrés à un double procès.
(i) Le premier dresse celui de l’homme – entendez l’homo philosophicus construit par Kant : au couple mal lié corps/âme, ou corps/esprit de la métaphysique et de la théologie traditionnelles, celui-ci avait substitué un être fait d’empirie et de transcendantal ; dans le domaine matériel et corporel, cet être se caractérisait par sa finitude – mais il était doté d’un attribut qui lui permettait d’échapper en partie à celle-ci et le distinguait du reste de la création : la liberté. L’homme ainsi conçu, et du même coup, l’anthropologie philosophique, sont des créations de l’épistémè qui émerge vers 1800 et a engendré la modernité.
« […] le lien des positivités à la finitude, le redoublement de l’empirique sur le transcendantal, le rapport perpétuel du cogito à l’impensé, le retrait et le retour de l’originel définissent pour nous [modernes] le mode d’être de l’homme. C’est sur l’analyse de ce mode d’être, et non plus sur celle de la représentation que depuis le XIXe siècle la réflexion cherche à fonder philosophiquement la possibilité du savoir » (ibid., p. 346).
Foucault retrace l’émergence, à la jointure des XVIIIe et XIXe siècles, de cette conception :
« Le seuil de notre modernité n’est pas situé au moment où on a voulu appliquer à l’étude de l’homme des méthodes objectives, mais bien le jour où s’est constitué le doublet empirico-transcendantal qu’on a appelé l’homme » (ibid., p. 329-330).
Foucault met alors en évidence les faiblesses et les contradictions de ce doublet : ce n’est pas la raison qui est à l’œuvre dans l’univers social, mais un jeu d’idées et de contraintes qu’ignore l’homo philosophicus. Celui-ci est donc remis en cause.
(ii) Foucault procède dans le chapitre suivant à une critique systématique des sciences humaines (à l’exception de celles qui s’enracinent dans l’inconscient) et de la construction philosophique sur laquelle elles s’appuient. Nous allons y revenir.
La leçon d’ensemble de l’ouvrage ? Foucault la dégage effectivement, mais c’est paradoxalement aux pages 13 à 16 de la préface qu’il la loge.
Les Mots et les choses ont l’avantage de se lire agréablement. L’ouvrage s’ouvre, sans introduction, par une analyse éblouissante du célèbre tableau peint par Vélasquez des infantes royales espagnoles, les Ménines : le jeu de décentrement auquel se livre le peintre annonce ceux auxquels est consacré l’ouvrage. C’est en jouant à répétition sur le thème : « le passé est pour nous un pays étranger » que Foucault nous invite à redécouvrir la Renaissance à travers l’épistémè qui domine l’époque (il donne un rôle central aux signes), puis celui qui s’impose à l’âge classique (il repose sur la volonté taxonomique de tout classer pour saisir l’ordre que le Créateur a imposé au monde), avant que ne s’impose, à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe, celui qui permet l’épanouissement de la science. Le parcours va d’auteur rare en auteur méconnu, de pamphlet en traité obscur ; cela lui confère un grand charme. L’érudition en est époustouflante et les démonstrations enlevées, même si la rhétorique est parfois un peu lourde.
« Les Mots et les choses » et les sciences de l’homme
Les Mots et les choses est un livre d’époque car furieusement structuraliste. L’épistémè apparaît comme une structure sous-jacente : c’est elle, et ses mutations, qui sont responsables des analogies et des parallélismes qui existent entre des domaines que tout semble séparer, celui des sciences de la vie, celui de l’économie et celui de la linguistique.
Les critiques n’ont pas manqué (Merchior, 1986). Pour nombre d’historiens, le choix des disciplines et des œuvres analysées est arbitraire ; des simplifications et des erreurs entachent parfois le raisonnement. La démarche structurale découpe l’histoire en tranches séparées par des sauts. Les continuités sont ignorées, les transitions gommées. Les oppositions sont surévaluées.
Foucault est conscient des faiblesses de son pari, mais celui-ci va dans le sens de ce qu’il cherche à démontrer : l’emprise sur chaque époque de grilles qui y déterminent les curiosités, y orientent les démarches et y dictent les interprétations. La scène intellectuelle n’y apparaît pas comme une arène où s’affrontent les idées ; elle est plutôt faite d’une série de galeries où chacun avance dans la même direction parce qu’il raisonne dans les mêmes cadres et subit les mêmes contraintes. Le pouvoir est partout sensible, mais sans que ceux qui le subissent en soient toujours conscients.
Pour Foucault, la connaissance du social s’inscrit dans des cadres que fixe la philosophie. Il ne s’attaque pas aux sciences sociales elles-mêmes, mais à la conception philosophique de l’homme dont elles ont hérité : il la subvertit ; ces disciplines n’ont plus pour objet l’homme comme mixte d’empirie et de liberté transcendantale, ce dont elles tiraient leur justification officielle. Elles ne traitent que de la façon dont la société contrôle les hommes et les ampute d’une partie de leur corporéité et des possibilités qu’elle devrait ouvrir à celle-ci.
La perspective de Foucault sur les sciences humaines empiriques est celle d’un philosophe qui n’essaie pas d’appréhender leur logique, mais cherche à préciser comment elles s’articulent sur les vraies sciences que sont les disciplines de la vie, de l’économie et du langage. Il propose une nouvelle façon d’aborder l’évolution des idées qu’il baptise archéologie du savoir – le sous-titre Des Mots et des choses.
« Les sciences humaines », le dernier chapitre des Mots et des Choses, ne traite en direct que d’une partie des sciences sociales, celle qui a trait à l’insertion de l’homo philosophicus dans la vie collective. Pour elle, comme le souligne d’entrée de jeu Foucault :
« Le mode d’être de l’homme tel qu’il s’est constitué dans la pensée moderne lui permet de jouer deux rôles : il est à la fois au fondement de toutes les positivités et présent, d’une façon qu’on ne peut même pas dire privilégiée, dans l’élément des choses empiriques » (Foucault, 1966, p. 355).
Pour Foucault, « positivités » renvoie aux instincts de l’individu et aux forces sociales, cependant qu’y est soulignée la présence d’un élément singulier : pour lui, et à la différence de Kant, il ne s’agit pas de la raison spéculative, si bien qu’on ne peut le qualifier de transcendantal ou de privilégié : c’est un espace de transgressivité qui ne s’enracine pas dans la liberté que vaut à l’homme sa raison, mais dans les forces dionysiaques qui animent la totalité de son être ; si le mot existait, on pourrait le considérer comme « immanental ». C’est l’homo philosophicus kantien qu’évoque la phrase que nous venons de citer, mais en renversant ses éléments. Ainsi se prolonge et se remet en cause « purement et simplement [l’] a priori historique, qui depuis le XIXe siècle, sert de sol presque évident à notre pensée ; ce fait est sans doute décisif pour le statut à donner aux ‘sciences humaines’, à ce corps de connaissances […] qui prend pour objet l’homme en ce qu’il a d’empirique » (ibid., p. 356).
La naissance des sciences humaines est liée au changement d’épistémè qui se produit à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe « lorsque, quittant l’espace de la représentation, les êtres vivants se sont logés dans la profondeur spécifique de la vie, les richesses dans la poussée progressive des formes de la production, les mots dans le devenir des langages » (ibid., p. 356).
Foucault poursuit :
« Il était bien nécessaire dans ces conditions que la connaissance de l’homme apparaisse, en sa visée scientifique, comme contemporaine et de même grain que la biologie, l’économie et la philologie si bien qu’on a vu en elle, tout naturellement, un des progrès les plus décisifs, dans l’histoire de la culture européenne, par la rationalité empirique » (ibid., p. 356).
La réalité est plus complexe :
« Il faut se représenter le domaine de l’épistémè moderne comme un espace volumineux et ouvert selon trois dimensions. Sur l’une d’elles, on situerait les sciences mathématiques et physiques […] ; il y aurait dans une autre dimension des sciences (comme celles du langage, de la vie, de la production et de la répartition des richesses) qui procèdent à la mise en rapport d’éléments discontinus, mais analogues, si bien qu’elles peuvent établir entre eux des relations causales et des constantes de structures. Ces deux premières dimensions définissent entre elles un plan commun […]. Quant à la troisième dimension, ce serait celle de la réflexion comme pensée du même » (ibid., p. 358).
Un trièdre épistémologique est ainsi défini. À l’intérieur de ce trièdre, on peut distinguer trois régions définies par le triple rapport des sciences humaines en général « à la biologie, à l’économie, à la philologie » (ibid., p. 367). Mais entre ces régions existe un lien constitué par des modèles constituants qui « jouent le rôle de ‘catégories’ dans le savoir singulier des sciences humaines » (ibid., p. 368) (c’est nous qui soulignons). Foucault procède ainsi à une analyse kantienne des sciences sociales.
Les modèles constituants des sciences humaines [l’équivalent des catégories kantiennes] « sont empruntés aux trois domaines de la biologie, de l’économie et de l’étude du langage » (ibid., p. 368). Ils tirent du premier les registres de la fonction et de la norme, du second ceux du conflit et de la règle et du troisième ceux de la signification et du système.
Le rôle de ces trois modèles a évolué au cours du temps. Le premier dominait au cours du XIXe siècle, le second autour de 1900, le dernier après la première guerre mondiale.
« Mais ce glissement a été doublé d’un autre : celui qui a fait reculer le premier terme de chaque couple constituant (fonction, conflit, signification) […], et fait surgir avec d’autant plus d’intensité l’importance du second terme (norme, règle, système) […] » (ibid., p. 371).
Pour Foucault, « ce passage au point de vue de la norme, de la règle et du système, nous approche d’un problème qui a été laissé en suspens : celui de la représentation » (ibid., p. 372). Aux deux tendances qu’il vient de souligner, Foucault en adjoint donc une troisième : « depuis le XIXe siècle, les sciences humaines n’ont cessé d’approcher de cette région de l’inconscient où l’instance de la représentation est tenue en suspens » (ibid., p. 373).
Ce que bâtit ainsi Foucault, c’est une épistémologie des sciences humaines inspirée par la théorie kantienne de la connaissance, mais où les modèles constituants se substituent aux catégories et organisent tout le champ du savoir. Il y a plus :
« [Ces nouvelles catégories] permettent la dissociation, caractéristique de tout le savoir contemporain, entre la conscience et la représentation. Elles définissent la manière dont les empiricités peuvent être données à la représentation, mais sous une forme qui n’est pas présente à la conscience » (ibid., p. 374).
Cela confère à l’inconscient un rôle fondamental dans les sciences de l’homme :
« À l’horizon de toute science humaine, il y a le projet de ramener la conscience de l’homme à ses conditions réelles, de la restituer aux contenus et aux formes qui l’ont fait naître, et qui s’esquivent en elle ; c’est pourquoi le problème de l’inconscient – sa possibilité, son statut, son mode d’existence, les moyens de le connaître et de le mettre au jour – n’est pas seulement un problème intérieur aux sciences humaines et qu’elles rencontreraient au hasard de leurs démarches ; c’est un problème qui est fondamentalement coextensif à leur existence même. Une surélévation transcendantale retournée en un dévoilement du non-conscient est constitutive de toutes les sciences de l’homme » (ibid., p. 376) (c’est nous qui soulignons).
L’emploi du terme de transcendantal est révélateur : Foucault transpose dans les sciences de l’homme la dimension transcendantale qui fonde la théorie kantienne de la connaissance, mais il l’inverse. Il modifie en même temps sa portée : aux catégories données a priori, il substitue les modèles constituants ; les uns et les autres ont des points communs, mais les seconds permettent de prendre en compte l’inconscient au lieu de se localiser dans le clair espace de la raison.
Foucault tire de cette analyse une conclusion logique :
« On dira donc qu’il y a ‘science humaine’ non pas partout où il est question de l’homme, mais partout où on analyse, dans la dimension propre à l’inconscient, des normes, des règles, des ensembles signifiants qui dévoilent à la conscience les conditions de ses formes et de ses contenus. Parler de ‘sciences de l’homme’ dans tout autre cas, c’est pur et simple abus de langage » (ibid., p. 376).
Les véritables sciences de l’homme devraient s’appeler sciences de l’inconscient.
Parmi les types de sciences de l’homme dont nous avons esquissé plus haut le développement depuis deux siècles, Foucault ne reconnaît de caractère scientifique qu’au troisième, celui qui est axé sur l’inconscient – qu’il soit économique comme chez Marx, biologique (en partie au moins) chez Freud et linguistique chez de Saussure. Appliquer ce qualificatif aux autres, « c’est pur et simple abus de langage ».
En introduisant, au-dessous de la sphère de la claire pensée, la « région médiane » où se déploient les épistémès, Foucault substitue à la théorie kantienne de la connaissance une interprétation qui en inverse la structure et déplace l’espace où se situe le génie de l’homme de la sphère transcendantale de la liberté à celle des forces profondes et inconscientes. Il la fait également passer du domaine hors du temps de la métaphysique à celui de l’histoire. Tant qu’elles restent conçues comme purement analytiques, les sciences sociales ne font que répéter les mensonges de la société. Elles ne deviennent libératrices qu’en levant le voile trouble de l’inconscient.
Rupture totale ou inversion de la métaphysique kantienne ?
La métaphysique spéculait depuis Aristote sur Dieu, sur la Substance, sur l’Un. Kant montre la vanité de cette forme de réflexion, mais pour lui, la possibilité que possède l’esprit d’atteindre l’universel dans les domaines de la morale et de l’art lui ouvre l’absolu. Kant construit ainsi une nouvelle métaphysique, propose une morale de la responsabilité et initie l’esthétique. L’éminente dignité de l’homme résulte de la capacité qu’a son esprit d’interpréter les témoignages des sens : elle naît de son pouvoir transcendantal.
L’Homme tel que le concevait la philosophie est mort, comme le proclame ainsi Michel Foucault. Le modèle kantien est inversé et mis à mal1. Ce qui est fondamental chez l’homme, est-ce bien la raison ? N’est-ce pas plutôt un niveau plus profond de son être, celui de l’instinct et des forces vitales, comme l’affirmait Nietszche ? Dans les ambitieuses constructions philosophiques de l’humanité, de la science ou de Dieu, est-ce vraiment la notion présentée comme centrale qui compte, ou bien des facteurs marginaux qui, en sous-main, structurent la démarche, explique Jacques Derrida (Derrida, 1967) ? Aux constructions hiérarchiques de la pensée dominante, ne convient-il pas de préférer les liens horizontaux que souligne la démarche rhizomatique, enseigne Gilles Deleuze (Deleuze et Guattari 1980) ? Les grands récits sur lesquels repose notre conception du monde sont-ils autre chose que des romans, suggère François Lyotard (Lyotard, 1979) ?
La déconstruction libère-t-elle la connaissance du social de toute attache métaphysique, comme elle le prétend ? Ne lui substitue-t-elle pas plutôt une métaphysique qui demeure kantienne par sa structure, mais s’oppose à elle parce qu’elle a été en quelque sorte inversée ? Des forces immanentes profondes remplacent la dimension transcendantale de la pensée.
Foucault et la critique du discours
Le succès Des mots et des choses est considérable : Foucault est désormais un personnage public. Le terme d’épistémè entre très vite dans l’usage courant – même s’il ne sert le plus souvent qu’à désigner ce jeu assez flou d’influences qu’on qualifiait jusque-là d’un mot allemand, la Weltanschauung, la vision du monde.
Foucault est sensible aux critiques qu’a soulevées un ouvrage qui allait trop loin dans le sens du structuralisme. Dans la « région médiane » de la culture où se mêlent les jeux du pouvoir et de la réflexion, désigner comme épistémè l’ensemble des perspectives et des modes d’explication qui en résultent à une époque donnée transforme celui-ci en un tout cohérent et rigide : le caractère structuraliste de son interprétation est inutilement grossi.
« L’Archéologie du savoir » : un ouvrage difficile
Foucault publie en 1969 un ouvrage destiné à renforcer le socle théorique sur lequel il avait bâti Les Mots et les choses. Il a comme titre le sous-titre de ce dernier : L’Archéologie du savoir, ce qui souligne la continuité de son projet et la complémentarité des deux livres. S’il traite toujours du même niveau médian de la culture et du savoir, il ne l’analyse plus en termes d’épistémè, mais de formations discursives, une notion plus floue et plus plastique.
Quelles sont les propriétés fondamentales de ces formations ? Foucault consacre près de deux cents pages à l’expliquer. Je les ai lues plusieurs fois la plume à la main, notant les idées, essayant de les raccorder : je n’y suis parvenu qu’en consultant aussi les travaux qui commentent et explicitent ce texte, l’ouvrage de James Miller (1995) et celui d’Hubert Dreyfus et Paul Rabinow (1994) en particulier.
Le rôle des formations discursives « sérieuses »
Parmi les actes de discours et sans le préciser clairement, « Foucault s’intéresse plutôt à ceux qui, étant dissociés du contexte local d’affirmation et de l’arrière-plan familier, arrivent à constituer une sphère relativement autonome » (Dreyfus et Rabinow, 1984, p. 75). Ces actes y accèdent en « subissant avec succès une sorte de test institutionnel, qui peut être les règles de l’argumentation dialectique, ou bien celles du questionnement, ou encore la confirmation empirique » (ibid., p. 75-76). La précision qu’introduisent Dreyfus et Rabinow pour clarifier l’Archéologie du savoir est ignorée par la plupart des lecteurs de l’ouvrage : ils appliquent donc sans hésiter ses conclusions à toutes les formations discursives, y compris celles qui portent sur les « codes fondamentaux d’une culture – ceux qui régissent son langage, ses schémas perceptifs, ses échanges, ses techniques, ses valeurs, la hiérarchie de ses pratiques » (Foucault, 1966, p. 11). Nous y reviendrons lorsque nous nous attacherons à la postérité de la pensée foucaldienne.
Foucault ne s’attache qu’aux actes de discours que Dreyfus et Rabinow qualifient ainsi de sérieux en précisant : « n’importe quel acte de discours peut être sérieux à condition qu’on convoque les procédures de validation nécessaires, la communauté d’experts, etc. » (Dreyfus et Rabinow, 1984, p. 76). À la différence des phénoménologues, de Husserl ou de Merleau-Ponty par exemple, Foucault ne se soucie pas de savoir si les discours sérieux qu’il retient sont vrais (ce qu’ils prétendent être) :
« […] Foucault affirme qu’il n’a pas besoin de partager les croyances de ceux qui prennent ces actes de discours au sérieux, pour trouver des actes de discours sérieux entre tout ce qui est dit et écrit, pour sélectionner et ainsi limiter ce qui est pris au sérieux à une époque donnée, et l’approuver, le commenter ou le critiquer. Il peut donc se limiter à l’étude des énoncés rares et sérieux qui ont été soigneusement préservés et à la pléthore de commentaires auxquels ils ont donné lieu » (Dreyfus et Rabinow, 1984, p. 81).
Le travail de sélection a été mené par les éditeurs qui ont accepté de publier les textes et par les bibliothécaires qui en ont assuré la préservation et les ont classés par catégories : Foucault fait confiance à cet échantillonnage historique pour sélectionner les écrits sur lesquels il travaille.
Les énoncés sérieux auxquels il s’attache présentent une autre caractéristique : « l’ensemble du contexte verbal est plus déterminant que ses éléments, et donc il équivaut à plus que la somme de ses parties. En effet les parties n’existent qu’à l’intérieur du champ qui les identifie et les individualise » (ibid., p. 86) (c’est nous qui soulignons).
Les formations discursives « sérieuses »
modèleraient le monde social
Pour Foucault,
« les relations discursives qui permettent l’existence d’une référence sérieuse […] ne sont pas des relations primaires, c’est-à-dire des relations indépendantes de tout discours ou de tout objet de discours telles qu’elles ‘peuvent être décrites entre des institutions, des techniques, des formes sociales’ (Foucault, 1969, p. 62). Ce ne sont pas non plus des relations secondes, telles que le sujet parlant les utiliserait pour définir réflexivement son comportement. […] Les normes de sérieux ne sont déterminées ni par les relations primaires ou réelles, ni par les relations secondes ou réflexives, mais par la manière dont les pratiques discursives agencent ces relations […]. Cette théorie selon laquelle les pratiques discursives seraient en quelque sorte prioritaires parce qu’elles instaurent des relations entre d’autres types de relations, est l’un des postulats les plus importants, mais les moins développés de l’Archéologie » (Dreyfus et Rabinow, 1984, p. 96-97).
Celles-ci auraient comme trait spécifique de dépendre, dans leur construction, de ce qu’il définit comme un énoncé :
« L’énoncé, ce n’est […] pas une structure (c’est-à-dire un ensemble de relations entre des éléments variables, autorisant un nombre peut-être infini de modèles concrets) ; c’est une fonction d’existence qui appartient en propre aux signes et à partir de laquelle on peut décider ensuite, par l’analyse ou l’intuition, s’ils ‘font sens’ ou non, selon quelle règle ils se succèdent ou se juxtaposent, de quoi ils sont signe, et quelle sorte d’acte se trouve effectué par leur formulation (orale ou écrite) » (Foucault, 1969, p. 115).
Foucault précise plus loin :
« On voit que l’énoncé ne doit pas être traité comme un événement qui se serait produit en un temps et en un lieu déterminé, et qu’il serait tout juste possible de rappeler – et de célébrer de loin – dans un acte de mémoire. Mais on voit qu’il n’est pas non plus une forme idéale qu’on peut toujours actualiser dans un corps quelconque, dans un ensemble indifférent et sous des conditions matérielles qui n’importent pas. Trop répétable pour être entièrement solidaire des conditions spatio-temporelles de sa naissance […], trop lié à ce qui l’entoure et le supporte pour être aussi libre qu’une pure forme […], il est doté d’une certaine lourdeur modifiable, d’un poids relatif au champ dans lequel il est placé, d’une constance qui permet des utilisations diverses, d’une permanence temporelle qui n’a pas l’inertie d’une simple trace, et qui ne sommeille pas sur son propre passé. Alors qu’une énonciation peut être recommencée ou ré-évoquée, alors qu’une forme […]
peut-être réactualisée, l’énoncé, lui, a en propre de pouvoir être répété, mais toujours dans des conditions strictes » (ibid., p. 138).
Pour Foucault, ces conditions assureraient la pérennité et la transmissibilité des formations discursives. C’est l’existence primordiale, mais généralement ignorée, de l’énoncé, qui assurerait leur reproduction à l’identique et leur confèrerait un caractère prescriptif. Les discours s’imposeraient ainsi comme évidents à l’ensemble des populations qui en prendraient connaissance. Formuler un énoncé, c’est ainsi disposer du pouvoir de transmettre la même vision à tous ceux qui le reprennent. Toute l’interprétation foucaldienne du discours repose en définitive sur l’existence de cette forme matricielle qu’est l’énoncé, dont la rareté ferait le prix.
Le sujet central (l’énoncé) de L’Archéologie du savoir est élusif. Il arme les formations discursives mais échappe à l’évidence. Il est au travail au niveau de la langue et échappe à l’attention des locuteurs. Foucault élabore ainsi une conception de la communication qui répond à la scientificité telle qu’il la conçoit parce qu’elle s’ancre dans l’inconscient du langage (cf. supra, paragraphe « Les Mots et les Choses et les sciences de l’homme »). Dans cet ouvrage, il offre de l’énoncé une interprétation similaire à celle que Marx proposait de la genèse de la plus-value dans le Livre 1 du Capital – ce qui explique le caractère ardu et ésotérique de ces deux livres.
La portée de la thèse de Foucault (à savoir qu’indépendamment de son contenu, le discours suffirait à modeler l’ordre des choses) est immense. Elle est en même temps fragile : le rôle de l’énoncé dans la communication est aussi difficile à comprendre que ne l’est celui de la valeur-travail dans la genèse de la plus-value. Comme le soulignent Dreyfus et Rabinow : « Ce n’est que lorsqu’[il] aura abandonné cette thèse semi-structuraliste […] qu’il pourra circonscrire le domaine légitime de fonctionnement des pratiques discursives et rendre compte de la manière tout à fait singulière dont le discours dépend des pratiques discursives qu’il sert tout en les alimentant » (Dreyfus et Rabinow, 1984, p. 102).
S’attacher aux discours sérieux, c’est ne prendre en compte que ceux qui sont socialement retenus – ceux qui constituent l’armature de la culture. Pour Kant, la dimension transcendantale de l’esprit le dotait de catégories a priori qui lui permettaient d’expliquer la réalité empirique et de lui donner un sens. Les sciences humaines étaient nées pour étendre ce savoir à l’homme social. Elles y parvenaient assez mal dans la mesure où elles ignoraient tout ce qui dans les comportements humains échappait à la conscience. L’archéologie du savoir permet d’appréhender la succession des cadres mis en œuvre pour appréhender la vie sociale et pour peser sur elle – elle s’attache à la formation des objets, à celle des modalités associatives, aux concepts imaginés, aux stratégies développées.
Aux catégories a priori de Kant, fondamentalement ahistoriques et rationnelles, l’analyse foucaldienne substitue donc les modèles constituants qui saisissent la réalité de l’homme dans ses dimensions physiologiques, dans leurs traductions comportementales et dans la double dimension des contrôles personnels et collectifs qui leur sont appliqués.
Un impact considérable
L’analyse des formations discursives (sous-entendu : sérieuses) que propose Foucault a un impact immense sur les sciences sociales : elle attire l’attention sur le rôle de la sphère intermédiaire entre les formes premières de la culture et les connaissances philosophiques ou scientifiques dans la genèse des faits de domination.
Dans le monde anglophone, son succès doit beaucoup à sa mobilisation dans L’Orientalisme d’Edward Saïd (Saïd, 1980/1978). Ce dernier se penche sur le structuralisme de Foucault (Saïd, 1972), avant de mobiliser ses thèses pour montrer comment la domination qu’exerce à partir du XVIIIe siècle l’Occident sur l’Orient musulman est en germe dans les études savantes comme dans les récits de voyages ou les peintures qui portent sur cette partie du monde. Elles préparent l’expansion coloniale et la justifient à la fois.
À partir de Saïd se vulgarise l’idée que l’étude de la société doit avoir fondamentalement pour but de démasquer les discours porteurs de formes de domination qui en font un monde d’inégalités.
C’est là la généralisation d’un modèle d’interprétation professé par Foucault à un certain moment de sa vie, mais qu’il a par la suite transformé et amendé, comme on le voit dans son Histoire de la sexualité. Le rôle qu’il y donne au discours est beaucoup plus divers que celui qu’il envisageait dans l’Archéologie du savoir :
« Il faut concevoir le discours comme une série de segments discontinus, dont la fonction tactique n’est ni uniforme, ni stable. Plus précisément, il ne faut pas imaginer un monde du discours partagé entre le discours dominant et celui qui est dominé ; mais comme une multiplicité d’éléments discursifs qui peuvent jouer dans des stratégies diverses. C’est cette distribution qu’il faut restituer, avec ce qu’elle comporte de choses dites et de choses cachées, d’énonciations requises et interdites ; avec ce qu’elle suppose de variantes et d’effets différents selon qui parle, sa position de pouvoir, le contexte institutionnel où il se trouve placé ; avec ce qu’elle comporte aussi de déplacements et de réutilisations de formules identiques pour des objectifs opposés. Les discours, pas plus que les silences, ne sont une fois pour toutes soumis au pouvoir ou dressés contre lui. Il faut admettre un jeu complexe et instable où le discours peut être à la fois instrument et effet de pouvoir, mais aussi obstacle, butée, point de résistance et départ pour une stratégie opposée. Le discours véhicule et produit du pouvoir : il le renforce, mais aussi le mine, l’expose, le rend fragile et permet de le barrer » (Foucault, 1976, p. 133).
Le discours du dominé ne s’oppose pas en bloc à celui du dominant. Il faut tenir compte de la multiplicité des arguments qui entrent en jeu. Ce nouveau Foucault nuance terriblement l’analyse qu’il proposait du rôle des formations discursives quelques années plus tôt dans l’Archéologie du savoir.
Pierre Bourdieu et l’habitus
Pierre Bourdieu (1930-2002) élabore à partir des années 1960 une formulation nouvelle de la sociologie. Ancien élève de l’École Normale Supérieure, il est philosophe de formation. Il manifeste dès le départ beaucoup d’intérêt pour les fondements épistémologiques des sciences sociales (Chamboredon, Bourdieu et Passeron, 1967). À l’occasion de son service militaire et après, il se forme à l’ethnologie en menant des recherches en Algérie. Il pratique aussi et de plus en plus la sociologie.
Un problème lui paraît central dans l’interprétation de la vie collective : quelle est la part de la culture dans nos comportements ? Ou encore : quelle est le rôle joué par le libre choix des individus et celui qui résulte des formes de domination ?
Il traite la question en termes d’habitus : la notion apparaît tôt dans son œuvre, mais s’enrichit et se précise progressivement, comme le montre Juliette Grange. Celle-ci nous rappelle que « si les habitudes sont faites de la seule accumulation passive d’usages devenus spontanés à force d’être réitérés, […] l’habitus n’est pas un état, mais une manière d’être, une disposition physique et morale » (Grange, 2009, p. 35). Elle précise : « En sociologie, [l’habitus] n’est pas une simple acquisition individuelle, il est naturellement donné et socialement construit » (ibid.).
Bourdieu est plus explicite :
« L’habitus assure la présence active des expériences passées, qui, disposées en chaque organisme sous la forme de schèmes de perception […] tendent […] à conforter la conformité des pratiques et leur constance à travers le temps » (Bourdieu, 1980a, p. 91).
L’habitus, c’est de la culture, et donc du social incorporé : ce n’est pas une qualité intrinsèque de l’individu :
« En somme, par la médiation de l’habitus, le dépôt des expériences passées se convertit en dispositions pour l’avenir, l’habitude se fait habitus » (Héran, 1987, p. 383).
Sédimentation issue du passé, l’habitus est tourné vers le futur :
« [C’est] un système de dispositions durables, structures structurées prédisposées à fonctionner comme structures structurantes, c’est-à-dire en tant que principe de génération et de structuration de pratiques et de représentations qui peuvent être objectivement ‘réglées’ et ‘régulières’ sans être en rien le produit de l’obéissance à des règles » (Bourdieu, 2000, p. 175).
La socialisation inscrit donc dans l’individu des schèmes d’action qu’il ne perçoit pas comme venant de l’extérieur. Son comportement est conditionné sans qu’il en soit conscient. Ses initiatives lui sont soufflées par les dispositions qu’il a acquises sans en avoir gardé le souvenir.
La société est ainsi divisée en deux ensembles : celui des couches qui élaborent et diffusent conceptions du monde, catégories et façons d’agir, et celui des groupes qui les reçoivent et les assimilent sans s’en rendre compte. On a là l’explication du paradoxe de La Boétie : « s’il se peut que tant d’hommes, tant de bourgs, tant de villes, tant de nations endurent quelquefois un tyran seul », c’est parce que leur habitus les a préparés à agir selon des modalités qu’ils ont incorporées sans y être contraints par la force. Gramsci venait de renouveler le marxisme en soulignant que le règne du capitalisme était celui d’une classe capable de bâtir et d’imposer par l’éducation et par la culture une idéologie qui justifiait sa situation et ses revenus. Sans le dire explicitement, Bourdieu s’inscrit dans la lignée marxienne dont le succès s’affirme très vite après la publication de 1948 à 1951 des Carnets de prison (Gramsci, 1978-1996).
Au milieu des années 1960, Bourdieu mobilise ainsi la notion d’habitus dans le cadre des oppositions de classe, chaque groupe étant défini par sa situation économique. La traduction qu’il réalise alors d’Architecture gothique et pensée scolastique d’Erwin Panofsky lui fait découvrir une autre facette de l’habitus :
« Opposer l’individualité et la collectivité pour mieux sauvegarder les droits de l’individualité créatrice et les mystères de la création singulière, c’est se priver de découvrir la collectivité au cœur même de l’individualité, sous la forme de la culture – au sens de cultivation, de Bildung – ou pour parler le langage qu’emploie M. Erwin Panofsky, de l’habitus par lequel le créateur participe de sa collectivité et de son époque, et qui oriente et dirige, à son insu, les actes de création les plus uniques en apparence » (Bourdieu, 1967, p. 142).
Juliette Grange commente : « Le concept d’habitus [est] dans les œuvres présence complexe du génie individuel et de la culture collective » (Grange, 2009, p. 5). Cela conduit Bourdieu à insérer la notion dans un cadre matérialiste. Ce n’est pas dans l’âme que la société s’imprime dans l’individu, mais dans son corps : il reprend là des idées qui viennent de Merleau-Ponty et de Marcel Mauss :
« […] la société existe sous deux formes inséparables : d’un côté les institutions qui peuvent revêtir la forme de choses physiques, monuments, livres, etc. ; de l’autre les dispositions acquises, les manières durables d’être et de faire qui s’incarnent dans des corps (et que j’appelle des habitus). Le corps socialisé (ce que l’on appelle l’individu ou la personne) ne s’oppose pas à la société : il est une de ses formes d’existence » (Bourdieu, 1980b, p. 29).
Bourdieu rompt ainsi avec toute forme de dualité corps/esprit ou société/individu. La réalité sociale ne comporte qu’un niveau : celui des pratiques.
« Les dispositions seront donc plus incorporées qu’intériorisées et, bien qu’elles soient plus collectives qu’individuelles, c’est dans la singularité des corps concrets qu’elles se font jour : ‘[…] le collectif qui est déposé dans chaque individu sous forme de dispositions durables, comme des structures mentales’ n’est pas par conséquent un ensemble de représentations : ‘en outre tous les principes de choix sont incorporés, devenus postures, dispositions des corps : les valeurs sont des gestes, des manières de se tenir debout, de marcher, de parler’ » (Grange, 2009, p. 7, citant Bourdieu, 1980, p. 87-88).
Bourdieu rompt ainsi avec la conception philosophique du sujet et de la société. Le monde qu’il analyse n’est fait que de corps socialisés. L’habitus ne transforme pas une individualité qui serait antérieure à la société. Il « socialise l’individu et individualise le social dans une pratique qui mêle symbolique et matérialité » (Grange, 2009, op. cit., p. 9).
La conclusion est simple : l’individu que l’on observe, celui qui parle et qui agit, celui que le sociologue étudie, n’existe jamais par lui-même. Il se confond avec ce mélange inextricable d’individuel et de social qu’est l’habitus. Il n’existe pas de manifestation de l’être en dehors de ce dernier. L’individu n’échappe jamais à la société où il est inséré. Celui qui pense s’élever au-dessus des luttes et contestations de la vie collective ne peut échapper à l’habitus dont il est imprégné et qui le fabrique. La notion que Bourdieu a puisé dans la scolastique en vient à subvertir totalement les présupposés de toute pensée philosophique puisqu’elle fait disparaître l’homme comme entité isolée.
Dans le cadre scolastique, l’habitus est compris comme « un ensemble de schèmes fondamentaux préalablement assimilés, à partir desquels s’engendrent, selon un art de l’invention analogue à celui de l’écriture musicale, une infinité de schémas particuliers » (Bourdieu, 1967, p. 152). C’est cela qui assure à la notion sa fécondité. Mais dans le même temps, le spectateur que suppose la démarche est « un esprit sans matière et une âme sans corps » (Grange, 2009, p. 11). « Il omet l’agent réel, subjectif et objectif, esprit et matière, compris dans le monde et parfois le comprenant. Et c’est l’habitus, concept décidément arraché à la scolastique et entièrement retourné contre elle, qui résume cette philosophie matérialiste de la connaissance qu’est la sociologie » (ibid., p. 11).
Bourdieu résume ainsi sa position :
« C’est précisément la notion d’habitus qui restitue à l’agent un pouvoir générateur et unificateur, constructeur et classificateur, tout en rappelant que cette capacité de construire la réalité sociale, elle-même socialement construite, n’est pas celle d’un sujet transcendantal, mais celle du corps socialisé » (Bourdieu, 1997, p. 164).
L’homme social n’existe qu’à travers l’habitus qui lui est incorporé. C’est vrai du chercheur en sciences sociales comme de ceux qu’il étudie. Mais leurs habitus diffèrent substantiellement. Dans la mesure où l’habitus de tout un chacun incorpore des réflexes de soumission, il sert de véhicule à la domination d’une élite sur les masses populaires. L’habitus du scientifique intègre en revanche une rupture épistémologique qui lui donne une liberté nouvelle et lui permet de dénoncer les injustices dont souffre une grande partie de l’humanité.
« Il y a un habitus scientifique. Cet habitus est le seul qui permette à l’agent de se poser des questions sur les modalités de sa propre pratique. […] Cet habitus est celui des sciences sociales qui, contrairement à la philosophie, sont capables de se prendre dans une certaine mesure elles-mêmes pour objet » (Grange, 2009, p. 13).
Juliette Grange dégage ainsi la leçon que l’on peut tirer de l’œuvre de Bourdieu :
« Bourdieu est un véritable sociologue ‘à la française’ dans la mesure où il nous dit 1/ vouloir séparer philosophie et sociologie au profit de cette dernière et mettre de côté les questions de philosophie dans leur expression classique, 2/ que la sociologie est désormais la philosophie. Elle pense, autrement, les questions du sujet et de la liberté, de la domination et de l’émancipation, du collectif et de l’individu. Cette manière particulière, à la fois théorique et pratique, de faire de la philosophie a été pensée et projetée par Comte, affinée et en partie réalisée par Durkheim. Bourdieu se situe dans cette lignée pour qui la sociologie est la mise en œuvre d’une philosophie réellement pratique et matérialiste en même temps que soucieuse de réflexivité critique » (ibid., 2009, p. 13).
De La Boétie à Bourdieu
Le « Contre’un » de La Boétie est un cri d’indignation qui marque profondément la philosophie occidentale et fait de la compréhension de la vie sociale et des jeux de pouvoir un de ses objets essentiels. Les théories du contrat social montrent que le problème doit être posé en termes d’intérêt général – en termes sociaux. Elles font comprendre, avec Hobbes, pourquoi la servitude volontaire est indispensable pour assurer à tous la sécurité – ce qui supprime la liberté ; avec Locke et Rousseau, elles soulignent à quelles conditions le gouvernement peut assurer à tous le maximum de liberté et d’initiative qui soit conciliable avec l’intérêt général. Les Lumières font naître l’espoir que la dénonciation des défauts de l’organisation du monde politique suffira à réformer le monde. L’échec de la Révolution montre que les sociétés sont suffisamment fortes pour résister au poids des mots. La façon de poser le problème change : la société ne naît pas d’un simple accord entre les hommes ; c’est une réalité complexe et qui s’impose à eux. La question n’est plus : « comment l’instituer ou la ré-instituer ? », mais « comment la comprendre pour la réformer ou la refonder ? »
Les succès qu’enregistrent l’astronomie et la physique depuis Newton font prendre conscience de la puissance de la science. L’interprétation que donne Hume de la démarche scientifique et la puissance du sens moral présent en chaque individu que met en évidence Rousseau conduisent Kant à repenser la métaphysique : ce n’est plus une réflexion sur l’Être suprême, mais une analyse de ce qui donne à l’homme accès à l’absolu. Cette nouvelle forme de métaphysique fait comprendre comment l’action humaine conduit au progrès dans la mesure où elle vise l’universel, ce qui est la marque de la vraie liberté – façon de résoudre le problème posé par La Boétie.
La démarche suivie par Auguste Comte pour résoudre le problème posé par La Boétie diffère de celle de Kant puisqu’elle repose sur la condamnation de la métaphysique et sur la substitution à celle-ci d’une étude scientifique de la vie sociale.
Trois voies s’ouvrent ainsi à la réflexion et à la recherche. La première aborde le problème empiriquement en observant l’homme en action, les outils qu’il utilise, les artefacts qu’il fabrique ou les paysages qu’il modèle. La diversité des formes documentaires mises en œuvre et le temps et l’espace sur lesquels portent la recherche font naître une multiplicité de disciplines, dont chacune élabore des approches spécifiques. Comme elles traitent toutes de l’homme social, elles se heurtent aux mêmes problèmes d’interprétation : elles se réfèrent à une métathéorie, dont Max Weber élabore parallèlement les principes en se penchant sur l’action sociale et sur les idéaux-types que l’on peut construire en l’analysant.
La seconde piste, celle qui ne reconnaît comme scientifiques que les disciplines qui mettent à jour des mécanismes inconscients, ne se systématise que dans la seconde moitié du XXe siècle – autour de Michel Foucault en particulier, comme nous venons de le voir.
La troisième voie n’oublie pas que le problème a été initialement posé en termes philosophiques – celui des rapports entre l’individuel et le collectif. De Comte à Bourdieu, elle propose de construire une discipline de l’homme social axée sur le problème de la liberté humaine et des limites que lui impose la vie sociale. Elle rompt avec la métaphysique, c’est-à-dire avec les catégories de personne, de liberté et de bien public – et donc avec un rationalisme qui traite de réalités transcendantales.
Pour y parvenir, Comte et Durkheim opèrent d’abord un décentrement : pour eux, la réalité fondamentale, c’est la société parce qu’elle apparaît avant que la conscience individuelle ne se forme pour le premier, parce qu’elle répond à une autre logique, celle des ensembles qui sont plus grands que la somme de leurs composants pour l’autre. Ils suppriment ainsi la dualité du sensible et du transcendantal sur laquelle repose la métaphysique kantienne – mais c’est pour en introduire une nouvelle, celle de l’individu et du groupe. Ils soulignent que les hommes sont conscients de la supériorité de celui-ci comme le prouve la tendance qu’ils ont à sacraliser ce qui est collectif. Comte aussi bien que Durkheim franchissent alors un pas : en confiant à la sociologie la responsabilité de fonder une nouvelle religion de l’humanité ou une nouvelle morale sociale, ils situent la discipline qu’ils fondent sur un plan qui excède celui du simplement humain. Ils lui restituent la dimension transcendantale que le positivisme reprochait précisément à la philosophie.
L’opération ne va pas sans danger. Raymond Aron en est conscient : « la primauté de l’ensemble sur le détail [lui] parait raisonnable, pourvu qu’elle ne débouche pas sur une ‘métaphysique de la totalité’ » (Aron, 1928). Et Aron est de ceux qui ont pris le plus tôt conscience du danger des rhétoriques totalitaires…
La démarche de Pierre Bourdieu est différente. Pour s’affranchir des catégories métaphysiques dans l’analyse du social, il a recours à une catégorie scolastique, celle d’habitus – mais il la définit de manière plus radicale que Thomas d’Aquin, Durkheim ou Weber. Il s’inspire d’Erwin Panofsky pour affirmer que l’homme qu’étudie le sociologue n’est pas double de nature – qu’il est en totalité social. Pas de dualité, pas de hiérarchie des statuts ontologiques, plus de métaphysique dans son approche…
« Bourdieu se situe à une rupture épistémologique avec la sociologie existante, non pas en vertu de ses seuls choix de méthode, mais également en fonction de cette conviction plus insolite selon laquelle le sujet de la connaissance est lui-même un produit de la société dans laquelle il vit, apprend et comprend. C’est pourquoi Bourdieu appelle à une ‘sociologie de la connaissance sociologique’ » (Grange, 2009, p. 9).
Le tableau serait parfait s’il ne faisait pas une place à part à l’habitus du chercheur. Comme les Kabyles qu’il a étudiés, comme les paysans béarnais parmi lesquels il a été élevé, comme les commerçants, comme les ingénieurs, le chercheur est le produit du groupe où il a été formé. Mais il en diffère par un trait essentiel : son habitus l’a rendu apte à mener des études critiques dans la mesure où il a assimilé la (ou les) rupture(s) épistémologique(s) qui permet(tent) à la science d’élaborer des savoirs efficaces.
Bourdieu réintroduit donc subrepticement une dimension métaphysique dans la conception de la société qu’il propose. Comme chez Platon, le gouvernement des hommes doit être confié à ceux qui ont accès à la vérité : chez Bourdieu, ce n’est plus le philosophe, c’est le sociologue !
L’interprétation du social que propose Bourdieu connaît un succès prodigieux. Elle justifie toutes les lectures qui font de la domination la source des injustices du monde actuel, transforment les minorités en victimes et mettent en accusation l’ensemble des formes d’influence intellectuelle. Elle constitue un des piliers sur lequel repose le terrorisme intellectuel du politiquement correct.
De l’indignation de La Boétie face à la servitude volontaire à laquelle consent une partie de l’humanité au monde façonné par l’habitus, et donc totalement socialisé qu’imagine Bourdieu, il y a à la fois une continuité d’inspiration sur les limites que la vie sociale impose à la liberté, et une volonté de réduire l’expression de celle-ci, dans la mesure où elle suppose que l’individu soit doté d’un certain pouvoir transcendantal. C’est à l’abolition de celui-ci que conduit la toute-puissance de l’habitus. Bourdieu conclut ainsi à l’inéluctable sujétion de l’homme qui en résulte – sauf, bien entendu, s’il se trouve dans sa communauté un sociologue qui tranche par ses aptitudes critiques.
Conclusion
Les fondements du poststructuralisme et du postmodernisme sont à chercher (i) dans la déconstruction des philosophies de l’histoire et des idéologies issues de la révolution copernicienne qui a donné une nouvelle vigueur à la métaphysique, et (ii) dans la transformation de la philosophie en science qui poursuit les objectifs de celle-ci par d’autres moyens et prône la mise en place d’une religion de l’humanité.
Les travaux de Foucault sur les formations discursives et ceux de Bourdieu sur l’habitus conduisent à la construction d’approches qui se disent critiques parce qu’elles ne retiennent des réalités du monde actuel que les manquements des sociétés occidentales à leurs idéaux affichés et ignorent leurs dimensions positives.
L’image que l’on se faisait jusqu’alors de la science sort affaiblie de ce travail de déconstruction. On admettait qu’il existait une hiérarchie des disciplines : elle opposait les sciences dures (mathématiques, physique et dans une moindre mesure, sciences naturelles) aux sciences molles (les sciences de l’homme et de la société). Pour améliorer leur statut, ces dernières n’avaient d’autre solution que d’imiter les premières : leurs chercheurs ne devaient s’intéresser qu’à ce qui relevait de la raison la plus rigoureuse ; il leur fallait se méfier de tout ce qui naissait du rêve. Un tournant épistémologique intervient alors : les pouvoirs de l’imagination ne sont-ils pas aussi profondément humains que ceux de la raison ?
Les sciences sociales ne singent plus les mathématiques, la physique ou les sciences naturelles : elles sont arrimées à l’inconscient et découvrent ce qu’elles peuvent tirer des humanités et des arts. Elles doivent être reconstruites.
Il n’apparaît plus possible de traiter des réalités sociales sans prendre en compte la place qu’y tient la pensée, qu’elle soit rationnelle ou animée par les jeux de l’imagination : on est entré dans l’ère du poststructuralisme. Mais on ne peut échapper aussi au tragique d’une situation où le rôle des formations discursives et de l’habitus condamne une partie souvent majoritaire de l’humanité à la servitude.
Si l’on veut comprendre les formes prises par la géographie poststructuraliste, il est donc indispensable de saisir pourquoi la réflexion poststructuraliste substitue aux formes empiriques de la recherche sociale celles qui reposent sur l’inversion de la métaphysique kantienne (les sciences sociales de l’inconscient, pour Foucault) ou sur la socialisation totale de l’individu (la sociologie de l’habitus de Bourdieu, héritière de celles de Comte et de Durkheim).
Note
- Pour plus de détails, voir le paragraphe suivant (Foucault et la critique du discours) et le chapitre 6 : « Foucault et l’espace ».