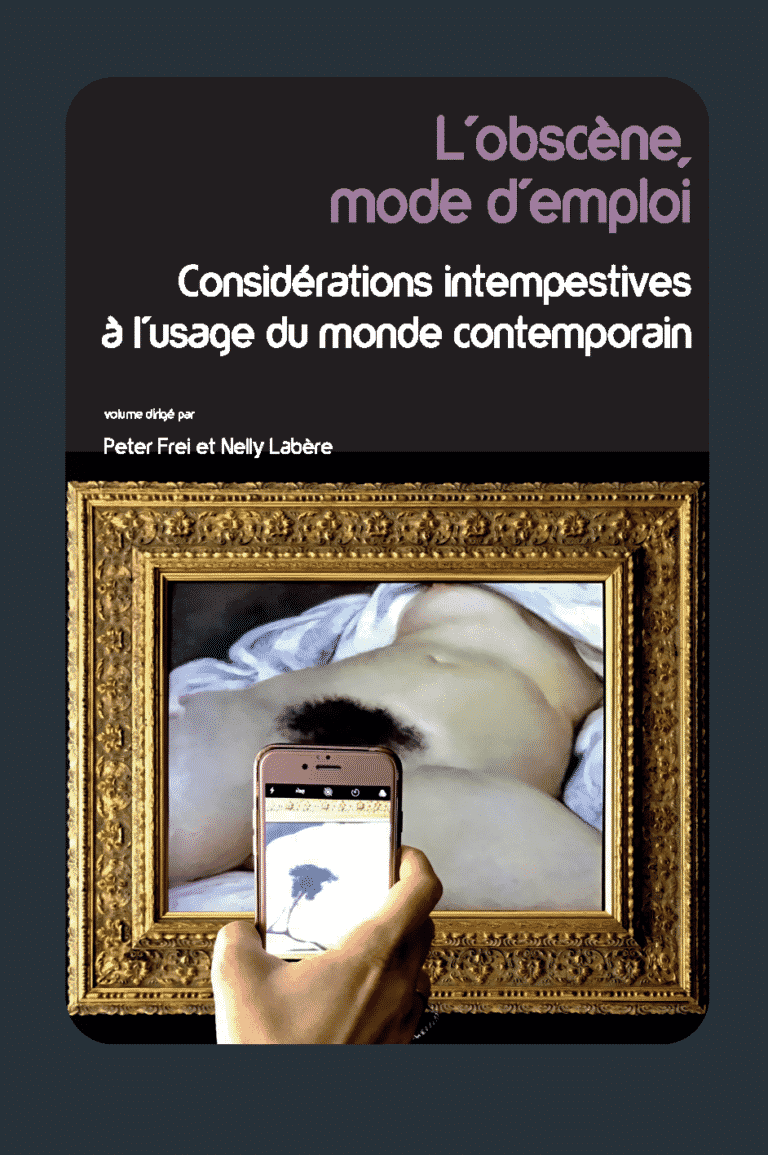En ouverture de l’essai White, Bret Easton Ellis évoque son adolescence, lorsqu’il regardait librement des films qui, écrit-il, l’ont mené vers l’âge adulte, avec leurs dialogues très crus et leurs représentations d’une mort « sanglante, réaliste, intime1 ». En 1979 – il avait alors quinze ans –, découvrit-il sur les écrans Apocalypse Now ? entendit-il l’ultime réplique du colonel Kurz ? They train young men to drop fire on people. But their commanders won’t allow them to write “fuck” on their airplanes because it is obscene2. Je me prends à imaginer que ces quelques mots retentirent dans l’esprit du jeune spectateur, au moment d’examiner la très grande portée de ce fuck chez l’écrivain qu’il est devenu : signe de survie, part demeurante d’art et d’humanité, autrement dit écriture de l’obscène, libératrice dans son énonciation quoiqu’elle fût souvent inacceptable dans sa réception, depuis le scandale d’American Psycho (1991) jusqu’aux bravades des récents tweets évoqués dans White (2019).
An obscene, satisfying angle
Pour commencer, rappelons brièvement quel tapage accompagna la sortie différée d’American Psycho. À la fin de l’été 1990, quelques pages du roman à paraître fuitèrent dans les journaux américains, et une campagne de presse agressive finit par faire plier l’éditeur : alors que le livre était déjà imprimé, Simon & Schuster annula finalement sa publication. Certes, un nouvel éditeur (Vintage Books) assura promptement cette publication, en mars 1991 ; mais l’influente National Organisation for Women en orchestra le boycott, relayé par diverses associations, alors que le romancier recevait de nombreuses menaces de mort. Comment expliquer ces réactions ? Aujourd’hui encore, le lecteur d’American Psycho ne peut manquer d’être saisi par sa sauvagerie glacée, ses déchaînements pornographiques, sa violence horrifique ; et pourtant, au-delà de cette évidence partageable, il n’est pas aisé de déterminer exactement ce que le roman contient de si durablement choquant.
Pour une part, il fonctionne comme une sorte de documentaire consacré à la jeunesse très dorée des années 80, les yuppies : des individus habitant à proximité de Wall Street et œuvrant dans la finance, dont on suit ici le quotidien creux et cynique, tissé (entre autres) de vêtements griffés, de cosmétiques, de cocaïne et de cartes de crédit. Sur ce cadre presque documentaire vient alors se greffer la part proprement fictionnelle, avec les forfaits inouïs du narrateur, Patrick Bateman : soit un diplômé de l’Harvard Business School, travaillant pour l’entreprise d’investissement de son père, rêvant d’être Donald Trump – et qui devient, la nuit tombée, tueur en série. Assassinats, tortures, cannibalisme, nécrophilie… l’étendue de ses crimes est telle qu’on ne sait plus à la fin dans quelle mesure ils sont effectivement perpétrés, ou relèvent de son imagination déréglée. Ellis a confessé à plusieurs reprises qu’il ne sortait pas lui-même de cette hésitation ; quelle que soit la fiabilité du narrateur, c’est en tout cas avec gourmandise et minutie qu’il relate les furies meurtrières que subissent prostituées ou amantes, collègue ou encore chien de clochard :
« Voilà vingt-cinq cents, dis-je calmement. Va t’acheter un chewing-gum, pauvre connard de nègre. » Puis je me tourne vers le chien qui aboie et, en me relevant, j’écrase ses pattes antérieures à l’instant où, ramassé sur lui-même, il s’apprêtait à bondir, montrant les crocs. Je lui brise instantanément les os des deux pattes, et il tombe sur le côté, glapissant de douleur, les pattes de devant tendues vers le ciel, formant un angle obscène assez plaisant3.
« Obscène » : le grand mot est lâché, dont ont justement usé les premières critiques d’American Psycho4. Le roman y était jugé coupable de n’accorder aucun respect aux êtres humains, de dénier tout caractère sacré à leur existence, de se complaire dans une forme d’érotisation de la violence, notamment de la violence misogyne. Comme s’il coulait les actes de sadisme dans une prose lascive, Ellis ne ménage aucune rupture de ton entre la représentation de l’excitation sexuelle et celle du carnage : les meurtres en série semblent alors toucher au dernier chic, et la haine des femmes atteindre de fascinantes hauteurs.
Cette lecture a pu justifier qu’on boycotte le livre, ou tout au moins qu’on s’en indigne. Ce faisant, on a aussi postulé que le narrateur pouvait avoir valeur de porte-parole, voire de modèle, dans une intrigue qu’on prenait à la lettre, en lui prêtant les contours du réel. Or il est hautement improbable que Bateman constitue un personnage réaliste, et qu’il faille croire à l’existence de ce financier psychopathe. Considérons donc, avec d’autres critiques, que cette chimère romanesque fonctionne comme une métaphore :
American Psycho peut être lu comme une prise au sens propre de la métaphore entrepreneuriale du « tueur ». Ce vacillement du figuré au propre est terrifiant dans son grotesque, porté par une esthétique trash et gore. Bateman est l’incarnation fictionnelle de l’obscénité du monde marchand : il est l’homme insensible qui, pour s’éprouver, poursuit une chimérique jouissance dans la destruction des faibles5.
L’absence d’émotions du serial killer ne serait donc que l’image outrée d’un capitalisme qui se saisit des individus comme de choses. Autre intelligence de l’obscénité : elle exprimerait ce système de prédations où triomphe l’argent, cet hédonisme consumériste où la sexualité des dominants « est dérégulée, excessive, s’épuisant dans un nihilisme criminel6 ». « Quant à son estomac, on dirait la lasagne à l’aubergine et au fromage de Il Marlibro […]7 » : avec Bateman qui compare une femme qu’il vient d’éventrer à tel plat d’un grand restaurant, nous tiendrions ainsi une figure paroxystique de la déshumanisation.
Il me semble qu’une autre interprétation est encore possible, interprétation que confortent certains commentaires ultérieurs d’Ellis. Étant donné le caractère insoutenable de nombreuses pages, Bateman ne nous semble rien d’autre qu’un monstre (quand bien même il ne serait qu’un monstre d’imagination), et par là le reflet d’une société monstrueuse. Mais l’on peut faire une expérience de (re)lecture qui met entre parenthèses les déchaînements de violence et de sexe et qui, davantage qu’aux crudités étalées, s’attache plutôt à certains dialogues :
— Et pour ceux qui veulent des vacances actives, il y a l’escalade, les randonnées souterraines, la voile, le cheval, le rafting. Pour les joueurs, de nombreuses îles ont un casino…
L’espace d’une seconde, je me vois tirer un couteau et couper un poignet, un de mes poignets, pour en présenter la veine jaillissante au visage d’Armstrong, ou mieux encore la diriger vers son costume, et je me demande s’il continuerait de parler. J’envisage la possibilité de me lever et de partir sans m’excuser, de prendre un taxi et de faire un tour aux toilettes, même passer un coup de fil à Evelyn, éventuellement, avant de revenir au DuPlex, et chacune des molécules qui composent mon organisme me dit qu’Armstrong serait toujours en train de parler, non seulement de ses vacances, mais de ce qui semble être le lieu de vacances du monde entier : ses Bahamas à la con. Entre-temps, le serveur emporte nos hors-d’œuvre à demi terminés, apporte deux autres Coronas, du poulet d’élevage au vinaigre de framboise et à la sauce verte, du foie de veau aux poireaux et à la laitance d’alose, et je ne sais plus qui a commandé quoi, mais cela n’a pas une grande importance, car les deux plats sont parfaitement identiques. Je me retrouve avec le poulet d’élevage garni en plus d’un coulis de tomates naines, je crois.
— On n’a pas besoin de passeport pour visiter la Caraïbe, il suffit de prouver sa nationalité américaine, et ce qui est encore mieux, c’est que la langue ne constitue pas une barrière. On parle l’anglais partout, même sur les îles où le français et l’espagnol sont la langue officielle. La plupart des îles étaient autrefois britanniques…
— Ma vie est un enfer, dis-je tout à trac, tout en faisant tourner machinalement les poireaux sur mon assiette, qui entre parenthèses est en porcelaine et triangulaire. Et il y a beaucoup de gens que je voudrais… que je veux, eh bien, disons assassiner. J’ai insisté sur le dernier mot, sans quitter des yeux le visage d’Armstrong.
— La desserte des îles s’est améliorée, car American Airlines et Eastern Airlines ont créé à San Juan une base d’où partent des vols8 […].
Comme le proclame cet adepte des Bahamas, on parle l’anglais partout. L’enfer capitaliste est ici-bas sans extériorité : c’est le règne de l’indifférencié – les plats se confondent – et de l’indifférent – chacun soliloque. La « conversation » est toutefois relatée au travers d’un point de vue qui n’a rien d’indifférent, Bateman se trouvant agité par une exaspération qu’il est très loisible d’admettre. On peut en effet comprendre qu’il rêve qu’une tache de sang, qu’une forme organique et malséante vienne enfin faire cesser un bavardage infini pour ramener son interlocuteur à une réalité sensible. Revenant sur la manière dont son roman s’inscrivait en faux contre l’Amérique des années 80, Ellis écrit en ce sens dans White :
[…] j’ai vu là une réponse appropriée à une société obsédée par la surface des choses et encline à ignorer tout ce qui pointait vers l’obscurité rôdant au-dessous […] la violence libérée à l’intérieur [du livre] était liée à ma frustration, et du moins évoquait quelque chose de réel et de tangible dans cette époque des surfaces. Parce que le sang et les viscères étaient réels, la mort était réelle, le viol et le meurtre étaient réels – même si, dans le monde d’American Psycho, ils n’étaient pas plus réels que l’imposture de la société qui était décrite9.
Cette violence correspond donc à un mouvement de négation, ou pour le dire en termes hégéliens, au moment du négatif : celui par quoi Bateman exprime un désaccord avec le monde donné. « Je n’étais qu’une imitation, la grossière contrefaçon d’un être humain. Seul un recoin obscur de mon cerveau fonctionnait10 » : ce recoin obscur, c’est celui des crimes, fantasmés ou accomplis ; sang, viscères, mort, viol, c’est bien là où il échappe à l’abstraction totale et à la perte du moi, quoique sa sauvagerie vienne à s’exprimer dans les formes mêmes – cliniques – de la société qui l’oppresse.
Voilà quelque chose d’assez déstabilisant : ce qui nous remplit de terreur et de dégoût, ce qui nous choque au-delà de tout, c’est dans American Psycho le dernier fil qui relie le personnage à la vie. Dite au moyen d’une écriture froidement obscène, sa monstruosité est en définitive le dernier endroit où loge l’individu, où il cesse de se conformer – en témoigne encore, dans un autre commentaire d’Ellis, cette juxtaposition très parlante : Bateman « errait dans les rues à la recherche d’une proie, affirmant sa monstruosité, son individualité11».
A black farce
Son « moi de cauchemar12 », ou encore « la pire version de moi-même par moi-même13 » : à plusieurs reprises, Ellis revient donc dans White sur cette créature romanesque qui semble désormais l’accompagner, avec laquelle il partage une origine privilégiée aussi bien que des difficultés à s’insérer. Entre autres interrogations, il se demande ce que ferait aujourd’hui Bateman : par exemple, comment s’adapterait-il à nos temps numériques ? « Aurait-il un compte Twitter pour se vanter de ce qu’il a accompli14 ? » Question d’autant plus intéressante que, sans lui être explicitement articulée, elle intervient dans un essai où Ellis évoque en détail sa propre expérience des réseaux sociaux.
Plantons le décor. En décembre 2012, réagissant au succès critique du film Zero Dark Thirty de Kathryn Bigelow (notamment lauréate de divers prix), Ellis poste une série de tweets qui vont être – c’est un euphémisme – mal perçus. Ainsi celui où il déclare « Kathryn Bigelow serait considérée comme un réalisateur vaguement intéressant si elle était un homme, mais comme c’est une femme très sexy, elle est complètement surestimée ». La phrase est longuement commentée dans White :
[…] je faisais du trolling. Et mon désir était de passer un bon moment, d’être provocateur, un critique un peu scandaleux aux opinions arrêtées, d’être un mauvais garçon, un abruti, et de mener la danse à ma façon dans ce train fantôme d’écrivain – le tout en cent quarante caractères maximum […]. Vous tweetez, les gens crient, les gens rient, vous haussez les épaules, tout le monde passe à autre chose – c’était comme ça que je voyais Twitter au départ. Mais au bout d’un moment j’ai compris que Twitter encourageait en fait la colère et le désespoir – depuis l’exagérément sincère, en passant par le signaleur de vertus, le débile, le littéral, jusqu’au dépourvu d’humour. Jusque-là, je n’avais jamais considéré que c’était l’endroit où définir son autorité morale ou obtenir du respect, ou encore étaler ce qu’on avait de plus sensible. Twitter était l’endroit pour les pensées fulgurantes et les réponses immédiates à des stimuli culturels, pour capturer des choses qui flottaient dans l’air du temps numérique, un endroit où proférer des insultes et manifester une absence de conscience – c’était une machine construite pour l’outrage et le scepticisme. Mes tweets sur la réalisatrice Kathryn Bigelow prouvaient-ils que j’étais « véritablement dément » ? Étaient-ils réellement « sexistes » et « toxiques » Kathryn Bigelow était-elle à ce point importante que la juger surestimée – pas incompétente ou incapable – parce qu’elle était belle constituait un franchissement intolérable de la ligne de la décence15 ?
Ellis représente Twitter comme un medium sans conséquence, c’est à dire sans importance, puisque ce qui est vite écrit vaut pour être aussitôt lu et bientôt oublié ; mais aussi inconséquent, puisqu’on écrit pour se faire peur et pour faire peur, en transgressant spontanément et en toute liberté l’interdit, la décence, l’intelligence même. On peut par ailleurs comprendre que cette inconséquence n’est pas sans art : c’est un « train fantôme d’écrivain »16, une petite machine lancée à toute allure pour produire des frissons, au gré d’une part de mise en scène difficilement appréciable. Est-ce un abruti péremptoire qui donne ici de la voix, ou un autre moi de cauchemar, ou encore Bret Easton Ellis lui-même en son âme et conscience ? Il parle quelques pages plus loin d’une forme d’expression « vaguement sérieuse », d’une « performance artistique et provocatrice […] réelle et fausse, facile à lire et difficile à déchiffrer »17 ; et encore, cette fois au sujet des tweets de Kanye West : « un truc bipolaire, une performance artistique dada »18.
Le tweet se voit ainsi situé dans le champ de la modernité, et de ses théâtres du dérèglement ; mais il pourrait, au sens festif et ambigu où l’entend Ellis, avoir de plus lointains ancêtres. Ainsi certains genres médiévaux, comme la farce, qu’on associe ordinairement à la présence de motifs corporels, sexués, scatologiques, et qui est plus profondément caractérisée par l’art de l’équivoque verbale, par les dispositifs qui s’entendent à troubler les registres et les discours, par les formes de polyphonie ou de polysémie qui font ponctuellement frémir ou jubiler le public19 : voilà qui peut faire songer aux tweets qui éclatent comme des bulles, et dont la fulgurance fait trembler le sens20.
« Twitter encourageait le mauvais en moi21 », écrit Ellis. D’un terreau d’obscénités à l’autre, on peut rapprocher ce bad boy du narrateur d’American Psycho ; et considérer que l’auteur de cette « longue blague de mauvais goût », de cette « farce sombre22 », a rejoué sur un mode mineur – autrement dit en 280 caractères maximum – la tentative de libération qu’avait chorégraphié le grand roman. Ce faisant, il dit s’être mépris sur la fonction de Twitter qui, pour nombre de ses utilisateurs, et peut-être la majorité, n’est pas conçu comme le véhicule d’un geste contradictoire et créatif, mais bien plutôt comme « l’endroit où définir sa position morale », le lieu d’une partition très univoque. De là, les réactions qui ont suivi ses tweets, réactions sans proportion avec ce qu’il avait voulu inspirer : non pas quelques rires, ou bien quelques frissons d’une indignation passagère, mais ce qu’il nomme de véritables « hurlements en ligne23 » et l’imputation, comme dans 1984 d’Orwell, d’un « crime de pensée24 ».
A new fascism
Si une anxiété fait se rejoindre tous les livres d’Ellis, c’est sans doute celle de la dissolution de l’individu, de son absorption dans un réseau de conformités. On s’étonnera peut-être, d’American Psycho à White, que ces conformités aient tant varié, dans une sorte de grand écart politique : si en 1991 il s’agissait de s’attaquer aux façades clinquantes du reaganisme, aujourd’hui sont plutôt visés les théâtres de vertu démocrates. On peut pourtant trouver une logique profonde, puisque Ellis s’attache toujours à décrire les effets du capital : quand s’écroulent les utopies de fortune économique, il n’y a plus de place que pour une « économie de la réputation25 ». C’est alors selon les lois de cette nouvelle économie que nous devons « manufacturer une construction de nous-mêmes destinée aux réseaux sociaux26 », avec sa « fausse surface sans défaut27 » :
S’il ne semble pas qu’une voie économique quelconque puisse vous permettre d’améliorer votre situation, alors la popularité devient l’échelle de mesure et la norme et aussi la raison pour laquelle vous désirez que des milliers de gens vous aiment sur Twitter, Facebook, Instagram, Tumblr, où que ce soit – et comme un acteur, vous essaierez désespérément d’être aimé28.
Au terme de cette phrase, on peut préférer la syllepse grinçante de l’anglais, avec le verbe liked29 qui évoque évidemment la pratique des réseaux sociaux. Ces réseaux viennent ainsi combiner une nouvelle société de cour en open space : l’écheveau des promotions et des déchéances s’y fonde sur de nouvelles lois de la représentation dont la transparence est la pierre angulaire. Ici le moi est censé s’exhiber dans sa vérité idéale, et refuser tout jeu d’énonciation. Dans cette société qu’Ellis qualifie d’« entreprise30 », où il va parfois jusqu’à distinguer « une nouvelle forme de fascisme31 », sa poétique demeure-t-elle possible ?
La question pourrait très largement se poser, si l’on considère par exemple, avec Pierre Lepape, que le propre de la littérature est d’inventer « une langue qui sait cacher autant qu’elle montre32 » – très loin des serial killers et des tweets – le critique évoque comment, confronté aux injonctions des pouvoirs spirituel et temporel, le Fénelon des Aventures de Télémaque a su « échappe[r] aux mécanismes de l’aveu33 » grâce à la fable et à son discours ombré, glissant, indécidable. Pour en rester à nos objets d’étude, on peut en tout cas se demander si l’indécision qui accompagne notre découverte de Patrick Bateman continue d’être envisageable ; et si la duplicité de son énonciation scandaleuse serait aujourd’hui admissible. Le romancier Ellis – dont il faut noter qu’il publie aujourd’hui un essai… –, tout en revenant sur les débats qui accompagnèrent la sortie d’American Psycho, tout en relevant leur violence, remarque en même temps qu’ils purent avoir lieu, et ce sans déboucher uniment sur cette condamnation que lui valurent des tweets d’une bien moindre portée. On peut alors soupçonner que, dans une culture qui fait primer l’idéologie sur l’esthétique et « ne se soucie plus du tout d’art34 », l’obscénité ne soit plus comprise comme expression nécessaire du négatif, puissance d’invention et d’émancipation ; mais qu’elle s’accompagne plus que jamais, dans la réception des œuvres et des discours, du sentiment d’un outrage insoutenable, et par voie inaudible. Le risque n’est plus, comme à Versailles, d’être ridiculisé, mais en quelque sorte obscenifié.
Notes
- Bret Easton Ellis, White, trad. P. Guglielmina, Paris, Robert Laffont, coll. Pavillons, 2019, p. 27.
- Dans la version française : « Ils entraînent les jeunes hommes à déverser du feu sur les gens. Mais leurs commandants leur interdisent d’écrire «fuck» sur les avions parce que c’est obscène. » C’est Marlon Brando qui incarne Kurz, devant la caméra de Francis Ford Coppola.
- Bret Easton Ellis, American Psycho, trad. Alain Defossé, Paris, Robert Laffont, coll. Pavillons, 1991, p. 148.
- Justine Ettler cite et commente de larges extraits de ces critiques dans son étude « «Sex Sells, Dude» 1: A Re-examination of the Mass Media Feminist Critique of American Psycho ». In ProQuest, 2014, [en ligne] https://www.proquest.com/docview/1649119232 [consulté le 02/11/22]
- Nicolas Léger, « Face à l’obscénité du monde », Esprit, 7, juillet-août 2017, p. 63.
- Ibid. Robert Zaller adopte la même grille d’analyse lorsqu’il rattache les agissements de Bateman aux rituels capitalistes de consommation insensée : He is insatiable, but so is the system he embodies. (« American Psycho, American Censorship and the Dahmer Case », Revue Française d’Études Américaines, 57, juillet 1993, p. 322). Je traduis : « Il est insatiable, mais le système qu’il incarne l’est aussi. »
- Bret Easton Ellis, American Psycho, op. cit., p. 381.
- Ibid., p. 160-161.
- Bret Easton Ellis, White, op. cit., p. 88. Ces propos sur la société reaganienne peuvent être sans mal rapprochés de l’évocation par Philippe Muray d’un nouveau contrat social : « La civilisation actuelle s’est engagée dans la besogne titanesque consistant à éradiquer l’instinct de mort, quel que soit le nom qu’on lui donne (part maudite, hostilité primaire, violence, péché, négativité, Mal, etc.), au profit de l’édification d’un monde abstrait, stylisé, épuré, nettoyé de toutes les irrégularités, de tous les accidents, de tous les écarts, de toutes les perturbations, de toutes les velléités de destruction ou d’autodestruction des siècles révolus. » (« Les ravages de la tolérance » [2009], Essais, Paris, Les Belles Lettres, 2010, p. 1294).
- Bret Easton Ellis, American Psycho, op. cit., p. 312-313.
- Id., White, op. cit., p. 87 (c’est moi qui souligne).
- Ibid., p. 254.
- Ibid., p. 87.
- Ibid., p. 255.
- Ibid., p. 217.
- La dimension foraine est bien présente dans le texte original, avec l’expression writer’s funhouse (White, London, Picador, 2019, p. 193).
- Bret Easton Ellis, White, op. cit., p. 215.
- Ibid., p. 280.
- Obscène Moyen Âge ?, dir. Nelly Labère, Paris, Honoré Champion, 2015, p. 190.
- On pourrait d’ailleurs poser l’hypothèse de la vitesse comme qualité de l’obscène : « Il y aurait un régime pépère du sens, et l’obscénité boosterait cette circulation-là. » (Arno Bertina, « Véhicule rapide », Inculte, 6, sept. 2005, p. 27).
- Bret Easton Ellis, White, op. cit., p. 220.
- Ibid., p. 142 pour les deux citations.
- Ibid., p. 207.
- Ibid., p. 135.
- Ibid., p. 137.
- Ibid., p. 139.
- Ibid.
- Ibid., p. 155. Il est à nouveau tentant de rapprocher ces analyses de celles de Philipe Muray : « Je propose […] de substituer, à la valeur d’usage et à la valeur d’échange, devenues secondaires dans la mesure où plus aucune marchandise n’a de qualité concrète, la valeur d’éloge, en précisant que celle-ci me paraît s’articuler dialectiquement avec une autre valeur, la valeur d’effroi ou d’intimidation. Et toutes deux peuvent être regroupées sous le label valeur de dressage. » (Entretien [2002], Essais, Paris, Les Belles Lettres, 2010, p. 1224).
- Dans le texte original, p. 135. Le passage au français fait de même perdre un sens spécialisé lorsque a troll and a hater (p. 116) est traduit par « un “troll” et un ennemi » (p. 135).
- Bret Easton Ellis, White, op. cit., p. 66. Dans le texte original, il écrit the corporation (p. 52).
- Ibid., p. 126. La traduction euphémise la formule plus tranchée dans le texte original a new fascism (p. 109).
- Pierre Lepape, Le Pays de la littérature, Paris, Seuil, Coll. Fiction & Cie, 2003, p. 258.
- Ibid., p. 259.
- Bret Easton Ellis, White, op. cit., p. 107.