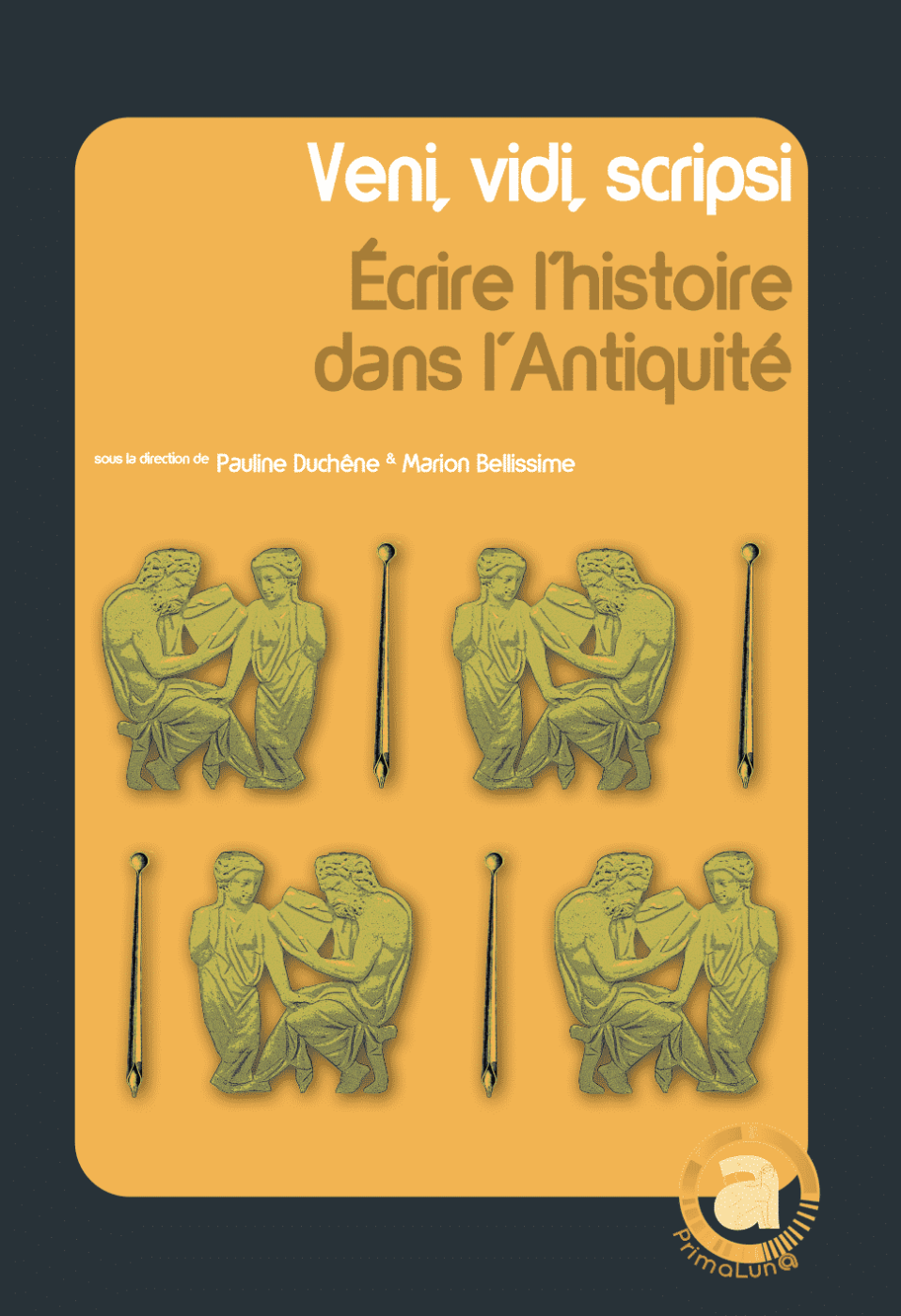Présentation du séminaire Historiographies antiques
L’idée du séminaire Historiographies antiques nous est venue en mars 2015, à un moment où nous avions toutes les deux soutenu nos thèses et cherchions un moyen de rassembler des chercheur.se.s, débutant.e.s et confirmé.e.s, travaillant en nombre croissant sur un sujet commun : l’écriture de l’histoire dans l’Antiquité. En effet, il n’existait pas, à cette époque, de lieu de rencontre spécifique à l’historiographie antique, dont les spécialistes intervenaient dans les marges des colloques en histoire ou en littérature grecque et latine et peu dans des rencontres abordant spécifiquement leur sujet, à plus forte raison lors de séances se réunissant à intervalles réguliers. Nous avions aussi, durant notre doctorat, éprouvé le manque d’une structure nous permettant de préciser nos idées dans ce domaine si particulier et de rencontrer des chercheur.se.s à la renommée déjà établie1.
Le séminaire est donc né d’une double dynamique. D’abord, mettre en place un espace décloisonné disciplinairement, afin de pouvoir aborder dans toutes ses dimensions ce genre à la frontière entre plusieurs domaines : littérature, histoire, archéologie, philosophie, monde romain, monde grec, voire même autres civilisations antiques. Ensuite, favoriser les rencontres entre jeunes chercheur.se.s et chercheur.se.s confirmé.e.s, grâce au système de “répondant.e” : à chaque séance, une personne supplémentaire reçoit à l’avance le texte de l’intervenant.e, afin de préparer quelques questions permettant de lancer la discussion ; quand intervient un.e chercheur.se confirmé.e, ce répondant.e est un.e chercheur.se débutant.e et inversement. Déplorant le peu de temps souvent alloué dans les colloques pour présenter travaux et réflexions, nous avons choisi de ne faire intervenir qu’une seule personne par séance, afin de lui donner pleinement le temps de développer sa pensée et, ensuite, de pouvoir échanger entre présent.e.s sans risquer de léser la personne devant parler après. Le but était d’accueillir aussi bien des développements poussés et aboutis que la présentation de recherches encore en cours.
L’une de nous s’étant installée à Lyon, nous avons décidé que les séances alterneraient entre cette ville – où, grâce à l’inclusion de V. Hollard, de l’Université Lyon 2, dans le projet, la Maison de l’Orient et de la Méditerranée (MOM) nous a accueilli.e.s –, et Paris, où M. Lencou-Barème et F. Bérard ont accepté de mettre à notre disposition les salles du département des Sciences de l’Antiquité. Le séminaire a aussi bénéficié, grâce à É. Wolff, de l’aide du laboratoire ArScAn Themam, de l’Université Paris Nanterre, ce qui nous a permis d’organiser, en 2017, deux séances dans le nouveau bâtiment M. Weber : qu’ils en soient tous remerciés. Le lien entre les séances lyonnaises et les séances parisiennes a été assuré par un blog hébergé sur la plateforme Hypothese.org, où l’actualité du séminaire était communiquée et les textes des interventions publiés. Depuis septembre 2018, les séances n’ont plus lieu qu’à Paris et sont co-organisées par P. Duchêne et L. Méry, après une journée d’études conclusive tenue le 1er juin 2018 à la MOM, à Lyon.
C’est l’organisation de cette journée d’études qui nous a donné envie de passer d’un partage numérique, sur le blog, à une publication “en bonne et due forme” des échanges ayant eu lieu durant ces trois premières années. Nous avons eu en effet l’occasion d’accueillir des chercheur.se.s renommé.e.s (M. Baumann, C. Chillet, I. Cogitore, M. de Franchis, C. Delattre, O. Devillers, F. Galtier, C. Guittard, S. Kefallonitis, L. Méry, E. Oudot, P. Ponchon, M. Simon, G. Van Heems…), mais aussi de jeunes chercheur.se.s prometteur.se.s, qui représentent sans aucun doute l’avenir de notre discipline (L. Autin, A. Jayat, M. Miquel, A. Pulice, G. Vassiliadès…). Certain.e.s d’entre eux ont contribué à ce volume, d’autres ont déjà publié ailleurs leurs interventions. Mais, avant de vous les présenter, nous voudrions rapidement revenir sur les perspectives en historiographie antique qui ont mené à la création de ce séminaire et qu’illustrent les contributions retenues ici.
L’écriture de l’histoire dans l’Antiquité : une branche de la rhétorique
Avant d’être un historien, l’auteur d’un ouvrage historique est un écrivain, qui a appris l’art de la composition et celui de la parole en suivant un enseignement, de plus en plus codifié, et en fréquentant ses prédécesseurs, de plus en plus classiques. Qu’il s’agisse de l’enseignement des sophistes ou de celui des rhéteurs, cette formation imprègne une société dont les institutions reposent en partie sur les assemblées, les plaidoiries et les débats. Dans les œuvres historiographiques, la marque la plus évidente de cette formation rhétorique se révèle bien sûr dans les discours, de l’antilogie sophistique dans laquelle se moule le débat perse d’Hérodote aux suasoires qui émaillent les histoires romaines2, chez César, Salluste, Tacite, Plutarque, Cassius Dion et tant d’autres. La rhétorique, entendue comme art codifié de la parole servant un propos argumentatif, propose peu à peu des exercices dont certains paraissent particulièrement adaptés à l’historiographie – même s’il n’y a jamais eu d’écoles d’historiens3. On pense au récit (diêgêma), exercice d’écriture ou de réécriture tiré d’un historien, ou à la description (ekphrasis) des personnes, des lieux, des actions, ou encore à la prosopopée, dont certains sujets sont – illustration des relations réciproques entre les deux pôles – tirés de l’histoire. Voici ce qu’en dit Quintilien (IO, 3.8.49) :
“Je considère les prosopopées comme l’exercice le plus difficile, car au travail propre aux suasoires s’ajoute la difficulté d’endosser un rôle. En effet, un même homme devra plaider tantôt comme César, tantôt comme Cicéron, une autre fois encore comme Caton. Cependant, c’est un exercice des plus utiles parce qu’il exige un effort double et parce qu’il apporte beaucoup aux futurs poètes et historiens4”.
Aelius Théon (Prog., 70.26-30) confirme que l’enseignement rhétorique concerne tout le monde : “L’entraînement à nos exercices est absolument nécessaire, non seulement aux futurs orateurs, mais à tous ceux qui veulent partager l’art de la parole des poètes, des historiens ou d’autres écrivains. C’est là comme le fondement de tous les genres d’expression5.”
Puis l’histoire, en tant que production littéraire, devient modèle pour les orateurs. Quintilien poursuit, à propos des suasoires (IO, 3.8.67) :
“Celui qui préfère lire – non seulement des orateurs mais aussi des historiens – plutôt que vieillir sur des commentaires de rhéteurs verra bien que j’ai raison ; en effet, dans les histoires, les harangues et les discours au sénat sont très souvent des modèles de suasoires pro et contra6.”
Autre lien dans ce sens, l’histoire fournit des exempla dès l’époque des orateurs attiques, et l’exemplum a une valeur probante et ornative à la fois7. Le lien est donc ancien entre rhétorique et histoire, et encore plus dans la Seconde sophistique8. Le summum de cette interaction est atteint peut-être avec les déclamations d’Aelius Aristide, “visant par-dessus tout l’exactitude dans la reconstitution historique, appuyée sur les meilleures sources9.”
Sans aller jusqu’à dire avec Cicéron que l’histoire est un “travail particulièrement propre à un orateur” (De Leg., 1.5, opus oratorium maxime)10, nous dirons que l’historien est orateur de formation. “Or ces discours ne sont pas des morceaux gratuits ; ils sont partie intégrante du projet historique, [… et dans le cas de Thucydide] une voie de la vérité11.” Il faudrait alors suivre les conseils de Lucien :
“S’il faut à l’occasion introduire un orateur, on veillera surtout à lui faire prononcer des paroles qui conviennent à son personnage et aux circonstances narrées, – et, de surcroît, il faudra qu’elles soient aussi claires que possible. Toutefois, c’est un moment dans lequel on tolèrera une démonstration d’éloquence et tu pourras alors exhiber tes compétences en matière de discours12.”
Souvent pourtant, c’est l’ensemble des outils rhétoriques qui est utilisé au service de l’argumentation historiographique. L’art du récit ou de la description, on l’a vu, se déploie dans l’historiographie antique. Le sens du terme rhétorique dérive alors : on se rapproche d’un art des effets de style, ce qui suscite des débats. Pour un historien et théoricien de l’écriture historique comme Denys d’Halicarnasse (Opuscules rhétoriques), le style ne fait pas l’histoire, mais n’y nuit pas, bien au contraire13. Mais pour d’autres, comme Quintilien (IO, 10.31-34), si l’histoire multiplie les phénomènes rhétoriques, ne faut-il pas la classer avec les œuvres poétiques ? La vérité peut-elle s’accommoder d’ornements ?
Dès son avant-propos, L. Pernot rappelle la méfiance suscitée dès l’origine par la puissance de la rhétorique14, brillamment illustrée dans l’Éloge d’Hélène de Gorgias, troublant jeu sur les paradoxes et tout à la fois réflexion sur les pouvoirs du logos. La dénonciation de la rhétorique par Platon imprègne les soupçons qui pèsent sur les récits historiographiques trop travaillés, et T. P. Wiseman15 cite encore un grammairien du Ve siècle, Phocas, s’adressant à Clio, la muse de l’Histoire, en ce sens : sola fucatis variare dictis paginas nescis, set aperta quicquid veritas prodit, recinis per aevum simplice lingua. “Toi seule ne sais pas nuancer tes pages de paroles fardées ; au contraire, quoi que révèle la vérité à découvert, tu chantes pour toujours dans une langue sans artifice”. Certains épitomateurs byzantins poursuivront cet idéal, du moins le clameront-ils dans leur préface, à l’instar de Zonaras (Praef., 1), dont la préface contient une critique des historiens qui ont laissé périr le souvenir des grandes actions en développant inutilement à l’inverse les discours et les dialogues16.
Le point culminant de cette opposition est atteint, semble-t-il, au XIXe, puis au XXe siècle. Certains opposent alors l’histoire, discipline scientifique rigoureuse et objective, à la littérature, et, plus généralement, vérité et non-vérité. Dans cette perspective, tout phénomène rhétorique est suspect ; seuls Thucydide, pour sa méthode, et Cicéron, pour sa théorie de l’histoire (dans le De oratore), trouvent grâce aux yeux des historiens17. Au XXe siècle, le débat est relancé par la controverse née de l’ouvrage de H. White, Metahistory18, dont la thèse s’appuie sur la certitude que l’historiographie est un genre littéraire, et qu’elle est de ce fait très marquée par des stratégies narratives propres à chaque historien19. L’histoire, en tant que récit ou argumentation, ne peut être neutre, tant les mots employés relèvent déjà de choix subjectifs. Ce positionnement a soulevé un problème éthique, dont A. Momigliano s’est fait le porte-parole20 : y a-t-il plusieurs façons d’écrire la vérité historique ? Faire varier la présentation de la vérité n’entraîne-t-il pas une dangereuse relativité des faits ? La question s’est déplacée sur le plan philosophique et P. Ricœur a notamment proposé des réflexions qui permettent de dépasser ce fossé21. La réflexion menée par Cogitore & Ferretti 2014, dont l’introduction rappelle quelques jalons de cette relation à rebondissements entre histoire et littérature, souligne le rôle de nombreux philosophes dans une nouvelle façon d’aborder la question22.
Poser ainsi le problème témoigne encore d’une franche opposition entre l’histoire vue comme un métier fondé sur une démarche scientifique (observation de traces, démarche critique, vérification des sources, présentation “comme cela s’est passé”23) et l’histoire vue comme un récit qui utilise le langage, et notamment la rhétorique, pour souligner les enjeux – et non comme un vain ornement24. La crainte d’une rhétorique considérée comme nécessairement dangereuse irrigue encore des articles récents comme celui de V. Ferry25, qui estime qu’un historien rhéteur parlera de sujets historiques sensibles et douloureux en tenant compte de son auditoire là où il faudrait se contenter d’être neutre, au risque de laisser les points de vue modifier la présentation historique. L’auteur renvoie aux recommandations de convenance tirées d’Aristote et défend à l’inverse le droit de choquer, par respect pour la vérité historique – mais admet la nécessité d’un “tact des mots”, citant Marc Bloch dans sa conclusion. On voit là qu’il y a deux perceptions possibles de l’art rhétorique, considéré soit comme un art sensuel qui s’adresse aux émotions du destinataire soit comme un art intellectuel, qui aide à la mise en forme la plus claire possible d’un récit historique.
Cependant, même si ces questions contemporaines sont les héritières des méfiances antiques vis-à-vis de la rhétorique, il serait anachronique de les appliquer telles quelles à l’historiographie ancienne, tant les conceptions de l’histoire ont évolué. Pour les historiens anciens, il était question de mesurer, de moduler la présence rhétorique, jamais de la supprimer, car elle est consubstantielle à leur formation et donc à leur écriture. Qui plus est, la forme rhétorique constitue un horizon d’attente partagé par l’ensemble de son lectorat, “en tant qu’élément de la culture et de l’univers mental du temps”26. Elle est nécessaire aussi, enfin, car elle fait la force de l’argumentaire de l’historien : l’histoire ancienne est en effet morale et le point de vue de l’historien ne peut qu’être sensible. C’est la raison pour laquelle l’historiographie ancienne doit être étudiée au plus proche du texte : toute traduction, aussi rigoureuse soit-elle, ne peut rendre les figures de style et les subtilités lexicales, et pourrait masquer, si ce n’est trahir, cette part primordiale de l’auteur27.
Une approche “utilitariste”
Il convient en effet de ne pas oublier que, de même qu’il n’y a pas de “métier d’historien” dans l’Antiquité, connaître et comprendre le passé ne représentent pas un but en soi. De fait, les liens de l’historiographie avec la rhétorique amènent les Anciens à toujours la concevoir en fonction d’une utilité qui dépasse le seul projet de faire mieux connaître un passé jugé important28.
L’utilité la plus connue pour nous, aussi parce qu’elle correspond à une pratique que la littérature française a conservée pendant longtemps29, est d’y chercher des exemples moraux pour apprendre à régler son propre comportement. C’est la fameuse historia magistra vitae de Cicéron30. Les exemplahistoriques ne servent pas uniquement à illustrer un point d’argumentation : ils fournissent également des modèles de conduite personnelle à suivre ou à refuser, à l’imitation des Anciens31. Le genre biographique, en particulier, a pour but de saisir dans sa complexité le caractère d’un grand homme, afin de comprendre ce qui l’a poussé à se comporter de telle manière ou à prendre telle décision : c’est ainsi que Plutarque, au début de la Vie d’Alexandre, oppose l’histoire détaillée des batailles et des grands événements, destinée à faire comprendre les causes historiques, et l’histoire biographique sélective, qui peut se contenter de n’évoquer que ce qui est représentatif de la façon dont le protagoniste a mené sa vie32. On comprend dès lors pourquoi Tacite déclare, dans les Annales, qu’il considère comme la principale tâche de l’histoire “de ne pas passer sous silence les exemples de vertu et de faire craindre d’être à l’avenir frappé d’infamie pour ce qu’on a dit ou fait33” : l’histoire permet d’avoir des modèles de comportement et, à son tour, d’en laisser à la postérité. Salluste ne fait pas dire autre chose à Marius, lorsqu’il évoque le désir d’émulation provoqué par les images des grands hommes de la République romaine et le récit de leurs hauts faits34.
Derrière cette question de l’exemple à laisser se cache une autre utilité de l’historiographie dans sa conception antique, plus importante encore que son utilité morale : éduquer politiquement les citoyens, en leur enseignant comment réagir dans une situation donnée. C’est ce qui correspond l’ “acquis pour toujours” de Thucydide au début de la Guerre du Péloponnèse35 : en tirant les leçons d’un événement politique, on donne à la postérité les moyens de s’en servir dans les moments décisifs pour la cité. La justesse de ce qui est rapporté est alors tout à fait primordiale, car un récit faux ou imprécis fausse à son tour ce que le lecteur peut en retirer. Voilà pourquoi Polybe insiste tout particulièrement sur la nécessité pour l’historien d’avoir fait de la politique lorsqu’il rapporte les débats dans la cité, mené une guerre lorsqu’il décrit un combat, visité les lieux dont il va être amené à parler36 : quand on ne sait pas de quoi on parle, non seulement on risque d’écrire des erreurs, mais on ignore aussi ce qu’il est important que le lecteur sache pour parfaitement comprendre la situation et apprendre de ce qui est relaté. De fait, presque tous les historiens antiques37, jusque sous Byzance, ont comme point commun une expérience politique ou administrative, à l’exemple de Cassius Dion, sénateur se dédiant à l’histoire après une carrière politique brillante qui accroissait l’autorité de son œuvre.
Cette conception de l’histoire comme recueil de précédents et d’enseignements a eu une conséquence inattendue pour des lecteurs modernes, mais logique lorsqu’on se souvient que, pour les Anciens, l’historiographie est une branche de la rhétorique : elle l’a transformée en instrument politique. Dès leurs débuts, les généalogiques mythiques et les chorographies sont souvent rédigées avec l’arrière-pensée de légitimer l’ascendant politique d’une famille ou les droits d’une cité sur un territoire38. À Rome, en particulier, l’importance des précédents familiaux et du capital politique symbolique que cela représentait39 a poussé les grandes familles à rédiger ce qui a sans doute compté pour une première forme d’écriture de l’histoire romaine, à travers les laudationes funebris et les archives familiales, puis a fortement pesé pour que celle-ci adopte des points de vue qui lui soient aussi favorables qu’ils devaient être défavorables pour leurs adversaires politiques40. Ce processus peut toutefois aussi s’appliquer à la communauté civique tout entière, lorsque l’on pense, par exemple, que la prise de Rome par les Gaulois en 380, avec tous les épisodes célèbre qui en découlent (oies du Capitole, “Vae victis”, intervention de Camille…) n’est pas attestée archéologiquement par une couche de destruction41.
Cette utilisation politique de l’histoire doit amener les chercheurs et chercheuses modernes à se montrer très prudent.e.s lorsqu’ils et elles s’appuient sur des textes historiques antiques, car ceux-ci ont dès lors un rapport à la vérité bien loin de correspondre à celui de la recherche actuelle. Ce rapport est tout d’abord induit par une contrainte matérielle, celle de la difficulté d’accès aux sources. En effet, dès que le cercle du pouvoir se réduit, il devient difficile de savoir si le récit qui est livré des événements correspond à ce qui s’est réellement passé ou à ce que le pouvoir veut qu’on pense qu’il s’est passé42. Les historiens antiques doivent dès lors tenter de faire la part des choses, en comblant les vides du discours officiel et en raisonnant, de plus en plus, à partir de la personnalité du détenteur du pouvoir43. À cette nécessité s’ajoute la pratique rhétorique de l’inuentio, qui consiste à “trouver” (inuenire) des détails supplémentaires pour rendre le récit plus vivant et crédible : ce qui, pour nous, relèverait de l’invention et donc serait hors du champ de l’histoire ne pose aucun problème dans l’Antiquité, car il s’agit simplement, pour les Anciens, le mettre en avant des éléments déjà potentiellement présents dans le matériau de départ44. Dès lors, les historiens antiques tentent de se représenter rationnellement comment les événements ont pu se passer, afin de combler les manques de leurs sources45.
Il apparaît ainsi que le véritable critère d’authenticité et de crédibilité, dans l’Antiquité, n’est pas tant une proximité plus ou moins grande avec la vérité historique, mais la vraisemblance. Il n’est dès lors pas étonnant de voir Thucydide, pourtant un des historiens antiques les plus rigoureux selon nos critères modernes, reconnaître sans aucun problème avoir reconstitué les discours contenus dans la Guerre du Péloponnèse selon la façon dont il était le plus vraisemblable que les orateurs se soient exprimés, étant donné le sens global des propos tenus46 : les paroles rapportées ne sont pas inventées ex nihilo, mais il n’était clairement pas nécessaire de signaler explicitement qu’il ne s’agissait pas d’une retranscription47. On comprend pourquoi, dans le passage bien connu du De Oratore où Cicéron énonce les “lois de l’histoire”48, le contraire de la vérité historique n’est pas la fiction, mais le préjugé49 : le “plus vraisemblable” n’est pas le même lorsqu’on adopte une perspective neutre et lorsqu’on a déjà une opinion sur les événements ou les personnages, ou qu’on cherche, par son récit, à s’attirer les bonnes grâces d’un puissant ou à en flétrir un autre. Le public savait néanmoins parfaitement comment et pourquoi les ouvrages d’histoire étaient écrits : le début de l’Apocoloquintose de Sénèque parodie un historien refusant de donner ses sources et déclarant insolemment que, si on le force à le faire, il donnera le premier nom qui lui viendra en tête50, et le Comment il faut écrire l’histoire de Lucien met en scène un auditoire sans réaction devant un historien prétendant avoir assisté en personne à ce qu’il raconte, quand tout le monde savait qu’il n’avait jamais mis les pieds hors des murailles de la cité51. L’écriture de l’histoire dans l’Antiquité n’est donc pas un jeu de dupes, où les historiens manipulent faits et récit afin de persuader leur public de la justesse de leur représentation : c’est un jeu dont les deux parties connaissent les règles et les acceptent, dans un même but littéraire, moral et politique, de sorte qu’on peut parler, entre elles, de pacte historiographique52.
Il est important, aujourd’hui, de bien avoir en tête ces spécificités lorsqu’on lit et utilise les textes d’historiens antiques. En effet, s’il serait absurde de refuser de s’en servir comme sources, en arguant qu’il s’agirait de purs textes littéraires53, il n’est pas possible non plus de s’affranchir des conditions historiques dans lesquelles ils ont été élaborés : pour citer N. Loraux54, Thucydide n’est assurément pas le collègue des historiens actuels. Pour mieux comprendre la nature de l’historiographie antique, c’est à plusieurs types de discours historiques modernes, tenus ces deux derniers siècles, qu’il faut recourir. Ainsi, l’ajout de détails pour donner au public l’impression d’assister à la scène décrite ou la réécriture des discours pour faire tenir aux personnages des propos adaptés à leur caractère et à la situation peuvent faire penser à ce que proposent certains documentaires télévisés, avec reconstitutions en 3D ou au moyen d’acteurs : comme nous aujourd’hui, les Anciens savaient qu’il ne s’agissait pas d’une reproduction absolument véridique de ce qui s’était passé et que les paroles attribuées n’étaient pas des citations littérales de celles qui avaient été prononcées ; comme le public moyen d’aujourd’hui, un grand degré de vraisemblance lui suffisait. La volonté de dramatisation du récit peut, pour sa part, faire penser aux écrits littéraires à sujet historique : roman, pièces de théâtre… et il n’est pas étonnant, par exemple, qu’E. Bachat ait pu croire que les Annales de Tacite étaient en réalité un ouvrage de fiction55. Là encore, comme de nos jours à la lecture d’un roman historique, personne n’en faisait le reproche aux auteurs, pour peu qu’ils écrivent bien56. La démarche antique s’approche donc en partie de ce que peut proposer I. Jablonka57, mais en partie seulement, car celui-ci cherche à emprunter à la littérature des modes d’écriture pour mieux faire comprendre, tout en conservant la rigueur scientifique de la méthode historique actuelle : dans l’Antiquité, l’écriture littéraire représente au contraire un important critère d’évaluation des historiens.
Enfin, par certains aspects, l’historiographie antique se rapproche également de pratiques abandonnées, et parfois encore combattues, par l’histoire scientifique actuelle. Ses visées morales et politiques ne sont ainsi pas sans rappeler les écrits de J. Michelet, au XIXe siècle, aujourd’hui remis en question à juste titre, car l’historien actuel ne cherche pas à promouvoir une idéologie : il tente de comprendre ce qui s’est passé, en s’appuyant sur des documents qu’il soumet à un examen critique ; que ses travaux puissent éventuellement être utilisés ensuite à d’autres fins n’est pas son affaire. Par cet aspect, l’historiographie antique peut être rapprochée des “historiens de garde58”, qui n’hésitent pas à choisir ce qui les arrange dans les sources qu’ils utilisent, voire à déformer leur propos ou à recourir à l’invention, pour servir leur vision politique59. Mais, dans l’Antiquité, les historiens ne prétendaient pas à la scientificité actuelle et, surtout, leur public était parfaitement au courant de leurs pratiques60. L’historiographie antique est une historiographie littéraire et orientée, mais elle n’est pas non plus une historiographie trompeuse, ni à l’époque ni aujourd’hui, pour peu qu’on l’approche dans toutes ses particularités. Ce sont ces “métamorphoses du genre historiographique”, pour reprendre l’expression de G. Lachenaud dans un ouvrage61 qui présente de multiples réflexions tendant à sortir le genre d’une définition étroite, que les articles de notre volume voudraient présenter, dans la lignée du séminaire Historiographies antiques.
Présentation des contributions contenues dans ce volume
1. Plusieurs contributions ont choisi de se concentrer sur un personnage historique, ce qui permet de voir l’historien à l’œuvre quand il s’agit de sélectionner les informations qu’il juge tout à la fois crédibles et symboliques. Plusieurs problématiques s’ouvrent ici : le traitement des sources, en particulier dans le cas d’événements lointains, la reconstitution d’épisodes phares, notamment les discours, ou encore le jeu avec les attentes du lecteur.
La question des sources est la première qui s’impose, et d’autant plus dans le cas d’épisodes archaïques. Gilles Van Heems propose de s’intéresser à la figure de P. Valerius Publicola, dans une contribution intitulée “Adfectatio regni et pratique du pouvoir au début de la République”. Il rappelle que ce que l’on sait de ce personnage, présenté par les historiens anciens comme l’un des premiers consuls, se situe à la frontière entre histoire et mythe, tant les traces d’anachronisme sont nombreuses. Travailler sur les premiers temps de Rome, les “antiquités romaines”, constitue un véritable numéro d’équilibriste, pour Tite-Live comme pour ses successeurs de langue grecque, Denys d’Halicarnasse et Plutarque. Les informations dont ils héritent sont biaisées par l’histoire politique écoulée depuis, l’impérieuse contrainte étiologique et l’influence de schèmes formatifs, fictionnels ou réels. Ainsi la geste de Publicola s’inscrit tout à la fois dans la volonté de mettre en avant la gens Valeria, le besoin d’expliquer certains rituels ancestraux et le choix de couler certains épisodes dans des mythes fondateurs grecs, des fils d’Œdipe aux fils de Pisistrate. Faut-il donc renoncer à croire quoi que ce soit sur Publicola et n’y voir qu’une construction postérieure ? Faut-il remettre en doute l’ensemble du travail des historiens anciens sur cette période et se contenter de comprendre les filtres qui se dressent entre eux et l’histoire, entre nous et la réalité ? Le bilan dressé par G. Van Heems ouvre cependant un nouveau questionnement : la question des sources menant à une aporie et l’épigraphie ayant apporté quelques témoignages tangibles de l’historicité de Publicola, il faut peut-être s’extraire du point de vue romano-centré des récits dont on dispose pour replacer les informations dans le cadre plus général de l’Italie tyrrhénienne. Vues sous cet angle, les notices consacrées à Publicola s’éclairent d’un sens nouveau, dressant de l’homme un portrait en tyran que ne pouvaient assumer les historiens romains anciens mais qu’ils ont toutefois transmis en filigrane.
Si la contribution de G. Van Heems permet de réhabiliter le texte des historiens anciens et de passer du mythe à l’histoire, l’article d’Antoine Jayat aborde quant à lui une zone plus délicate encore en termes d’historicité puisqu’il s’agit de la reconstitution de discours. Quoi de mieux en effet qu’une prosopopée pour dresser le portrait vivant d’un homme à un moment clé de son histoire ? Mais quoi de plus sujet au doute, puisque les sources sont rares – quand le discours n’est pas tout simplement inventé ? A. Jayat choisit de traiter ces questions à travers l’exemple de “César orateur”, dans un passage de Cassius Dion (Histoire romaine, 43.15-18). Il ne s’agit pas là d’un discours reconstruit mais plus probablement d’un discours entièrement créé par Dion, qu’aurait prononcé Jules César au lendemain de la bataille de Thapsus, en 46 a.C., dans l’espoir de rassurer les Romains sur ses intentions. Le tour de force de ce discours, analysé dans le détail par A. Jayat, réside dans sa visible médiocrité. Jules César, modèle d’éloquence selon la tradition (voir notamment infra la contribution de R. Cytermann), échoue à plusieurs niveaux dans ces chapitres puisque sa performance est incohérente tant dans le fond que dans la forme et renforce, qui plus est, le scepticisme de ses destinataires. La réflexion que livre A. Jayat tend à montrer que ce discours, sans doute inventé, n’est pas le fruit de la fantaisie de l’auteur, et qu’il vaut au contraire pour lui-même, sorte de portrait sans filtre de César après sa victoire. En choisissant un moment non attesté, Dion s’empare d’une zone grise de l’histoire dans laquelle il peut imaginer tout ce qui lui semble cohérent avec le personnage. Il y anticipe l’échec à venir de César et crée dans ce discours manqué un sentiment d’ironie tragique pour le lecteur. Pour fonctionner et s’insérer dans la cohérence de l’œuvre, ces inventions ne doivent pas être de purs phénomènes rhétoriques ; elles témoignent d’une connaissance intime des faits et des personnages historiques.
La tradition est souvent riche, à l’inverse, pour le récit de la mort des personnages historiques. L’historien manque rarement d’informations, bien au contraire. Deux contributions s’attellent à ce moment particulier, qui est souvent le lieu d’un bilan consacré à la vie du personnage. Dans “Hinc Othonem posteritas aestimet : Tacite et l’exemplarité de la mort d’Othon”, Fabrice Galtier, tout d’abord, traite du second des quatre empereurs de l’année 69. Il rappelle que les différentes versions du suicide d’Othon, défait par Vitellius à la bataille de Bédriac, concordent en grande partie chez tous les auteurs (Suétone, Plutarque, Cassius Dion) et que l’épisode ne prête pas à la controverse dans les sources. Plus intriguant, l’éloge d’Othon auquel se livre Tacite contraste avec le récit de sa vie dans les Histoires. Othon est en effet présenté sous un jour assez négatif par Tacite. F. Galtier s’interroge sur l’influence de modèles de morts stoïciennes ou de schémas littéraires qui l’emporteraient sur le point de vue de Tacite. La mort de Caton d’Utique est notamment convoquée. Mais l’auteur souligne cependant une part de distanciation de la part de l’historien face à un empereur capable de mettre en scène sa mort pour la postérité de son image. L’ensemble du récit est précédé, qui plus est, d’un excursus sur les guerres civiles, sur lesquelles Tacite livre des réflexions, inspirées semble-t-il de Lucain, et auxquelles le suicide d’Othon apporte une réponse éthique. Le récit fournit donc ici un exemplum, nous y reviendrons un peu plus loin. Dans la contribution suivante, le récit de la mort constitue également un moment propice à une réflexion plus profonde. Avec “La dernière année du règne de Tibère dans les Annales de Tacite (6.45.3-6.51)”, Olivier Devillers étudie en effet la notice nécrologique consacrée à Tibère sous un angle élargi, en tenant compte des chapitres précédents, pour dépasser la problématique biographique. Le bilan que Tacite dresse de la vie de Tibère se double d’une analyse du contexte politique et du régime. O. Devillers met en regard les choix tacitéens avec les choix de Suétone et de Cassius Dion pour illustrer les différents traitements possibles d’une même tradition et montrer que la présentation de Tibère comme un tyran est prétexte chez Tacite à une réflexion sur la libertas.
2. Avant d’en venir à l’aspect éthique de l’écriture de l’histoire (cf. infra), plusieurs contributions ont consacré leur propos à la composition d’une œuvre historiographique, à différentes échelles. Le souci de cohérence, pour faire avancer le récit et pour en faire jaillir le sens, est sensible dans la trame de fond – dans la répétition de motifs, les choix rhétoriques et syntaxiques – comme dans l’organisation plus globale – la mise en évidence de borne, la disposition de l’ensemble de la matière.
Deux contributions analysent ce bruit de fond qui assure la cohérence d’une œuvre. O. Devillers, dans la contribution présentée ci-dessus, détaille le travail de chaîne entre les différentes unités, plus ou moins grandes, entre les motifs, qui reviennent de façon significative, entre les allusions et les sous-entendus tacites, internes à l’œuvre de Tacite mais aussi externes, qui donnent tout leur sens aux derniers chapitres sur la vie de Tibère. Plus encore, la contribution de Mathilde Simon “Sur quelques aspects religieux du livre X de Tite-Live” démontre l’importance, dans la construction d’une cohérence d’ensemble, de la mention, répétée, de notations en apparence marginales. M. Simon présente d’abord les différents types de mention, des dédicaces de temples aux serments solennels en passant par l’accès aux prêtrises. Sa contribution permet de revenir sur la méthodologie de Tite-Live quant à son traitement des sources, guidée ici par une volonté de lisser les informations mais aussi de fournir à ses lecteurs une part plaisante d’archaïsme. Si un travail de confrontation s’impose pour l’historien moderne qui veut s’approcher au plus près de la réalité historique, ce n’est pas tant là que réside l’intérêt des mentions religieuses, suspectes pour la plupart. Elles nourrissent in fine dans la trame narrative une réflexion sur les institutions politiques : elles constituent des jalons qui, de loin en loin, mis en parallèle, permettent de mesurer les controverses entre les ordres de Rome à la fin du IVe siècle a.C., et doivent, de ce fait, être prises en compte dans la construction générale.
Un traitement syntaxique spécifique mais régulier permet également d’assurer la cohérence d’un récit long. Il en va ainsi dans les Annales de Tacite des interventions orales des personnages féminins. Dans une contribution commune intitulée “Muliebriter fremere ? Le discours féminin dans les Annales de Tacite”, Isabelle Cogitore et Louis Autin commentent avec précision toutes les formes de prise de parole d’une femme ou d’un groupe de femme, sous l’angle rhétorique puis narratologique. Leur étude classe les discours des Julio-Claudiennes en termes d’efficacité politique et de leurs effets sur le prince en particulier. Contrairement aux groupes de femme–s, dont les prises de parole sont déconsidérées, les femmes de la domus impériale bénéficient de compétences rhétoriques à la mesure de leur pouvoir, qu’il s’agisse de Livie, d’Agrippine l’aînée ou d’Agrippine la jeune, de Messaline, de Poppée ou d’Octavie. Le travail de Tacite est réel sur ce point et son traitement est cohérent d’un bout à l’autre. Du point de vue narratologique, I. Cogitore et L. Autin constatent que les femmes sont le plus souvent privées de discours direct, en particulier les groupes de femmes, souvent présentés de façon caricaturale, dont les propos sont reformulés par l’auteur. Tacite ne choisit de rendre autonome la parole de certaines que dans des cas bien particuliers. Le statut à part des Julio-Claudiennes, et leur proximité avec le pouvoir, leur assurent un traitement syntaxique différent, analysé en fin d’article, et qui varie selon la personne. Chaque exemple détaillé vient renforcer la thèse d’un travail spécifique et conscient de caractérisation des personnages féminins tout au long du récit, au soutien d’une réflexion sur le pouvoir impérial.
À ce travail de cohérence interne, assurée par un motif ou par des choix récurrents de caractérisation, s’ajoute la nécessité de mettre en forme l’œuvre globale, en marquant son plan ou en choisissant une disposition adéquate. Dans une contribution consacrée au “Mythe hérodotéen des ‘hommes de bronze’, une césure historiographique”, Dominique Barcat s’intéresse à un épisode particulier du livre 2, prologue à l’arrivée des Grecs en Égypte. Il est question du roi Psammétique Ier, dont le règne a ouvert la période des rois récents en Égypte. Selon la tradition rapportée par Hérodote, Psammétique a bénéficié du soutien de mercenaires grecs venus de la mer pour prendre seul le pouvoir. Le récit de cet épisode fait la part belle au mythe, ce qui n’a pas laissé de surprendre. D. Barcat propose de voir dans ce traitement la volonté d’Hérodote de faire de cet épisode, grâce aux outils narratifs – et notamment donc le recours à des schémas mythiques et la réécriture de célèbres passages – un moment fondateur de son entreprise historiographique. Il s‘agit en effet d’une borne essentiel dans la chronologie d’Hérodote, le début de l’Égypte des Grecs. De même que le format mythologique permet, dans le cas de personnages historiques fondateurs, comme Publicola (cf. supra la contribution de G. Van Heems), d’élever l’homme au rang d’exemple, de même ici inscrire un épisode historique dans le moule d’un mythe permet à Hérodote de marquer fortement la césure historiographique que représente le moment où la langue grecque s’est répandue en Égypte : dès cette date, l’historien gagne en autonomie et n’est plus dépendant de la parole des prêtres égyptiens.
Enfin, Aurélien Pulice consacre sa contribution à l’ordonnancement de la matière dans le livre I de Thucydide : s’agit-il d’ “une τάξις homérique ?” Cette réflexion prend naissance dans l’étude des commentaires à Thucydide – Denys d’Halicarnasse, Marcellinus, commentaire anonyme conservé sur papyrus –, qui témoignent d’un débat réel, dès l’Antiquité, sur la justesse de l’organisation de livre I, souvent qualifiée d’homérique. Ce matériau apparaît ici comme un précieux élément pour comprendre le texte. En croisant les différentes remarques, A. Pulice parvient à élucider les raisons d’une telle caractérisation, qui rapproche l’Histoire de l’Odyssée. Le livre I se caractérise en effet par une structure annulaire, dont les mécanismes, présentés en détail, aboutissent à une analepse. Celle-ci sert d’écrin à la description par Thucydide de la cause réelle de la guerre du Péloponnèse, la montée en puissance d’Athènes. Bien qu’antérieure, elle est développée après les causes supposées (les crises d’Épidamne et de Potidée) : ce bouleversement de l’ordre chronologique, d’autant plus assumé qu’il se déploie dans une structure complexe, a suscité la critique d’un Denys d’Halicarnasse par exemple. Cette contribution permet donc, à travers l’exemple de Thucydide et des débats générés chez ses pairs, de saisir l’importance des choix de composition dans l’historiographie, l’agencement naturel, chronologique, n’allant pas toujours de soi.
3. La composition choisie par Thucydide répond aussi à un enjeu herméneutique – faire comprendre les vraies causes de la guerre –, qui relève cette fois de la raison d’être de l’historiographie. Plusieurs contributions rappellent que l’œuvre historiographique antique pour spécificité de raconter les faits non seulement de façon claire mais surtout de façon utile aux hommes, pour que le passé éclaire l’avenir. Est-ce là la définition du genre historique ?
La mise en évidence de l’aspect moral et critique des œuvres historiographiques ouvre aussi la question de la liberté d’expression, abordée en toute fin d’ouvrage.
Aurélien Pulice rappelle que deux conceptions de l’histoire s’opposent déjà dans les commentaires antiques à Thucydide. L’une de ces conceptions, défendue notamment par Denys d’Halicarnasse dans ses écrits théoriques, est celle d’une histoire qui déroule le fil du temps et recherche la plus grande clarté dans sa description des faits. L’autre en revanche entend élucider le passé et apporter une connaissance fine, quitte à paraître complexe, des faits. Dans un cas c’est le plaisir du lecteur qui prime, dans l’autre la démonstration. Certains historiographes sont en mission. Les contributions de G. Van Heems, O. Devillers ou F. Galtier insistent sur l’argumentaire mis en place dans les stratégies narratives étudiées plus haut : le récit se fait moralisateur et certaines figures sont construites comme des exempla, ou bien l’historien se livre à des réflexions éthiques et pessimistes sur la dégradation des mœurs et les conséquences funestes pour l’état de la soif de pouvoir des hommes. Les bilans se font prospectifs.
Pierre Ponchon aborde également la question de l’usage de l’historiographie en questionnant la définition générique de celle-ci : “Doit-on lire la Guerre du Péloponnèse comme un livre d’histoire ? À propos de Thucydide, 1.20-22.” Selon lui, Thucydide se place certes parmi les écrivains qui traitent du passé mais conteste la fiabilité de la plupart des œuvres et le manque d’esprit critique de la plupart des lecteurs. Sa quête d’acribie répond à l’un des maux athéniens les plus néfastes, l’ignorance des hommes, qui mène au désastre politique. La connaissance du passé n’est pas tant importante en elle-même que pour son utilité pragmatique politique au sens large. Chaque situation décrite par Thucydide met en évidence un même paradigme, dont les Athéniens doivent prendre conscience pour changer. L’histoire sert à philosopher au sens où son étude permet de prendre du recul et d’agir ensuite ; sa visée intervient donc dans une morale pratique. La thèse défendue par P. Ponchon consiste à voir dans la forme historiographique choisie par Thucydide un choix utile : il s’agissait de la forme la plus à même d’éclairer les raisonnements athéniens avant l’action. L’art thucydidéen de la précision et de la démonstration historiques serait ainsi la conséquence d’une volonté originelle qui relève d’abord de l’éthique.
La dernière contribution, “La construction d’une histoire de l’éloquence romaine dans le Brutus”, par Raphaële Cytermann, présente un développement historique un peu différent à première vue puisqu’il s’agit d’une histoire de l’art et non d’une histoire des hommes. Cicéron, dans le Brutus, propose une galerie de portraits d’orateurs, pour une approche empirique de l’éloquence. Le dialogue revient sur chacune des grandes figures de l’éloquence romaine par ordre chronologique, de façon à mettre en évidence une progression et affirmer ainsi une perspective téléologique. Chaque orateur a fait progresser l’art de la parole, qui trouve un aboutissement à l’époque de Cicéron, où l’orateur parfait et l’homme accompli ne font plus qu’un. Toutefois, le Brutuscommence par la mort d’Hortensius, avant de replonger dans le temps. Cette mort constitue une borne pour Cicéron, elle coïncide avec la mort de l’éloquence reine de la cité. C’est ici que l’historiographie de l’art oratoire coïncide avec le temps des hommes : paradoxalement, la progression des orateurs a permis l’envol de Jules César, passé maître dans cet art mais responsable de la fin de la libre parole politique et donc de la chute de la république. La perfection atteinte par Cicéron se vide de son sens, elle est cantonnée à la sphère intellectuelle. L’histoire de l’art recouvre in fine une histoire de la fin d’un régime, à une époque où la parole n’est déjà plus libre : émerge alors une nouvelle façon d’écrire l’histoire, sans qu’elle n’y perde pour autant sa visée magistrale.
Nous concluons cette présentation par des remerciements tout particuliers à V. Hollard pour sa participation à l’organisation des séances lyonnaises et de la journée d’études du 1er juin 2018 à la Maison de l’Orient et de la Méditerranée, ainsi que pour sa relecture de l’article de G. Van Heems.
Notes
- Les ateliers de l’équipe ANR Dioneia, rencontres périodiques portant sur Cassius Dion, constituent une notable exception.
- De façon générale, voir Pernot 2000. Voir aussi Utard 2008, qui élargit la réflexion sur l’usage de la rhétorique dans les discours des historiens au champ du discours indirect.
- Hartog 1999, 19-20 : “À la différence des médecins et des philosophes, les historiens n’ont pas formé d’écoles. Pas plus que l’histoire n’a fait l’objet d’un enseignement, même si les livres (certains du moins) des historiens ont été utilisés dans les écoles de rhétorique : mais pour leur style. S’est ainsi constitué, à l’époque hellénistique, un canon des historiens et une histoire (littéraire) de l’histoire, que Cicéron connaissait bien, à partir de laquelle il a réfléchi, qu’il a prolongée et dont nous avons hérité. Mais à aucun moment l’historiographie n’a été relayée ou prise en charge par une institution, qui serait venue en codifier les règles d’accréditation et en contrôler les modes de légitimation”.
- Quint. 3.8.49 : Ideoque longe mihi difficillimae videntur prosopopoeiae, in quibus ad reliquum suasoriae laborem accedit etiam personae difficultas. Namque idem illud aliter Caesar, aliter Cicero, aliter Cato suadere debebit. Utilissima vero haec exercitatio, vel quod duplicis est operis, vel quod poetis quoque aut historiarum futuris scriptoribus plurimum confert (nous traduisons).
- Πάνυ ἐστὶν ἀναγκαῖον ἡ τῶν γυμνασμάτων ἄσκησις οὐ μόνον τοῖς μέλλουσι ῥητορεύειν, ἀλλὰ καὶ εἴ τις ἢ ποιητῶν ἢ λογοποιῶν ἢ ἄλλων τινῶν λόγων δύναμιν ἐθέλει μεταχειρίζεσθαι. Ἔστι γὰρ ταῦτα οἱονεὶ θεμέλια πάσης τῆς τῶν λόγων ἰδέας (traduction CUF).
- Quint., IO, 3.8.67 : Quae omnia vera esse sciet, si quis non orationes modo sed historias etiam (namque in iis contiones atque sententiae plerumque suadendi ac dissuadendi funguntur officio) legere maluerit quam in commentariis rhetorum consenescere (nous traduisons).
- Malosse et al. 2010 ; David & Berlioz 1980.
- Bompaire 1976.
- Pernot 2000, 203. L’auteur donne ici plusieurs exemples, dont les Discours sur l’alliance avec les Thébains, fondés sur ce que l’on sait de la vie de Démosthène.
- Nous empruntons la traduction à Pernot 2000, 160, mais nous signalons ici les nuances à apporter à cette expression selon Cogitore & Ferretti 2014 : “Une nécessaire prudence s’impose en effet. Citée ainsi, l’expression est tronquée : la phrase complète est ‘opus, ut tibi quidem uideri solet, unum hoc oratorium maxime’ (De Leg., 1.2.5). De plus, cette phrase est prononcée par Atticus, même si celui-ci en accorde la paternité à Cicéron : il y a là un filtre, souvent négligé. Ce n’est pas la définition que Cicéron donne de l’histoire, mais bien celle qu’Atticus a comprise et attribue à Cicéron. L’une des meilleures traductions nous paraît celle de l’édition Nisard de 1864 : ‘de votre propre aveu, c’est un genre d’écrit éminemment oratoire’. De cette façon, opus rend bien l’idée d’un travail écrit, sans véritablement qu’on parle de genre littéraire, et l’adverbe maxime porte bien sur l’adjectif oratorium.”
- Pernot 2000, 37.
- Luc., Hist. Conscr., 58 : Ἢν δὲ ποτε καὶ λόγους ἐροῦντα τινα δεήσῃ εἰσάγειν, μάλιστα μὲν ἐοικότα τῷ προσώπῳ καὶ τῷ πράγματι οἰκεῖα λεγέσθω, ἔπειτα ὡς σαφέστατα καὶ ταῦτα. Πλὴν ἐφεῖταί σοι τότε καὶ ῥητορεῦσαι καὶ ἐπιδεῖξαι τὴν τῶν λόγων δεινότητα (traduction CUF).
- À propos des discours, Wiseman 1979 distingue les discours réécrits par Polybe et Thucydide, réalistes car proches de l’auteur, et ceux de Diodore et Denys d’Halicarnasse, qui les défendent d’abord pour leur intérêt stylistique et le plaisir du lecteur. Pour une étude plus récente de l’écriture de Denys, voir Hunter et de Jong 2019.
- Pernot 2000, 5.
- Wiseman 1979, 3.
- Zon., Praef., 1.
- Woodman 1988 met en évidence les failles d’une telle représentation.
- White 1973.
- On citera aussi le débat ouvert par la réflexion de Veyne 1971, qui refuse la tyrannie des sources et remet l’observation empirique en première ligne de la méthode historique, pour montrer qu’écrire l’histoire ne peut se résumer à dérouler un fil événementiel, et que l’aspect descriptif, nécessairement subjectif, ne peut en faire une science. Du point de vue philosophique, cette question a notamment été abordée par Ricœur 1983.
- Voir par exemple Momigliano 1984.
- Pour un point bilan sur la question, voir l’article de Ridky 2017.
- “Marc Fumaroli a réintroduit la rhétorique dans les études littéraires sous une forme nouvelle. Celle-ci consistait à dépasser le cadre d’une rhétorique réduite aux figures et présentée comme un outillage abstrait et atemporel pour l’inscrire dans l’histoire comme une partie de celle-ci. Cette approche a renouvelé non seulement le champ de la littérature, qui était ainsi étudiée dans son histoire et dans ses rapports avec le discours et l’éloquence, mais aussi, il faut le souligner, l’histoire elle-même. De cette réorientation générale ont résulté, en histoire, nombre d’enquêtes neuves sur lectures, lecteurs, narration dans le champ socio-politique, notamment par Roger Chartier et Denis Crouzet, qui ont suscité maintes interrogations sur le discours de l’histoire et ses liens avec la rhétorique. Par ailleurs, les réflexions articulées d’Alain Michel sur la philosophie du logos chez Cicéron et de Paul Ricœur sur la notion de temps et le récit, ou encore celles de G. Genette sur la narratologie, ont complété le dispositif du dialogue qui lie de manière novatrice histoire, rhétorique et philosophie. Ces directions empruntées par de nombreux chercheurs ont mis en lumière la présence essentielle de la rhétorique dans l’histoire, ainsi que leurs liens à travers les siècles et les écoles de pensée.”
- Leopold von Ranke, auteur de cette expression tirée de son ouvrage Geschichte der romanischen und germanischen Völker 1494-1535, est considéré comme l’un des pères de la science historique, appuyée uniquement sur des sources et relatée sans aucun jugement. Pour une histoire et une description de la redéfinition de la méthode historique en Allemagne au début du XIXe, voir le chapitre “Les conceptions et les récits de l’histoire universelle en Europe”, dans Inglebert 2014, 755-792 (en particulier p. 757 à 764).
- Dans ce cas, titrer un chapitre “Rhetoric and embellishment” dans un ouvrage consacré à l’historiographie antique ne conforte-t-il pas cette perception ? Voir Marincola 2019.
- Ferry 2017.
- Pernot 2000, 260.
- Cette nécessaire prise en compte du texte dans sa version originale vaut aussi pour tout commentaire des realia : on renverra par exemple le lecteur à un projet consacré au vote dans l’antiquité, qui reprend, à nouveaux frais, l’ensemble des occurrences traduites le plus souvent uniformément par le verbe “voter”, ce qui a conduit à une perception lissée de la complexité du vote à Rome (Séminaire “Lire et relire le vote romain”, coordinateurs : V. Hollard et R. Meltz, Lyon 2).
- Entre bien sûr aussi en compte, après Hérodote, le désir d’acquérir à son tour par là une gloire personnelle. Marincola 1997, 34-63, énumère quatre motifs évoqués par les historiens dans leur préface pour justifier leur projet historiographique : la grandeur du sujet choisi ; un événement personnel ; l’incitation des amis et un désir de gloire.
- Cf. par exemple les Essais de Montaigne, littéralement truffés de références à des exemples antiques.
- Cf. Cic., De Or., 2.9.36. Selon Rambaud 1953, 51, Cicéron considérait comme du dilettantisme le désir de connaître le passé pour lui-même.
- Cf. par exemple Sen., Ad Luc., 3.24.11 à propos de l’attitude à avoir en face de la mort.
- Cf. Plut., Alex., 1.1-3 et Frazier 1996. Cf. aussi l’organisation “par caractéristique” des Faits et dits mémorables de Valère-Maxime, même s’il ne s’agit pas d’un ouvrage d’histoire proprement dit.
- Tac., Ann., 3.65.1. La traduction est la nôtre.
- Cf. Sall., B. J., 4.5-6.
- Cf. Thuc., 1.22.4. Sur la façon dont la syntaxe de la phrase contenant cette expression n’est peut-être pas aussi simple qu’elle pourrait le sembler, cf. Rawlings 2016. Sur la façon dont Thucydide envisage la postérité de son œuvre et peut être mis en parallèle avec Tacite, cf. Damon 2017.
- Cf. Pol. 12.25 e 2-7, puis g 1-h 6, Pédech 1964, 32, 258, 358 et Sack 1981, 21-95.
- On ne compte que deux exceptions : Cornélius Népos et Tite-Live. Il peut s’agir aussi bien d’une réaction aux guerres civiles de la fin de la République romaine que d’une lacune dans notre documentation.
- Cf. Mazzarino 1966, 29-37.
- Cf. Jacotot 2013, en particulier le chapitre 9 “La gestion de l’honneur”, p. 429-460.
- Cf. Wiseman 1979 et, sur la question de la tradition historiographique relative aux Claudii, l’introduction de Humm 2005.
- Cf. Coarelli 1978. Sur cet événement et la façon dont il a été raconté, cf. Briquel 2008.
- Cf. Marincola 1997, 86-95.
- D’où l’essor grandissant du genre biographique.
- Cf. Wiseman 1981, 388-390.
- Pour un très bon exemple de ce type de raisonnement historiographique antique, à partir du récit de la mort d’Agrippine II (critiqué par tous, à juste titre, comme plein d’incohérences), cf. Devillers 1995.
- Cf. Thuc. 1.22.1.
- Pour un bon exemple de comment un historien pouvait remanier un discours existant, cf. Devillers 1994, p. 197-209, sur la Table Claudienne de Lyon et la version tacitéenne de ce discours dans les Annales.
- Cf. Cic., De Or., 2.62-63.
- Cf. Woodman 1988, p. 70-117, pour une analyse de ce passage et sa mise en relation avec la Lettre à Luccéius.
- Cf. Sen., Apoc., 1.1-3.
- Cf. Luc., Hist. conscr., 29.
- Cf. Duchêne (à paraître).
- Dérive à laquelle a parfois conduit le linguistic turn.
- Cf. Loraux 1980.
- Cf. Bachat 1906.
- Lucien (Hist. conscr., 43-45) critique le style de certains auteurs, pas la dramatisation de leur récit.
- Cf. Jablonka 2014. Il est étonnant que cet auteur n’ait pas recours aux recherches récentes en historiographie antique, car elles lui fourniraient des arguments – peut-être à double tranchant, car l’historiographie antique permet aussi de saisir les limites et les dangers de ce genre d’approche de l’écriture historique.
- Cf. Blanc et al. 2013.
- Cf. par exemple une citation de L. Deutsch qui apparaît souvent dans Blanc et al. 2013 (par exemple en exergue du chapitre 1, p. 23), car elle est représentative de son rapport idéologique, et non scientifique, à l’écriture de l’histoire : “si on peut tendre vers le fait scientifique, tant mieux, surtout si ça accrédite ma chapelle et ce que je pense, mon éclairage de l’histoire. Pour moi, la vérité scientifique, elle est dans l’éclairage”. Cette idée d’éclairage fait penser, notamment, au color rhétorique, qui consiste à présenter les faits de la façon qui arrange le plus l’orateur et non de manière exhaustive, critique et impartiale. Si cette pratique est normale dans le cadre d’un procès, où il s’agit de défendre son client, elle ne l’est pas, de nos jours, lorsqu’on se prétend historien.
- Cf. Duchêne (à paraître).
- Lachenaud 2004.