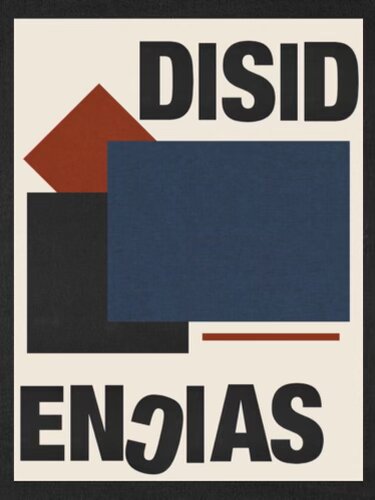Introduction
L’une des conséquences découlant nécessairement de l’indéniable hégémonie de l’idéalisme, est qu’une partie non négligeable des outils théoriques dont nous disposons ont été forgés dans ses “ateliers”. Deleuze nous rappelle ainsi que l’acte de penser ne renvoie pas à “l’exercice naturel d’une faculté”1, contrairement à ce que l’image dogmatique de la pensée s’emploie à nous faire croire, mais que tout exercice intellectuel est déterminé, par des conditions qui demeurent cachées. Ces conditions sont médiatisées, en premier lieu, par tout un corpus épistémologique, toute une batterie de concepts, au travers desquels l’on construit une réalité conforme à la vision idéaliste du monde. Ceci nous amène à nous interroger, à l’instar de Negri2, sur la pertinence de ces outils dans le cadre d’une approche matérialiste de la réalité. Est-il possible de rendre compte, more materialista (selon une optique proprement matérialiste) de la réalité au moyen d’outils forgés par la tradition idéaliste ?
Sujet et objet sont deux des concepts sur lesquels s’est érigée la tradition idéaliste mais également des concepts que le courant matérialiste a soumis à une critique féroce. L’idéalisme conçoit tout acte épistémologique comme une transaction entre un sujet et un objet constitués, par conséquent, la remise en question de ces deux concepts doit forcément avoir des implications dans le champ de la connaissance.
À cet égard, Marx inaugure une tradition de pensée axée sur la critique du sujet constitué cartésien, laquelle ne cessera de faire l’objet d’approfondissements successifs tout au long du XXe siècle par le courant de pensée matérialiste. La sixième thèse sur Feuerbach, celle-là même qui définit l’essence humaine comme “l’ensemble de ses rapports sociaux”3, ouvre la voie à une compréhension de la subjectivité comme effet de ses multiples médiations, comme Sartre prendra le soin de le souligner dans les “Questions de méthode” qui précédent la Critique de la raison dialectique. Gramsci montrera, quant à lui, que ce qu’il appelle “philosophie de la praxis” a pour effet principal de démontrer l’inexistence d’une nature humaine abstraite, “fixe et immuable”4. Quant à la mort de l’homme, que Foucault annonce dans les pages de Les mots et les choses, elle n’est autre que la conséquence nécessaire découlant d’une approche matérialiste du sujet. Parce que sous (sub-) ce qui a été jeté (-iectum), on ne peut rencontrer qu’une multiplicité hétérogène et instable de stimuli qui finissent par se cristalliser en un quelque chose auquel, pour nous comprendre, nous avons prêté le nom de “moi”.5 C’est en ce sens que, dans Le singe grammairien, Octavio Paz écrit :
Notre réalité la plus intime est hors de nous et n’est pas nôtre, pas plus qu’elle n’est une mais plurale, plurale et instantanée, nous sommes cette pluralité qui se disperse, le je est réel peut-être mais le je n’est pas mien et n’est pas tien non plus, c’est un état, un battement de paupières, la perception d’une sensation qui se dissipe.6
On retrouve cette idée dans la conception deleuzienne de la subjectivité comme pli au sein duquel est intériorisé tout un amas de médiations et d’influences, qui finissent par configurer une singularité fort éloignée de cette idée d’une nature humaine universellement partagée, qui avait été au fondement de la tradition cartésienne. En ce sens, le matérialisme donne naissance à une certaine idée de la subjectivité qui apparaît comme une singularité différentielle et instable qui, par conséquent, aborde le réel à partir de sa spécificité propre.
En ce qui concerne le deuxième concept, celui d’objet, il demeure soumis à l’effet dissolvant de la temporalité. Le temps, évincé de la réalité, est d’ailleurs le grand absent de la tradition idéaliste. Inversement, le temps comme accident des accidents, selon les dires de Sextus Empiricus7, est bien présent au sein de la tradition matérialiste, que ce soit au travers du concept de kairos, ou de celui d’histoire ou et d’événement. La réalité est alors considérée comme devenir, elle perd son caractère substantiel et stable, elle se transforme en une succession d’accidents, c’est-à-dire – étymologiquement parlant – de faits qui arrivent, accidens. La sphéricité achronique de l’être parménidien se trouve désormais soumise à l’incessante érosion du temps, de sorte que le plus insignifiant des objets, tout comme le monde dans sa totalité, cessent d’être identiques à eux-mêmes, et sont en permanence soumis aux effets de la temporalité.
Le matérialisme dissout les deux extrémités de l’équation idéaliste, sujet et objet, de sorte que tout ce qui est solide finit par se dissoudre dans l’air, pour reprendre et filer la célèbre métaphore de Marx. Si le poète russe Andreï Biély imputa, d’une manière ouvertement sarcastique, “la disparition de toute matière”8 au triomphe du matérialisme en Russie (en référence à l’état de guerre permanent qui accompagna la révolution, et qui s’ajoutait à la violence de la Première Guerre mondiale), c’est aussi pour souligner que le paradoxe d’une approche matérialiste de la réalité consiste à priver l’être et le sujet de la densité ontologique que la tradition idéaliste leur reconnaissait. Mais dès lors, comment nous est-il possible de composer avec un sujet qui n’est plus à lui-même son propre fondement, et qui éclate en une multiplicité de différences, avec une réalité qui n’est plus res mais accidens ? Comment fomenter la rencontre de deux flux hétérogènes ? Et comment doter cette rencontre, ces multiples rencontres, ce “flux de vécu”9 dont nous parle Deleuze, d’une certaine consistance qui, à son tour, permette d’élaborer une politique ?
Il se peut que ce soit Jorge Luis Borges qui exprime d’une manière plus précise le problème qui se présente à nous. Dans sa célèbre nouvelle (extraite de Fictions) “Funes el Memorioso” (“Funes ou la mémoire”), Borges raconte l’histoire de Funes (le “chronométrique Funes”), un jeune paysan qui vivait le temps si intensément qu’il lui était possible de dire l’heure exacte sans avoir à consulter une montre. Un jour, après une terrible chute de cheval, Funes se retrouve doté d’une capacité perceptive inoüie lui permettant d’observer les infimes changements survenant sur le visage d’un cadavre durant la veillée, ou de distinguer chacune des feuilles d’un arbre luxuriant, et chacune des variations de la réverbération des rayons du soleil à sa surface. Le monde n’est alors plus seulement multiple, délicat et insaisissable, il est également indescriptible, puisqu’à chacune des variations de chacun des éléments de ce monde devrait correspondre un mot adéquat et unique. Impossible de solidifier le monde dans un langage qui, écrit Borges, serait condamné à être “trop général, trop ambigu”.
En effet, non seulement Funes se rappelait chaque feuille de chaque arbre de chaque bois, mais chacune des fois qu’il l’avait vue ou imaginée.10
Tâche ardue, sans aucun doute, que celle qui se présente à Irénée Funes. Mais le problème se complique encore si l’on songe au fait que le sujet percevant lui-même se trouve, qui plus est, soumis à la tension extrême d’un devenir parallèle à celui du monde qui le constitue. La stupéfaction que provoque en nous pareille image indique qu’il n’est peut-être d’autre échappatoire que le silence. Mais comment s’y résoudre lorsque l’on songe au fait que l’exercice même de la politique réside dans l’accès à la parole ? Il serait pour le moins choquant qu’après des siècles de combat pour l’iségorie (l’égal accès de tous à la parole), et au terme d’une histoire faite de luttes sanglantes au nom de la démocratie, le matérialisme se condamne au silence. Nous tenterons d’apaiser ces craintes tout au long des pages qui suivent.
De l’abstraction dialectique à l’empirisme transcendantal
En à peine deux pages de l’introduction aux Grundrisse, dans un paragraphe intitulé “La méthode de l’économie politique”, Marx propose une série de réflexions qui, alliées à la conception du sujet telle qu’elle s’esquisse dans la sixième thèse sur Feuerbach, impliquent, selon nous, une profonde mutation épistémologique qui s’inscrit, par ailleurs, dans le droit fil de ce que Deleuze dénommera “empirisme transcendantal”.
Mais avant d’entrer dans la lecture dudit fragment, commençons par extraire les conséquences auxquelles donne lieu la sixième thèse sur Feuerbach dans le champ anthropologique. Dans cette thèse, comme nous l’avons déjà souligné, Marx affirme que l’essence humaine est l’ensemble des rapports sociaux qui traversent le sujet. Cette phrase, si brève soit-elle, n’en comporte pas moins une profonde charge polémique à l’encontre de la conception moderne de la subjectivité. Elle implique en effet une remise en cause radicale de l’essentialisme anthropologique moderne, même si Marx continue à employer le concept d’essence, pour des raisons qui tiennent, soit au maintien d’un obstacle épistémologique, comme le soutient Althusser11, soit en guise de concession conceptuelle faite à Feuerbach, avec lequel il polémique alors. Mais cette essence ne s’en trouve pas moins diluée et remise en question, de telle sorte que le simplisme propre à une certaine tradition marxiste, qui comprend la classe sociale comme la seule et unique médiation du sujet, est démasqué avant la lettre par Marx lui-même. En effet, l’auteur du Capital ouvre la voie à une conception constructiviste de la subjectivité, en vertu de laquelle celle-ci doit être dorénavant comprise comme le produit d’une multiplicité de médiations. Comme Sartre et Luckács s’emploieront à le développer (respectivement dans la Critique de la raison dialectique et dans l’Ontologie de l’être social) la subjectivité est, selon Marx, façonnée par un ensemble de médiations, de rapports sociaux, qui l’affectent et ne se laissent aucunement circonscrire aux limites de la seule classe sociale12. Ainsi pouvons-nous dire que Marx emboîte le pas à Spinoza, qui invoquait déjà le caractère individuel de la nature humaine13, et esquissait les contours d’une anthropologie de la différence dans laquelle cette multiplicité de médiations transforme les sujets en des singularités uniques.
Impossible, selon nous, de saisir toute la portée des Grundrisse sans se référer à la conception de la subjectivité qui se fait jour dès les thèses sur Feuerbach En effet, ce texte contient une critique implicite de l’empirisme14, dans la mesure où celui-ci nous impose de partir d’une conception essentialiste du sujet, qui serait la seule capable de nous restituer le réel concret. “Il semble que ce soit la bonne méthode de commencer par le réel et le concret”, écrit Marx15. Mais ce “il semble que” démonte d’emblée toute certitude. Il semble qu’il en soit ainsi, mais il en va, en fait, tout autrement. Car le réel et le concret ne sont en rien un point de départ, une origine, mais une synthèse, un résultat, un effet. D’une manière fort particulière et, pour ainsi dire, contre-intuitive, Marx pose que le processus dialectique fait entrer en jeu “la méthode qui consiste à s’élever de l’abstrait au concret”16, en vertu de quoi l’abstrait apparaît comme moment initial, et non comme effet d’un processus représentatif, ou comme un calque du réel. Mais pourquoi l’abstrait a-t-il pour Marx valeur d’origine ? Et, d’autre part, comment est-il possible que, d’une manière manifestement paradoxale, le concret soit l’effet d’une synthèse qui conserve pourtant sa condition d’origine ? À ce propos, Marx écrit :
Il [le concret] apparaît dans la pensée comme procès de synthèse, comme résultat, non comme point de départ, bien qu’il soit le véritable point de départ.17
En sa qualité de penseur matérialiste, Marx accorde un privilège ontologique au réel concret, mais il sait, en vertu de cette conception anthropologique, tout imprégnée de matérialisme, que pareille réalité ontologique demeure soumise à une appréhension subjective et toujours différenciée. La singularité du sujet, son caractère propre de construction, ou d’instance construite à partir de multiples rapports sociaux, subordonne l’ontologique à une synthèse épistémologique ajustée aux profils de la subjectivité. Le sujet, produit de la combinaison du réel, accède au rang d’instance lectrice singulière du réel. La rigueur matérialiste marxienne nous conduit donc à envisager la conscience comme effet, et ce dans la mesure où c’est la vie qui détermine la conscience, comme nous le rappellent Marx et Engels dans L’idéologie allemande, qui font de cette conscience singularisée une médiation indispensable à la lecture du réel concret. C’est ainsi que se clôt le cercle ontologique et épistémologique au sein duquel le réel concret est, simultanément, synthèse et origine.
Par conséquent – conclut Marx –, dans l’emploi de la méthode théorique aussi, il faut que le sujet, la société, reste constamment présent à l’esprit comme donnée première18.
En procédant de la sorte, Marx parvient à démasquer les limites et faiblesses de l’empirisme traditionnel et, ce faisant, décide d’introduire la médiation subjective dans l’appréhension de la réalité, sans dédaigner pour autant l’une des qualités essentielles de l’empirisme, qui tient à l’attention toute particulière que ce dernier sait porter au monde réel concret. Une entreprise que Marx mène à bien dans une optique rigoureusement matérialiste. Or, le résultat de cette opération n’est autre que l’apparition d’un “concret pensé”, ou d’une “totalité concrète”, comme conséquence de l’appropriation du concret matériel par la pensée. Et c’est ainsi, écrit Marx, que “la totalité concrète en tant que totalité pensée, en tant que représentation mentale du concret, est en fait un produit de la pensée”19. La réalité est donc entendue, par conséquent, comme un exercice matérialiste de production subjective.
Il nous semble, en ce sens, que l’opération marxienne n’est pas très éloignée du processus auquel se réfère Deleuze sous le nom d’“empirisme supérieur” ou d’“empirisme transcendantal”. Point qui requiert, avant toute chose, une série de précisions conceptuelles. Chez Deleuze, “transcendantal” n’a absolument rien à voir avec “transcendant” et ne s’oppose aucunement à l’idée d’immanence. Deleuze en précise d’ailleurs le sens dans ce texte, court mais dense, dont le titre est “L’immanence : une vie…” : il y est écrit qu’un champ transcendantal “se distingue de l’expérience, en tant qu’il ne renvoie pas à un objet ni n’appartient à un sujet (représentation empirique)”20. Le transcendantal désigne ce qui se situe au-delà du sujet et de l’objet, ce qui déborde, par conséquent, ces mêmes catégories forgées par la tradition idéaliste, et qui sont au fondement de tout acte épistémologique. C’est pourquoi Deleuze établit que l’“on parlera d’empirisme transcendantal, par opposition à tout ce qui fait le monde du sujet et de l’objet”21. Nous avons vu dans quelle mesure Marx dénonçait l’empirisme traditionnel et sa prétention de dédoublement représentatif d’une réalité concrète. Deleuze adopte une position similaire en ce sens qu’il renonce à l’idée d’objectivité et, par conséquent, à celle d’une connaissance conçue comme dédoublement de l’empirique. Raison pour laquelle il se fait le défenseur de l’empirisme transcendantal qu’il considère comme “le seul moyen de ne pas décalquer le transcendantal sur les figures de l’empirique”22. Une fois de plus, anthropologie, ontologie et épistémologie sont appelées à interagir et, en ce sens, à exiger la mise en œuvre d’une nouvelle stratégie d’approche du réel. La compréhension deleuzienne de la subjectivité comme pli, fait de cette dernière un effet du réel dans toute sa multiplicité et son devenir, de telle sorte qu’elle accède au rang d’“heccéité” ; laquelle, à son tour, investit le réel en donnant lieu à une appréhension singularisée de ce dernier.
Ce n’est peut-être pas un hasard que Deleuze envisage l’immanence sous le prisme d’une vie, et que, pour leur part, Marx et Engels comprennent la vie comme l’origine de toute pensée. “Ce n’est pas la conscience qui détermine la vie, mais la vie qui détermine la conscience”, écrivent-ils dans l’une des pages les plus citées de L’idéologie allemande23. On ne saurait trouver meilleure définition du matérialisme : la vie. L’empirisme transcendantal ou supérieur s’emploie à rendre raison de ce “flux de vécu” qui dissout les catégories traditionnelles de sujet et d’objet. À l’instar de Marx, il nous faut comprendre le maintien du concept d’empirisme comme la reconnaissance que le réel concret est doté en un sens, bien que de façon imprécise, d’une certaine consistance ontologique ; reconnaissance qu’il y a bien un monde-là opérant comme ressort du flux de subjectivation qui nous constitue. Sa modulation au travers de l’adjectif “transcendantal” nous rappelle le mouvement d’appropriation que le pli de subjectivation réalise à même le réel concret. C’est ainsi qu’affleure un plan d’immanence qui “échappe à toute transcendance du sujet comme de l’objet”24. Sa modulation au travers de l’adjectif “supérieur” nous éloigne de l’empirisme des choses et des objets ; elle nous met en prise avec un flux de subjectivation qui est, dans tous les sens du terme, le constituant du réel.
En définitive, ce que nous pouvons trouver chez ces deux auteurs, Marx et Deleuze, c’est une compréhension épistémologique qui transgresse la naïveté de la tradition empiriste pour mettre en œuvre un jeu inextricable entre le monde-là et une subjectivité constituée-constituante. Le résultat de cette manière d’aborder la question de l’épistémologie est la singularisation des produits épistémologiques, de telle sorte qu’il n’y a que des regards multiples sur le réel, des exercices multiples de production du réel. Irréductible perspectivisme, pour reprendre les mots de Nietzsche, pour lequel il n’existe que des capta, et non des data. La vérité de la relativité, comme l’expriment Deleuze et Guattari25. Le défi épistémologique consiste, par conséquent, à dépasser le panorama archipélagique dans les limites duquel nous circonscrit pareille conception d’une vérité relative. Tel sera le propos des lignes qui suivent.
À propos de quelques concepts, noms et notions commun.e.s
Mais continuons avec Deleuze, bien qu’il soit, convenons-en, le moins indiqué ici pour nous aider à réaliser la tâche que nous avons définie. On trouve ainsi chez Deleuze et Guattari une relecture ou une problématisation de la notion de concept, par ailleurs centrale dans leur discours ; ce n’est en effet pas un hasard si la création de concepts y est promue au rang de fonction spécifique de la philosophie26. Mais cette problématisation minutieuse ne se prolonge pas en une réflexion sur les possibilités de construction d’un horizon commun de sens, en dépit du fait que la production de sens soit considérée, par nos deux penseurs, comme l’une des tâches primordiales de la philosophie27. Si Deleuze et Guattari s’emploient à déconstruire le sens commun impliqué dans l’image dogmatique de la pensée et procèdent, pour ce faire, à la critique radicale de la stratégie idéaliste de conceptualisation, reste qu’ils éludent toute réflexion relative aux conditions de production d’un nouveau sens commun de nature matérialiste28.
Dans la préface de Différence et répétition, Deleuze écrit la chose suivante :
Tel est le secret de l’empirisme. L’empirisme n’est nullement une réaction contre les concepts, ni un simple appel à l’expérience vécue. Il entreprend au contraire la plus folle création de concepts qu’on n’ait jamais vue ou entendue. L’empirisme c’est le mysticisme du concept, et son mathématisme. Mais précisément il traite le concept comme l’objet d’une rencontre, comme un ici-maintenant, ou plutôt comme un Erewhon d’où sortent, inépuisables, les “ici” et les “maintenant” toujours nouveaux, autrement distribués. Il n’y a que l’empirisme qui puisse dire : les concepts sont les choses mêmes, mais les choses à l’état libre et sauvage, au-delà des “prédicats anthropologiques”.29
Deleuze transforme en réflexion philosophique le profond mal-être d’Irénée Funes, ce personnage du conte de Borges “Funes ou la mémoire” qui trouvait particulièrement dérangeant que “le chien de trois heures quatorze (vu de profil) ait le même nom que le chien de trois heures et quart (vu de face)”30. Ou le constat établi par Octavio Paz à propos de la distance infranchissable qui sépare l’écriture des hommes de celle des dieux :
La différence entre les écritures humaine et divine réside en ceci que la première a un nombre de signes limité tandis que ce nombre est infini dans la seconde ; c’est la raison pour laquelle l’univers est un texte dépourvu de sens et illisible même pour les dieux.31
En ce sens, il appartiendrait au processus de conceptualisation de se régler sur le devenir insaisissable du réel et, corrélativement, sur le flux de subjectivation en lequel s’est transformé le sujet.
Dans Qu’est-ce que la philosophie ?, Deleuze et Guattari consacrent de longues pages à la notion de concept, qu’ils travaillent activement à redéfinir sur la base des implications découlant de l’ontologie et de l’anthropologie matérialistes. Aussi pourrait-on dire du chaos qu’il est le lieu de travail privilégié de la philosophie. Mais il ne s’agit pas là d’un choix fortuit ; bien au contraire, ce dont il est question c’est de reconnaître que nous avons affaire à une réalité traversée par l’infini. Tandis que la science renonce à l’infini, à la vitesse ou au temps pour mieux travailler –pourrait-on dire – sur un matériau stable et susceptible d’être capturé dans un réseau conceptuel bien établi, la philosophie opère quant à elle d’une toute autre façon en s’ouvrant au devenir et à l’infinitude, à l’accident. Si l’opération de production conceptuelle qui échoit à la philosophie consiste en une tentative de conférer au réel une certaine consistance32, reste que pareille entreprise ne saurait perdre de vue que le monde échappe constamment à notre maîtrise ; raison pour laquelle – écrivent Deleuze et Guattari – “le concept dit l’événement, non l’essence ou la chose”33. Et d’ajouter quelques pages plus bas :
Le concept est évidemment connaissance mais connaissance de soi, et ce qu’il connaît, c’est le pur événement, qui ne se confond pas avec l’état des choses dans lequel il s’incarne. Dégager toujours un événement des choses et des êtres, c’est la tâche de la philosophie quand elle crée des concepts.34
Les concepts acquièrent de la sorte un caractère diffus. Ils sont des multiplicités à entrées multiples qui résonnent et vibrent avec d’autres concepts ; ils sont absolus et relatifs à la fois ; ils sont autoréférentiels ; enfin, ils possèdent des zones d’indiscernabilité, de sorte que “chaque concept sera donc considéré comme le point de coïncidence, de condensation ou d’accumulation de ses propres composantes”35. Or, il ne s’agit pas seulement de créer des concepts comme autant de façons d’organiser le réel ; il est tout aussi nécessaire de produire avec eux un plan d’immanence qui les dote de cohérence et leur permette d’entrer dans des rapports de résonnance et de co-implication. Ce plan d’immanence conceptuel engendre ainsi une nouvelle image de la pensée, qui vient se substituer à l’image dogmatique, dont on a vu combien elle avait présidé à l’articulation conceptuelle idéaliste.
C’est dans le domaine proprement philosophique que Deleuze et Guattari mettent en lumière l’extrême singularité de la production conceptuelle. Commentant un texte de Nietzsche, ils écrivent dans les pages initiales de Qu’est-ce que la philosophie ? :
C’est des concepts que le philosophe doit se méfier le plus, tant qu’il ne les a pas lui-même créés36.
Vraisemblablement, il ne s’agit pas là d’un privilège réservé au philosophe, mais d’une mise en garde, d’un appel à la prudence que se doit d’observer tout sujet. La singularisation est un effet qui accompagne inextricablement tout processus épistémologique.
Cependant, il est une position deleuzienne qui, au nom de cette même singularité fondatrice, court-circuite d’emblée n’importe quelle prétention de produire un regard commun, partagé, sur la réalité. Nombreux sont en effet les passages de Qu’est-ce que la philosophie ? où l’on peut trouver une critique virulente de toute prétention au dialogue philosophique. La philosophie, telle que l’entend d’ailleurs Deleuze, n’a rien à communiquer, une fois dit que la communication implique des universaux qui sont totalement dépourvus de sens37. Un manque de sens qu’accuse également la conversation philosophique :
Les discussions, le moins qu’on puisse dire est qu’elles ne feraient pas avancer le travail, puisque les interlocuteurs ne parlent jamais de la même chose. […] La communication vient toujours trop tôt ou trop tard, et la conversation, toujours en trop, par rapport à créer. On se fait parfois de la philosophie l’idée d’une perpétuelle discussion comme “rationalité communicationnelle” ou comme “conversation démocratique universelle.” Rien n’est moins exact, et, quand un philosophe en critique un autre, c’est à partir de problèmes et sur un plan qui n’étaient pas ceux de l’autre.38
Si l’on extrapole cette position à n’importe quelle conversation, alors, dans la mesure où toutes sans exception s’adossent à des universaux, on en arrive à une conclusion pour le moins terrifiante : l’impossibilité de toute rencontre et, par conséquent, de toute politique. C’est d’ailleurs le sens de la critique de Mengue à ce qu’il considère être l’anarchisme théorique et pratique deleuzien39. Il nous est toujours possible, ici, de faire l’hypothèse suivante : si Deleuze et Guattari entendent prendre pour cible la philosophie habermasienne de la communication, qu’ils rattachent aux affects cyniques du capitalisme, c’est peut-être parce qu’ils considèrent que les choses, envisagées sous l’angle du matérialisme de la différence, pourraient être radicalement autres et, donc, tout changer, comme cela est d’ailleurs suggéré dans un célèbre fragment de Différence et répétition sur lequel nous reviendrons plus loin. Mais on ne saurait trouver ici un quelconque développement qui abonde dans ce sens, ni aucune note qui nous permette d’alimenter un brin d’optimisme. C’est pourquoi il convient à présent de porter notre regard vers d’autres textes, de nous tourner vers des œuvres antérieures et postérieures, comme celle de Spinoza ou d’Antonio Negri.
Il n’est pas surprenant que, pour poursuivre notre recherche, nous ayons à faire appel à un auteur qui, pour de nombreuses raisons, constitue à lui seul une anomalie au sein de la Modernité : Baruch Spinoza. Anomal pour la raison suivante : s’il est vrai que la remise en question du modèle cartésien de la subjectivité est devenue aujourd’hui, pour ainsi dire, un véritable topos philosophique, cela n’a pas toujours été le cas. Et c’est Spinoza qui, à l’aube de la Modernité, a su le premier remettre en cause l’essentialisme anthropologique, et développer une anthropologie de la différence où la nature humaine est considérée de manière individuelle. Cet individualisme anthropologique, qui n’a rien à voir avec celui du libéralisme, puisqu’il repose sur une base matérialiste, ouvre une brèche profonde au sein de l’épistémologie traditionnelle, dans la mesure où il récuse, comme nous l’avons déjà vu avec Deleuze, tout universalisme. Pour Spinoza, les concepts universels sont le fruit de l’abstraction et ne correspondent pas au réel concret ; ils sont simplement le constat de l’incapacité humaine pour rendre raison de la singularité de l’événement :
Ces termes – Spinoza se réfère ici aux universaux – proviennent du fait que, le Corps étant limité, il n’a le pouvoir de former simultanément qu’un certain nombre d’images […]. Si elles excèdent ce nombre, les images commenceront à se confondre ; et si le nombre des images que le Corps est capable de former simultanément d’une façon distincte est considérablement dépassé, toutes se fondront totalement les unes dans les autres.40
Ces universaux sont, en outre, interprétés de différentes manières, ce qui en réduit l’efficacité épistémologique. Selon Spinoza, ces concepts résonnent différemment chez les sujets, en fonction des spécificités, notamment corporelles, et du rapport de chacun avec le concept :
Il convient de noter, toutefois, que ces notions – Spinoza fait à nouveau référence aux universaux – ne sont pas formées de la même façon par tous, mais selon des modalités chaque fois diverses, eu égard à la nature de l’objet par lequel le Corps fut le plus souvent affecté, et que l’Esprit peut le plus aisément imaginer ou bien rappeler. Par exemple ceux qui ont le plus souvent admiré, chez l’homme, la stature, entendront sous le nom d’homme un animal de station verticale ; mais ceux qui ont l’habitude de considérer d’autres traits formeront autrement l’image commune de l’homme.41
Spinoza part donc d’une anthropologie matérialiste de la différence – ou de la singularisation – en ce qui a trait à la saisie du monde. Mais tandis que Deleuze en reste à ce constat, Spinoza cherche des stratégies et des outils lui permettant d’élaborer, de construire un regard commun sur le réel. C’est ainsi qu’il forgera le concept de “notions communes”, lesquelles sont le résultat de la mise en commun de ce que les corps partagent entre eux et qui engendre une connaissance adéquate. La proposition XXXIX de l’Éthique énonce :
De toute propriété commune au Corps humain et aux corps extérieurs par lesquels il est habituellement affecté, propriété se trouvant dans une partie de l’un de ces corps aussi bien que dans le tout, il existera aussi dans l’Esprit une idée adéquate.42
Et dans son corollaire :
Il suit de là que l’Esprit est d’autant plus capable de percevoir adéquatement un plus grand nombre d’objets que son Corps a plus de propriétés communes avec les autres corps.43
La manière dont Spinoza rattache la connaissance à la communauté, ou du moins, à la proximité, s’avère extrêmement intéressante, dans la mesure où celui-ci laisse entendre que plus grande sera la répétition dans les rencontres, et plus grande sera la possibilité d’engendrer un regard commun. En d’autres termes, le fait de partager un monde commun favorise le développement d’une communauté de connaissance. Renforcer le “flux de la vie”, pour dire les choses à la manière deleuzienne, est donc une manière de promouvoir la construction de notions communes. La vie, souvenons-nous de Marx et Engels, construit la conscience.
Mais nous ne saurions clore cette approche de Spinoza sans souligner une difficulté supplémentaire que l’auteur de l’Éthique, de manière fort pertinente, pointe du doigt. Il s’agit de la difficulté relative à la transmission de la connaissance comme telle, ou de la compréhension de la connaissance des autres ; en un mot, le problème de la communication et de l’altérité. En effet, la manière irréductiblement singulière dont le sujet aborde la réalité engendre des perspectives à tout le moins nuancées et diverses sur le réel.
Et c’est de là – explique Spinoza – que naissent la plupart des controverses : les hommes n’expliquent pas rigoureusement ce qu’ils ont dans l’esprit, ou ils interprètent mal la pensée des autres.44
Par conséquent, il s’ensuit une tâche supplémentaire, qui n’est autre que celle de communiquer tout en ayant conscience de pareille singularité. Nous y reviendrons un peu plus loin.
Nous avons souligné l’anomalie spinozienne. Nous avons aussi pris acte de sa capacité à déborder les cadres de la Modernité à partir d’une position matérialiste. Mais encore faut-il rappeler que Spinoza est un penseur du XVIIe siècle, avec tout ce que cela implique en termes de limitations, ou, mieux encore, en termes de spécificités historiques qui, nécessairement, l’éloignent de l’époque contemporaine. C’est pourquoi la philosophie d’Antonio Negri nous apparaît comme un outil des plus adéquats pour continuer de réfléchir aux problèmes que sut poser avant lui son bien-aimé Spinoza, mais cette fois-ci dans un contexte post-moderne.
“Où se trouve celui qui développe la recherche ontologique du champ matérialiste ?”45, se demande avec une amertume non dissimulée Negri dans les pages de Kairos, Alma Vénus, multitude. On pourrait prolonger la question de Negri et demander à notre tour: mais où peut bien se tenir celui qui, aspirant à connaître depuis une position matérialiste, se retrouve en proie à un vertige ontologique et matérialiste susceptible de lui faire perdre la raison ? Ces affres, ou cette inquiétude, est ce que Negri appelle “inquiétude ontologique de la temporalité”46. Le temps, qui avait été évincé de la réflexion philosophique, ou à tout le moins domestiqué par la tradition idéaliste, refait surface comme une puissance sauvage au sein de l’ontologie négrienne. Le réel n’est réel que dans le temps, soumis comme il l’est au kairos, à l’occasion, à l’événement. Cette extrême volatilité du monde, qui est aussi celle du sujet qui s’emploie à le connaître, devrait pouvoir être transposée, d’une manière ou d’une autre, dans le domaine de la connaissance, puisque “connaître le vrai, c’est regarder, exprimer et vivre l’être du point de vue du kairos, c’est-à-dire de l’instant qui se trouve à cheval entre l’accomplissement du temps et l’ouverture sur l’avenir”47.
L’artefact théorique dont s’arme Negri pour faire face à l’inquiétude ou au malaise ontologique est le nom commun. Negri considère que les outils conceptuels de l’idéalisme constituent un obstacle épistémologique à l’appréhension de la réalité et entravent, par conséquent, toute possibilité d’action sur elle. C’est pourquoi le matérialisme doit mener à bien un travail intensif de production d’outils linguistiques, de noms communs, qui soient susceptibles de s’ajuster au réel. Un ajustement qui n’est pas le fait d’une stratégie de dédoublement ou de décalque du réel, déjà dénoncée par Deleuze, mais qui se mue en un exercice de production ontologique. À cet égard, Negri écrit: “Il est de notre intérêt que le nom appelle la chose à l’existence” ;48 considération qui conduit notre auteur à se demander de manière assurément rhétorique :
Est-il possible d’affirmer que, dans le kairos, l’acte de nommer et la chose nommée passent “en même temps” à l’existence et qu’ils sont, par conséquent, “ça là” ?.49
Et comme si le vertige auquel nous sommes en proie n’était pas déjà assez profond, il se trouve que ce kairos, sauvage et singulier, demeure exposé à la pluralité des sujets, de sorte qu’il se trouve démultiplié à l’infini. C’est ainsi que la tâche qui se présente à nous n’est autre que celle de reterritorialiser le kairos, de lui attribuer un sens commun dont il est, par nature, dépourvu.
Dans cette optique, il nous semble que le geste négrien possède incontestablement des traits spinoziens. S’il est vrai que chez Spinoza la production de “notions communes” est rendue possible par la proximité vitale des corps, on peut dire que chez Negri, ce sera désormais la praxis, concept aux échos indéniablement marxiens, qui aura en charge de promouvoir la communauté épistémologique50. Production de vérité (production épistémologique) et production de réalité (production ontologique) se déploient parallèlement. Et, comme on le comprend aisément, ce “parallèlement”, tel qu’il est formulé par un auteur aux influences ouvertement spinoziennes, est loin d’être une simple coïncidence. Ainsi, seuls l’être-avec et le faire-avec débouchent pour Negri sur la “praxis ontologique du vrai”51.
Tout cela nous situe face à une épistémologie de l’avenir, tournée vers l’avant, au sein de laquelle le sujet ne reconnaît pas, ne constate pas, ne représente pas, mais où il produit. Une aventure sauvage qui galope en chevauchant l’événement. Comme le disait en effet Althusser, le philosophe matérialiste prend le train en marche. Et c’est ainsi qu’il sabote la machine de l’idéalisme dont le rationalisme est, dès lors, largement remis en question. Et par idéalisme nous entendons n’importe quel artefact qui a fait du mécanisme et de la téléologie sa raison d’être philosophique. Mais ne nous égarons pas dans de trop longues digressions, et reprenons le fil d’Ariane qui, peut-être, nous permettra d’échapper au monstre. Cette ouverture negrienne sur l’avenir restaure pour la tradition matérialiste une faculté qui a souvent fait l’objet de dédain ou de mépris : l’imagination. Il n’y a pas, il ne peut y avoir une quelconque trace ontologique, raison pour laquelle il n’est pas possible, en bonne logique matérialiste, de l’anticiper rationnellement. Alors, seule s’offre à nous la possibilité d’imaginer, de définir les traits de ce qui voudra bien advenir. Puissance de la production matérialiste, médiatisée par l’imagination. C’est ainsi que Negri écrit :
Le kairos, par définition, se prolonge dans l’avenir. La construction du nom commun aura donc lieu dans ce prolongement de l’être, au travers de cet avènement du kairos ouvert sur l’avenir, auquel nous donnons le nom d’imagination. L’imagination n’est pas fantaisie […]. L’imagination consiste en un geste linguistique et, par conséquent, commun ; elle est le geste de qui tente de capturer l’avenir afin de le connaître, de le construire, de l’organiser avec puissance.52
Encore un effort si nous voulons être matérialistes53
Les analyses que nous avons proposées dans le but d’esquisser les fondements d’une épistémologie matérialiste produisent immanquablement en nous une profonde sensation de vertige : le vertige de la différence matérialiste. Face au monde paisible de l’idéalisme, face à son sujet mesuré et réfléchi, le matérialisme nous place face à un “paysage d’événements”54, qui dissout le rapport traditionnel entre le sujet et l’objet. Désormais, il n’y a plus que des trajets, des interactions, des rapports fluides au sein de processus de subjectivation et d’objectivation parallèles, tel que Virilio nous en dresse le tableau dans certaines de ses œuvres. La singularité devient la figure dominante de ce nouveau chaosmos matérialiste.
Cette singularisation du réel débouche sur une épistémologie de la différence pure, de la différence sans concept, comme le dit Deleuze. Or, la tâche qui nous incombe, nous l’avons déjà signalé avec Spinoza et Negri, consiste à conférer à cette différence un certain type de consistance, une certaine forme conceptuelle, un certain nom ou notion commune. Ne serait-ce que “pour nous comprendre”. Car la conclusion la plus évidente, et extrême, d’une approche matérialiste de l’épistémologie est l’impossibilité même d’une épistémologie matérialiste. Ou, à tout le moins, d’une épistémologie pleinement et radicalement matérialiste, c’est-à-dire, soumise au flux extrême du réel et du pli de subjectivation.
Deux voies, comme au temps de Parménide, s’ouvrent alors à nous : celle de l’être et celle du non-être. Et comme Parménide, forts de notre positionnement politique55, nous ne saurions choisir d’autre voie que celle de l’être. La voie du non-être, pour sa part, est celle qui constate l’impossibilité d’une telle épistémologie matérialiste et exprime, de façon cohérente, le court-circuit se produisant entre les sujets ; court-circuit qui conduit nécessairement à l’impossibilité de tout discours commun et, par conséquent, de toute politique. Tout en prenant acte de cette impossibilité, la voie de l’être se met, quant à elle, en quête de stratégies permettant de surmonter les difficultés auxquelles nous confronte le matérialisme pour tenter de construire un discours commun qui rende possible l’entente et la compréhension mutuelle, qui sont les deux conditions de possibilité d’un agir commun.
Pour parcourir ce long chemin, deux outils, à peine utilisés dans le discours philosophique, nous paraissent indispensables : l’écoute et la traduction. Notre tradition politique, depuis la Grèce antique, a mis l’emphase sur l’accès à la parole comme condition essentielle de toute participation à la politique. Aussi pourrait-on dire de notre tradition qu’elle est une tradition iségorique, en ce sens qu’elle recherche l’accès symétrique à la parole politique. Une question qui, dans nos sociétés médiatiques, régies par une fausse liberté d’expression, et dont le caractère censitaire n’a pas été suffisamment souligné, n’a rien perdu de son actualité. Cependant, cette égalité de parole doit être accompagnée d’un effort d’attention et d’écoute envers l’autre, et ce qu’il a à nous communiquer. Dans sa magnifique lecture d’Antigone, la tragédie de Sophocle, Castoriadis suggère, face aux interprétations traditionnelles qui envisagent cette œuvre sous l’angle de l’affrontement entre les raisons divine (Antigone) et citoyenne (Créon), d’y lire plutôt une critique féroce contre l’incapacité d’écouter, et la prétention à la vérité absolue qui imprègne les discours des uns et des autres.56 Mais il ne s’agit pas seulement de la critique d’un dire qui se croirait dans le vrai. En effet, comme nous avons tenté de le montrer au cours de notre analyse, tout dire est un dire relatif, singularisé, qui exprime un fragment du réel, et c’est à partir de cette vérité du relatif – comme l’appelle Deleuze – que s’impose à nous un exercice d’écoute dont l’objectif est d’entrevoir d’autres pièces de ce grand puzzle qu’est le réel. Comme le souligne Hémon, fils de Créon mais fiancé d’Antigone, l’hubris de la possession de la vérité est ce qui conduit au désastre. L’écoute s’impose. Mais cet effort d’écoute peut s’avérer vain ; car comme nous le rappelle Spinoza, les distorsions entravant le processus communicationnel tiennent toujours à la manière différente qu’ont les sujets de comprendre les mêmes concepts. C’est pourquoi, outre cette prédisposition à l’écoute, s’impose aussi la nécessité d’engager un processus de traduction de ce que l’on dit et de ce que l’on écoute. À l’instar de Sousa Santos qui évoque la nécessité de réaliser une traduction entre les différentes cultures de la planète57, nous pensons que cette traduction doit accompagner tout processus communicationnel entre les sujets. En effet, comme nous nous sommes employés à le démontrer dans les pages précédentes, la manière d’aborder la réalité est riche d’une singularité qui, contrairement à ce qu’a voulu nous transmettre la tradition idéaliste, transforme le monde en une appréhension subjective et différenciée. Ce à quoi il convient d’ajouter que l’emploi d’un même langage ne garantit aucunement la référence à une même réalité. Ces deux questions, le perspectivisme, pour le dire avec les mots de Nietzsche, et le caractère idiolectique de tout langage, en référence à la théorisation de Roland Barthes58, exigent de promouvoir une attitude de traduction entre les sujets, seule possibilité de parvenir à une certaine efficacité communicationnelle et politique. Le Comité Invisible synthétise cette idée d’une façon magistrale :
La tâche révolutionnaire est devenue partiellement une tâche de traduction. Il n’y a pas d’espéranto de la révolte.59
Face au refus deleuzien de la communication, nous pensons que cette dernière demeure essentielle, incontournable. Mais cette communication présuppose implicitement les actes d’écoute et de traduction. C’est dans la cadre de la praxis commune que doit être entrepris cet effort de mise en commun et/ou de complicité épistémologique, qui rende possible la tâche plus que complexe de nous munir d’outils linguistiques nous permettant de changer le monde. Comme disait Negri, l’épistémologie matérialiste est tournée vers l’avenir : ce qui l’intéresse n’est pas tant ce qu’elle a été, mais plutôt ce qu’elle est appelée à être ; elle n’interprète, ni ne représente, ni ne duplique, mais elle transforme, crée, produit.
Le langage – précise une fois de plus le Comité Invisible –, loin de servir à décrire le monde, nous aide plutôt à en construire un.60
Cette construction du commun est, parallèlement, ontologique et épistémologique. Et, sans l’ombre d’un doute, politique.
Notes
- Deleuze, G., Nietzsche et la philosophie, Paris, PUF, 1983, p. 118.
- Negri, A., Fábricas del sujeto. Ontología de la subversión, Madrid, Akal, 2006.
- Marx, K., “Thèses sur Feuerbach”, in Marx, K., Engels, F., L’idéologie allemande, Paris, Éditions sociales, 1968, p. 33.
- Gramsci, A., El moderno príncipe, Omegalfa, Biblioteca Virtual, p. 18.
- Deleuze, G., Pourparlers, Paris, Minuit, 1990, p. 193.
- Paz, O., Le singe grammairien, Paris, Flammarion, 1992, pp. 48-55.
- Apud. Morfino, V., Le temps de la multitude, Paris, Amsterdam, 2010, p. 210.
- Apud. Groys, B., Obra de arte total Stalin, Valencia, Pre-Textos, 2008, p. 57.
- Cf. Barroso, M., La piedra de toque, Madrid, Biblioteca Nueva, 2008, p. 101.
- Borges, J.-L., “Funes ou la mémoire”, in Borges, J.-L., Œuvres complètes, Paris, Gallimard, 2010, vol. 1, pp. 515-517.
- Althusser, L., “La querelle de l’humanisme”, in Althusser, L., Écrits philosophiques et politiques II, Paris, STOCK/IMEC, 1997.
- À ce propos, voir Aragüés, J.-M., De la vanguardia al cyborg. Una mirada a la filosofía actual, Zaragoza, PUZ, 2020.
- Certains ont, dans les rangs mêmes du marxisme, défendu des positions épistémologiques dépassant à peine l’empirisme le plus élémentaire, pour ne pas dire l’aristotélisme. C’est notamment le cas de Mao, comme l’attestent par ailleurs ses Quatre thèses philosophiques où ce dernier écrit : “La connaissance rationnelle dépend du sensible, lequel doit se développer jusqu’au point de devenir connaissance rationnelle. Voilà en quoi consiste la théorie matérialiste et dialectique de la connaissance” (Mao Tse Tung, Cuatro tesis filosóficas, Barcelona, Anagrama, 1974, p. 20).
- Marx, K., Introduction à la critique de l’économie politique, Lausanne, L’Altiplano, 2008, p. 65.
- Ibid., p. 68.
- Ibid., p. 67.
- Ibid., p. 70.
- Ibid., p. 69.
- Deleuze, G., “L’immanence : une vie…”, Philosophie, nº 47, Paris, Minuit, septembre 1995, p. 3.
- Ibidem.
- Deleuze, G., Différence et répétition, Paris, PUF, 1993, p. 187.
- Marx, K., Engels, F., L’idéologie allemande, Paris, Éditions sociales, 1968, p. 51.
- Deleuze, G., “L’immanence : une vie…”, Philosophie, nº 47, Paris, Minuit, septembre 1995, p. 4.
- Deleuze, G., Guattari, F., Qu’est-ce que la philosophie, Paris, Minuit, 1991.
- Ibidem.
- Deleuze, G., Nietzsche et la philosophie, Paris, PUF, 1983, p. 3.
- À propos de la construction d’un nouveau sens commun critique, voir les réflexions fort pertinentes de Sousa Santos dans Sociología jurídica crítica. Para un nuevo sentido común en el derecho, Madrid, Trotta, 1998.
- Deleuze, G., Différence et répétition, Paris, PUF, 1993, p. 3.
- Borges, J.-L., op. cit.
- Paz, O., op. cit., p. 53.
- Deleuze, G., Guattari, F., Qu’est-ce que la philosophie ?, Paris, Minuit, 1991, pp. 111-112, et aussi, pp. 120-121.
- Ibid., p. 26.
- Ibid., p. 36.
- Ibid., p. 25.
- Ibid., p. 11.
- À propos de cette critique des universaux, citons à titre d’exemple le fragment suivant de Qu’est-ce que la philosophie ? : “Le premier principe de la philosophie est que les Universaux n’expliquent rien, ils doivent être eux-mêmes expliqués”, p. 12.
- Ibid., p. 32.
- Mengue, P., Deleuze ou le système du multiple, Paris, Kimé, 1994, p. 71. Nous ne partageons toutefois pas l’analyse de Mengue, qui établit une distinction entre un “bon Deleuze”, le “Deleuze libéral” d’avant sa rencontre avec Guattari, et l’“anarchiste démesuré et excessif” auquel nous avons fait référence.
- Spinoza, B., Éthique, Paris, Éditions de l’Éclat, 2005, p. 175.
- Ibid., p. 176.
- Ibid., pp. 173-174.
- Ibid., p. 174.
- Ibid., p. 185.
- Negri, A., Fábrica del sujeto, op. cit., p. 356. Nous traduisons.
- Ibid., p. 340.
- Ibid., p. 341.
- Ibid., p. 336.
- Ibid., p. 340.
- Ibid., p. 345.
- Ibid., p. 347.
- Ibid., p. 344.
- Clin d’œil de l’auteur au pamphlet du Marquis de Sade intitulé “Français, encore un effort si vous voulez être républicains” in Sade, La philosophie du boudoir, Paris, 10-18, 1998. [NdT]
- Virilio, P., Un paysage d’événements, Paris, Galilée, 1996.
- À propos du rapport entre Parménide et la politique, et des conséquences qui s’ensuivent pour une lecture matérialiste de sa pensée, voir : Capizzi, A., Introducción a Parménides, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2016.
- Castoriadis, C., La cité et les lois. Ce qui fait la Grèce. 2, Paris, Seuil, 2008.
- Sousa Santos, B., El milenio huérfano, Madrid, Trotta, 2005.
- Barthes, R., Le Bruissement de la langue : Essais critiques IV, Paris, Seuil, 1984.
- Comité invisible, À nos amis, Paris, La Fabrique, 2014, p. 233.
- Ibid., p. 45.