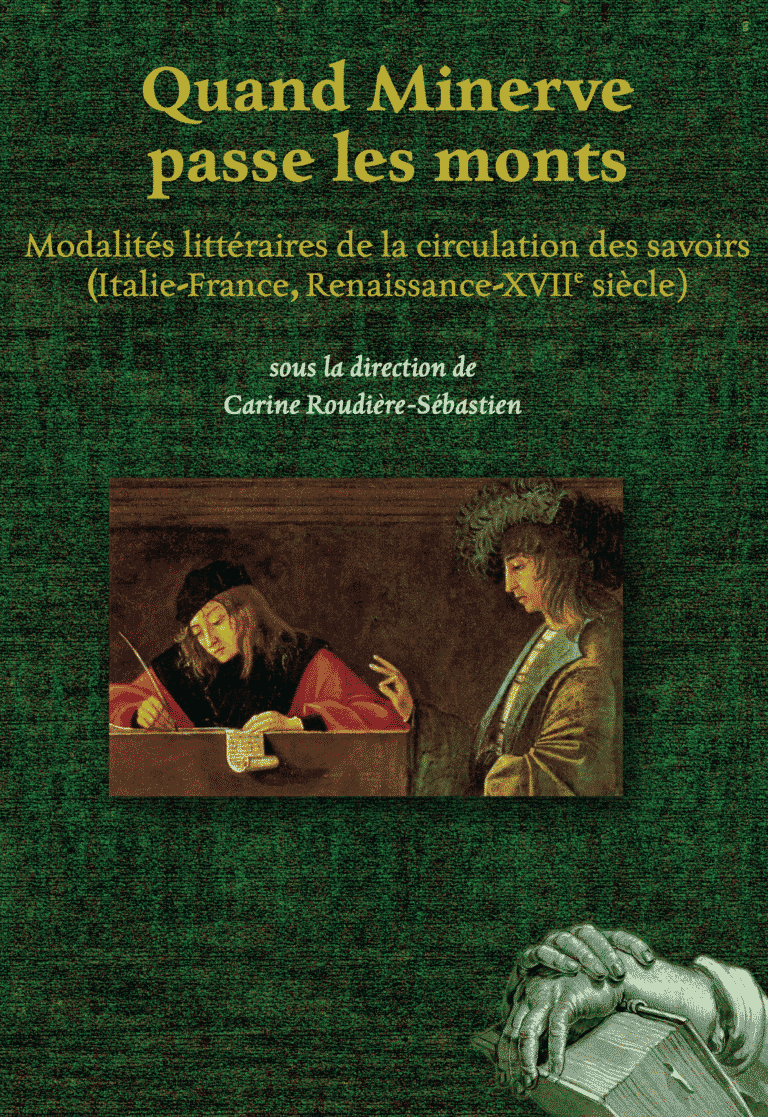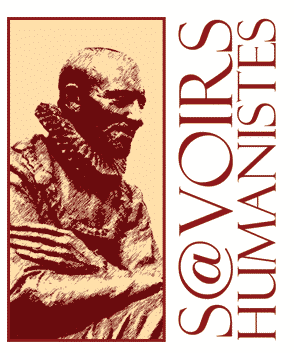Dans le cadre des travaux que recueille ce volume, notre contribution se consacrera à quelques-uns des savoirs de la nature : il ne s’agit pas d’embrasser ici le très vaste domaine que constitue la philosophia naturalis enseignée et discutée dans les universités européennes, ou d’analyser la circulation de savoirs spécialisés comme par exemple les traités de botanique, mais de tenter de recenser les diverses formes de porosité ayant existé entre la culture italienne et la culture vernaculaire française. Partant du postulat que l’Italie est un foyer important de renouveau des connaissances sur la nature, nous essaierons de comprendre quels sont les éléments de connaissance qui circulent de l’Italie vers la France dans les écrits lus par le public des lettrés (par opposition au monde restreint des universitaires), sous quelle forme, et, si possible, pourquoi.
Les savoirs liés à la nature, en particulier la physique et la météorologie, suscitèrent un intérêt important dans le milieu des curieux, en France comme en Italie (et partout en Europe). Or dans ce domaine, l’Italie du XVIe siècle mit à disposition de la France un fonds de textes particulièrement riche, tant pour ce qui regarde la forme que les variations savantes sur le vieux socle du savoir aristotélicien. Tous ne circulent pas, ni dans les mêmes proportions ou selon les mêmes modes : nous allons donc tenter de formuler quelques hypothèses sur le choix et les modalités textuelles ou discursives de la circulation de ces savoirs italiens, en nous fondant sur des traces de lecture et de réécriture parfois ténues.
État des lieux
Les textes de philosophie naturelle italienne au XVIe siècle
Il faut commencer par rappeler le décalage entre la France et l’Italie dans le domaine de la philosophie naturelle et la richesse parallèle de la production italienne tout au long du XVIe siècle. Les savoirs sur la nature occupent en Italie une place importante dans les études universitaires. La physique, au sens scolastique du terme, englobe les savoirs portant sur la matière inanimée, la formation du monde, les phénomènes météorologiques, la formation des pierres et des métaux, et débouche sur ce que nous appellerions aujourd’hui la biologie. Cet enseignement se fait depuis le Moyen Âge sur la base de l’étude du corpus des traités naturels aristotéliciens : Physique, De cœlo, De generatione et corruptione et Météorologiques, éventuellement suivis des traités biologiques. L’enseignement (plus ou moins) détaillé de ce corpus fait partie, en France, de l’enseignement reçu pour l’obtention de la licence ès arts (tout lettré ayant poursuivi des études universitaires y a donc été formé, ou du moins initié) et, en Italie, pour l’obtention de la licence ès arts et médecine, la liaison de la philosophie et de la médecine expliquant l’importance de la place des études réservées à la nature1.
Il est difficile d’établir une typologie des textes qui ont été alors publiés en Italie, car la classification ne sera pas la même selon que l’on se fonde sur le lectorat visé, le genre et la forme des ouvrages, l’orthodoxie du contenu, la langue employée… On peut cependant opérer quelques distinctions. Existent d’abord les commentaires et traités universitaires proprement dits, inscrits dans la tradition de l’enseignement de la philosophie naturelle. Outre les divers commentaires des textes d’Aristote, qui circulent sous forme imprimée ou manuscrite (dont une déclinaison simplifiée se diffuse parallèlement grâce aux manuels qui commencent à se multiplier dans toute l’Europe2), quelques textes majeurs font date et parfois suscitent d’importantes discussions, comme le De rebus naturalibus de Giacomo Zabarella3, ou les Peripateticarum quæstionum libri quinque d’Andrea Cesalpino4. On peut signaler, à côté de ces grands traités discutant le socle commun aristotélicien, les propositions de systèmes cosmologiques nouveaux, également exposées dans des œuvres massives, comme le De natura iuxta propria principia de Bernadino Telesio, dont une publication partielle a lieu en 15655, puis qui paraît sous sa forme définitive en 15866, ou la Nova de universis philosophia de Francesco Patrizi7. Le goût des lecteurs érudits pour ces grands systèmes venus d’Italie est attesté par une édition publiée à Genève par Eustache Vignon en 1588, réunissant, avec un texte de Filippo Mocenigo, les traités de Cesalpino et de Telesio8.
À côté de ces grands traités existent aussi des œuvres moins systématiques et beaucoup plus inclassables, comme le De subtilitate de Cardan9, dont plusieurs chapitres sont consacrés à la physique et en particulier à la réfutation du statut élémentaire du feu, et, dans un genre tout différent, ce que l’on pourrait nommer la physique géographique d’Antonio de Ferrariis (dit Il Galateo), qui décrit les quatre éléments à partir de leur géographie physique dans le monde sublunaire10.
On trouve enfin des ouvrages de vulgarisation de bon niveau, qui ne sont d’ailleurs pas nécessairement dépourvus d’originalité, qu’il s’agisse d’une vulgarisation latine policée et littéraire, avec le De elementis de Gasparo Contarini11, ou d’une vulgarisation au sens premier du terme, avec les œuvres d’Alessandro Piccolomini12 et d’Antonio Brucioli13.
De cette importante production, qu’est-ce qui parvient au lectorat français ? Les œuvres universitaires ne semblent que peu voire pas avoir été diffusées en dehors des stricts cadres universitaires. Il est très difficile d’en trouver des traces significatives en France : si la présence de Cardan et de Contarini dans les bibliothèques françaises est bien attestée, la circulation de Zabarella ou de Cesalpino n’est pas documentée, et les textes hétérodoxes ont quant à eux surtout été utilisés au XVIIe siècle par les milieux libertins14. Les œuvres de vulgarisation, en revanche, sont de toute évidence mieux connues, et ce, qu’il s’agisse d’une vulgarisation en latin, lisible par tout lettré, ou d’une vulgarisation en toscan. Manifestement, le contenu comme les modèles formels constitués par les textes de Contarini, Brucioli ou Piccolomini sont lus et appréciés des lettrés français. Une trace objective s’en trouve dans les commentaires que Simon Goulart a apportés à La Sepmaine de Du Bartas. Dans ses annotations sur la physique des éléments, il écrit :
Or quant à ces disputes des principes et elemens, cela ne se peut enclore en un indice ou brief recueil d’annotations. Attendant que quelque autre en discoure exactement en un commentaire, et previenne ce que j’ay commencé dès longtemps d’en tracer, le lecteur curieux pourra lire les commentaires sur les livres de la Physique d’Aristote, et ceux De Cælo ; Contarenus ès livres Latins de elementis ; Galateus au traité De numero et situ elementorum ; Scaliger en divers endroits de ses exercitations ; F. Patricius au 4e tome de ses discussions peripatetiques, liv 7 et 8; André Calepin [Sic. En vérité: Cesalpino, ici confondu avec Calepino] en ses Quest. Peripat. et B. Tilesius ès neuf livres de natura rerum, où il dispute fort et ferme contre Aristote15.
On le voit, la bibliographie donnée par Goulart sur la question du débat moderne sur les éléments est purement italienne, sauf si l’on considère Scaliger comme un français…
La situation française de la philosophie naturelle est assez différente. Elle n’est peut-être pas tant en retard (du moins en latin et si l’on considère l’ensemble de la physique), qu’à la fois différente et différemment perçue. Si l’on trouve comme partout en Europe des commentaires et des expositions sur l’œuvre d’Aristote, parfois remarquables, et si l’intérêt pour la physique a été manifeste à la fin du XVe siècle (avec Lefèvre d’Étaples et Josse Clicthove, bien sûr, mais aussi Thomas Bricot ou Pierre Tartaret, mais qui ne sont pas des spécialistes de philosophie naturelle), si la France propose aussi des œuvres originales, en particulier le Théâtre de la nature universelle de Jean Bodin à la toute fin du siècle16, le XVIe siècle français ne semble pas manifester le même goût que l’Italie pour les transformations de la matière élémentaire. Le milieu universitaire français ne montre que peu d’intérêt pour la physique des éléments (les français ne commentent pas le De generatione, contrairement aux Italiens) et on ne relève pas non plus de productions vraiment équivalentes aux systèmes alternatifs proposés en Italie. Les productions novatrices peuvent être dues à des Italiens enseignant en France, comme le commentaire de Vimercato sur les Météorologiques d’Aristote17. Les œuvres existantes sont en outre souvent datées et pour certaines (Bricot, Tartaret) peu prisées des milieux humanistes lettrés du XVIe siècle français.
De la même manière, la vulgarisation est en retard : il n’existe presque pas d’ouvrages latins de vulgarisation de la philosophie naturelle d’origine française, sauf sous forme de manuel, comme celui de Jacques Charpentier, à qui on doit en 1560 une Universæ naturæ brevis descriptio ex Aristotele, si brevis qu’elle fait tenir toute l’œuvre d’Aristote en trente-deux feuillets18. Avant la toute fin du siècle, il n’y pas non plus de texte en français, à l’exclusion du Premier Curieux de Tyard (1557)19. C’est en fait dans la poésie philosophique des années 1580 (Du Bartas puis Du Monin) que l’on trouve encore le plus nettement exprimé le contenu de la physique d’Aristote, mais nous sommes ici très loin de l’idée d’exposition systématique et ordonnée telle que la pratique la vulgarisation italienne. Il faut attendre les années 1590 pour avoir les premières tentatives de vulgarisations systématiques de la physique sur le mode du traité20.
Une philosophie vulgarisée
La spécificité du discours sur la vulgarisation
Dans le paysage varié que nous venons d’esquisser, il faut insister sur la place qu’occupe la vulgarisation de cette physique des qualités. Un certain nombre d’humanistes italiens attachent une grande importance à la translatio du savoir aristotélicien, encore généralement exprimé en latin bien plus qu’en grec, vers divers dialectes italiens. La différence d’attitude entre la France et l’Italie est rendue manifeste par la manière dont Du Bellay adapte, dans la Deffence, le Dialogo delle lingue de Sperone Speroni21. Comme on le sait, Du Bellay, en pillant Speroni, a détourné vers la poésie l’essentiel du propos : même s’il mentionne la question de la langue philosophique dans le chapitre X (Que la langue française n’est incapable de la philosophie), il se contente alors de reprendre presque littéralement Speroni, mais en l’abrégeant, signe probable d’un relatif désintérêt pour une question qui, dans le texte italien, occupe en revanche une place très importante. Chez Speroni, en effet, le dialogue initial en enchâsse un autre : l’un des locuteurs premiers, L’écolier, rapporte un échange entre son maître, le philosophe padouan Pietro Pomponazzi, dit Peretto, et le grand helléniste Giovanni Lascaris. La question de la vulgarisation philosophique est l’objet d’un âpre débat entre les deux hommes, l’helléniste ne comprenant pas l’intérêt du philosophe pour la langue vulgaire, et cette question donne naissance à un échange long et circonstancié.
Résumons le début du dialogue italien : Lascaris vient de France et rend visite à Pomponazzi ; il lui demande quel est l’objet de son cours de l’année. Pomponazzi répond qu’il analyse les quatre livres des Météorologiques d’Aristote. Lascaris lui demande à l’aide de quels commentateurs, et découvre alors – horreur et stupéfaction – que Pomponazzi lit Alexandre d’Aphrodise en latin et voudrait même pouvoir le lire et écrire lui-même en vulgaire. Les positions de Pomponazzi engagent une réflexion profonde :
PER. Je croy pour certain que les langues de tous païs, aussi bien l’Arabique & l’Indianne, que la Romaine & Greque, sont d’un mesme effet & valeur, & formées des hommes par un mesme jugement, à une mesme fin […] Traduisant donc en ce temps cy de Grec, en vulgaire, la philosophie semée par nostre Aristote, parmy les fertiles champs d’Athenes; ce ne seroit point la getter parmy les pierres, dans le bois, ny luy donner ocasion de devenir sterile, se seroit plustost (d’eslongnée qu’elle est) l’aprocher, & d’estrangere, la rendre domestique à toute nation: […] Aussi les speculations d’Aristote, nous deviendroient plus familieres qu’elles ne sont, & plus facilement les entendrions, si quelque docte personne les reduisoit de Grec en beau Vulgaire. […]
PER. J’ayme mieulx croire qu’Aristote & la verité, c’est assavoir que quelque langue qui soit au monde n’a point de soy ce privilege de signifier les conceptions de nostre ame, & que le tout en consiste souz l’arbitre des personnes : tellement que quiconque voudra parler de philosophie en langue Mantouane ou Milannoise, on ne peut par raison luy refuser non plus qu’on luy peut empescher l’estude de philosophie ou l’intelligence de l’ocasion des choses. Bien est vray que pour-ce que le monde n’est point coustumier de parler de philosophie sinon en Grec & Latin, il nous semble estre impossible de povoir faire autrement22.
Le passage est particulièrement intéressant, parce qu’on n’y entend pas seulement un défenseur du vulgaire contre un helléniste, mais aussi un philosophe aristotélicien contre un platonicien tenant du cratylisme. Or les savoirs de la nature sont aristotéliciens et l’épicentre de leur vie intellectuelle à la Renaissance est Padoue, il n’est donc pas innocent que Speroni ait placé dans la bouche de Pomponazzi, l’un des très grands aristotéliciens padouans du début du siècle, la défense d’une langue vulgaire apte à dire la philosophie.
La vulgarisation de la philosophie
Se développe ainsi en Italie toute une littérature de vulgarisation de la philosophie naturelle qui se forme plus tôt qu’en France, et de manière systématique. L’un des représentants le plus accompli de ce travail de vulgarisation est sans doute l’humaniste florentin Antonio Brucioli (1498-1566). Poursuivi après l’affaire du complot contre le cardinal Giulio de Medici (1522), il se réfugie à Lyon et fréquente alors les milieux français. On lui doit, outre un nombre très important de traductions néo et vétérotestamentaires, une mise en vulgaire du système complet de la philosophie universitaire, soigneusement ordonné :
– Dialogi della morale philosophia, Venise, Bartholomeo Zanetti, 1537.
– Dialogi della naturale philosophia humana, Venise, Bartholomeo Zanetti, 1537.
– Dialogi della naturale philosophia, Venise, Bartholomeo Zanetti, 1537.
– Dialogi della metaphisicale philosophia, Venise, Bartholomeo Zanetti, 1538.
Signe de son intérêt pour la vulgarisation des savoirs naturels, Brucioli a traduit également le célèbre Tractatus de sphæra de Johannes de Sacrobosco23, ainsi que, pour les sources antiques, Pline et Aristote lui-même. Or si Pline est traduit assez vite en français par Louis Meigret puis par Antoine du Pinet, aucun équivalent n’existe aux traductions par Brucioli des textes composant le corpus naturel aristotélicien. En France, le savoir aristotélicien sur la nature reste officiellement une sorte de repoussoir pour les lettrés, car il cristallise le rejet persistant de la scolastique, de ses méthodes et surtout de son langage. En Italie, en revanche, la vulgarisation des savoirs de la nature se fait d’abord dans la reprise et la translation des savoirs universitaires, dont le contenu ne subit pas le même opprobre mondain, et ne semble incompatible ni avec la ou plutôt les langues vulgaires de l’Italie, ni avec une forme de savoir policée qui parvient à transformer nettement les modes d’exposition de la scolastique.
L’illustration de ce mouvement s’incarne dans l’Academia degli Infiammati de Padoue, qui a brièvement vécu entre 1540 et au plus tard 1550 et se voulait l’héritière de la pensée de Pomponazzi, une académie où l’on pouvait philosopher, promouvoir une nouvelle hiérarchie des savoirs et défendre la langue vulgaire. Elle a compté parmi ses membres Sperone Speroni, Benedetto Varchi et Luigi Alamanni. Outre le dialogue de Speroni, on peut mentionner, pour témoigner des réflexions sur le rôle du vulgaire, les Ragionamenti della lingua toscana, publié par Bernardino Tomitano en 1545 à Venise : Tomitano dit y recueillir les conversations tenues dans la maison de Sperone Speroni ; il y affirme la dignité de la langue vulgaire et sa capacité à traiter n’importe quel sujet, y compris scientifique ou philosophique.
L’autre grande figure de vulgarisateur des savoirs de la nature est également étroitement liée à l’Academia degli infiammati : Alessandro Piccolomini (1508-1579). Siennois, il arrive à Padoue dans les années 1538 et est l’un des membres fondateurs des Infiammati. Il prit part, semble-t-il à l’instigation de Sperone Speroni, à la mise en œuvre volontaire de tout un programme de mise en vulgaire des savoirs naturels24. On lui doit plusieurs œuvres consacrées sur le sujet, directement issues de son activité à l’Académie, ou conséquences plus tardives de son double intérêt pour la science et pour la langue vulgaire :
• un traité de la sphère (Della sfera del mondo) complété par un traité sur la sphère des étoiles fixes, qui est en réalité une carte du ciel, la première du genre25,
• un traité original sur la terre et l’eau, saisis sous leur forme cosmographique : Della grandezza della Terra et dell’Acqua26, dans lequel il compare les opinions de Ptolémée et du Stagirite sur l’étendue relative des terres et des mers,
• et un ouvrage de vulgarisation de la philosophie naturelle qui paraît en plusieurs livres et se compose d’une logique (L’instrument, soit un retour au sens premier de l’Organon aristotélicien) et d’une physique en deux parties, ensuite régulièrement reliées ensemble :
• L’Instrumento de la filosofia, Rome, Giovanni Maria Bonelli, 1552.
• La Prima parte della filosofia naturale, Rome, V. Valgrisi, 1551.
• La Seconda parte de la filosofia naturale, Venise, V. Valgrisi, 1554.
Piccolomini a également exercé une activité de traducteur : en 1540, il traduit et commente du grec le commentaire sur les Météorologiques d’Alexandre d’Aphrodise, celui-là même que Pomponazzi est en train d’utiliser pour son cours dans le dialogue de Sperone Speroni27. Tout ceci rappelle l’importance cruciale de Padoue, comme épicentre de la philosophie naturelle au XVIe siècle, de Pomponazzi à Zabarella à la fin du siècle, mais aussi comme épicentre d’une vulgarisation qui conjugue connaissance fine de la philosophie aristotélicienne universitaire, souci humaniste de la pédagogie, enrichissement et illustration de la langue vulgaire, et souci tout aussi humaniste de l’élégance.
Or les deux grands vulgarisateurs italiens ont été partiellement traduits en français. De Brucioli, en effet, on conserve une traduction des dialogues de philosophie naturelle (Dialogues sur certains points de la philosophie naturelle et choses meteorologiques, pris des dialogues d’Antoine Brucioli28), et pour Piccolomini, sa traduction de la Sphère, plus tardivement complétée par la traduction de son traité sur le lieu des éléments29. La traduction du traité sur l’étendue de la terre et de l’eau ne date ainsi que du début du XVIIe siècle, presque soixante ans après celle de la Sphère seule et rencontre alors un certain succès, puisqu’elle connaît au moins une réédition, en 1619. L’ensemble formé par la logique et la physique n’est pas traduit, même partiellement30.
Du paysage italien, on peut donc retenir une présence très importante des savoirs de la nature, sous des formes variées ; un fort poids de l’aristotélisme, qui peut être combattu à des degrés divers (Cesalpino, Cardan, Telesio) mais est remarquable et remarquablement vivant (Zabarella) ; une évolution nette du premier humanisme vers une conciliation avec l’aristotélisme universitaire ; la variété des identités de ceux qui écrivent sur la nature et de leurs productions : la liste des œuvres de Contarini, Brucioli, Il Galateo ou Piccolomini dit bien que l’étude de la physique fait partie de la panoplie de l’honnête humaniste. Aucun n’est un spécialiste de philosophie naturelle, et celle-ci vient bien souvent dans leurs travaux après d’autres préoccupations, mais leurs œuvres ont joué un rôle important dans la diffusion hors d’Italie de cet Aristote humaniste.
Formes de la circulation des savoirs
La bibliographie établie par Simon Goulart ne révèle pas uniquement le poids écrasant des Italiens dans la constitution d’un fonds d’ouvrages modernes traitant de la nature (ou la place privilégiée qu’on veut leur accorder) : elle met aussi en évidence une dichotomie entre pratiques de lecture et pratiques d’écriture. Si on peut considérer, avec quelques précautions, que la bibliographie de Goulart atteste que les lettrés connaissaient les textes universitaires, on trouve en revanche très peu de traces de ces derniers, voire pas du tout, dans les écrits français, et ce, qu’il s’agisse de références explicites ou de réécritures. En revanche, certains auteurs comme Contarini ou Cardan sont cités et/ou traduits et imités. Il y avait donc des textes qui étaient lus, et seulement lus, et d’autres qui étaient imités ou traduits à des degrés divers. La question est évidemment : pourquoi ? Je voudrais donc maintenant donner des exemples différents de mise en circulation par l’écriture, et non plus seulement par la lecture, des textes italiens, et essayer d’avancer très prudemment quelques hypothèses sur les raisons de leur ingestion par la littérature française (entendue au sens large et renaissant de « ce qui s’écrit »).
Contarini : une figure d’autorité au destin français
Gasparo Contarini est né en 1483 à Venise et mort à Bologne en 1542. Issu d’une grande famille vénitienne, il fut d’abord magistrat de la République de Venise, puis fait cardinal par le pape Paul III en 1535. Figure majeure du catholicisme pré-réformé, c’est aussi un homme qui fit ses études à Padoue, où il fut formé à tous les aspects de la philosophie et fut l’élève de Pomponazzi. Dans son œuvre, essentiellement liée à la théologie chrétienne, on trouve ainsi une réfutation du traité sur l’immortalité de l’âme de Pomponazzi et, point qui nous intéresse ici, un traité sur les éléments exposant les principes de la physique aristotélicienne. Or ce texte de Contarini connut un destin assez étonnant, qui témoigne à la fois de la circulation des savoirs entre la France et l’Italie et de l’importance que revêtait la forme pour garantir un succès français à un texte de philosophie naturelle.
Le De elementis est à notre connaissance l’unique texte à être volontairement consacré à la seule question élémentaire et à avoir tenté d’en faire un savoir autonome. Contarini considère en effet que les éléments, qui occupent une place centrale et fondatrice dans le cosmos, doivent être également le point nodal autour duquel s’organise tout traité de physique. Le plan de l’ouvrage et les limites de son champ d’exploration sont ainsi définis à partir de la seule notion d’éléments et s’appuient sur l’étendue du rôle de ces derniers dans le cosmos. Il englobe tout ce qui a trait au monde sublunaire, mais s’arrête aux portes de l’étude des différentes sortes de mixtes et n’entre pas dans le détail des propriétés respectives de ces derniers. Le mouvement de l’ouvrage suit une progression logique qui va du plus simple et du plus pur (l’élément comme corps cosmologique) aux principes de la formation des mixtes, en passant par l’étape intermédiaire de l’élément en tant que corps engagé dans la génération des réalités naturelles. Sur la base d’une définition rigoureusement tirée d’Aristote, Contarini distingue avec un soin extrême le rôle de l’élément en tant que constituant structurant du cosmos (ce qu’il appelle les elementa compositionis), de celui de l’élément engagé dans le processus de génération des corps composés (les elementa mixtionibus ou elementa mixtionis), en consacrant à chacun de ces domaines, qui conditionnent la forme effective de l’élément, des chapitres distincts. Il accorde ainsi une grande place aux météores (livre II), qui permettent d’observer les éléments quasiment à l’état pur. Il aborde ensuite la science des mixtes et les principes de la classification des corps, qu’il traite à la suite de la description des éléments dans le livre III, les différentes formes de chaleur et la variété de leurs actions, jusqu’à la question des tempéraments, dans le livre IV, et les théories de la sensation et des couleurs, dans le cinquième et dernier livre. Il s’agit d’un traité qui ne ressemble à rien de connu dans les manuels latins, écrit dans un beau latin cicéronien. Il reprend la théorie aristotélicienne, mais la complète par des échos de Sénèque, probablement quelques réminiscences souterraines de Lucrèce31, des considérations venues de la médecine, ainsi que des notations beaucoup plus personnelles liées à son intérêt pour les voyages et la cosmographie.
Or ce texte noue une histoire singulière avec la France. Le traité de Contarini, d’abord, est publié non en Italie, mais en France, après sa mort, à Paris, chez deux éditeurs différents : en 1548 chez Nicolas Le Riche et en 1560 chez André Wechel. Dans l’édition Wechel, il est suivi du poème De principiis rerum, de Scipione Capece (1480-1551), dédié au pape Paul III, avec une épître à Pietro Bembo. Signe de son succès, il est encore publié en 1633, à Leide. L’édition de Leide est donnée comme la cinquième, car il y a eu une édition parisienne des Œuvres, chez Nivelle, en 1571, et enfin seulement, une édition italienne, aldine, des Œuvres, à Venise en 1577.
L’histoire du texte lui-même est assez révélatrice. En France, il est considéré comme une référence absolue en matière de physique, et, fait rarissime, il est nommément cité par plusieurs auteurs, avec une révérence particulière. Simon Goulart le mentionne, ce qui n’est pas surprenant puisqu’il donne de véritables petites bibliographies, et l’on sait que Baïf l’a lu pour rédiger son poème sur les météores, même si ce n’est pas sa première source (le Premier des Meteores est surtout inspiré par les Commentarii de Velcurio32). Mais plus remarquables sont les mentions faites par plusieurs lettrés français.
Pontus de Tyard, d’abord, le cite nommément dans Le premier curieux, ce qu’il ne fait pour aucun autre contemporain. Lorsqu’il expose les principes du système élémentaire d’Aristote, il écrit ceci :
Semblable divorce tient en suspens la seicheresse et l’humidité : celle ayant plus de resistance que d’action, et ceste disposée au contraire : qu’il faut toutesfois entendre diversement selon le divers rapport de leurs concurrences en l’un ou l’autre Element : et selon qu’elles sont premieres, ou secondes qualitez. Cecy d’une diserte abondance a esté escrit par l’honneur du pourpre Romain de son temps, le docte Cardinal Contaren.
Puis trente pages plus loin, au sujet des diverses théories sur les marées :
La cause en est vulgairement rejettée (comme vous avez dit) sur le corps et mouvement de la Lune, à laquelle aucuns donnent pour aide la force du mouvement solaire. Mais de quelle faculté procede ceste effect, personne ne l’a (que je sçache) encore bien descouvert : si ledocte Contaren n’a fait la subtile rencontre, disant que le Flux n’est autre chose, qu’une enfleure et eslevation de la Mer, procedante de la rarefaction de la substance aquée attirée à ceste elevation par la chaleur des rayons de la Lune33.
Tyard n’est pas le seul : on trouve des louanges adressées au « Docte Contaren » chez le polygraphe Pierre Boaistuau, qui, dans son Theatre du monde de 1558, le mentionne lui aussi nommément sur la question des raz-de-marée, lorsqu’il traite des « merveilles de l’eau » :
Gaspard Contaren en son livre des quatre elements, escrit que de nostre temps, Vallence, cité d’Espaigne, avec tous ses citoyens faillit à estre submergée, par une violente, et incongneuë irruption d’eau34.
Il lui rend également un hommage appuyé dans ses Histoires prodigieuses : « Gaspard Contarenus en l’œuvre docte et plein de philosophie qu’il a faict De quatuor elementis35 ». Le médecin Jacques Grévin le cite quant à lui au sujet de la très grande froideur des métaux dans son Second Discours sur les vertus et facultez de l’antimoine (1567) :
Ce passage d’Aristote se doit ainsi entendre, et ainsi l’ont entendu ceux, lesquels y ont mieux estudié que vous. Toutefois à celle fin qu’il ne vous semble q eu j’en vueille estre creu tout seul, je vous allegueray ce que Gaspar Contaren, excellent philosophe de son temps, a dit touchant ce lieu36.
Il le mentionne à nouveau quelques pages plus loin, en l’utilisant de manière manifeste comme figure d’autorité : « comme nous avons dit et comme Contaren l’explique », « au contraire Contaren les nomme tres froids », « au contraire Contaren qui l’a fort bien expliqué37 ».
On trouve la trace de Contarini sans doute la plus marquée dans le traité que Claude Duret consacra à la théorie de la salure de la mer et des marées38. Il y mentionne d’abord « les curiositez touchant les Elemens remarquées par Aristote […], Galien […], Cardan […], le Cardinal Contaren [et] Ponthus de Tyard39 » lorsqu’il évoque la description générale du système élémentaire. C’est cependant lorsqu’il touche au cœur de son propos, la théorie des marées, que le texte révèle l’importance du legs du De elementis. Le chapitre IX s’ouvre par ces mots :
Entre tous les Anciens et Modernes Philosophes, le grand Cardinal Contaren livre second des Elemens, me semble avoir mieux et plus pertinemment definy l’Element de l’Eau, disant…40.
Suit une longue citation en traduction française, clairement démarquée par la typographie, qui court de la p. 52 à la p. 54. Le procédé revient à plusieurs reprises dans le traité, Duret citant encore, par exemple, « le grand Cardinal Contaren » pendant plus de huit pages au sujet des parties de la terre laissées découvertes par l’eau, pendant plus de vingt au sujet des marées, pendant six pages sur la salure de la mer41. Toute une partie du De elementis est donc traduite, « rapporté[e] de mot à mot42 » dans le Traicté de Duret (traduction ou adaptation qu’il faudrait encore examiner en détail sur le plan linguistique). Contarini est le seul à être toujours « grand43 » : ni Cardan, souvent mentionné (et réfuté), ni Vimercato, ni Piccolimini, également présents, n’ont droit à ce qualificatif (Scaliger y a droit quant à lui quelques fois, ses réfutations du De subtilitate de Cardan étant longuement citées en traduction également).
À la différence de Tyard, Grévin ou Duret nomment souvent leurs sources et invoquent leurs contemporains comme autorités, mais ces quelques exemples de citations par des auteurs variés, en contextes eux-mêmes variés (un dialogue philosophique sur l’univers, des Histoires prodigieuses, un traité sur l’antimoine…) montrent que le texte de Contarini a été non seulement lu attentivement en France, mais aussi qu’il était senti comme suffisamment important pour être cité et son auteur nommément identifié.
Son destin éditorial et sa vie comme autorité ne s’arrêtent pas là. En effet, si le texte n’a été imprimé qu’assez tard en Italie, il a été est très probablement imité, sous forme d’une libre traduction partielle, faite par Paulo Manuzio. L’ouvrage est publié de manière doublement anonyme par l’officine Aldine en 1557 (au moment où le texte est sans cesse cité dans les milieux français), sans le nom de l’auteur initial ni celui du traducteur, et sans être signalé comme une traduction, sous le titre De gli elementi et di molti loro notabili effetti. Elizabeth Gleason, biographe de Contarini, y voit un signe de l’importance du texte pour ses concitoyens44. Un travail de comparaison sérieux entre ce texte italien et le traité de Contarini reste cependant à faire : l’information selon laquelle le texte italien est une traduction partielle de Contarini a été donnée d’abord par Lynn Thorndike dans A History of magic and Experimental Science45 et nos propres sondages semblent montrer que la version italienne est plutôt un résumé en vulgaire qu’une traduction, mais le texte initial demeure reconnaissable, et a donc circulé sous cette forme italienne adaptée. Ultime ironie de ce parcours franco-italien, cette traduction dissimulée est elle-même traduite en latin par l’universitaire parisien Jacques Charpentier en 1558 sous le titre De elementis et variis eorum effectis iisque potissimum quæ in meteoris apparent, liber : ex Italorum vernaculis latinus factus46.
Le texte de Contarini, qui n’a jamais été traduit en français, offre aux lettrés français ce qui leur manquait : un modèle d’aristotélisme poli, écrit dans un beau latin humaniste, très différent du latin scolastique des universitaires, ce qui explique sans doute son grand succès de notre côté des Alpes. Et s’il n’est pas traduit, il est partiellement imité, au moins par Pontus de Tyard, qui ne se contente pas de le citer. Tyard doit en effet non seulement à Contarini ses analyses sur le feu et sur les mouvements de la mer – les deux passages où il paie sa dette –, mais aussi, sans le dire, l’opposition entre « éléments de composition » et « éléments pour le mélange des mixtes », absolument caractéristiques de Contarini (p. 114), la distinction entre éléments comme parties du monde et comme parties des corps mixtes, ainsi que sa définition du principe (p. 110). Il imite également la manière singulière de Contarini dans un passage où le Solitaire interrompt le discours du Curieux (p. 147-149), par une intervention directement empruntée à Contarini, qui fait état de l’expérience des navigateurs pour confirmer les hypothèses sur la théorie des marées. Enfin, il est très probable qu’il a également utilisé Contarini plutôt que directement Platon pour la présentation géométrique des éléments. Comme la version en vulgaire publiée chez Alde, Tyard résume dans sa propre langue le traité de Contarini, qui apparaît comme une alternative formelle viable à la philosophie des universités. Sans en altérer profondément la nature, elle en modifie la forme linguistique et les modes d’exposition, de même qu’elle en restreint le contenu à une substance plus facile mais aussi plus moderne, propice à séduire les lettrés mondains.
Cardan et ses histoires
L’autre ouvrage dont on trouve des traces abondantes est le De subtilitate de Jérôme Cardan, publié en 1550, et qui fut sans doute l’un des plus grands succès de librairie du moment (on ne compte pas moins de quinze éditions de 1550 à 1642.) Le texte est presque immédiatement traduit du latin au français, la traduction de Richard Leblanc en 1556 étant quant à elle rééditée au moins six fois (1566, 1578 et 1584 pour le XVIe siècle). On sait que Ronsard en avait dans sa bibliothèque un exemplaire annoté de sa main.
Il est difficile de savoir avec certitude pourquoi l’ouvrage eut un si considérable succès, sinon qu’il aborde la question de la nature et de ses transformations de manière extraordinairement variée et composite. Il propose ainsi une théorie de la nature qui accepte une possibilité constante de transformations (justifiant par exemple la possibilité de la transformation des espèces proches – le chien et le loup – et intégrant les monstres et merveilles comme autant de possibilités normales quoiqu’irrégulières), une très grande attention portée aux phénomènes naturels remarquables, mais aussi aux arts, aux inventions diverses et surtout un mode de composition tendant à réunir ces différents points, quand ils sont ailleurs séparés : quand Cardan traite du feu, par exemple, il évoque aussi bien la théorie d’Aristote, qu’il réfute, que la chaleur du corps, la manière de construire une cheminée qui ne fume pas ou le fonctionnement de l’artillerie. Le De subtilitate est en particulier célèbre pour avoir exclu le feu du nombre des éléments et suscité ainsi une discussion sur la physique aristotélicienne au retentissement important. La réaction la plus notable vient d’un Italien de France : Scaliger le réfute précisément dans le quinzième livre de ses Exotericæ exercitationes47. Duret, qui s’appuie beaucoup sur Contarini, cite également abondamment Cardan et Scaliger, pour prendre le parti du second contre le premier.
On pourrait donc s’attendre à ce que Cardan connaisse un destin parallèle à celui de Contarini, au moins pour être discuté, mais c’est loin d’être le cas. De son œuvre, c’est surtout la question des merveilles naturelles que retient le lectorat français, et si cela nous éloigne un temps de la physique, la singularité du cas Cardan mérite d’être évoquée. Cardan, d’abord, est reconnu comme une autorité scientifique. On en trouve un exemple avec l’usage qu’en fait Bernard Palissy dans son Discours admirables de la nature des eaux et fontaines, tant naturelles qu’artificielles, des metaux, des sels et salines, des pierres, des terres, du feu et des emaux48, où il l’attaque sur la question des fossiles :
J’ay veu autrefois un livre que Cardan avoit fait imprimer des subtilitez, où il traite de la cause pourquoy il se trouve grand nombre de coquilles petrifiées jusques au sommet des montages et mesme dans les rochers : je fus fort aise de voir une faute si lourde pour avoir occasion de contredire un homme tant estimé49.
Mais c’est surtout comme pourvoyeur d’anecdotes merveilleuses qu’il est utilisé, sur un mode qui n’a plus rien à voir avec le destin textuel de Contarini. Significativement, par exemple, Pierre Boaistuau puise dans Cardan, sans aucune considération de sa pensée générale ni de son système physique, comme dans un réservoir de formes brèves à transposer. Dans le Theatre du monde, ainsi, on trouve, deux ans après la traduction française du De subtilitate, de nombreux emprunts, parfois référencés sur des questions variées (transmission du strabisme de la nourrice à l’enfant, cas historiques de « pestilences », description de la « peste » en Angleterre – en réalité, la suette anglaise). C’est Cardan encore qu’il utilise sur la question des poisons, en une réécriture manifeste :
Boaistuau —… ce qu’il appelle Marmacica, lequel est si contagieux que la pesanteur d’un grain
de bled, faict mourir l’homme en un moment : et se vendoit cent escuz l’once, et autant
de tribut en payloit celuy qui l’achaptoit, encores avoient ilz ceste consideration, de les
faire jurer qu’ilz n’en useroient point en leu province. (p. 193)
Cardan —… Marmarica, duquel le poids qui est un grain de blé, fait incontinent mourir l’homme,
et dix hommes en la quatriesme partie d’une heure, tant est grande sa force mortelle.
L’once en est venduë cent escus, on paye autant de tribut qu’il est achepté. Celuy qui
l’achepte jure qu’il n’en usera point en sa province. (f. 66r°)
Mais, fait significatif, c’est surtout dans les Histoires prodigieuses que Boaistuau l’exploite explicitement :
Hierosme Cardan écrit qu’un medecin empirique de Tours appelé Laurentius Grascus avoit de ceste pierre, et promettoit par le moyen d’icelle de penetrer tout la chair sans douleur, ce que le dict Cardan pensoit estre fabuleux, jusques à ce qu’il en eust faict l’experience…
Hiéronyus Cardanus livre sixieme de subtilitate, écrit une histoire prodigieuse, et quasi repugnante à nature, mais par ce qu’en la presence de tous les citoyens d’une cité l’experience en as esté veuë, cela la rend et probable, et croyable. Lors (dit-il) que j’escrivois mon œuvre des subtiles inventions, je veiz un quidam à Milan, lequel lavoit ses mains et sa face de Plomb fondu, …
Hierosme Cardan, lequel merite d’estre mis au premier reng de tous les plus celebres philosophes de nostre temps, racompte presque une semblable histoire de ces espritz malings…
Je n’ignore point semblablement qu’il n’y en ait plusieurs autres qui ont asseuré par leurs écritz qu’il y avoit des espritz familiers, qui conversoient avec les hommes : ce que Cardan atteste de son père Facius Cardanus…50.
Le De subtilitate, qui aurait pu connaître de tout autres utilisations, comme en témoigne la querelle avec Scaliger, est ainsi transformé en simple réservoir de faits merveilleux. Si par exemple Ambroise Paré le cite de manière logique dans son livre sur les monstres, à propos de la naissance d’un enfant « demi-chien », il en profite pour mentionner à son tour l’anecdote déjà reprise par Boaistuau de l’homme qui se lave les mains dans du plomb fondu et invoque aussi Cardan au sujet de l’existence du Manucodiata. Contarini et Cardan incarnent ainsi deux modèles absolument opposés de circulation d’un savoir de la nature, d’abord exprimé en latin, dans la culture vernaculaire française.
La traduction
Je voudrais dire pour finir quelques mots (trop rapides) des deux traductions qui me semblent intéressantes dans la perspective de la circulation littéraire des savoirs, celle des Dialogues sur la philosophie naturelle de Brucioli, et celle de la Sphère de Piccolomini. Ces deux traductions ont en effet pour point commun d’être des traductions de l’italien, et non du latin comme celle de Cardan, et elles sont aussi beaucoup plus soignées. Or il y a là un point important : on ne traduit pas simplement un contenu, mais aussi un modèle littéraire. Les Dialogues de Brucioli comme la Sphère de Piccolomini sont en Italie des exemples types de vulgarisation réussie, conformes aux goûts des humanistes, des lettrés et des courtisans, comme le traité de Contarini était un modèle de vulgarisation latine élégante. Par ailleurs, coïncidence sans doute significative, ces deux seuls textes traduits de l’Italien semblent chacun venir combler un vide dans le paysage culturel français, mais précèdent en même temps chacun de très peu l’apparition de ce qui semble un équivalent français, dont l’écriture était très certainement déjà engagée au moment de la parution de ces traductions. La Sphère de Piccolomini, ainsi, est traduite en 1550, or en 1551 paraît sous la plume du mathématicien français et lecteur du Collège Royal, Oronce Finé, La Sphere du monde, proprement ditte cosmographie […] comprenans la premiere partie de l’astronomie, & les principes universels de la geographie & hydrographie51, qu’il avait d’abord rédigée en latin et sur laquelle il travaillait depuis des années. La traduction de Brucioli précède quant à elle d’un an la publication du Premier Curieux (ou L’Univers) de Pontus de Tyard (1557). La traduction du texte de Brucioli, au moins, semble un indice que ce libraire engagé fortement dans la publication d’œuvres traitant de la nature qu’était Guillaume Rouillé, avait senti le besoin d’une vulgarisation en français dans ce domaine, vulgarisation dont l’Italie fournissait le modèle mais qui n’anticipait qu’à peine un mouvement français qui pouvait à son tour semblait imiter l’Italie. Or, malgré les apparences, il y a de vraies différences entre les productions françaises et les productions traduites de l’italien, et on peut de ce fait penser qu’il y a là la mise en circulation de deux manières différentes d’envisager la vulgarisation.
Commençons par la Sphère de Piccolomini, qui a été bien étudiée par Isabelle Pantin52. Sur la question de la vulgarisation des sciences, d’abord, Isabelle Pantin considère que la France n’imite pas l’Italie : « il est permis de penser qu’on soit simplement en face d’une sorte de parallélisme décalé : des phénomènes similaires, déclenchés par les mêmes causes, se seraient produits dans les deux pays à peu d’années de distance, sans que les interférences, l’émulation ou l’imitation aient eu besoin d’y jouer un rôle déterminant53 ». De fait, on peut observer que la vulgarisation italienne mise en circulation en France et la vulgarisation spécifiquement française ne se recoupent que très partiellement. Oronce Finé travaille surtout dans une perspective pratique, ce que l’on pourrait appeler une vulgarisation d’application : il vise à doter un lectorat qu’il définit lui-même comme constitué des « bons esprits naturelz tant de gentilz hommes bourgeois que mechaniques […] privez de la langue latine par le deffault de leurs parens54 » des connaissances nécessaires aux calculs astronomiques élémentaires. Il insère dans sa Sphere un dernier livre qui s’écarte nettement de la tradition et traite de cartographie et d’hydrographie, et l’on peut dire, suivant Isabelle Pantin, que son travail de vulgarisation cherche surtout ici « à former de véritables astronomes, ingénieurs ou géographes55 ».
Le traité de Piccolomini ne vise pas le même public et n’utilise pas les mêmes méthodes : il s’adresse à des lettrés, qu’il initie à l’astronomie sur un mode plaisant et qu’il incite à pratiquer les sciences en savants amateurs et non en professionnels ayant des besoins pratiques. Dans la lignée du programme des Infiammati, il s’agit de pourvoir ici à l’éducation savante de l’élite humaniste et l’on est dans le cadre d’une circulation du savoir « courtoise » et policée. La traduction de la Sfera, qui peut, de loin, paraître redondante par rapport au travail parallèle de Finé et donner l’impression d’avoir voulu le prendre de vitesse, répond donc en réalité à une autre préoccupation, plus conforme aux aspirations d’un humanisme de la cour et de la ville, raffiné et policé, dont il faut plutôt chercher l’équivalent du côté de la Pléiade. En revanche, si l’on suit les conclusions convaincantes d’Isabelle Pantin, c’est dans la rédaction plus tardive des Institutions astronomiques de Jean-Pierre de Mesmes56 que l’influence probable du modèle italien se fait sentir et qu’une vulgarisation d’un type similaire à celle produite par l’Italien apparaît dans le domaine de l’astronomie.
La traduction des Dialogues de Brucioli participe du même mouvement d’importation d’une vulgarisation policée des arides savoirs naturels. Elle est ornée d’un beau frontispice et se présente comme une édition soignée et prestigieuse, signe de l’importance que le libraire lui accorde. Elle a été manifestement faite par un fin italianisant (ainsi que le confirme Chiara Lastraioli, qui a examiné l’ouvrage57 ; la traduction est anonyme mais est attribuée à Jean Poldo d’Albenas), bien que le traducteur s’en défende, et il faut voir derrière cette édition la volonté du libraire, Guillaume Rouillé, ce qui confirme que Brucioli était apprécié des milieux lyonnais (mais peut-être pas très connu ailleurs)58. Selon Élise Rajchenbach-Teller, la publication chez Rouillé, en effet, est un signe :
Guillaume Rouillé se présente ainsi comme chaînon culturel : il est l’acteur privilégié d’une migration des textes. Il est celui qui rend disponibles des textes qui, par leur éloignement géographique et éventuellement à cause du mauvais travail de ses congénères – c’est-à-dire de son voisin Jean de Tournes –, n’étaient pas accessibles au public français. Dans certains cas toutefois, l’éloignement géographique n’est pas la seule raison qui interdise l’accès aux textes. La langue est un barrage que Guillaume Rouillé se pique d’abattre, par la translation, cet acte de faire passer d’une langue à l’autre, quand le translateur se fait passeur59.
Le paratexte confirme que le traducteur – demeuré anonyme – répond à la sollicitation du libraire. Rouillé est en effet connu pour être particulièrement intéressé par les savoirs de la nature, ainsi que tout ce que produit l’humanisme savant italien. Il entend, avec la traduction des Dialogues de Brucioli, combler un manque criant dans la culture française : le dialogue ne traite pas seulement de matières absentes des écrits humanistes vernaculaires, mais revêt aussi une forme différente du modèle pratiqué en France, liée à la forte identité italienne de l’officine de Rouillé et à sa volonté de faire entrer en France une culture humaniste typiquement italienne.
Tyard écrit surtout pour illustrer la langue française et opérer une forme de translatio studii, il se réclame de modèles antiques comme Apulée traduisant le De mondo aristotélicien ou Cicéron adaptant le Timée. Par ailleurs son dialogue fait entendre de manière dominante la voix du Curieux, qui transmet pour l’essentiel une doctrine aristotélicienne simplifiée, et largement appuyée sur le petit traité de Contarini. Le modèle de dialogue que propose Brucioli est en réalité assez différent. Le fond de l’information vient aussi d’Aristote et des universités, mais la forme est tout autre. Le contenu, en effet, est constitué d’un savoir aristotélicien plus poussé et qui intègre les débats scientifiques récents : les discussions sont plus savantes et ardues que chez Tyard. Le dialogue consacré à la Terre, par exemple, aborde la question de son mouvement pour le réfuter méthodiquement. Dans le même temps, Brucioli travaille à une mise en forme plus fouillée et plus originale que les dialogues français. Il met en scène des conversations scientifiques contenant de réels échanges, réalistes, où la confrontation des opinions est plus réelle et plus disputée que dans les dialogues français. L’ouvrage est fragmenté en vingt-cinq dialogues différents parfois très brefs, mais denses, portant chacun sur un point précis, et logiquement ordonnés (dans l’ordre : le monde, la nature, l’art, la matière première, les éléments, la Terre, etc.). L’œuvre est donc à la fois plus scientifiquement lisible que celle de Tyard, plus maniable, et d’une pédagogie plus efficace.
Elle est aussi toute différente sur le plan formel. Brucioli introduit en effet chaque dialogue de manière soignée, grâce une mise en scène de circonstances construites de manière à créer un fil fictionnel cohérent et naturel, qui fait que ses dialogues ressemblent beaucoup moins à des leçons ou à des avatars policés de dialogues maître/élève (Tyard se contente d’une fiction initiale de dialogue au jardin pour ensuite dérouler le propos en un flot rarement interrompu). Maura Felice a parfaitement décrit le mode de construction visant à produire cet effet de réel ou de naturel :
Les incipits reproduisent des moments vraisemblables, un des personnages arrive à réunion déjà commencée ; un autre n’arrive pas à tout suivre parce qu’il est loin de l’orateur de la dispute à laquelle est en train d’assister ; un autre encore se renseigne sur de nouveaux philosophes arrivés de loin en visite; d’autres manifestent leurs scrupules ou font des salamalecs avant de demander un avis ou se joindre à un groupe déjà formé ; on se rappelle de discussions laissées à moitié ou qu’on a évité expressément de porter à terme. Les conversations commencent parce qu’un des personnages a besoin de se renseigner chez un spécialiste avant de participer à une invitation pour dîner à thème, organisée par le Podestat de Padoue ; ou parce que c’est un fait de la vie réelle, comme par exemple une condition météorologique, à susciter la discussion60.
Enfin, Brucioli ne s’interdit pas une forme d’expansion personnelle poétique dans la description de certains phénomènes, et donne à ses dialogues un ton plus personnel.
Tous ces éléments font que la traduction des dialogues italiens, pas plus que celle de la Sfera de Piccolomini, n’entrent en réalité en concurrence avec les productions françaises. Dans les deux cas, et surtout Brucioli, on découvre une traduction extrêmement fidèle au texte originel, qui tente d’en restituer les nuances littéraires comme le caractère scientifique et respecte la démarche de l’auteur, un travail de traduction qui n’est donc pas une appropriation ou une imitation, comme c’est parfois le cas, mais le vrai cadeau à la culture française d’un modèle italien.
Si on considère maintenant l’ensemble de ces modalités de circulation des savoirs et des textes, que peut-on en conclure ? D’abord (et sans surprise), la forte prégnance des œuvres italiennes dans le domaine d’une vulgarisation de la philosophie naturelle en France, qu’elles aient été simplement lues ou imitées et intégrées à des œuvres françaises. Leur utilisation révèle que ces œuvres sont avant tout des modèles formels pour la littérature et la langue françaises, par l’orientation humaniste générale, la manière formelle et les choix lexicaux en latin aussi bien qu’en vulgaire. Le lectorat semble porter beaucoup moins d’intérêt au pouvoir subversif de certains de ces textes ou même à leur contenu philosophique que celui du XVIIe siècle.
Il est par ailleurs difficile de mesurer leur succès exact : si tout le monde a lu Cardan, qui a lu Brucioli ? Il apparaît comme un modèle surtout pour Rouillé, qui se veut passeur d’une culture à l’autre, mais s’il est traduit, il n’est guère repris (et on ne connaît aujourd’hui que cinq exemplaires survivants de la traduction lyonnaise, pourtant prestigieuse), alors que Contarini n’est pas traduit, mais est sans cesse cité et repris et semble d’ailleurs connaître un succès plus nettement français qu’italien. Si donc la France peut apparaître (plus nettement qu’en astronomie) en retard sur l’Italie pour la philosophie de la nature comme sa vulgarisation, elle intègre peu à peu les modèles italiens sans pour autant s’y inféoder servilement. La circulation de traductions permet justement à deux voies de vulgarisation, l’une italienne, l’autre française, de se compléter plutôt que de se concurrencer.
Notes
- Voir Paul F. Grendler, The Universities of the Italian Renaissance, Baltimore, J.H.U.P., 2011.
- Charles B. Schmitt, « The Rise of the Philosophical Textbook », dans Charles B. Schmitt, Quentin Skinner, Eckhard Kessler and Jill Kraye (dir.), The Cambridge History of Renaissance Philosophy, Cambridge, C. U. P., 1998, p. 792-804.
- Venise, Lucantonio II Giunta, 1571.
- De natura iuxta propria principia liber primus, et secundus, Rome, Antonio Baldo, 1565.
- De rerum natura iuxta propria principia. Libri IX, Naples, Orazio Salviani, 1586.
- Nova de universis philosophia in qua aristotelica methodo, non per motum, sed per lucem et lumina, ad primam causam ascenditur, Ferrare, Benedetto Mammarello, 1591.
- Tractationum philosophicarum tomus unus, in quo continentur: I. Philippi Mocenici, Veneti, Universalium institutionum ad hominum perfectionem, quatenus industria pararipotest, contemplationes V. II. Andreæ Cæsalpini, Aretini, Quæstionum peripateticarum libri V. III. Bernardini Telesii, Consentini, De rerum natura juxta propria principia libri IX, Genève, Eustache Vignon, 1588.
- De subtilitate, Nuremberg, Johannes Petreius, 1550, trad. Richard Le Blanc : Les livres intitulés de la subtilité et subtiles inventions, ensemble les causes occultes et raisons d’icelles, Paris, Guillaume Le Noir, 1556.
- Liber de situ elementorum. [De Situ terrarum. Argonautica, sive de Peregrinatione. Libellus de mari et aquis. De Fluviorum generibus], Bâle, Petrus Pernam, 1558. Publication posthume tardive, Il Galaeto est mort en 1517.
- De elementis et eorum mixtionibus libri quinque, Paris, Nicolas Le Riche, 1548.
- La prima parte della philosophia naturale, Venise, Giovanmaria Bonnello, 1552, La seconda parte delle philosophia naturale, Venise, Vincenzo Valgristo, 1554.
- Dialogi della naturale philosophia humana, Venise, Bartholomeo Zanetti, 1537.
- Il existe en effet une différence importante entre la réception du XVIe siècle et celle du XVIIe pour certains de ces auteurs, car au XVIIe les libertins s’emparent de Cardan ou de Telesio pour remettre en cause le système théologique lié à l’Aristote chrétien. Voir pour Cardan l’article d’Étienne Wolff, « Les lecteurs de Jérôme Cardan : quelques éléments pour servir à l’histoire de la réception de son œuvre », Nouvelle Revue du XVIe siècle, n°9, 1991, p. 91-107.
- Du Bartas, La Sepmaine ou Creation du monde, tome II, L’Indice de Simon Goulard, éd. Y. Bellenger, Paris, Classiques Garnier, 2011, p. 164.
- Universæ naturæ theatrum, Lyon, Jacques Roussin, 1596 ; Le Theatre de la nature universelle […] traduict du Latin par M. François de Fougerolles, Lyon, Jean Pillehotte, 1597.
- In quatuor libros Aristotelis Meteorologicorum commentarii, Paris, Michel de Vascosan, 1556.
- Universæ naturæ brevis descriptio ex Aristotele, Paris, Thomas Richard, 1557.
- Pontus de Tyard, Le Premier Curieux, dansJean Céard (dir.), Œuvres complètes, IV, 1, Paris, Classiques Garnier, 2010.
- Voir Jean de Champaignac, Physique françoise expliquant universellement la cognoissance de toutes choses naturelles, Bordeaux, Simon Millanges, 1595 et Scipion Dupleix, La Physique, Paris, Veuve Salis et Laurent Sonnius, 1603.
- Publié dans I dialogi di Messer Speron Sperone, Venise, Fils d’Aldo Manuzio, 1542.
- Les Dialogues de messire Speron Sperone, italien, traduitz en françoys par Claude Gruget, Paris, Jean Longis, 1551, f. 162ro-163vo. Édition électronique : transcription d’après l’exemplaire de la Médiathèque de Poitiers. Transcription P. Martin, révision I. Hersant, version html M.-L. Demonet. URL : http://xtf.bvh.univ-tours.fr/xtf/data/html/B861946101_D3775_1/B861946101_D3775_1.html (consulté le 2 novembre 2020)
- Trattato della sphera, nel quale si dimostrano, e insegnano i principii della astrologia raccolto da Giovanni di Sacrobusto, e altri astronomi, et tradotto in lingua italiana per Antonio Brucioli e con nuove annotationi in piu luoghi dichiarato, Venise, Francesco Brucioli e i frategli, 1543.
- Voir sur ce point sa notice dans la version 2015 du Dizionario Biografico degli Italiani.
- Venise, [s.n.],1540.
- Venise, Giordano Ziletti, 1558.
- Alexandri Aphrodisiensis […] In quatuor libros meteorologicorum Aristotelis commentatio […] quam latinitate donavit Alexander Piccolomineus Accedit insuper ejusdem Alexandri Piccolominei Tractatus de iride noviter impressus in quo quamplurima tum Aristo [telis] tum etiam Alexandri et Olympiodori dicta dilucidantur, Venise, Girolamo Scotto, 1540.
- Lyon, Guillaume Rouillé, 1556.
- La sphere du monde, composée par Alexandre Piccolomini gentilhomme italien, en si grãde facilité, que chacun ayãt les principes ci apres mis, pourra le tout facilement entendre : traduitte de tuscan en françois par Jacques Goupyl […], Paris, Guillaume Cavellat, 1550 ; Sphere du monde […] Plus un Discours de la terre & de l’eau, fait par ledit Picolomini, traduict nouvellement en françois par Jacques Martin, piedmontois […], Paris, Denise Cavellat, 1608.
- Signe caractéristique des centres d’intérêt français, son Éthique est traduite, ainsi que la Raphaella : La philosophie et institution morale du seigneur Alexandre Piccolomini. Mise en francois, par Pierre de Larivey Champenois, Paris, Abel L’Angelier, 1581. Instruction pour les jeunes dames, [s.l.], 1572, publiée également sous le titre Dialogues et devis des damoiselles pour les rendre vertueuses et bienheureuses en la vraye et parfaicte amitié, Paris, Vincent Norment, 1581.
- Voir notre étude : « L’influence de Lucrèce sur les théories des éléments à la Renaissance : concepts et représentations », Franck Lestringant et Emmanuel Naya (dir.), La Renaissance de Lucrèce, Cahiers Saulnier, n°27, Paris, PUPS, 2010, p. 97-112.
- Jean-Antoine de Baïf, Le premier des Meteores, Paris, Robert Estienne, 1567 et éd. G. Demerson, dans Le premier livre des poèmes, Grenoble, P.U.G., 1975. Demerson signale un emprunt à Contarini en particulier pour les vers 769 sq.
- Éd. cit, p. 118 et 147.
- Le Théâtre du Monde (1558), éd. M. Simonin, Genève, Droz, 1981, p. 197.
- Paris, Vincent Sertenas, 1560, p. 58.
- Paris, Jacques du Puys, 1567, ici f. 16v°.
- Ibid., ici f. 30r°.
- Traicté de la vérité des causes et effects : des divers cours, mouuements, flux, reflux, & saleure de la mer Océane, mer Méditerranée et autres mers de la terre, Paris, Jacques Rezé, 1600.
- Ibid., p. 19.
- Ibid., p. 52-53.
- Ibid., respectivement p. 76-84, p. 218-239 et 310-316.
- Ibid., p. 218.
- Encore par exemple p. 102, « le grand Cardinal Gaspard Contaren », où il côtoie Clavius, Jean Bodin, Aristote, les Conimbricenses, Jean de Sacrobosco…, dont aucun à part lui n’est grand. Il est « grand », p. 111, 157, 158, 218, etc. Notons cependant qu’Aristote lui aussi est « grand », un peu plus loin dans le livre (p. 153), et reçoit le titre de « prince des philosophes » (p. 156), l’honneur est sauf.
- Voir Gasparo Contarini : Venice, Rome, and Reform, Berkeley et Los Angeles, U.C.P., 1993, p. 86-87.
- Vol. 5, New York, C.U.P et London, O.U.P, 1941, p. 555-556.
- Paris, Matthieu David, 1558.
- Exotericarum exercitationum liber quintus decimus, de subtilitate, ad Hieronymum Cardanum, Paris, Michel de Vascosan, 1557.
- Paris, Martin Le Jeune, 1580.
- Éd. cit., p. 211.
- Histoires prodigieuses, respectivement : f. 50-51, 28, 114v° et 116r°.
- Paris, Michel de Vascosan, 1551.
- Voir « Alessandro Piccolomini en France : la question de la langue scientifique et l’évolution du genre du traité de la sphère », dans Alfredo Perifano (dir.), La Réception des écrits philosophiques, scientifiques et techniques italiens en France à la Renaissance, Paris, Presses de l’Université Paris III, 2000, p. 9-28.
- Ibid., p. 9.
- Oronce Finé, La Theorique des cielz, mouvements et termes practiques des sept planetes, Paris, Simon Dubois, 1528, ici f. 3ro.
- Art. cit., p. 15.
- Paris, Michel de Vascosan, 1557.
- Chiara Lastraioli, « Brucioli sconosciuto : de certaines traductions françaises des Dialogi et d’un manuscrit inconnu », dans Élise Boillet (dir.), Antonio Brucioli. Humanisme et évangélisme entre Réforme et Contre-Réforme, Paris, Champion, 2008, p. 147-173.
- Voir ici en particulier le rôle joué par l’anti-italianisme des milieux français : Jean Balsamo, Les Rencontres des muses (Italianisme et antiitalianisme dans les Lettres françaises de la fin du XVIe siècle), Genève, Slatkine, 1992 ; et du même, « Traduction de l’Italien et transmission des savoirs : le débat des années 1575 », dans Violaine Giacomotto-Charra et Christine Silvi (dir.), Lire, choisir, écrire : la vulgarisation des savoirs du Moyen Âge à la Renaissance, Paris, École des chartes, 2014, p. 97-107.
- « De « ceux qui de leur pouvoir aydent et favorisent au publiq » Guillaume Rouillé, libraire à Lyon », dans Christine Bénévent, Anne Charon, Isabelle Diu et Magali Vène (dir.), Passeurs de textes. Imprimeurs et libraires à l’âge de l’humanisme, Paris, École des chartes, 2012, p. 99-116.
- La Science en dialogue dans l’Europe de la Renaissance. Une enquête autour des dialogues scientifiques du XVIe siècle en langue vernaculaire, thèse soutenue à l’Université de Bologne, 2016, p. 115-116.