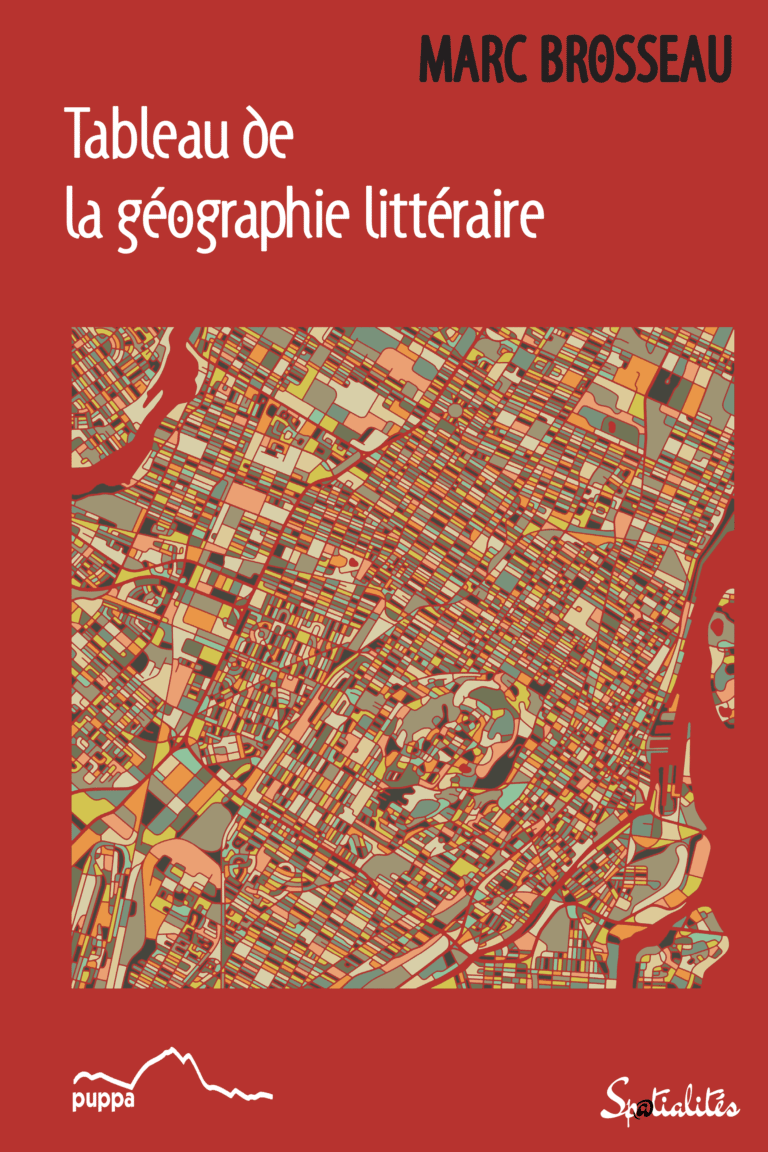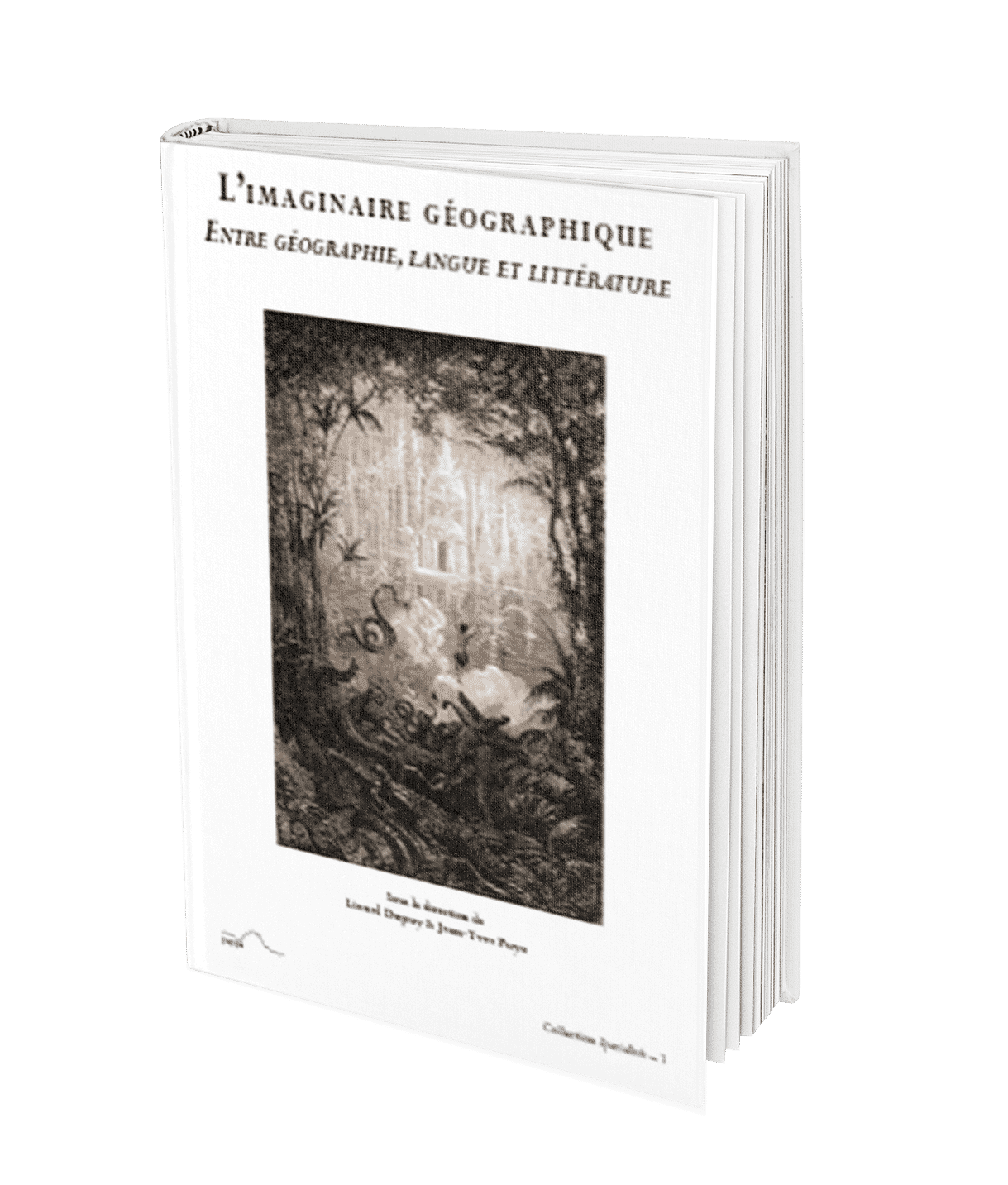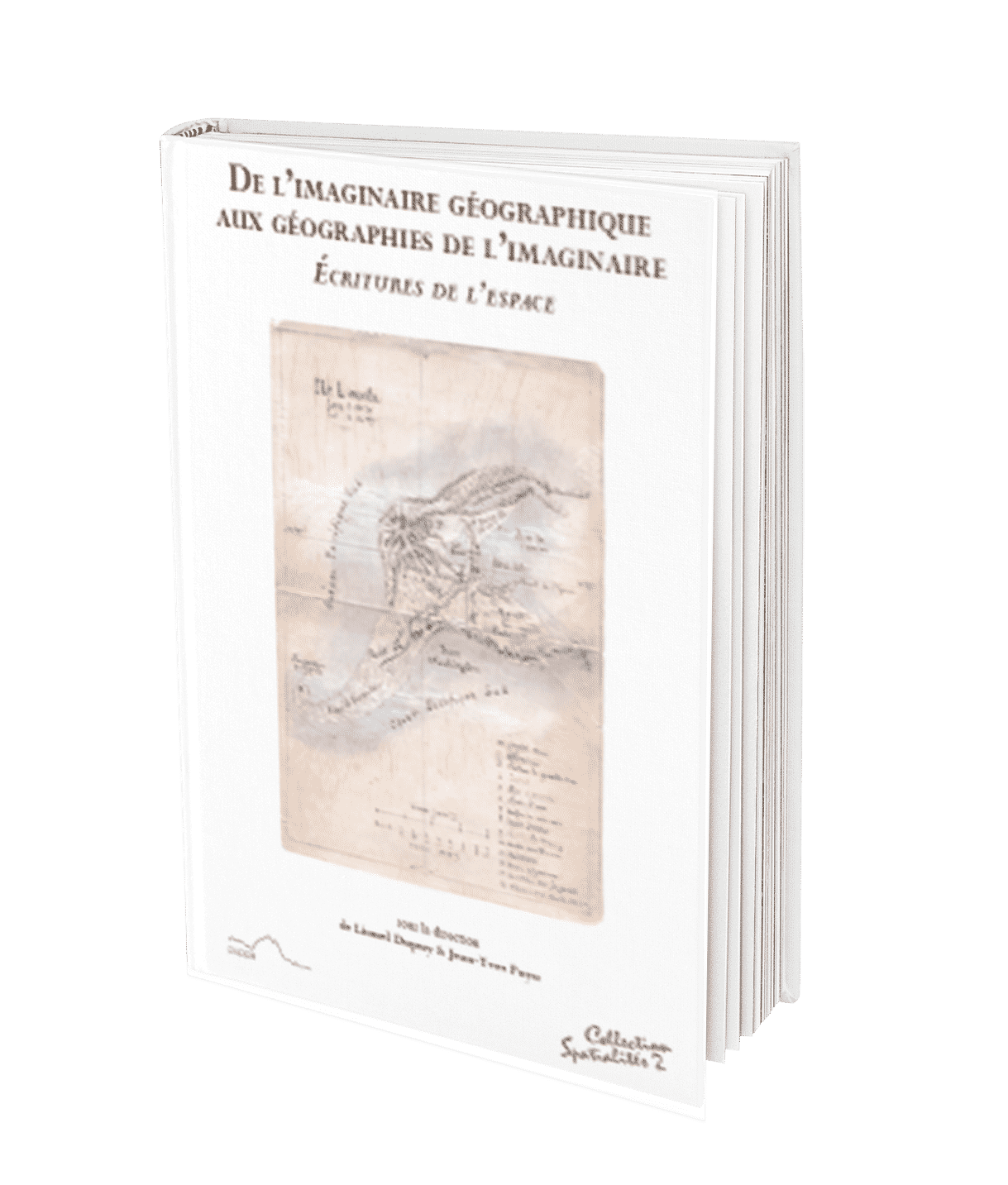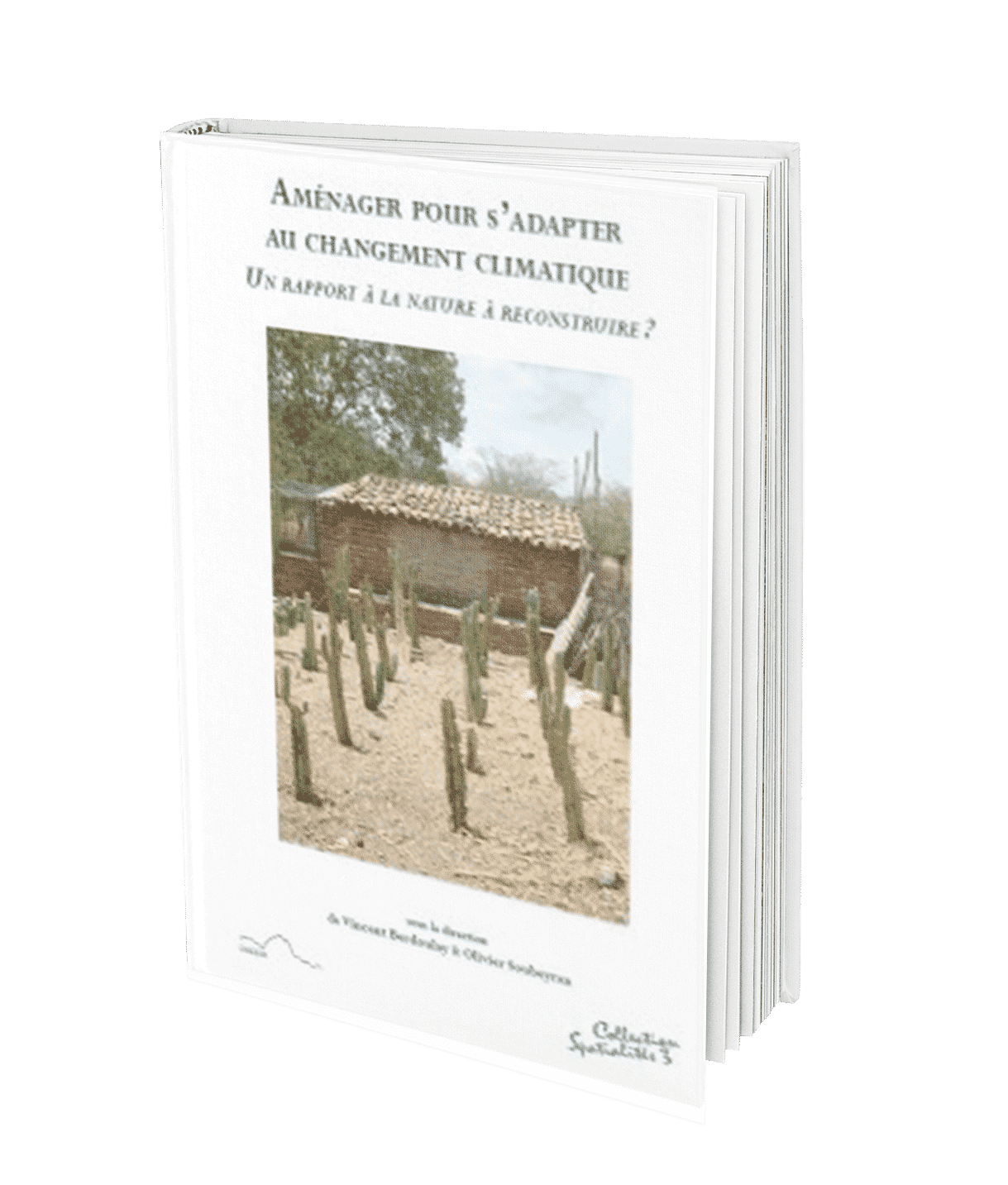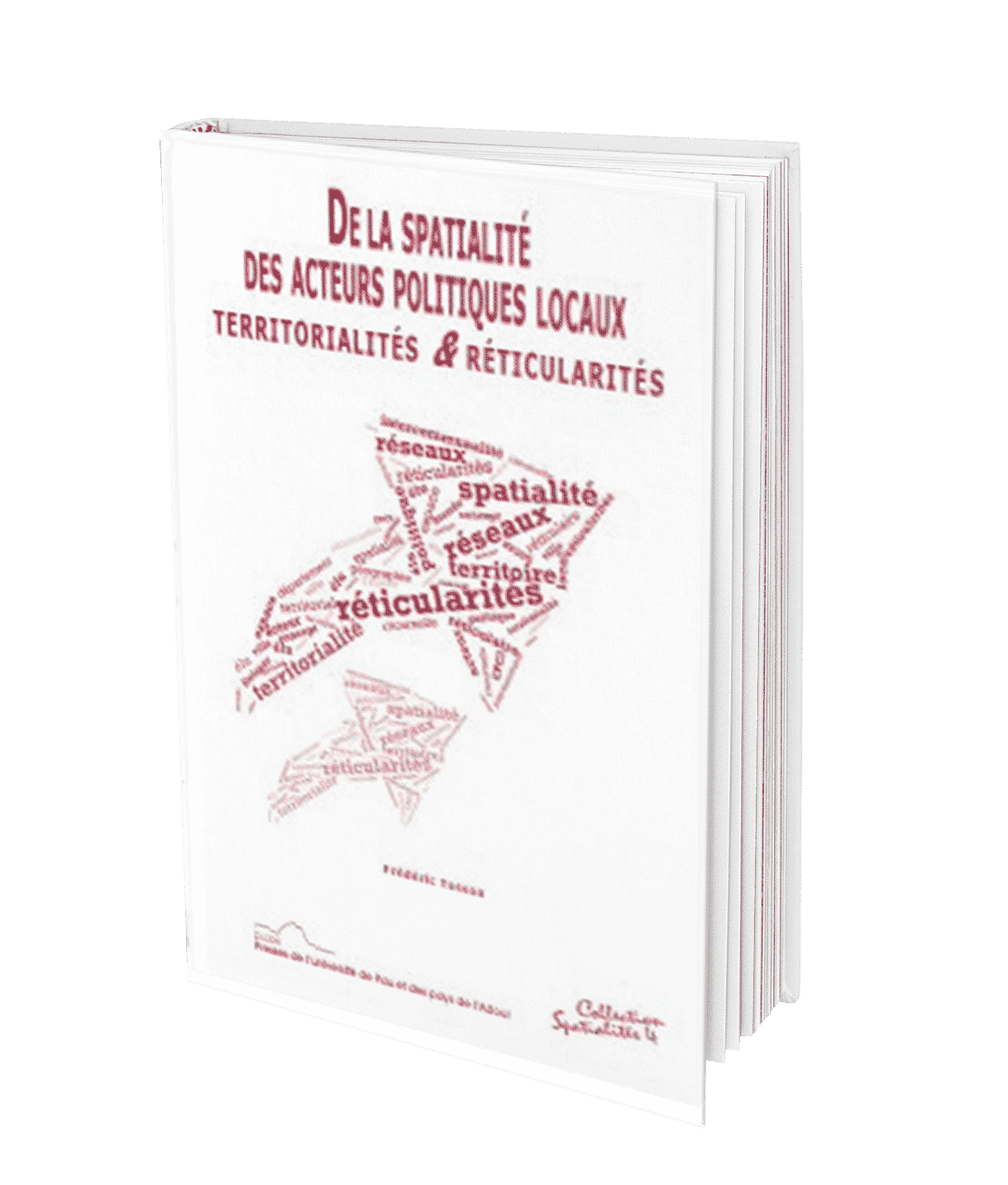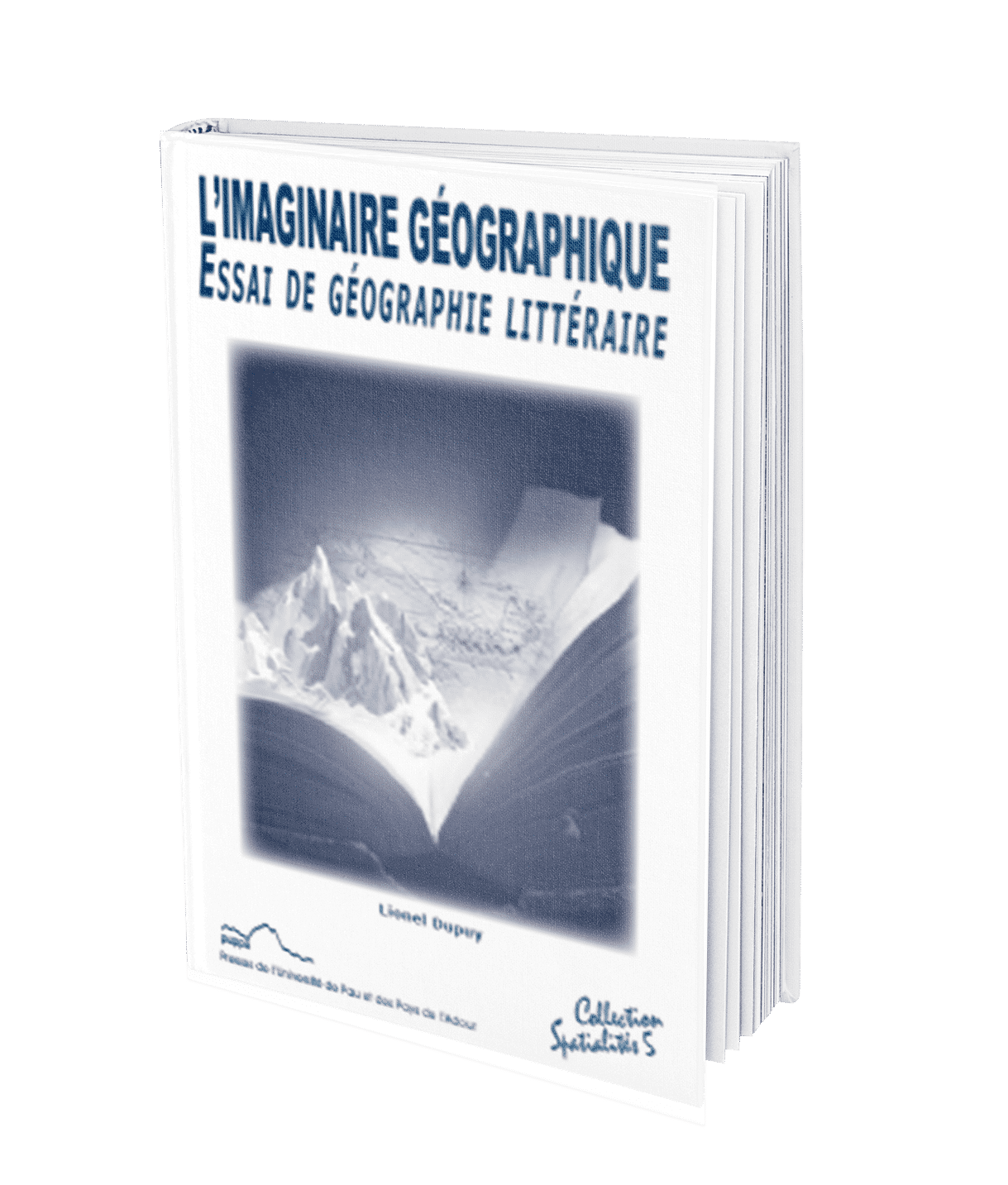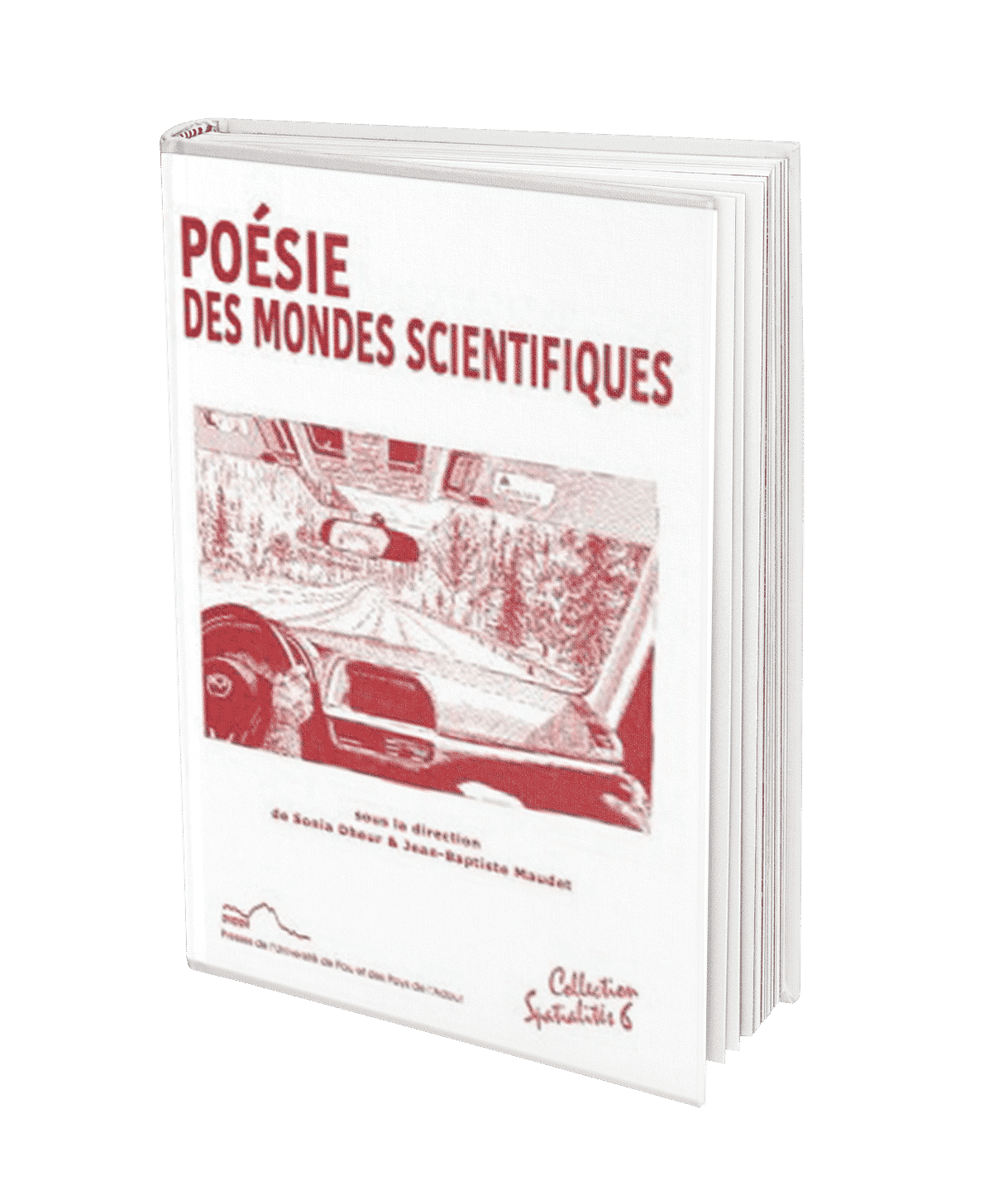Depuis le milieu des années 1980, les géographes s’interrogent sur le sens, la légitimité et les implications de la postmodernité. On peut y lire des enjeux très divers : nouvelles conditions socio-économiques qui bousculent les rapports sociaux et leur emprise territoriale ; nouvel ensemble de valeurs qui entraine une fragmentation de l’espace social en fonction de formations culturelles plus autonomes ; critique, sur le plan du savoir, du rôle dominant de la raison et des métarécits théoriques dans leur prétention de rendre compte de la réalité dans son ensemble ; ironie, surfiction, esthétique de la citation dans les domaines artistiques. Rupture radicale, mutation progressive, épuisement ou simple prolongement de la modernité, le débat s’est prolongé au courant des années 1990, pour enfin perdre un peu de vigueur à l’arrivée du millénaire actuel (Staszak, 2001).
Certains parlent d’un processus de « postmodernisation » de la géographie (Smith, 1987). Ce processus s’élabore en effet à la faveur de la consultation assidue de nombreux auteurs français qui incarnent pour la géographie anglo-saxonne le corpus incontournable du postmodernisme : Barthes, Beaudrillard, Deleuze, Derrida, Foucault, Lefebvre, Lacan ou Lyotard (Staszak, 2001). Quel sens faut-il donner à un tel processus ? Ladite postmodernisation se réfère-t-elle à un réaménagement interne des fondements épistémologiques de la discipline qui conditionne un autre regard sur le monde ou, plus prosaïquement, se rapporte-t-elle à des changements sociaux, économiques et politiques qui attirent l’attention des géographes sur de nouvelles réalités ? Ces deux options, qui ne sont pas mutuellement exclusives, donnent quand même le ton : ou bien la géographie, du moins certains travaux de géographes, se fait postmoderne de l’intérieur (ce qu’il est convenu de désigner comme le postmodernisme), ou bien la géographie s’interroge sur les conséquences de conditions économiques, sociales et politiques externes – bien qu’elle soit aussi affectée par elle – selon un mode d’investigation qui, lui, demeure relativement inchangé (ce qu’on étudie alors sont les effets de la postmodernité). Le postmodernisme en géographie, et notamment le relativisme culturel et épistémologique (refus d’une hiérarchie des savoirs qui pose la science en position de surplomb) dont il s’est fait le promoteur – sert de toile de fond au renouvellement de la géographie culturelle désormais investie d’une mission plus large et politisée comme les nombreux exemples examinés au chapitre précédent en témoignent. Quoiqu’il en soit, ces transformations importantes ont contribué à donner à la géographie culturelle et à l’étude des représentations une pertinence renouvelée et, parallèlement, a attiré l’attention de nombreux géographes sur les dimensions discursives et sur la poétique de la recherche. Cela ne sera pas sans effet sur le rapport que la géographie entretiendra avec la littérature, ni sur les leçons qu’elle peut en tirer.
Nous verrons dans un premier temps comment la réflexion des géographes sur les modalités discursives de leur entreprise amorce au cours des années 1980 un certain tournant textuel qui informe les transformations à venir dans l’analyse géographique des textes littéraires. Ces transformations s’effectueront à la faveur d’une consultation plus intensive des travaux issues de la théorie littéraire de l’époque et du post-structuralisme ambiant dont il sera question dans un deuxième temps. Nous verrons ensuite comment ces développements ont servi de trame de fond à la proposition de passer d’une étude du contenu géographique des romans (romans géographiques) à une réflexion sur les multiples façons que les romans peuvent générer eux-mêmes une géographie alternative : c’est l’idée de roman-géographe autour de laquelle la troisième partie du chapitre est construite. L’intérêt d’un recours plus intensif à la théorie littéraire sera d’abord illustré par le détour d’une réflexion sur la description, ces moments du texte où les géographes ont longtemps cherché la matière spatiale du roman. En montrant que la description avait tout intérêt à être interprétée en relation avec les autres dimensions du récit, nous pourrons voir que c’est l’ensemble du roman qui génère sa géographie propre. Cet effort pour problématiser la description dans l’analyse géographique des textes sera suivi d’une réflexion plus large sur les stratégies et techniques narratives déployées dans deux romans urbains : New York, incarnation de la ville moderne au début du XXe siècle dans Manhattan Transfer de John Dos Passos (1925), et Toronto, incarnation de la ville multiculturelle au début du XXIe siècle dans Les désirs de la ville de Dionne Brand (2011). Enfin, nous suivrons dans un quatrième temps les développements plus récents de ce type de rapport à la littérature dans une section intitulée « Des Romans-géographes 2.0 ». Nous y verrons comment certains géographes poursuivent la réflexion sur la spécificité de la géographie qui s’écrit en littérature en mobilisant un ensemble différent, et plus contemporains, de travaux théoriques sur la littérature. Chemin faisant, se dessine un passage qui va d’une attention axée sur la textualité littéraire (dans ses dimensions plutôt formelles) à une réflexion davantage centrée sur le caractère fictionnel de mondes construit par la littérature.
Tournant textuel : la discursivité géographique
Sans prétendre que les géographes ne commencent à s’interroger au versant discursif de leur activité qu’au cours des années 1980, il est clair que la question gagne nettement en importance à partir de cette époque. Il serait faux de dire que tous les géographes entretenaient jusqu’alors un rapport naïf, bêtement instrumental, au langage. En revanche, il est clair que la question avait été jusqu’alors peu thématisée. Certes, les géographes de la tradition vidalienne ont discuté du rôle de la description (explicative, raisonnée, etc.) pour rendre compte de la réalité régionale, et les géographes anglo-saxons du recours à la formalisation mathématique – et donc d’une nouvelle rationalité discursive – pour assurer une nouvelle scientificité à la discipline au tournant des années 1960. Or la question n’est pas abordée sous l’angle du discours, en tout cas pas du discours « comme une pratique que nous imposons aux choses », pour emprunter la formulation de Michel Foucault (1971). À la fin des années 1970, le structuralisme aidant, en géographie comme dans plusieurs autres sciences sociales, la question du langage et du discours devient un objet de réflexion en tant que tel. Articles et ouvrages se multiplient.
On s’interroge sur le rôle actif du langage et du discours au sein de la géographie, tant pour en identifier les limites que pour en explorer le potentiel créatif. La philosophie du langage chez les uns, et analyses rhétoriques ou linguistiques chez les autres, sont mises à profit. L’attention portée au discours des sciences humaines nous indique qu’à bien des égards nos concepts et nos théories fonctionnent comme des métaphores pour les réalités qu’ils cherchent à recouvrir (Barnes et Duncan, 1992). La métaphore constitue en effet un important déclencheur de l’innovation en même temps qu’elle permet d’en transmettre la teneur cognitive (Berdoulay, 1982 ; 1988a). D’abord axée sur certaines figures rhétoriques isolées, la réflexion s’étend aux formes de discours ou aux genres que les géographes pratiquent (Claval, 1984 ; Fel 1988). Epistémologique dans ses visées premières (cerner, en termes discursifs, les limites de l’entreprise cognitive ou les conditions de la création de nouveaux savoirs), elle deviendra aussi l’occasion d’une réflexion historique (étude du langage et des formes utilisées à travers l’histoire). En somme, le discours devient une interface qui nous permet de problématiser le rapport aux réalités que nous étudions. Cela ouvre une brèche pour penser autrement le rapport que la géographie peut entretenir avec la littérature, le type de connaissance qu’elle peut en tirer et, chemin faisant, le terrain sur lequel la rencontre peut s’effectuer.
L’analyse du discours se déplace aussi à l’échelle du genre, niveau d’organisation plus complexe (Berdoulay, 1988a). Parce qu’il opère comme une institution, modelant règles d’écriture et horizons d’attente, le genre offre un angle d’analyse riche pour penser autrement l’histoire des idées : du manuel à la monographie en passant par l’article scientifique, on sent bien que les idées doivent s’ajuster aux conventions du genre. La pensée géographique s’inscrit ainsi dans un autre réseau d’idées, où les jeux du savoir, du contexte et des idéologies sont éclairés en fonction des contraintes propres aux genres. En mettant en lumière les contraintes formelles de la recherche, et en les posant en termes discursifs, l’analyse rhétorique attire ainsi l’attention sur les rôles du lecteur, soit en examinant les effets sur lui des stratégies textuelles mobilisées (lecture courtoise), ou en posant le texte et ses ambiguïtés comme la porte d’entrée d’un lecteur tout-puissant qui le transforme en simple pré-texte pour démonstration brillante (lecture symptomatique). Les motivations peuvent être nombreuses. Le texte, celui des géographes, et d’autres jugés porteurs de savoirs géographiques (toute une série de discours para ou proto-géographiques, discours d’urbanistes ou d’aménageurs, textes littéraires, etc.) peuvent ainsi être passés au crible. Cet intérêt pour les enjeux textuels constitue une activité principalement réflexive, posée sur les discours passés ou contemporains. En prenant le texte au sérieux, en lui imposant un régime de lecture plus sensible au langage dans sa chair et dans ses formes (régime de lecture que l’on pratique plus souvent avec des textes littéraires), ces travaux ont en quelque sorte attiré l’attention sur le lecteur dans sa fonction « co-créatrice » du texte.
La fin des années 1980 a été riche en réflexions sur ce type d’enjeux épistémologiques. Vincent Berdoulay valorisait la pluralité des formes de discours et la nécessité de ne pas « sous-estimer la force des modalités discursives mises en œuvre en géographie et, plus particulièrement, le besoin d’énoncer des théories générales » (Berdoulay, 1989, p. 32). Derek Gregory constatait, pour sa part, la relative pauvreté des formes discursives mobilisées par la géographie radicale : « when set alongside the variety of textual strategies encompassed by the contemporary novel… the conservative character of many of the most radical geographers is truly astonishing » (Gregory, 1989, p. 90)1. Chevalier, regrettait que la géographie française se soit « coupée du public en recourant au vocabulaire et aux méthodes des sciences physiques et humaines ». Il affirmait par ailleurs que « à la différence de l’histoire, la géographie a donc laissé le champ libre à diverses paragéographies : livres de voyage, périodiques à thèmes géographiques, domaine touristique, ouvrages géographiques réalisés par des non-géographes » (Chevalier, 1989, p. 5). Bien qu’il ne s’agisse certainement pas d’une réponse à l’invitation indirecte de Chevalier, Alain Reynaud annonçait dès l’année suivante la « naissance de l’essai géographique ». Dans le compte rendu conjoint des trois ouvrages de Brunet, Ferras et Berque, tous parus en 1990, il remarquait l’originalité de leur facture et de leur ton, de même que la fraîcheur de leur argumentation (Reynaud, 1990). Que l’on fasse la promotion d’une pluralisation des formes discursives ou que l’on dénonce leur relative pauvreté, on insiste sur le fait que l’expression de la pensée et de la connaissance géographiques, de même que le rapport plus pragmatique aux lecteurs, ne sont pas sans liens avec la forme des textes. C’est parfois même en comparant les genres géographiques et littéraires que ce rapport est mis en relief. En montrant que le langage est plus que l’habit de mots de la pensée, mais bien son matériau et son mode d’expression, en insistant sur le fait que les genres de discours sont plus que de simples conventions mais qu’ils servent à la fois de « modèles d’écriture » et « d’horizon d’attentes » (Todorov, 1978), ces réflexions rappellent aux géographes tout l’intérêt qu’il y a de prendre la forme au sérieux. La forme de leur propre discours, bien sûr, comme celui des textes littéraires qu’ils étudient. Et pour comprendre les rouages particuliers du discours littéraire, le détour par la théorie et la critique littéraires est impératif.
Les géographes ont appliqué un régime de lecture de type littéraire au discours géographique, avec des textes qui ne sont pas « constitutivement littéraires », avant de l’appliquer aux textes littéraires qui le sont. Les distinctions que suggère Gérard Genette (1991) entre littérarité « constitutive » et littérarité « conditionnelle » est ici révélatrice du chemin qui restait à parcourir en géographie littéraire au tournant des années 1990. Selon Genette, relèverait de la littérarité constitutive toute activité discursive pratiquée comme une activité à finalité esthétique telles la « fiction » et la « poésie ». D’autre part, tout texte qui ferait l’objet d’un investissement esthétique de la part du récepteur sans que la finalité en soit clairement esthétique, relèverait de la littérarité « conditionnelle ». Genette lie cette distinction à deux régimes esthétiques différents : régimes intentionnel et attentionnel où se recoupent donc les notions de création et de réception. Cela veut dire, par exemple, que rien ne nous empêche de lire le Tableau de la géographie de la France, de Vidal de la Blache, pour en tirer un plaisir esthétique, de mettre entre parenthèse sa fonction dénotative, de le lire donc, comme une œuvre littéraire. Seulement, il faut bien reconnaître que cet investissement esthétique est le propre du récepteur et non de l’intention de l’auteur, ni celle que porte le texte lui-même. Lorsque Jules Sion (1934) se penche sur l’art de la description chez Vidal, sur la puissance évocatrice de son utilisation du langage, son but est bel et bien de voir comment cet art particulier est mis au service de la dénotation. En revanche, il m’apparaît un peu plus surprenant ou problématique de négliger, comme l’ont fait les géographes pendant longtemps, la finalité esthétique d’un texte « constitutivement littéraire », de mettre entre parenthèses la fonction connotative de son utilisation du langage et l’importance des structures formelles ou de composition dans la production d’effets sémantiques inédits.
Prendre la littérature, en tant que littérature, au sérieux, commande ainsi une attention nettement plus grande à la fois à son utilisation des ressources du langage et au caractère fictionnel des mondes qu’elle construit (bref, sa littérarité constitutive). Tzvetan Todorov (1987) a d’ailleurs bien montré que le caractère poétique du langage littéraire est constamment associé, dans les définitions de la littérarité, à la nature fictionnelle du monde raconté. Que l’on cherche à saisir la spécificité de la littérature dans son utilisation du langage ou dans sa forme, on invoquera presque toujours, en cours de route, la fictionnalité du monde qu’elle met en scène. Inversement, si l’on insiste sur le caractère fictif, on se sentira obligé, devant la variété de rapports possibles entre monde « réel » et monde « fictif » que nous proposent les œuvres différentes, de revenir sur l’intransivité de la structure qui le génère.
La médiation de la théorie littéraire
En dépit de leurs différences fondamentales, les travaux effectués par les géographes jusqu’au milieu des années 1980 ont tous en commun de ne prêter au texte littéraire, à sa langue, ses formes, sa rhétorique, sa fictionnalité, bref sa littérarité, qu’une attention somme toute superficielle. Les faits géographiques y sont facilement repérés et isolés de leur cadre fictif, les témoignages des expériences des lieux consignés et souvent bien cernés dans des passages descriptifs précis, et ses dimensions sociales ou idéologiques à moitié fournies par un contexte de production préalablement reconstitué. Chaque face de ce triangle disciplinaire (faits, expérience, idéologie), qui résume (un peu vite bien sûr) la géographie humaine des années 1970 et 1980, cherchait pour ainsi dire dans « l’objet littéraire » des éléments susceptibles de conforter ses positions épistémologiques et idéologiques respectives. Discours et textualité ne faisaient pas partie intégrante du champ de leurs préoccupations dominantes. En un sens, on pourrait dire que chacune de ces approches entretenait un rapport instrumental à la littérature, lequel avait pour effet de la transformer en un objet relativement « docile » ou, dans les mots de Brian Robinson, un « prêt-à-porter » pour l’analyse géographique (« a ready-made source for the social science ») (Robinson, 1987, p. 192). À chaque fois, on sait exactement quoi chercher dans le texte (ou son contexte) et, à coup sûr, on le trouve. On ne cherche pas dans le roman matière à remettre en question ses schèmes d’analyse, ses prérogatives méthodologiques ou épistémologiques ni à s’ouvrir à de nouvelles questions ou de nouvelles façons de les poser. C’est en ce sens que l’on peut dire que, par un processus disciplinaire d’annexion tranquille, les géographes ont transformé les romans qu’ils étudiaient en documents géographiques. En proposant l’idée de « romans-géographes », nous le verrons bientôt, je cherchais précisément à éviter les écueils d’une pareille annexion méthodologique. Et c’est par les voies du dialogue que j’ai tenté de résoudre la tension.
L’intérêt d’une relation dialogique réside dans sa volonté de reconnaître l’autre en tant qu’autre (et donc le texte littéraire en tant que texte littéraire), c’est-à-dire le refus de le transformer en objet, de l’homologuer. À l’intérieur d’une telle relation, l’autre demeure sujet en quelque sorte. Todorov évoque trois types de relations critiques qui reposent sur autant de rapports à l’altérité :
« Le premier consiste à unifier au nom de soi : le critique se projette dans l’œuvre qu’il lit et tous les auteurs illustrent, ou exemplifient, sa propre pensée. Le second type correspond à la ‟critique d’identification” […] : le critique n’a pas d’identité propre, il n’existe qu’une seule identité : celle de l’auteur examiné, et le critique s’en fait le porte-parole ; nous assistons à une sorte de fusion dans l’extase, et donc encore à l’unification. Le troisième serait le dialogue préconisé par Bakhtine, où chacune des deux identités reste affirmée (il n’y a pas d’intégration ni d’identification), où la connaissance prend la forme d’un dialogue avec un ‟tu”, égal au ‟je” et pourtant différent de lui » (Todorov, 1981, p. 166).
On retrouve ce premier type de relation critique dans l’attitude répandue selon laquelle le roman pourrait servir à tester des hypothèses géographiques : on part du même pour mieux y revenir. On ne retient de l’autre que ce qui nous permet de confirmer notre idée de départ. Cela expose aussi les contradictions ponctuelles de la géographie humaniste dans son rapport à la littérature. Car en même temps qu’elle cherche à y « tester des hypothèses géographiques », elle vise à s’identifier à la conscience de l’œuvre dans sa façon d’exprimer un autre rapport au monde. Pour créer les conditions de possibilité d’une relation dialogique avec la littérature, sans la transformer en simples « données » pour l’analyser, ou s’y fondre pour mieux la comprendre, le recours à la théorie et la critique littéraires est essentiel, tant pour mettre en lumière les « rouages » sémiotiques du texte que les dimensions fictives des mondes qu’il génère.
Si, pendant longtemps, les géographes ont peu consulté la théorie littéraire, les théoriciens de la littérature préoccupés par l’espace littéraire n’ont pas plus consulté le savoir théorique géographique. L’absence de consultation mutuelle entre géographes et littéraires en matière d’espace romanesque était jusqu’alors assez nette sans être complète2. Les visées des uns et des autres étaient pour l’essentiel fort différentes. Le recours au texte littéraire par les géographes s’inscrivait d’abord et avant tout dans un effort pour mieux comprendre l’espace, les lieux et les rapports que les individus et groupes dans différents contextes entretiennent avec eux. Bref, et quel que soit le courant, il s’agit pour les géographes de mieux comprendre l’espace par l’entremise du texte littéraire. Chez les littéraires, l’espace comme tel n’est pas souvent un objet d’intérêt en soi. Il constitue davantage une catégorie d’analyse qui, avec d’autres, permet de mieux comprendre ou bien le texte et son fonctionnement, ou encore certaines dimensions culturelles ou idéologiques d’une œuvre et d’un auteur. Bref, il convient ici de mieux comprendre le texte (une œuvre ou un auteur) par l’entremise de l’espace. Aussi, pourrait-on dire que pour les géographes, l’intérêt de l’espace romanesque réside dans ce qu’il peut nous apprendre sur le monde extérieur (en termes de faits, d’expérience ou de perception) ou en tant que révélateur des tensions dont il fait l’objet dans le monde social. En cela, les géographes n’ont jamais entièrement abandonné la référence – même oblique – au monde extérieur, comme ont pu le faire plusieurs littéraires (voir Compagnon, 1998, chap. 3). Chez les littéraires, et en particulier chez les théoriciens de la littérature, l’espace est considéré comme une catégorie interne du discours qu’il faut mettre en relation avec les autres instances du récit. Chez les uns, on se penche sur l’espace pour comprendre le texte, chez les autres on se penche sur le texte pour comprendre l’espace. Bien qu’un peu caricaturale, cette formule résume la situation qui a longtemps prévalu et explique en partie pourquoi la consultation a été si lente à venir et qu’elle tarde encore à le faire (Hones, 2008). Or, pour l’essentiel, même lorsqu’elles opèrent sur un terrain commun, les traditions et cultures disciplinaires différentes informent des pratiques de lecture et d’écriture davantage parallèles qu’authentiquement partagées (Brosseau et Cambron, 2003).
Les travaux des géographes que sollicite la théorie littéraire ne relèvent pas souvent de la géographie littéraire comme telle, mais bien de ceux de la géographie humaine plus théorique. Je pense notamment aux références fréquentes à David Harvey, Edward Soja et Doreen Massey pour leur théorisation de l’espace et de la spatialité ou encore à ceux de Yi Fu Tuan et Edward Relph sur les distinctions entre lieu, espace et non-lieu (place, space et placelessness). Inversement, la théorie littéraire dont s’inspirent les géographes qui travaillent sur la littérature n’est pas celle qui emprunte aux théories géographiques (narratologie, sémiotique, stylistique par exemple). Pour l’essentiel, les littéraires qui le font s’inspirent des théoriciens de la géographie (Tally, 2013) et les géographes des théoriciens de la littérature. Bref, il y a bel et bien échange interdisciplinaire, mais ce sont rarement les mêmes auteurs qui y participent. Il faudra attendre le tournant des années 2000 pour qu’un véritable processus d’inter-fécondation entre géographie et critique se mette en marche à la faveur, cette fois, de l’émergence la géocritique sous l’impulsion de Bertrand Westphal (2000 ; 2007), de la géopoétique de Kenneth White (1994) et des ateliers qui s’inscrivent dans son sillon (voir Bouvet 2015 par ex.), d’une géographie littéraire pratiquée par les littéraires eux-mêmes (Collot, 2014) ou encore, plus largement, de ce qu’on a appelé tout récemment les spatial literary studies (Tally, 2017 ; Hones, 2018).
Les approches examinées au chapitre 1 ont peu mobilisé les outils d’analyse ou le savoir-faire de la théorie littéraire. Les travaux des géographes préoccupés par la valeur documentaire de la littérature ont parfois trouvé dans l’histoire littéraire classique ou les approches biographiques de quoi conforter leurs interprétations. Les emprunts à la critique littéraire des géographes humanistes, pour leur part, seront peu nombreux au départ. D’abord soucieux de restaurer le sujet (créativité, subjectivité, valeurs, etc.) au sein de la discipline, les géographes humanistes ont plutôt cherché appui chez les philosophes des traditions phénoménologique, existentialiste ou herméneutique. Ils ont en fait très peu consulté (ou cité tout au moins) les travaux issus de la théorie littéraire. En pleine ferveur structuraliste, il est vrai qu’une bonne portion de la théorie littéraire du moment (narratologie, sémiologie, etc.) n’aurait été d’aucun secours, c’est le moins qu’on puisse dire, pour préconiser une restauration du sujet, de la conscience et d’une conception conquérante de l’imaginaire3. En effet, si la critique fut parfois sollicitée, c’est bien une critique de l’imaginaire, dans la foulée des travaux de Bachelard, dont La poétique de l’espace fait figure d’incontournable. Les géographes radicaux ont pour leur part, lorsqu’ils y ont eu recours de façon explicite, mobilisé les penseurs de l’esthétique marxiste ou néomarxiste tels Lukacs ou Marcuse. Les choses se mettront à changer au cours des années 1990 à la faveur du tournant culturel et de l’introduction progressive en géographie littéraire des approches inspirées des cultural studies britanniques et des études postcoloniales, ces dernières ayant mobilisé, nous l’avons vu, certains des enseignements de la critique déconstructionniste. Mais retournons pour l’instant à la fin des années 1980, à l’époque où la question de la discursivité commençait aussi à interpeller les géographes s’intéressant à la littérature.
Du roman géographique aux romans-géographes
« Un par un, le roman a découvert, à sa propre façon, par sa propre logique, les différents aspects de l’existence : avec les contemporains de Cervantès, il se demande ce qu’est l’aventure ; avec Samuels Richardson, il commence à examiner ‟ce qui se passe à l’intérieur”, à dévoiler la vie secrète des sentiments ; avec Balzac, il découvre l’enracinement de l’homme dans l’Histoire ; avec Flaubert, il explore la terra jusqu’alors incognita du quotidien ; avec Tolstoï, il se penche sur l’intervention de l’irrationnel dans les décisions et le comportement humain. Il sonde le temps ; l’insaisissable moment passé avec Marcel Proust ; l’insaisissable moment présent avec James Joyce. Il interroge, avec Thomas Mann, le rôle des mythes qui, venus du fond des temps, téléguident nos pas. Et cætera, et cætera » (Kundera, 1986, p. 86).
Parmi les premiers, Stephen Daniels (1985) a dénoncé le peu d’attention portée aux conventions littéraires et à leur importance pour comprendre la nature du monde représenté dans la littérature. Robinson insiste de son côté sur le caractère instrumental du recours à la géographie et le peu de sensibilité à ce que la littérature exprime de différent sur l’espace et les lieux. Il fut un des premiers, sinon le premier géographe, à se pencher sur la littérature moderniste du XXe siècle et à y explorer le caractère souvent fragmenté de l’espace représenté (Robinson, 1977 et 1987). Dans le même esprit, Richard Lafaille (1989) explique le mépris des géographes pour la littérature moderne par leur attachement farouche au primat de la communication, lui-même révélateur d’un désir de langage référentiel communiquant transitivement une relation au monde, non au texte. Ces rares travaux, de concert avec le nombre grandissant de réflexions sur les dimensions proprement discursives de la géographie ont constitué un terreau fertile pour penser autrement la façon d’aborder le texte littéraire et les outils pour le faire.
C’est en prenant acte de ces constats que j’ai tenté d’explorer les géographies alternatives qui s’expriment dans le roman. Fort de l’idée selon laquelle le roman, grâce à sa grande capacité d’intégrer différents genres de discours et formes de savoir, mobilise « tous les moyens intellectuels et toutes les formes poétiques pour éclairer ‟ce que seul le roman peut découvrir” » (Kundera, 1986, p. 86), j’ai cherché à mettre en lumière ce que le roman, en tant que « forme qui cherche », pouvait découvrir de nouveau en matière d’espace et de lieux. Ce travail m’a conduit à lancer l’idée de romans-géographes qui, pris un à un, génèrent des géographies bien différentes de celles auxquelles les géographes sont habitués, et dont la nouveauté réside en bonne partie dans l’utilisation particulière que ces romans font du langage, dans sa chair et dans ses formes (Brosseau, 1996). Pour installer ce trait d’union entre géographie et roman, la critique et la théorie littéraires ont été absolument nécessaires. Narratologie, sémiologie, théories de la description, théories des genres (en particulier Bakhtine et son idée de chronotope), poétiques du récit et rhétorique furent sollicitées pour montrer en quoi la spécificité de la géographie romanesque était liée à la forme. En bout de ligne, j’ai essayé de convaincre mes collègues géographes de l’importance de prendre la forme au sérieux et, dans cette voie, à quel point la théorie littéraire était incontournable. On en verra ici une première manifestation en se penchant sur la description, portion du texte par excellence qui contribue à l’inscription de l’espace dans le récit. C’est une première façon d’illustrer l’idée de roman-géographe : la teneur géographique des descriptions de l’espace est mieux comprise lorsqu’on les met en relation dynamique avec les autres dimensions du roman.
Problématiser la description
De façon générale, quand les géographes font l’analyse de textes littéraires, ils ont tendance à concentrer leurs efforts sur les passages descriptifs. Dans les trois premières traditions de la géographie littéraire, l’attention portée sur la description s’avère facile à expliquer. La première tradition considère le texte littéraire comme un reflet de la réalité géographique dans un souci documentaire (Darby, 1948 ; Watson, 1965 ; Gilbert, 1972). Le travail consiste pour l’essentiel à vérifier l’exactitude de la description des lieux, respect des formes et des particularités du paysage et des traces de la présence humaine qu’ils contiennent. Le reste – la narration, l’intrigue, les personnages, la composition, etc. – ne recèle que fiction pure et n’offre qu’un intérêt secondaire pour une lecture sérieuse des faits. Moins préoccupée par les faits géographiques en tant que tels, mais bien par le sens des lieux ou l’expérience subjective qu’on en fait, la géographie humaniste (deuxième tradition) a tout de même elle aussi privilégié la description (Tuan, 1978 ; et Pocock, 1984). L’expression du retentissement intérieur du rapport aux lieux est à chercher, on l’aura compris, dans les passages descriptifs. En fait, la géographie humaniste a à ce point misé sur les passages descriptifs que certains ont qualifié leurs travaux, comme nous l’avons vu plus tôt, de simple « philatélie » (Thrift, 1978) ou de « saccage désinvolte » (Gregory, 1981). Dans de nombreux cas, il est vrai, l’effort d’analyse se limitait à isoler un ensemble de descriptions de lieux, d’en faire le collage et de les décrire à nouveau avec un langage plus près de celui de la géographie universitaire. Dans les rares travaux des géographes radicaux (troisième tradition), lorsque le regard se pose sur le texte, c’est encore une fois, du moins pour l’essentiel, les mêmes parties du texte qui retiennent l’attention. Bien que ce penchant presque naturel pour la description soit moins manifeste dans les approches géographiques plus contemporaines, les questions posées étant de nature un peu différente, il semble que ce soit encore une fois dans les passages descriptifs que l’on trouve des illustrations pour les développements plus complexes que nous suggère notre lecture de la littérature.
Les théoriciens de la description tels Philippe Hamon (1981 et 1991) ou Jean‑Michel Adam (1993) et de la narratologie comme Genette (1966) par exemple nous ont toutefois appris que les frontières du récit et de la description n’étaient pas aussi étanches que l’on pouvait le croire à première vue. La description est bien plus qu’un simple moment d’arrêt dans la course du récit, ou un procédé commode servant à produire un « effet de réel » (Barthes, 1968). Elle constitue aussi un moment où le texte stocke une partie de son information vive. Bref, c’est dans ses multiples rapports d’échange et de tension avec les autres instances du récit que la description tire sa puissance sémantique et cognitive, son pouvoir organisateur, et par conséquent, il ne faut pas l’isoler de son environnement narratif pour en faire l’interprétation. Jean-Yves Tadié l’exprime très bien au sujet du récit poétique :
« Ce n’est que par hypothèse de recherche que nous isolons des pages appelées ‟descriptions” : bien que ces unités présentent l’avantage de dépasser le trait, et la phrase, descriptifs isolés, en les replaçant dans un ensemble, cet ensemble lui-même (…) ne prend sens, et forme, que par rapport à la totalité du récit, dont il est parfois le dernier mot, à quoi renvoie chaque lieu devenu symbolique » (Tadié, 1978, p. 49).
On trouvera aussi des arguments militant pour une revalorisation de la description dans les travaux ethnographiques de Clifford Geertz (1983), avec la notion de thick description, lesquels ont d’ailleurs inspiré bon nombre de géographes de nouvelle géographie culturelle anglo-saxonne (Duncan et Ley, 1993). Dans un contexte interprétatif, la description « étoffée » ou « étayée » a pour fonction à la fois de servir de « guide à la résolution d’un problème d’explication » et de gérer « un problème de communication » (Borel, 1989, p. 131). Même dans sa fonction la plus mimétique, celle qui sert à fournir les bases empiriques d’un problème à résoudre, elle contient déjà les germes d’une élaboration théorique. Ainsi, la description littéraire ou ethnographique, aussi banale qu’on a bien voulu la croire, constitue-t-elle tout de même une forme d’interprétation.
Pour parler en géographe physicien, c’est comme si le fleuve de la narration déposait, en prenant un certain repos, ses sédiments les plus riches dans les passages descriptifs. Et que la description, en retour, les organisait en strates sémantiques plus stables, qui rendent l’interprétation des dimensions spatiales du roman plus aisée. De là, son côté commode pour fournir des illustrations bien ramassées. Or, pour en tirer toute la substance, la théorie littéraire nous rappelle qu’il faut non pas isoler les passages descriptifs de l’ensemble de la narration (avec toutes ses caractéristiques) mais bien chercher à montrer comment le sens de la description et donc de l’espace qu’elle produit est à mettre en relation dynamique avec les autres instances du récit. On ne fait pas que mettre en lumière le contenu géographique des passages descriptifs, on montre comment le roman dans son ensemble, et chaque roman à sa propre façon, génère une géographie particulière.
En procédant à une lecture rapprochée de quatre romans dans Des romans‑géographes, j’ai montré que la matière géographique vive que l’on peut trouver dans les passages descriptifs entretient des rapports dynamiques, mais à géométrie variable, avec les autres aspects du roman (Brosseau, 1996). Pour comprendre la spécificité de la représentation de l’espace dans Le Rivage des Syrtes de Gracq (1951), il convient par exemple de tenir compte de son style et de son usage intensif de la métaphore grâce auxquels la description devient elle-même narrative. Elle « raconte » l’histoire des lieux et souvent transforme les paysages en présage de l’action à venir. Tout l’univers imaginaire du Rivages des Syrtes se construit aussi à la faveur d’un riche réseau toponymique et d’un réseau métaphorique encore plus riche produisant un jeu d’échos et de résonnances par l’entremise duquel chaque description de lieux rappelle au lecteur les rapports étroits que les lieux entretiennent entre eux et avec les personnages. L’œuvre de Gracq, par son important caractère géographique, a retenu l’attention de nombreux géographes (Tissier, Lacoste, Rosemberg, Dupuy) et de critiques littéraires encore plus nombreux. Le travail de ces derniers sur les dimensions stylistiques de l’œuvre (la métaphore de premier chef), les particularités de ses descriptions narratives, l’onomastique très riche, les personnages souvent conçus comme autant de « plantes humaines » notamment, enrichit notre compréhension de la pensée géographique qui s’y exprime. En un sens, c’est ce que j’ai tenté de montrer dans mon travail sur Gracq ; le style de Gracq est à la rigueur plus géographe que Louis Poirier (le vrai nom de Julien Gracq) qui a suivi une formation de géographe (Brosseau, 1996).
Je me suis aussi penché sur un roman de Michel Tournier (1975). Dans Les Météores, cette « longue et aventureuse méditation sur la notion d’espace », Tournier explore les parts relatives de l’hérédité et du milieu, mais surtout de l’espace et du temps, dans la formation identitaire et la courbe du destin des protagonistes, des jumeaux identiques. Cette exploration s’articule autour d’une série d’oppositions de conceptions du temps (chronologique ou météorologique) ou de rapports à l’espace (sédentaire ou nomade) correspondant à chacun des jumeaux. Le récit de leur histoire montre comment l’espace, plus que le temps, participe de l’évolution des identités changeantes de Jean et de Paul et fait émerger de la cellule des « frères-pareils », deux individus distincts. La course autour du monde de Jean à la poursuite de Paul met en lumière les vertus « altérantes » des lieux qui, par leur extrême contingence n’ont pas les mêmes effets sur l’un et sur l’autre. Or, pour y déchiffrer les dimensions contingentes des lieux (Les Pierres Sonnantes en Bretagne, Paris, Casablanca, Venise, Djerba, l’Islande, le Japon, le Canada, Berlin), il est nécessaire, notamment de s’arrêter à la structure mythique du récit, à l’intrigue comme telle, ainsi qu’au dialogisme des voix. Polyphonique, le récit alterne entre plusieurs voix narratives : un narrateur omniscient, Jean, Paul (et leur oncle Alexandre). À chaque voix correspondent des descriptions différentes des lieux, descriptions dont l’interprétation ne peut bien se faire qu’en rapport avec l’ensemble du texte.
Le même type de démarche a été déployé afin de reconstituer la géographie olfactive générée par le roman à succès de Patrick Süskind, Le Parfum (1986). Dans la description littéraire comme dans la description géographique des lieux, la part du lion revient presque toujours aux dimensions visuelles de l’espace (Weisberger, 1971). Dans ce roman de Süskind, c’est plutôt l’odorat qui a le haut du pavé. Cela est rendu possible grâce à un art de la description particulièrement achevé, véritable tour de force descriptif. Or la puissance de la description est à mettre en rapport avec la rhétorique de la narration (qui fait par exemple circuler le personnage central la nuit alors que l’on ne voit rien mais peut sentir…), la création d’un personnage fictif (doté d’une hyperosmie, sorte d’équivalent olfactif d’un diapason absolu), le tout campé dans un univers romanesque parfaitement vraisemblable (le Paris et la France du XVIIIe siècle) à une époque où, selon Corbin, les problèmes liés à l’hygiène urbaine interpellèrent la vigilance olfactive des médecins, ingénieurs, hommes politiques et philosophes (Corbin, 1986). En cours de narration, le protagoniste développe une véritable épistémologie olfactive, qui passe de l’accumulation inductive de nouvelles odeurs sur un plan horizontal à leur organisation hiérarchique sur un plan vertical, épistémologie qui, grâce à un « stage de formation » chez un grand parfumeur, s’accompagne bientôt d’un savoir et d’un langage techniques. Les nombreuses descriptions des lieux conservent la trace de ces développements et élaborent de proche en proche un tour de France olfactif. Le roman met à profit les ressources imaginaires pour ouvrir la géographie à un univers que la géographie scientifique peut difficilement saisir de façon empirique. Il procure aussi au lecteur une expérience de connaissance géographique fictive et un aperçu des moyens pour l’écrire (Brosseau, 1996).
Ces trois exemples de romans-géographes illustrent le fait que chaque roman a sa propre façon de générer sa géographie, ce qu’une grille d’analyse standardisée ne saurait adéquatement mettre en lumière. « Tous les textes sont différents, écrivait Jacques Derrida. Il faut essayer de ne jamais les soumettre à ‟une même mesure”. Ne jamais les lire ‟du même œil”. L’écriture tend aussi, poursuit-il, à dessiner la structure et la physiologie d’un œil qui n’existe pas encore et auquel l’événement du texte se destine, pour lequel il invente parfois sa destination, autant qu’il se règle sur elle » (Derrida, 1988, p. 30). Dialoguer avec le roman, c’est se rendre sensible à sa façon de produire une géographie différente. En un sens, c’est le roman lui-même qui aiguille le lecteur sur les aspects du texte qui font son originalité et celle des lieux qu’il sécrète.
Nous verrons ici, avec deux exemples de romans urbains, comment le texte contribue à dessiner l’œil de son lecteur ou du moins à définir le type de lecture nécessaire à la compréhension de la géographie qu’il construit. Ces deux exemples montrent aussi que bien que la description puisse être un moment du texte privilégié pour étudier la représentation de l’espace, d’autres dimensions du texte contribuent à la construction d’une géographie romanesque. Afin de faciliter la comparaison des stratégies discursives déployées dans les deux romans, nous verrons d’abord les trois grandes formes de romans urbains (roman-portrait, roman écologique, et roman synoptique) identifiées par Gelfant (1970). Le premier, Manhattan Transfer de Dos Passos (1925 ; et 1928 en français), est l’incarnation par excellence de la forme synoptique du roman. Nous verrons comment la structure narrative de ce roman moderniste, de même que son art particulier de la composition et du montage, réussit à exprimer l’expérience et le rythme frénétique de la grande métropole américaine, New York. Le second, Les désirs de la ville, Dionne Brand (2005 ; et 2011 en français) est plutôt un compromis entre ces trois formes de romans. Nous examinerons les stratégies narratives par l’entremise desquelles Brand cherche à saisir le caractère proprement multiculturel de la métropole canadienne, Toronto.
Formes du roman et forme de la ville
Dans The American city novel, Gelfant cherchait à définir le roman urbain en tant que genre. Sa réflexion sur les rapports entre forme et matériau d’une part, et entre visions de la vie urbaine et techniques littéraires de l’autre, l’a conduit à identifier trois grandes formes de romans de la ville : le « roman portrait », le « roman écologique » et le « roman synoptique » (Gelfant, 1970). Selon elle, le « roman portrait » révèle la ville par l’entremise de l’exploration qu’en fait un seul et même personnage, dans la tradition du roman de formation. Les romans de Theodore Dreiser ou de Thomas Wolfe en seraient de bonnes illustrations. Le « roman écologique » insiste plutôt sur une portion de la ville – un quartier par exemple – pour en décrire la vie quotidienne. Les romans de James Farrell sur le South Side de New York en seraient de parfaites incarnations. Enfin, le « roman synoptique » n’a pas de héros véritable. Grâce à une technique de montage et de composition particulièrement fragmentée, voire kaléidoscopique, la ville y devient le personnage central de la narration. Manhattan Transfer de John Dos Passos (1925), dont il sera question ici, en est l’exemple le plus probant. Le roman synoptique, en brisant de façon radicale la linéarité du récit, en opérant une certaine dislocation de la séquence temporelle au profit d’une juxtaposition spatiale, nécessite pour ainsi dire un mode de lecture différent, qui relève de ce qui a été identifié par Joseph Frank (1972) comme la « forme spatiale » en littérature.
Manhattan Transfer : la ville en forme de texte
« Un livre est un monde, un monde fait, un monde avec un commencement et une fin. Chaque page d’un livre est une ville. Chaque ligne est une rue. Chaque mot une demeure » (R. Ducharme).
Le phénomène urbain a fasciné plusieurs grands romanciers depuis la fin du XIXe siècle. On retient sans doute comme meilleurs exemples, le Paris de Proust, le Dublin de Joyce, le Berlin de Döblin, le Vienne de Musil ou le New York de Dos Passos (Tadié, 1990). Manhattan Transfer de Dos Passos fait notamment intervenir une esthétique et un art de la composition particulièrement riches en enseignements sur le travail que l’œuvre littéraire effectue avec son matériau pour en faire éclater les contraintes, pour braver, en somme, les résistances du langage devant l’expression de la ville. Il pose aussi la question de l’adaptation de la forme littéraire à l’objet qu’elle cherche à représenter. Dos Passos a absorbé un large éventail des courants littéraires de son temps (réalisme, surréalisme, le monologue intérieur, l’esthétique cinématographique, voire le cubisme, etc.), pour produire une forme à même de représenter ce phénomène complexe et multiforme qu’est la ville moderne.
Les commentateurs de Dos Passos n’ont pas manqué de souligner les liens entre son roman et les travaux de sociologie urbaine qui lui étaient contemporains (Astre, 1974 ; Magny, 1948 ; Morel, 1990). La conception de la ville et de la vie urbaine proposée par l’École de Chicago semble bien se rapprocher, du point de vue de la présentation concrète du milieu urbain, du New York de Dos Passos (Saint-Arnaud, 1997 ; Lassave, 2002). À une échelle plus générale, c’est-à-dire d’un point de vue philosophique, les transformations que font subir à l’homme les genres de vie urbains ne sont pas sans liens avec les idées d’un Weber ou d’un Simmel. L’assujettissement de l’homme urbain, sa dépossession, sa « dénaturalisation », le caractère écrasant des grandes cités, liés au procès cynique d’une Amérique capitaliste et du rêve américain, sont fortement thématisés dans le roman. Je voudrais insister ici sur les aspects plus techniques de l’œuvre afin de mettre en lumière les rapports entre les formes du discours et la représentation de la ville. Manhattan Transfer est un des rares romans à avoir aussi clairement « imité » la forme de la ville dans la matérialité du texte lui-même.
Dans Manhattan Transfer, le temps est ponctuel, fragmenté et les repères chronologiques sont aussi rares que dispersés. C’est un temps atomique et impersonnel, conjugué à l’éternel présent. La conception du temps et de l’espace qui est développée dans Manhattan Transfer est concordante avec le rythme et le morcellement de la vie urbaine. Morel a bien souligné l’absence presque totale de « régie temporelle explicite », c’est-à-dire que le narrateur manifeste rarement le souci de situer temporellement l’action qui se déroule (Morel, 1990). À ce flou temporel relatif correspond un « ancrage spatial de l’action » très prononcé bien que la trame spatiale soit, elle aussi, très fragmentée. Les sites sont donnés mais les localisations relatives sont pratiquement absentes. Des scènes sans lien aucun entre elles se succèdent dans le texte sans que l’on puisse réellement savoir si elles se passent en même temps ou si la succession narrative correspond en fait à une succession dans la chronologie interne du roman. L’éclatement du temps et de la trame spatiale, morcelée en une « mosaïque de petits mondes qui se touchent sans s’interpénétrer », comme l’écrivait le sociologue Robert Park (cité par Morel, 1990, p. 19), contribue à la vacuité du personnage.
La représentation de New York s’appuie sur une technique de montage et un art de la composition très particuliers. Le roman est divisé en trois grandes parties de taille comparable, elles-mêmes subdivisées en cinq, huit et cinq chapitres respectivement. À l’intérieur de chaque chapitre, sont juxtaposées un nombre considérable de scènes (42, 39, et 55 respectivement) qui décrivent une courte tranche de vie de quelques personnages dans des lieux souvent très précis. Cet éparpillement apparemment insurmontable est partiellement compensé par le croisement de différentes lignes narratives, lorsque des personnages étant apparus dans une scène en rencontrent d’autres, associés jusque-là à des scènes totalement indépendantes. Le sens sera souvent produit par la rencontre de deux scènes contrastées, contraste qui fait ressurgir la diversité et les inégalités de la ville. On passe par exemple d’une séquence à l’autre, sans transition, d’une ruelle où parient de pauvres gamins à un restaurant luxueux :
« Quatre d’entre eux filaient déjà sournoisement le long du quai […] Le gamin comptait les pièces dans sa main. Dix : ‟Bon Dieu ! ça fait cinquante cents… J’leur dirai que le grand Léonard m’a barboté le pèze.” Comme ses poches n’avaient pas de fond, il noua les pièces dans un des pans de sa chemise.
À chaque place, autour de la table ovale, d’une blancheur étincelante, un gobelin à vin du Rhin trinquait avec une coupe à champagne. Sur huit assiettes blanches, miroitantes, huit canapés de caviar, flanqués de quartiers de citron, saupoudrés de chapelure d’oignon et de blanc d’œufs, ressemblaient à des ronds de perles noires sur des feuilles de laitues » (Dos Passos, 1928, p. 37).
Ces contrastes se lisent aussi à l’intérieur d’une même séquence : pendant que Cassie et Morris discutaient de leur problème d’argent, « Derrière eux limousines, cabriolets, voitures de touristes, conduites intérieures filaient sur la chaussée, serpents lumineux glissant en deux rivières unies, interminables » (Dos Passos, 1928, p. 206-7). La critique sociale n’est donc pas « littéralement » ou transitivement exprimée comme elle le serait dans une analyse sociologique : c’est le type de montage contrasté qui aiguille le lecteur sur les injustices que génère la grande métropole.
La ville est aussi représentée par l’entremise d’une grande variété de perspectives et de points de vue. Si l’on reprend la terminologie cinématographique, comme le suggère Claude-Edmonde Magny (1948), Dos Passos fait alterner gros plans et grande profondeur de champ, utilise des plans fixes et des travellings, des vues panoramiques et des descriptions déambulatoires. La diversité de ces techniques un peu « objectives » est toutefois conjuguée à des registres descriptifs d’une richesse étonnante : tous les sens (vue, ouïe et odorat) sont sollicités. Toutes les saisons sont mises en scène, de jour comme de nuit, sous le soleil ou la pluie. Les descriptions du paysage urbain font parfois un usage des formes et des couleurs d’une palette impressionniste. À d’autres moments, faisant leurs les hallucinations ou l’ébriété des personnages (souvent exprimées en recourant la technique du « flux de conscience »), les descriptions verseront presque dans l’expressionnisme.
On aura donc l’impression, de prime abord, d’avoir affaire à un tableau un peu figé et disloqué de la géographie sociale de New York : des personnages sans lien, dans des lieux disjoints, dont les destins ne se rencontrent guère. C’est avec la reconnaissance progressive des apparitions et des réapparitions de personnages au fil de la lecture, de leurs rencontres anodines, uniques ou récurrentes, que le tableau se met en mouvement. Ce qui avait été pressenti jusque-là comme une simple juxtaposition statique de scènes évoluant simultanément (ou, du moins, sans repère temporel précis) accédera à une dimension dynamique avec le croisement occasionnel des différentes lignes narratives.
Le mouvement est d’abord suggéré, à l’intérieur des diverses scènes, par les nombreux déplacements dont le caractère répétitif donne lieu à une réelle « syntaxe des déplacements ». Très souvent, à l’intérieur d’une même séquence, les personnages passent de la chambre à la rue, au restaurant, du bureau au restaurant, du théâtre à l’hôtel, des entrepôts du port au banc de parc, etc… La description déambulatoire (ou cinétique) prendra le relais du plan fixe, de la description-tableau, pour suggérer la sensation du mouvement. Ainsi, suivra-t-on les déambulations de Bud dans un quartier pauvre non loin du port :
« De son pas allongé et lent, Bud descendait Broadway […] Il passa devant les terrains vagues où des boîtes de conserves miroitaient dans l’herbe, sous des touffes de sumac et des ronces. Il passa entre les rangées de palissades et d’affiches de Bull Durham, devant des cabanes et des huttes de squatters abandonnées, devant des fondrières où s’entassaient des monceaux de détritus creusés d’ornières, où des tombereaux déversaient des cendres et du mâchefer, devant des affleurements de roche grise que des perforeuses à vapeur frappaient et grignotaient sans cesse, devant des trous que des charrettes pleines de pierres et d’argile qui, par des chemins planchéiés, se hissaient péniblement jusqu’à la rue. Ensuite, sur des trottoirs neufs, il longea des maisons en briques jaunes, et il regardait à travers les vitrines les épiceries, les blanchisseries chinoises, les restaurants, les boutiques de fleurs et de fruits, les magasins de vêtements et les charcuteries » (Dos Passos, 1928, p. 34-35).
Le discours de la rue sera, à l’occasion, reconstitué par un recours au collage – procédé valorisé par les surréalistes – qui juxtapose, un peu aléatoirement, des éléments empruntés (fictivement ou non) au monde extérieur (Morel, 1978). D’une certaine façon, c’est le « texte » de la ville qui s’inscrit dans l’intertexte du roman :
« Printemps riche en gluten… chargé de principes nourrissants, volupté dans chaque bouchée. THE DADDY OF THEM ALL. Printemps riche en gluten. Personne ne peut acheter de meilleur pain que PRINCE ALBERT. Acier forgé, aluminium, cuivre, nickel, fer forgé. All the world loves natural beauty. LOVE’S BARGAIN, ce complet chez Gumpel, meilleur marché de la ville. Conservez ce teint de fillette… JOE KISS, démarrage, allumage, magnétos et générateurs » (Dos Passos, 1928, p. 441).
Ces déplacements donnent aussi l’occasion de parcourir un « transect » socioéconomique de la ville, où le subtil recours à la technique « flux de conscience » fait alterner les focalisations interne et externe de la description. Sortant de son bureau dans le quartier des affaires, le jeune avocat Gus McNeil se dirige chez un futur client :
« […] il prit un tramway qui remontait Broadway. Il s’engagea dans la 4e Rue côté ouest et longea Washington Square. Les arbres étendaient leurs branches d’un violet délicat sur un ciel gris tourterelle. Les maisons d’en face, avec leurs grandes fenêtres, brillaient toutes rouges, nonchalantes et prospères. L’endroit rêvé pour un avocat à grosse clientèle bien établie. On verra ça. Il traversa la 6e Avenue et suivit la rue malpropre, côté ouest. Il y régnait une odeur d’écurie, et les trottoirs étaient couverts de détritus dans lesquels des gamins se vautraient : ‟Bon Dieu, quand on pense qu’il y a des gens qui vivent là, au milieu de ces Irlandais de basse catégorie, de ces étrangers, le rebut de l’univers” »
(Dos Passos, 1928, p. 67-68).
Promenade ou errance, autobus ou trams aériens, taxi ou limousine, la ville est sans cesse en mouvement. Ces multiples déplacements constituent autant de pratiques de la ville qui mettent en valeur différentes facettes de son image. On pourra dire que cette question est abordée par les sciences sociales, que des auteurs comme Walter Benjamin (c1939 ; réédité en 1989) ou, plus près de nous, Michel de Certeau (1990), sont attentifs à de telles pratiques de l’espace quotidien. Seulement, leur lecture de ces pratiques est essentiellement sociologique : leur discours cherche à exprimer transitivement ces expériences, alors que Manhattan Transfer les met en scène textuellement grâce à diverses stratégies rhétoriques et un travail concerté sur le style et la syntaxe.
L’atmosphère et la conception de la ville dans Manhattan Transfer sont intimement liées à l’organisation, à la forme du matériau. Le caractère aliénant et dépersonnalisant de New York est par ailleurs signifié, symboliquement par les titres de chapitres, aussitôt suivis de petits textes poétiques qui contiennent, en condensé, toute la charge symbolique et axiologique du roman. Ces relations, que Genette (1987) qualifie de paratextuelles (relations du texte avec son titre, ses sous-titres, préface, notes etc.), sont ici particulièrement éloquentes : les titres de chapitres et les courtes vignettes qui les accompagnent se lisent comme autant de panneaux de signalisation situés à l’entrée d’un nouveau district textuel.
Des titres tels que Rouleau à Vapeur, Gratte-ciel et Portes Tournantes évoquent bien la nature écrasante de la ville. La critique du capitalisme, de la mégalomanie et de la corruption politique est déjà contenue, en germe, dans des titres comme Dollars, Métropole et Cinq causes légales. L’éternelle succession « Succès, échec, succès, échec » (Dos Passos, 1928, p. 381), est symbolisée par l’image des Montagnes russes. La ville du paraître, du pastiche – « des maisons grises semblables à des boîtes en carton » (Dos Passos, 1928, p. 142) – est annoncée par Une grande dame sur un cheval blanc. L’éphémère et le transitoire sont exprimés par les titres Embarcadère, Merveille du jour, Rails, voire même par le titre du roman lui-même : Manhattan Transfer est une gare de triage qui « aiguille » les destinés. Le sort de la ville accède aussi à une dimension mythique ou biblique : Le fardeau de Ninive, Encore une rivière avant le Jourdain. Le roman possède d’ailleurs la structure circulaire du mythe : Jimmy Herf arrive à New York par bateau au début du roman et quitte la ville à la fin à partir de son lieu d’arrivée, l’entrée de Bud se fait au début de la première partie, son suicide la termine. Aussi, par un subtil jeu de variations, certains passages ou titres de chapitre sont-ils enchâssés dans diverses parties du texte comme pour insister sur la charge mythique du roman. Le petit texte poétique au début du chapitre 2 (Métropole), d’ailleurs repris mot pour mot au chapitre 7 de la deuxième partie (Dos Passos, 1928, p. 320), met en parallèle le sort des grandes cités du monde (Babylone, Ninive, Rome, Constantinople et New York). Il annonce le sort de cette ville « orgueilleuse » et laisse présager le pire : babélisation (agrégation d’unités disjointes auxquelles se juxtaposent plusieurs niveaux de langue et accents) et destruction : Pompe à incendie. La destruction plane sur la ville.
La charge symbolique des titres, l’arrière-plan mythique, l’ensemble de l’organisation du matériau, le temps morcelé et l’espace fragmenté sont autant d’aspects du roman qui concourent à la création de l’atmosphère de la ville. La tension toute moderne entre la contingence de la vie quotidienne et le mouvement inexorable de l’histoire est constamment réanimée. L’absence de point de vue zénithal organisant de haut l’interprétation du roman et de la ville – l’absence de régie est de ce point de vue la marque de la non-volonté du romancier de prendre le rôle d’un narrateur omniscient – traduit l’effondrement des valeurs caractéristique de notre modernité, effondrement dont l’avènement a sans doute été accéléré par la croissance des mégalopoles du monde occidental.
Écrire la ville multiculturelle : défis formels
« En de nombreux domaines l’excès d’ambition est critiquable, mais non pas en littérature. La littérature ne peut vivre que si on lui assigne des objectifs démesurés, voire impossibles à atteindre. Il faut que poètes et écrivains se lancent dans des entreprises que nul autre ne saurait imaginer, si l’on veut que la littérature continue de remplir une fonction. Depuis que la science se défie des explications générales, comme des solutions autres que sectorielles et spécialisées, la littérature doit relever un grand défi et apprendre à nouer ensemble les divers savoirs, les divers codes, pour élaborer une vision du monde plurielle et complexe » (Calvino, 1989, p. 179).
Si le rythme et le caractère fragmenté de la grande ville moderne a posé des défis de taille aux analystes et aux écrivains, le caractère pluriel et proprement multiculturel de la ville contemporaine continue de les mettre dans l’embarras. Si chez les uns, la solution est à chercher dans le développement de conceptualités plus labiles devant rendre compte des modalités de plus en plus multi-centrées, complexes, voire volatiles, de la diversité urbaine, chez les autres, elle est à chercher dans le développement ou l’adaptation de stratégies narratives permettant de représenter ces réalités nouvelles. Les désirs de la ville (traduction francaise de What we all long for), roman de l’écrivaine torontoise Dionne Brand (2005 ; 2011) dont il a été question au chapitre 2, fournit un exemple particulièrement convaincant de stratégie narrative capable de générer un univers géographique fictif où cohabitent différentes identités culturelles, trajectoires individuelles et relations de pouvoir complexes dans un Toronto plus divers que jamais. Il semble bien qu’il s’agisse d’un objectif littéraire, pour reprendre les mots de Calvino, que l’auteure elle-même se soit donné :
« I learned about cities, like Paris or New York or whatever, from reading about them. (…) So when I went to New York, I knew where I was. (…) I thought that this city was worth knowing that way. (…) What interested me was that there are various communities, but they don’t live completely discretely from one another ; they overlap » (Brand, en entrevue avec Susan Walker, 2005, p. E04)4.
L’enjeu central de ce roman n’est pas tant, comme ce fut le cas pour les grands romans de la ville du siècle dernier, ceux de Proust, Joyce, Musil ou encore Dos Passos comme on vient de le voir, de rendre compte du phénomène urbain dans son ensemble, ou d’exprimer une philosophie de la cité moderne in extenso. Il en partage pourtant une partie des ambitions en cherchant à saisir Toronto comme un tout, en mettant en lumière sa diversité culturelle, ses contradictions, ses violences mais aussi les désirs qu’elle provoque. Toronto, incarnation canadienne par excellence de la ville multiculturelle, y apparaît souvent comme un personnage en tant que tel.
En termes de stratégie narrative d’ensemble, le roman de Brand occupe un espace mitoyen entre les trois grandes formes de romans urbains identifiées par Gelfant : le « roman portrait », le « roman synoptique » et le « roman écologique » (Gelfant, 1970). Pour réussir à décrire la ville multiculturelle en ce qu’elle a de proprement multiple, la forme « roman portrait » souffrirait sans doute d’un monologisme incompatible avec le caractère pluriel de l’objet, ne saisissant la diversité par l’entremise que d’une seule et même perspective. À l’autre extrême, la forme synoptique, dont le Manhattan Transfer de Dos Passos constitue pour ainsi dire l’idéal-type, nécessiterait ici une surmultiplication des personnages et des lignes narratives (pour s’approcher de la diversité socioculturelle effective de la ville) qui risquerait de fournir une image résolument éclatée ou fragmentée de la réalité urbaine à laquelle aucune lecture, aussi tabulaire soit-elle, parviendrait à redonner une forme de cohérence. Le résultat, aussi stimulant que difficile à imaginer, pourrait ressembler à une cacophonie babélienne. La forme « écologique », pour sa part, se concentrerait sur les réalités urbaines d’un seul des quartiers de Toronto. Et comme la réception critique du roman de Brand le rappelle, les exemples de romans consacrés à un seul segment culturel de la ville abondent déjà :
« The ‟we” in Dionne Brand’s new novel, What We All Long For, implies inclusion, of shared desires. It’s us Toronto, the city that crows about how it is the most multicultural place in the world. High time it showed up that way in our fiction. We’ve had WASP Toronto, Italian Toronto, West Indian Toronto, South Asian Toronto – all the diasporas. But Brand is the first Toronto novelist to capture a generation born and bred into this masala of cultures, creeds and nationalities » (Walker, 2005, p. E04)5.
Le compromis proposé par Brand est un roman polyphonique, animé par quatre axes narratifs dominants – ceux des quatre protagonistes – qui confèrent à la représentation un caractère pluriel qui manquerait sans doute au roman portrait et au roman écologique mais qui évitent du même coup l’effet de multiplicité déroutante que comporterait un véritable roman synoptique multiculturel de Toronto. Rappelons que ces personnages sont issus de milieux différents : Tuyen est fille de réfugiés vietnamiens, Carla est la fille d’une mère italienne et d’un père jamaïcain, Oku est le fils d’immigrants jamaïcains, et Jackie est la fille de Néo-Écossais noirs (donc pas des immigrants au sens strict) ayant migré à Toronto à la recherche de travail. Bien que de façon elliptique et bien approximative, ce quatuor constitue une forme de condensé romanesque de la diversité torontoise. Autour de ces quatre personnages dont les destins s’entrecroisent, une série de personnages secondaires (familles, amis et connaissances des protagonistes) et quelques figurants plus ou moins anonymes complètent la « distribution » du roman. Ces personnages contribuent à augmenter l’impression de diversité, parce qu’ils appartiennent eux-mêmes à des communautés ethnoculturelles différentes, et suggèrent, chemin faisant, les autres possibles de la représentation. En un sens, nous avons quatre petits romans portraits en un, en partie démultipliés par la présence de nombreux personnages secondaires. Mais ce ne sont pas des destins parfaitement parallèles car les vies, comme les lignes narratives, s’entrecroisent : l’amitié relie les protagonistes entre eux, la famille les relie aux autres. Si l’on considère les trames narratives familiales comme des ensembles autonomes, on pourrait dire que nous avons aussi affaire à quatre petits romans écologiques qui reconstituent l’histoire de quatre familles immigrantes à Toronto : le Toronto d’une famille vietnamienne du « Chinatown » à la banlieue de Richmond Hill, celui d’une famille jamaïcaine dans « Little Jamaica », ou encore celui d’une famille italienne dans le Corso Italia. Ce roman polyphonique a aussi quelque chose de synoptique car, entremêlée au sein des axes narratifs évoqués, on entend la voix de Toronto elle-même, le chant de ses rues, le spectacle de sa foule, le damier de ses avenues et la texture de son paysage.
Par rapport aux trois formes de romans urbains évoquées plus tôt, le roman de Brand constitue aussi une forme de compromis narratif en termes de régie temporelle et d’ancrage spatial. Dans le roman synoptique, la tendance veut qu’à ancrage spatial très explicite de l’action corresponde une absence presque totale de régie temporelle, tout au moins un relatif flou temporel. Chez Brand, l’ancrage spatial est très explicite et précis : lieux, rues, parcs et commerces sont clairement identifiés dans un souci manifeste de référentialité. Même les adresses civiques sont souvent fournies, ce qui a facilité une transcription cartographique relativement précise de l’espace vécu des principaux personnage (fig. 3, 4 et 5). L’ancrage spatial est aussi nettement moins elliptique que dans le roman synoptique car les descriptions cinétiques de nombreux déplacements relient les lieux entre eux et permettent au lecteur de reconstituer mentalement les localisations relatives. En cela, son roman partage le penchant pour les déambulations que commande le caractère exploratoire du roman-portrait. La ville est parcourue, tous azimuts, en voiture, en transport en commun, en vélo. Le lecteur franchit des quartiers entiers et peut saisir les différences morphologiques plus générales entre les différentes composantes de la ville. Alternant entre le récit à consonance et le monologue narrativisé, les descriptions cinétiques des traversées urbaines de Carla en vélo sont à ce titre particulièrement réussies. Celle-ci décrit le parcours entre la prison, où elle vient de visiter son frère, et le centre-ville :
« Elle fonça à travers la banlieue cossue de High Park, avec ses vieilles maisons à l’anglaise. Les gens qu’elle s’imaginait les habiter, avec leurs petites vies parfaites, la rendait encore plus mal à l’aise que d’habitude parce qu’elle venait de quitter son frère. Les ravissantes boutiques de luxe, la carapace de richesse, semblaient ne pas être affectées par la luminosité de son corps. Le guidon de son vélo était comme ses propres os, et comme ses os, elle l’inclina vers le parc. […] Bientôt elle était de nouveau dans la rue Bloor, filait vers l’est, en direction du centre de la ville, se lançait au milieu des feux de circulation de la rue Keele, obliquait vers le lac au sud… » (Brand, 2011, p. 31-32).
Combinées, les nombreuses descriptions des trajectoires et pratiques de la ville exploitent un vaste « échantillon » de la diversité urbaine. Elles les abordent à partir de perspectives multiples qui font entendre les nombreuses voix qui animent la ville. Ensemble, elles révèlent que les uns et les autres n’habitent pas la même ville et n’ont pas pour elles, ni pour eux-mêmes, les mêmes aspirations.
La régie temporelle est presqu’aussi explicite que l’ancrage spatial : on sait toujours où l’action se déroule et à peu près quand. Cette régie temporelle est double : le temps de l’action principale suit la vie des protagonistes à une époque contemporaine (printemps-été 2002) et une série de retours en arrière retrace l’histoire de leurs parents. Décrites avec des détails très variables d’une famille à l’autre, ces histoires de vie permettent tout au moins de reconstituer la séquence chronologique de leur établissement à Toronto. Du coup, elles exposent ce que divers quartiers de la ville ont pu représenter pour divers groupes à différentes époques et constituent pour ainsi dire autant de portes d’entrée dans l’histoire sociale de la ville. C’est le cas par exemple de M. et Mme Bernard, les parents de Jackie, une famille noire ayant immigré à Toronto depuis la Nouvelle-Écosse.
Le roman évoque le processus de ghettoïzation par l’entremise duquel race et classe sociale, conjuguées avec une absence presque totale d’options, ont poussé les parents de Jackie dans le désespoir d’un paysage urbain dominé par le béton et le bitume. En revanche, la description de leur vie trépidante sur la « scène noire » du Toronto des années 1980 fait découvrir aux lecteurs des bars célèbres tels le Paramount et The Elephant Walk, aujourd’hui disparus, qui ont constitué des « haut lieux » de la vie nocturne afro-antillaise torontoise. Véritables espaces identitaires, leur fermeture a causé un grand désarroi dans la communauté et chez les parents de Jackie en particulier. Le roman offre ici un fragment de roman écologique des espaces de la communauté noire de Toronto. Le caractère récapitulatif de la narration permet aussi de mettre en lumière les traces de la mémoire urbaine, la grande contingence des lieux, la rapidité des transformations de la ville et de leurs effets variés sur différents groupes.
« Pendant un moment un coin de rue existait pleinement, superbe de désirs, puis il disparaissait sous de constantes rénovations. Une banque se recyclait en pizzeria, pour ensuite être abandonnée, ses murs couverts de graffitis et ses fenêtres placardées ; après des semaines où l’on passait et repassait devant sans noter les changements infinitésimaux, on la voyait soudain renaître sous l’apparence d’un condo chic. Ce magasin de vins et spiritueux, qui était jadis le Paramount, subirait probablement, discrètement, le même sort dans trois ou quatre ans, et le bon temps que les parents de Jackie avaient passé là – ces nuits jamais assez longues où ils se retrouvaient tous à la porte arrière d’une boite clandestine sur l’avenue St. Clair, (…) où chez Fran’s dans College, à manger des œufs graisseux au petit matin – , tout cela, leur adorable vie, ils ne pourraient convaincre personne qu’elle avait déjà existé » (Brand, 2011, p. 174).
La description de la Little Jamaica, où se sont établis les parents de Oku à leur arrivée de la Jamaïque s’ajoute au tableau du paysage associé à la communauté noire de Toronto :
« Toute la section d’Eglinton entre Marlee et Dufferin était remplie de magasins antillais vendant de la nourriture épicée, des coupes de cheveux, des perruques, des cosmétiques et des vêtements. Il y avait des boutiques qui vendaient des barils pour le transport de biens destinés aux familles dans les Caraïbes et il y avait des boutiques qui vendaient des bananes plantains, des patates douces, de la sauce piquante, des mangues et de la morue salée, toutes les saveurs des Caraïbes ramenée de l’autre côté de l’Atlantique à ce quartier de la ville. Enrobés d’huile, de sucre et de piments forts, assaisonnés d’oignons et de thym, modifiés, durcis rendus âcres et rances par la distance, ces aliments seraient difficilement reconnaissables si quelqu’un d’ici se donnait la peine de retourner à cet endroit jadis appelé le pays » (Brand 2011, p. 180).
À la faveur de la narration des trajectoires des différents personnages, on retrouvera, dispersées çà et là, des descriptions similaires des autres quartiers ethniques de la ville, Chinatown, Korean town, Little Italy, Greektown, etc. Ensemble, elles dessinent le portrait, approximatif et plein de trous, d’une ville dont l’aspect pluriel est presque toujours en avant-plan.
Il n’est pas question ici de proposer une évaluation normative de la « réussite » littéraire de Brand en fonction des ambitions qui l’animaient pour écrire cette œuvre. L’examen de quelques-unes des stratégies narratives mobilisées dans son roman a tout de même mis en lumière comment il conjugue, comme le suggérait Calvino, « divers savoirs, divers codes, pour élaborer une vision plurielle et complexe » du Toronto contemporain. L’heureux compromis entre les trois grandes formes de romans urbains lui a permis de brosser la géographie d’une ville plurielle et d’explorer, comme nous l’avons vu au chapitre précédent, les multiples façons de vivre la diversité culturelle de la ville au quotidien.
Des romans-géographes 2.0
Toute une série de travaux géographiques sur la littérature se sont penchés sur les dimensions formelles de la création de géographies fictives depuis la fin des années 1990. Qu’il s’agisse de stratégies narratives d’ensemble, comme nous venons de le voir, de descriptions (Brosseau, 2008), de voix narratives (Hones, 2011), de techniques narratives (Savary, 2007) ou de conventions génériques (Tavares et Lebel, 2008), l’accent y est mis sur les dimensions proprement textuelles ou discursives de la littérature (et beaucoup moins, par conséquent, sur l’auteur, les déterminations socioculturelles qui informeraient sa vision du monde). La littérature y est conçue non pas comme le reflet mimétique d’une réalité géographique préexistante, mais bien comme un discours qui génère une représentation du monde qui a le potentiel de déstabiliser et nos façons de le concevoir et de l’écrire, et donc de comprendre les rapports complexes entre modes de représentation, connaissance et réalité. Le rapport à la littérature y est plutôt dialogique. Plus besoin de neutraliser les dimensions fictives du texte (départager les faits de la fiction) ; elles peuvent être sources d’interrogations nouvelles. Loin d’être considérées comme de simples « façons de parler » (ou d’écrire bien sûr), les dimensions formelles du texte (forme, composition, rhétorique, structure et voix narratives, conventions génériques, style, etc.) sont constitutives des géographies alternatives que la littérature génère. En un mot, pour reprendre la formule heureuse de Laurent Matthey (2008), ces travaux s’acharnent à montrer, par divers moyens, que « la forme témoigne ». Or, à la reconnaissance de l’importance de la textualité pour comprendre les rouages discursifs de la géographie qui s’écrit en littérature, qui constitue d’une certaine façon un acquis de la géographie littéraire contemporaine, se greffe progressivement une réflexion plus soutenue sur la fictionnalité littéraire et ce qu’elle peut nous apprendre d’un point de vue géographique. Ce mouvement suit d’ailleurs les transformations des grandes préoccupations de la critique et de la théorie littéraire comme nous le verrons maintenant.
De la textualité à la fictionnalité
Les travaux de géographie littéraire, même ceux qui ont accordé à la textualité une importance centrale, sont rarement tombés dans les pièges d’un textualisme radical, comme si le monde des représentations littéraires n’était jamais en rapport avec le monde extérieur ou d’une véritable pertinence pour le penser. Comme si le texte, littéraire ou non, ne savait bien parler que de l’objet qu’il a lui-même construit et que le travail du critique ne consistait qu’à démonter les échafaudages discursifs dont il procède. Le fait que l’on n’y cherche pas nécessairement de références directes, concrètes, avec de vrais lieux, de vrais paysages avec lesquels on pourrait les comparer pour en mesurer « empiriquement » l’exactitude, comme ont cherché à le faire les premiers géographes qui s’intéressaient à la valeur « documentaire » du texte littéraire, ne change rien au fait que la géographie n’a jamais totalement abandonné la référence au monde. En s’inspirant d’une certaine théorie littéraire structuraliste ou poststructuraliste française en vogue dans les années 1970 et 80, en recourant aux outils d’analyse de la narratologie par exemple, certains travaux ont certainement pu négliger la référence au monde et, avec elle, la fonction mimétique de la littérature. En 1988, dans son ouvrage récemment réédité, Les univers de la fiction, Thomas Pavel écrivait :
« Depuis déjà vingt ans, la poétique du récit a pris pour objet le discours littéraire dans sa formalité rhétorique au détriment de sa force référentielle, resté à la périphérie de l’attention critique. Or, une théorie rééquilibrée de la littérature ne peut se restreindre aux enquêtes formelles, pour importantes que soient ces dernières ; elle doit, tôt ou tard, aborder les questions de sémantique. Et si les poéticiens en ont jusqu’à tout récemment différé l’examen, la philosophie et l’esthétique analytiques leur ont, en revanche, consacré des efforts considérables » (Pavel, 1988, p. 7).
En insistant sur les dimensions formelles du texte, en un mot sur sa poétique, on pouvait perdre de vue leur pertinence pour penser le rapport au monde. Cependant, « le déni de la faculté référentielle de la littérature » qui fut, selon Antoine Compagnon, caractéristique de la théorie littéraire française (Barthes l’affirmant en recourant à l’idée d’effet de réel ou Riffaterre à celle d’illusion référentielle par exemple), n’a pas été adopté, en tout cas jamais radicalement, par les géographes s’intéressant à la littérature.
Dans Le démon de la théorie, Antoine Compagnon a bien diagnostiqué la fausse alternative, « soit la littérature parle du monde, soit la littérature parle de la littérature » (Compagnon, 1998, p. 113). Autant la vieille querelle des anciens et des modernes qui hier opposait un Picard et un Barthes semble-t-elle dépassée, autant la querelle correspondante qui oppose poststructuralisme déconstructiviste et néo-réalisme est-elle aussi un peu tombée en désuétude. Bien rares sont ceux qui refuseraient aujourd’hui de reconnaître l’importance de la fonction médiatrice du langage, dans sa chair, ses formes et sa rhétorique de même que le poids de conventions génériques. De la même façon, le fait que la littérature ne nous parle pas uniquement de textes et de relations intertextuelles mais bien aussi du monde et du rapport au monde, que ce soit de façon directe, indirecte, oblique, allusive, etc., ne soulève ni passions ou objections intempestives. Après le passage d’une « ancienne » critique historique ou positiviste à la « nouvelle » critique structuraliste ou poststructuraliste, Compagnon annonce (ou constate) la « réintroduction » de la réalité dans la littérature :
« on est passé, avec la théorie littéraire (…) d’une totale absence de problématisation de la langue littéraire, d’une confiance innocente, instrumentale – dissimulant, si l’on veut, à coup sûr des intérêts objectifs, comme on disait à une époque – dans la représentation du réel et l’intuition du sens, à une suspicion absolue de la langue et du discours, au point d’exclure toute représentation. (…) Ainsi, réintroduire de la réalité en littérature, c’est encore une fois, sortir de la logique binaire, violente, tragique, disjonctive, où s’enferment les littéraires – ou bien la littérature parle du monde, ou bien la littérature parle de littérature –, et revenir du plus ou moins, de la pondération, de l’à-peu-près : le fait que la littérature parle de la littérature ne l’empêche pas aussi de parler du monde » (Compagnon, 1998, p. 147).
C’est à la fin des années quatre-vingt, à la faveur d’un certain tournant textuel, que se dessine un passage comparable – de la confiance aveugle à la suspicion à l’égard de la langue – en géographie. Les géographes soucieux de séparer le bon grain (factuel) de l’ivraie ou ceux qui cherchaient dans la littérature des traces d’une transcription de l’expérience des lieux le faisaient avec « une absence totale de problématisation de la langue littéraire ». La suspicion des géographes littéraires envers la langue et le discours ne fut pas, en tout cas exceptionnellement, absolue. Ultimement, et quelle que soit l’approche préconisée ou l’intensité de l’attention portée à la textualité, même dans ses dimensions les plus techniques, le monde ou le rapport au monde demeure à l’horizon comme objet de préoccupation.
Cette « réintroduction de la réalité en littérature », coïncide avec une réévaluation de sa fonction mimétique : « Réévaluer la mimèsis malgré l’opprobre que la théorie littéraire a jeté sur elle, reprend Compagnon, cela revient d’abord à souligner son lien avec la connaissance, et par là au monde et à la réalité » (Compagnon, 1998, p. 150). Le regain d’intérêt pour les « romanciers du réel » n’est pas étranger à ce processus de réévaluation de la mimésis (Dubois, 2000). Régine Robin (1989) observe d’ailleurs, à pareille époque, une certaine réintroduction de la réalité dans le roman français lui-même, réalité un peu boudée par la vogue du nouveau roman par exemple. Tout cela commande aussi que l’on déplace le centre d’attention critique, un peu moins sur le texte dans sa poétique et un peu plus sur le monde représenté. Par voie de conséquence, on ne mobilisera plus les mêmes ressources théoriques. Du point de vue philosophique, au moins deux grandes traditions seront mises à profit, la tradition herméneutique d’une part et la philosophie analytique de l’autre.
Les travaux importants de Paul Ricœur sur la mimésis, dans Temps et récit plus spécifiquement, fournissent un cadre très fécond pour réfléchir aux rapports entre le monde et le texte, notamment en cessant de penser la mimésis comme un simple reflet ou copie de la réalité mais bien comme une « imitation créatrice » qui fait d’elle « une forme spéciale de la connaissance du monde humain ». Sans négliger les travaux de la poétique et de la sémiotique, il cherche à développer une herméneutique plus générale des manifestations du temps dans le récit, tant historique que fictif. Avec la mimésis I, le récit procède à une préfiguration du temps humain dont l’expérience demeure pour ainsi dire chaotique et disloquée sans sa médiation. Avec la mimésis II, aussi appelé mise en intrigue, le récit procède à une configuration du temps. En faisant aussi intervenir la réception (et donc le lecteur), la mimésis III, le temps est reconfiguré. La connaissance de soi et du monde passe par leur mise en récit. Bien que l’espace et les lieux soient peu thématisés dans ce travail de Ricœur, on peut facilement deviner que, comme pour le temps, le roman ouvre à la manifestation de l’espace « une carrière illimitée ». C’est d’ailleurs à ce travail que des géographes comme Berdoulay et Entrikin se sont consacrés (Entrikin, 1991 ; Berdoulay et Entrikin, 1998 ; Berdoulay, 2000).
Pour remettre en valeur la « force » référentielle de la littérature, plusieurs travaux cherchent plutôt des appuis du côté de la philosophie analytique. Refusant par exemple l’idée selon laquelle » les textes poétiques ne parlent point du monde mais uniquement d’eux-mêmes et d’autres textes » ou encore que le « monde extérieur a perdu toute autonomie référentielle », Pavel mobilise les résultats de la logique modale et la notion de « mondes fictionnels » qui sont « les principaux dépositaires des moyens référentiels de la littérature » (Pavel, 1988, p. 150 et p. 185). La réflexion contemporaine sur les mondes possibles, ou sur « l’espace des possibles » ouvert par la fiction, se prolonge dans tout un ensemble de travaux critiques contemporains (Lavocat, 2016, par exemple) dont la géographie littéraire contemporaine commence à exploiter les ressources (Dupuy, 2019). Réfléchissant lui aussi à partir de la philosophie analytique, Jacques Bouveresse, critique de longue date de la philosophie continentale post-structuraliste (Bouveresse, 1984), examine pour sa part le type de connaissance de l’écrivain et s’interroge sur ce qui « fait exactement la spécificité, considérée comme une voie d’accès, qui ne pourrait être remplacée par aucune autre, à la connaissance et à la vérité » (Bouveresse, 2008, p. 30). Ces recherches et bien d’autres, participent d’un mouvement plus général de réflexion sur « ce que peut la littérature » (Finkielkraut, 2006), sur les limites d’un enseignement littéraire trop axé sur les dimensions techniques du texte au détriment de son contenu moral, sur les pouvoirs de la littérature pour formuler toute sorte de propositions sur le bon vivre ou encore pour produire un sens permettant au lecteur « de mieux connaître l’homme et le monde, pour y découvrir une beauté qui enrichit son existence » (Todorov, 2007, p. 24-25).
C’est dans cette perspective que se concentre un certain nombre de travaux géographiques récents. Une nouvelle génération de travaux français poursuit la réflexion sur ce que la littérature peut apporter à la géographie (Rosemberg, dir. 2016). Ceux-ci s’intéressent moins aux dimensions formelles du texte littéraire et plus à ses dimensions fictionnelles, en un mot l’autre versant de ce qui fait d’un texte, un texte littéraire (ou sa littérarité). Les réflexions que mène Muriel Rosemberg depuis une dizaine d’années prolongent ce type de dialogue avec la littérature, en cherchant à mieux cerner quel type de connaissance géographique la littérature peut produire (Rosemberg, 2012). Or, le dialogue ne se situe pas tant sur le plan de la textualité comme telle, en tout cas pas dans ses dimensions proprement discursives voire techniques, mais bien sur le romanesque ou les possibilités ouvertes par la fiction de façon plus générale. Rosemberg s’inspire, elle aussi, de la conception du roman que propose Kundera à l’effet qu’il y a tout un pan de l’existence humaine que « seul le roman peut découvrir », ou que « ‟les romanciers dessinent la carte”, non pas de la réalité, mais ‟de l’existence”, c’est-à-dire ‟le champ des possibilités humaines, tout ce que l’homme peut devenir, tout ce dont il est capable” » (Kundera, 1987, cité par Rosemberg, 2016, p. 406). Elle cherche dans la littérature « ce que la science ne vise pas à montrer ou peine à dire » (idem, p. 406). Or, c’est plutôt dans la substance des représentations littéraires, et moins sur le plan des techniques qui les produisent, qu’elle cherche réponse à ces interrogations. C’est parce que la littérature décrit des expériences « possibles » et non nécessairement « réelles », que la pensée y est exprimée plus en images qu’en raisonnement, qu’elle produit une forme de connaissance géographique différente dont la géographie devrait s’inspirer. Ce ne sont donc pas tant les possibilités formelles qu’offre le roman pour la représentation de l’espace qui lui est le plus important. Ce sont plutôt les multiples façons dont la littérature peut nous aider à penser la « géographicité » en tant que « dimension vécue de l’espace et des lieux », telle que la conçoit Besse dans le prolongement des réflexions de Dardel (Besse, 1990 ; 2009).
Lorsque Fabienne Cavaillé s’interroge sur « ce que peut la littérature pour la géographie », elle s’inscrit directement dans ce sillon. Elle explore les propriétés des fictions littéraires destinées à la jeunesse qui, « en tant qu’expérience de pensée, fournissent aux lecteurs des mondes possibles, des mondes mixtes occasionnant des allers et retours entre imaginaire et réel » (Cavaillé, 2016, p. 246.). Pascal Clerc mène une réflexion similaire sur les caractéristiques spatiales des situations romanesques dans le roman Épépé de l’écrivain hongrois Ferenc Karinthy. Le héros du roman est parachuté dans une ville parfaitement étrangère et, ne possédant aucune connaissance de la langue ou du lieu, il doit parvenir à s’y repérer. Cette situation géographique invraisemblable constitue, selon Clerc « une forme d’expérience spatiale qui mobilise des savoirs géographiques » et met en jeu « dans des circonstances extrêmes, des concepts spatiaux et spatialisés : se repérer, communiquer, habiter ». Et si l’étude de la littérature n’apporte que peu de réponses concrètes aux géographes, elle fournit tout au moins « des questions qui permettent d’interroger la spatialité des individus » (Clerc, 2016, p. 295 et 306). Le roman devient alors une forme d’exploration des possibles géographiques qui met à profit les ressources de la fiction pour y parvenir (Desbois et al., 2016). Les travaux de Dino Gavinelli sur les transformations de Milan dans la poésie italienne contemporaine procèdent d’une conception comparable du rôle que peut jouer la littérature : il la mobilise « pour sa capacité à développer un autre regard sur l’espace » (Gavinelli, 2016, p.336)
Le rapport à la littérature continue ainsi de se penser en termes dialogiques : elle ouvre des questions, propose des axes de réflexion, suggère des modes des connaissances moins théoriques, plus conceptuels ou pratiques, etc. L’esprit dans lequel se pense la rencontre est tout à fait compatible avec l’idée des « romans-géographes » telle que formulée il y a plus de 25 ans. Mais la rencontre se situe sur un terrain un peu différent en relation avec des horizons théoriques ou disciplinaires eux aussi différents à la faveur des évolutions intellectuelles : un peu moins de Foucault, Barthes, et Genette, un peu plus de Pavel, Compagnon et Bouveresse par exemple. Cela contribue à repenser les termes et les objets de la réflexion géographique sur la littérature.
Or, il s’agit bien d’une question de degrés et de focale, et non d’incompatibilité épistémologique. L’examen des aspects plus techniques d’un texte contribue à une meilleure compréhension des modalités par l’entremise desquelles les possibles de la fiction prennent forme. L’examen plus formel des stratégies narratives déployées dans le roman de Dionne Brand pour brosser un portrait pluriel de Toronto par exemple, permet de mieux comprendre comment s’exprime l’expérience urbaine des personnages au quotidien. Cela met aussi en lumière les différences importantes entre le mode romanesque d’exploration de ces enjeux et l’analyse qu’en font les sciences sociales. S’interrogeant par exemple sur les « découvertes » du roman concernant la vie dans un monde bureaucratisé Kundera écrit : « Weber a fait une analyse sociologique, historique, politique du phénomène de la bureaucratie. Stifter se posait une autre question : vivre dans un monde bureaucratisé, qu’est-ce que cela signifie in concreto pour un homme ? Comment son existence en est-elle transformée ? (Kundera, 2005, p. 157). L’exploration fictive de la géographie sociale torontoise dans le roman de Brand pose le même type de question : « vivre dans une ville multiculturelle, qu’est-ce que cela signifie in concreto, pour des enfants d’immigrants ? Comment leurs existences en sont-elles transformées ? ». Se pencher sur les dimensions formelles du texte ne fait qu’enrichir notre compréhension de ce que le roman peut nous apprendre, en substance, en matière de connaissances géographiques comme nous l’avons vu au chapitre précédent.
Dans son dernier essai, Dupuy prolonge la recherche ouverte par les travaux des géographes qui ont accordé à la textualité une attention plus assurée en la combinant notamment aux apports théoriques des travaux sur les mondes possibles de la fiction (Dupuy, 2019). Il illustre tout l’intérêt qu’il y a à conjuguer le type de regard éloigné qui embrasse l’ensemble de l’univers géographique fictif d’un roman avec une lecture rapprochée qui examine, à l’échelle de la phrase ou du paragraphe, les procédés narratifs ou encore rhétoriques à l’œuvre dans le texte. Cela prend la forme, à l’échelle macro, d’une analyse des stratégies de brouillage référentiel qui président à la création de l’espace fictif dans Le Rivage des Syrtes, lequel relève, selon Dupuy, d’une forme particulièrement achevée de syncrétisme géographique, défini comme une « fusion d’éléments géographiques et historiques différents, éloignés et disparates dans le référent réel, qui, dans la fiction romanesque, tendent à former un tout cohérent et plausible, avec des lois qui lui sont propres et qui ne déroutent pas autant le lecteur » (Dupuy, 2019, p. 47) . À l’échelle micro ou syntaxique, c’est plutôt par l’entremise d’un repérage minutieux et des différents types de métaphores (synecdoques paysagères et métaphores métonymiques, hypallages à fondements métonymique et oxymorique, etc.) que sont examinées les transformations de la relation du narrateur de À la recherche du temps perdu avec les lieux. C’est grâce à ce type de lecture sensible à la textualité que l’on peut suivre le passage « d’une conception de l’espace qui est d’abord discontinue à celle d’un espace continu où les lieux sont finalement reliés » (Dupuy, 2019, p. 29), et mettre en lumière la représentation et l’interprétation de l’espace dans La recherche ou encore sa géographicité particulière.
Les tournants culturel et textuel se sont produits à peu près en même temps en géographie humaine. Si le premier a surtout contribué à politiser l’étude des phénomènes culturels en général et celle de la littérature en particulier, le second a plutôt incité les géographes à prendre le texte littéraire au sérieux, dans sa forme et ses fictions, sur fond d’ambiance postmoderne. Si le premier a surtout informé l’approche géographique de la littérature dans le monde anglo-saxon, le second s’est davantage manifesté dans la géographie d’expression française. Ensemble, ils résument l’essentiel des nouveaux développements de la géographie littéraire des années 1990 et 2000. Les deux approches, évoluant en parallèle, se sont aussi mutuellement influencées. De sorte qu’il n’est pas rare qu’une analyse plutôt politique des enjeux de la représentation soit sensible à la textualité qui les porte. L’inverse est aussi fréquent. Mais la réflexion sur ce que la littérature peut apporter à la géographie en matière de connaissances ne partage pas cette préoccupation presqu’obsessive sur l’inégalité des rapports de pouvoir. Comme nous le verrons dans la deuxième partie, les études les plus prometteuses ou les plus achevées sont d’ailleurs celles qui réussissent à interpréter la géographie des œuvres en relation avec les formes qui les produisent et les ressources de la fiction qui multiplient les façons de l’imaginer.
Notes
- « Lorsque mis en parallèle avec la variété des stratégies textuelles que recouvre le roman contemporain… le caractère conservateur de bon nombre des géographes les plus radicaux est vraiment étonnant » (Gregory, 1989, p. 90).
- Cette absence n’est évidemment pas complète, même à l’époque. Je pense ici, du côté des littéraires, à Jourde (1991) et à Roudaut (1990). En anglais, Lutwack (1984) est certainement un des meilleurs exemples. Chez les géographes, la première véritable tentative d’interfécondation remonte à 1987, avec le collectif de Mallory et Simpson-Housley.
- Les travaux de Lévy (1989 et 1992) sur l’espace existentiel dans l’œuvre de Herman Hesse, dont il a été question dans le chapitre 1, est aussi symptomatique de la réticence des géographes humanistes à recourir à la théorie littéraire.
- « J’ai appris à connaître les villes, comme Paris ou New York ou autre, en lisant à leur sujet. (…) Donc quand je suis allée à New York, je savais où j’étais. (…) Je pensais que cette ville valait la peine d’être connue de cette façon. (…) Ce qui m’a intéressée, c’est qu’il y a plusieurs communautés, mais elles ne vivent pas de manière complètement discrète les unes des autres ; elles se chevauchent » (Brand, en entrevue avec Susan Walker, 2005, p. E04).
- « Le ‟nous” du nouveau roman de Dionne Brand, What We All Long For, implique l’inclusion de désirs partagés. C’est nous, Toronto, la ville qui se vante d’être l’endroit le plus multiculturel du monde. Il était grand temps que cela apparaisse ainsi dans notre fiction. Nous avons eu le Toronto des WASP, le Toronto italien, le Toronto antillais, le Toronto sud-asiatique – toutes les diasporas. Mais Brand est la première romancière de Toronto à présenter une génération née et élevée dans ce masala de cultures, de croyances et de nationalités » (Walker, 2005, p. E04).