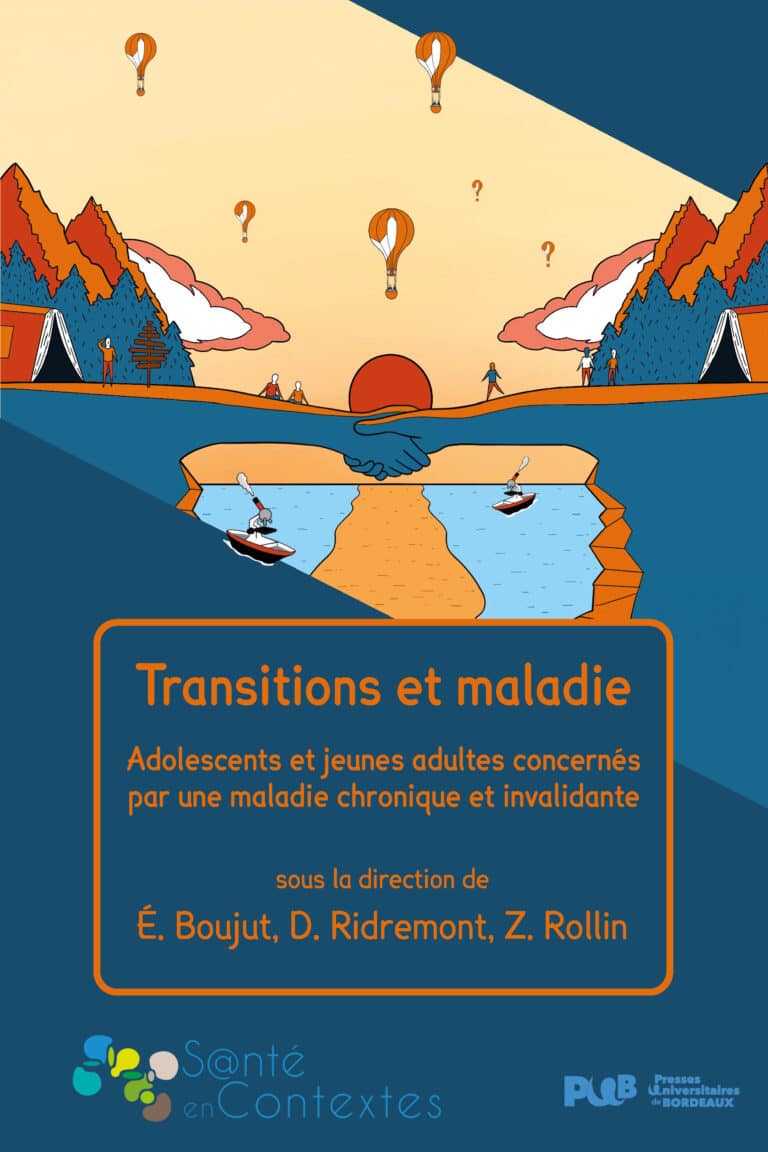Médecin, j’ai travaillé pendant 20 ans comme Praticien Hospitalier puis cheffe de service auprès des personnes touchées par le « grand handicap » (c’est-à-dire, handicap nécessitant une aide humaine), tout particulièrement celles affectées par une lésion cérébrale. C’est mon expérience personnelle, moi-même touchée par une maladie rare d’origine génétique (Boucand, 2022), qui m’a conduite à travailler sur les maladies rares génétiques et leur retentissement sur le soin et leurs conséquences sociétales.
Dans le cadre d’une thèse de philosophie (Boucand, 2015, 2018), nous avons recueilli, lors d’entretiens à leur domicile, la relecture du vécu de 16 patients, dont cinq parents, les 11 autres étant des adultes avec des pathologies génétiques variées. Nous avons sélectionné, pour les adultes, le groupe des personnes myopathes (myopathie de Duchenne et myopathie facio-scapulo-humérale, amyotrophie spinale), deux personnes touchées par une maladie sensorielle (maladie de Stargardt1, deux frères), deux personnes touchées par le syndrome d’Ehlers-Danlos hypermobile 2(maladie à expression variable et non visible), une personne touchée par la maladie de Strümpell-Lorrain3, ainsi qu’une personne touchée par une spondylarthrite épiphysaire congénitale conduisant à une petite taille et a une autre ayant la maladie de cutis laxa4 maladie à expression visible.
Afin qu’il y ait aussi la présence d’une personne ayant une maladie à expression viscérale, ou maladie chronique à proprement parler, nous avons retenu une personne ayant de l’hypertension artérielle pulmonaire d’origine génétique.
Pour les entretiens avec des parents, nous avions retenu une mère dont l’enfant avait le syndrome d’Ehlers-Danlos classique5, deux ayant le syndrome de Rett6, et une mère d’une enfant ayant la maladie de cutis laxa, enfant qui avait été très médiatisée lors du Téléthon en 2000. Enfin, nous avons retenu une maladie en lien avec un handicap mental et cognitif afin d’illustrer tous les handicaps d’origine génétique tels que définis dans la loi de 2005, ce qui nous a conduits vers le syndrome Kabuki7 d’un enfant dont nous nous sommes entretenues avec le père.
Les entretiens ont été de type qualitatif semi-directif avec une phase exploratoire et une question largement ouverte : « pouvez-vous me parler de votre histoire, de la survenue et de votre vécu de la maladie, de son diagnostic, de son évolution, de son retentissement ? ». La consigne initiale visait à permettre une parole narrative spontanée à partir du point de départ choisi par la personne, avec le moins possible d’induction et de suggestion de notre part. Quand une tournure de phrase ou une métaphore étaient utilisées, nous avons systématiquement vérifié que la compréhension que nous en avions était correcte, par une reformulation soit pour enrichir le contenu, soit pour en diminuer le biais d’interprétation.
Un guide d’entretien a été établi : la première partie portait sur la période qui précédait le diagnostic, puis était abordé le moment du diagnostic, et enfin la description et le vécu du retentissement de la maladie. Le temps était à la disposition de la personne.
Nous avons volontairement induit le moins possible le discours. Les grandes thématiques du vécu ont ainsi pu être identifiées secondairement à l’analyse des entretiens : l’expérience pathique de l’éprouvé, les modèles de représentation de la rareté et de la génétique, les métaphores utilisées pour les dire, le lien avec le corps médical et l’expérience sociale des patients.
Nous nous sommes inspirées des grandes lignes du McGill Illness Narrative Interview mis au point par Groleau, Young et Kirmayer dans sa version de 2006. Ce questionnaire est construit autour de plusieurs axes principaux :
- la parole spontanée sur la maladie, les symptômes et l’enchaînement des différents événements ayant trait au problème de santé actuel ;
- les prototypes basés sur des expériences passées, personnelles, ou de l’entourage familial et social, les représentations populaires et celles des médias, à partir desquelles les patients construisent leur raisonnement en utilisant des images ou des métaphores ;
- les modèles explicatifs, à la recherche de cause, les attentes vis-à-vis de la prise en charge et des traitements, les perspectives ;
- l’impact de la maladie sur l’identité du patient, sa perception de lui-même, et celle du regard des autres (famille, société).
Nous avons peu exploré l’itinéraire thérapeutique traditionnel ou alternatif, et l’adhésion aux traitements (section 4 du McGill), ceux-ci étant très limités compte tenu de la rareté des maladies pour lesquelles il n’y a parfois pas de traitement proposé, mais le parcours thérapeutique a été parfois abordé spontanément lors de l’entretien. Nous avons retenu parmi toutes les méthodes phénoménologiques proposées celle de Amadeo Giorgi, psychologue américain, initiateur d’une approche phénoménologique qualifiée de « méthode phénoménologique scientifique » (Giorgi, 1997). Il propose plusieurs étapes : celle de la collecte des données verbales, le protocole descriptif, l’adoption de la réduction par le chercheur le conduit à mettre entre parenthèses les connaissances passées, et tirer le sens général, global de l’ensemble de la description du phénomène étudié.
À partir d’une lecture très lente et détaillée, il faut identifier les unités de signification naturelles en discriminant le sens de chacune d’elles. Les idées maîtresses contenues dans les extraits d’unités de signification ou unités de signification approfondie sont regroupées en sous-thèmes et en thèmes. La synthèse des résultats dresse la structure typique du phénomène étudié. Il s’agit alors de ne garder que les unités de signification qui sont essentielles au phénomène étudié. La dernière phase proposée par Giorgi est un travail de reconstruction. Ce qui est important est de connaître l’expérience vécue. Cette synthèse finale est porteuse de sens et décrit le phénomène étudié tel qu’il est vécu et non tel qu’il est conçu. Nous nous sommes donc fortement inspirées de cette méthode, point par point, chaque texte verbatim a été annoté en structures primaires. Puis, nous avons regroupé chaque structure primaire en une carte heuristique, dans laquelle les variations proposées par les sujets eux-mêmes apparaissaient. Les différentes cartes nous ont conduits à repérer les grands thèmes abordés par les informateurs.
La survenue d’une maladie rare génétique
Dès les premiers entretiens, nous avons perçu combien l’irruption d’un diagnostic de maladie rare d’origine génétique impacte l’ensemble de la constellation familiale et touche la triade père/mère/enfant (Scelles, 2007, p.18).
C’est un événement très violent qui touche la personne dans toutes ses composantes, sa subjectivité, son identité comme son intimité. Les caractéristiques de cette situation particulière résident dans la déstabilisation des repères identitaires de la personne malade jusqu’à celui de sa filiation. La maladie est à l’origine d’une perte majeure de repères, déstructurant, proche de l’expérience du chaos. Le patient, enfant ou adolescent et sa famille doivent convoquer et inventer toutes sortes de stratégies pour pouvoir vivre avec cette contingence, de façon définitive, puisque le plus souvent sans guérison.
Ces stratégies sont multiples et permettent aux personnes d’apprivoiser au mieux leur situation et de la communiquer. La plus basique, mais parfois difficile, est l’explicitation, le besoin de mettre des mots sur ce qui est vécu ou éprouvé : « j’en parle quand ça devient trop lourd pour moi et qu’il faut que la personne comprenne ! ».
L’humour ou la dérision font partie de la trousse à outils : « J’aime bien rigoler aussi de ma taille » nous dit Corinne de petite taille, qui continue « Comme les entreprises ont besoin des personnes handicapées pour leur quota. Ils les chouchoutent ! C’est pas plus mal pour nous ! » et précise à propos de l’aide financière qu’elle a pu obtenir qu’elle « [a] la chance d’être sponsorisée par ma banque qui me paye une partie de la femme de ménage une fois par semaine et c’est parfait… ». Corinne est « gogo danseuse » le week-end, et quand elle parle de l’intérêt de ses spectacles, elle le fait encore avec beaucoup d’humour : « Je suis une bonne vivante au milieu d’eux et j’aime bien discuter avec eux, leur dire des petites bêtises ou taquineries, j’aime bien rigoler aussi de ma taille ! Et j’aime bien quand ils en rigolent aussi parce que là c’est tout gagné. » Et parlant de ses projets de couple : « Moi j’ai été plutôt avec des hommes de taille classique et dans ma tête je me dis “qu’il ne faut pas accumuler les tares !” parce que si j’ai besoin d’un truc qui est, trop haut s’il est petit comme moi, ça va être compliqué ! »
Clotilde a la même ressource intérieure, ayant eu dès l’enfance un visage aux traits de personne beaucoup plus âgée, elle en parle sous le mode de l’humour, quand elle dit à ses amies : « j’ai de la chance parce que moi je ne vais pas me voir vieillir ! ».
Les patients touchés par une maladie rare génétique ont une représentation très particulière des termes de rare, de génétique et de galère, souvent usités pour désigner le vécu de ces maladies, qui sont pour certaines invisibles. La maladie est le plus souvent étiquetée par le recours à un nom propre (du médecin qui l’a initialement décrite) ou par des chiffres et des lettres qui évoquent la mutation, jusque-là totalement insignifiante pour la personne touchée. Ils vont devenir une part de la construction identitaire de la personne. Ce nom concourt à l’ambiance d’incompréhension sociale qui entoure ces maladies, qui, parfois, ne s’expriment que par une symptomatologie invisible (douleur, fatigue) et ne donnent rien à voir au niveau médical (biologie et imagerie normales), ce qui concourt à un sentiment d’incompréhension et de non-reconnaissance.
La rareté – moins d’une personne sur 2000 – est le critère d’identification de ces maladies. Il est souvent associé à celui de l’errance et de galère secondaires à la méconnaissance de la maladie. Dans ce contexte, la conjonction de la rareté et de la génétique concourt parfois à une objectivation de la personne malade et à son isolement, au risque de la réduire à sa seule maladie et/ou à son « anomalie génétique ». « Je suis une mutante » nous dit un jour une patiente ! Terrible identification.
La signification de cette entité nosologique récente de « maladie rare génétique » est déstabilisante dans une société où la médecine est supposée tout connaître, avoir un pouvoir de guérison infini, avec des techniques poussées à l’extrême et sans cesse en progression.
Du côté des parents
Lorsque le diagnostic est posé chez l’un des parents, la question de l’éventuelle transmission à venir et du déroulement d’une éventuelle grossesse est l’une des premières questions posées. « Mon plus gros souci était de savoir si je pouvais le transmettre. On m’a dit qu’il y avait un risque sur deux à chaque fois. Je me souviens m’être dit “et bien finalement je n’aurai jamais d’enfant” parce que je ne voulais pas lui transmettre ».
La maladie peut être héritée d’un ou des parents eux-mêmes touchés, selon les modes de transmissions biologiquement connus, ou être une mutation de novo. Donner la vie s’articule alors avec le risque de donner une anomalie génétique, la vie et la mort sont mêlées au sens de la tragédie grecque.
Les grossesses sont parfois interrompues volontairement de façon précoce si le fœtus est atteint. Si l’un des autres enfants est déjà né et atteint, le retentissement peut être majeur pour lui. « Ma vie ne vaut rien, si mes parents avaient su ils m’auraient supprimé ! ».
Dès que le diagnostic est posé sur un des enfants, les parents témoignent tous de la recherche qui a été faite pour savoir si leurs autres enfants, déjà nés, étaient atteints de la même maladie. C’est comme s’il était nécessaire de circonscrire l’étendue de l’atteinte et de protéger ainsi les descendances des autres enfants. « C’était important pour moi de savoir qu’aucun des frères et sœurs étaient porteurs et qu’aucun de mes petits enfants n’étaient porteurs non plus et que c’était une mutation spontanée. ».
S’associe, pour l’adulte touché, la recherche de l’origine de la maladie génétique qui fait parcourir l’historique de la famille, l’arbre généalogique, les souvenirs des aïeux pouvant aider. « C’était mon père qui était susceptible d’être porteur de la maladie et peut-être atteint lui-même, il s’est renseigné auprès de ma grand-mère, si elle avait entendu qu’il y avait dans la famille un problème musculaire, mais elle ne se souvenait pas de quoi que ce soit. ».
Les prélèvements sur l’ensemble de la famille, parfois stockés longuement, permettent même tardivement « d’innocenter » les parents quand la mutation de la maladie est enfin identifiée. Après la découverte de la mutation de novo de leur fille, la mère de P. nous confie : « Le fait de savoir que ni son père ni moi, on n’était porteurs de quoi que ce soit, ça fait du bien ! ».
Parfois, malgré toutes les recherches, aucun diagnostic n’est posé et il est très difficile de ne pas savoir le nom de sa maladie. L’errance est maximale. Elle conduit à une incapacité de se projeter, surtout quand on avait dit aux parents dès la naissance que leur enfant ne vivrait pas et que 20 ans après, ils le portent toujours à bout de bras.
Si la maladie est diagnostiquée dès la naissance, « la fête de la naissance se nimbe de déception, de chagrin et de souffrance injuste et inutile. Le bonheur s’enfuit […]. ». Avec la question de l’indicible : « comment faire comprendre aux autres cette épreuve cruelle ? » (Gardou, 2012 p.12).
Le travail psychique nécessaire pour vivre avec la maladie touche tout particulièrement la mère dans son lien avec l’enfant malade. Tout est centré sur la mère peut-être parce qu’ « elle est la trace-témoin du manquement maternel récent en cas de mutation génétique […] Si le gène est transmis par le père, c’est paradoxalement tout de même la mère qui est imaginairement responsable de n’avoir pas su protéger son bébé » (Aubert-Godard, 2005). La mère devient ainsi responsable de la bonne ou mauvaise « fabrique » de l’enfant à venir, sous-entendant des capacités à être une bonne ou une mauvaise mère.
Nous avons aussi, dans les échanges avec les mères de jeunes patients, senti combien c’est la mise au monde, l’accouchement qui est alors mobilisé comme seul initiateur de la maladie. Comme si c’était ce qui sort du corps de la mère, chair de sa chair, en germination pendant neuf longs mois, qui met en cause ses propres capacités à engendrer de l’humain, à faire don de la vie. Nous touchons-là le retentissement existentiel pour la mère de transmettre la vie altérée biologiquement par une maladie génétique. C’est comme si le biologique devenait l’unique objet de la transmission et de la filiation : « il est fréquent dans ces situations si complexes pour les parents, qu’une transposition entre filiations biologique et symbolique se produise, comme si tout ce qui allait se transmettre à l’enfant pouvait se résumer en un mot : “le gène” ». (Gargiulo, 2002)
De façon récurrente, la culpabilité de la mère est évoquée lorsque l’enfant est touché « parce que pour une maman c’est trop difficile […] Cette culpabilité de donner une vie difficile alors que l’on veut donner une vie heureuse, donc ça peut se travailler, s’apaiser un peu, mais il me reste toujours un truc qui me noue la gorge et qui me fera toujours monter les larmes aux yeux ».
La posture des pères est souvent celle du retrait, exprimant plus difficilement comment le handicap ou la maladie de l’enfant les touchent (Scelles, 2007 ; Gardou, 2012).
Le donner naissance s’articule directement avec le spectre de la fragilité et de la mort, insupportables lorsqu’il s’agit de son enfant (Gardou, 2012, p.14). Ce qui est encore plus accablant est la permanence de l’actualisation de la menace, qui vient dire la fragilité de la vie donnée à l’enfant. Si cette menace de perdre un enfant est vraie pour tous les parents, elle est ici de conscience plus aiguë, manifestée par la maladie et ses conséquences qui sont constamment sous les yeux des parents. Accepter que l’enfant ne soit pas parfait est tout un travail narcissique difficile et long, souvent associé à un travail de deuil de l’enfant imaginé (Aubert-Godard, 2006). « La faille génétique est assimilée à une faille narcissique primaire, irreprésentable, mais essentielle, au niveau de l’être » (Aubert-Godard, 2005). « Je veux un enfant parfait, qu’il ne soit pas malade, qu’il réussisse sa vie, qu’il n’ait aucun des défauts de la terre, l’enfant idéal ! Or aucun de nos enfants n’est normal ! Ils sont tous classiques avec leurs différences et Clotilde est tout aussi classique que ses frères et sœurs ! ».
Cette culpabilité de la naissance d’un enfant différent ou malade ravive parfois des culpabilités enfouies et non dites : « Mes parents sont cousins germains […] et il reste en moi une miette de culpabilité qui est l’âge que j’avais à la naissance de Clotilde. J’avais 37 ans et on sait que les grossesses tardives augmentent le risque de mutations au moment de la procréation. ».
Rarement, mais c’est possible d’être dans la situation qu’Anne Aubert Godard (2005) propose sous le terme de « filiation inversée », il s’agit d’un des parents dont le diagnostic a été porté à partir de celui fait sur un des enfants : « Le généticien m’a dit : “Madame, ça peut être un gène mutant, mais ça peut aussi être héréditaire”. Je lui ai raconté mes difficultés, il m’a dit : “il me semble que ce n’est pas mutant chez elle.” », et le diagnostic a été posé sur la mère en même temps que sur l’enfant. Quel poids imaginaire pour l’enfant d’être responsable du diagnostic de la maladie chez sa mère !
L’annonce du diagnostic marque un avant et un après. Même si l’annonce peut être vécue parfois comme un soulagement lorsque l’errance diagnostique a été longue, son annonce peut aussi être vécue comme très violente, surtout si un pronostic vital est sous-entendu et qu’aucun soutien n’est prévu après l’annonce : « Une fois la porte fermée, il n’y avait personne qui aurait pu me dire « madame vous venez d’avoir une annonce violente, est-ce que je peux vous aider à quelque chose ? » […] on nous a tout déballé sur toutes les formes de cutis laxa, avec tous les symptômes associés de toutes les formes […] tous les organes pouvaient être atteints y compris un retard mental et avec une épée de Damoclès d’emphysème et voilà… « Allez démerdez vous avec ça ! »
L’attitude des parents va retentir sur l’ensemble de la cellule familiale, déstructurée par l’annonce du diagnostic. Charles Gardou dans « Frères et sœurs de personnes handicapées » évoque la difficulté des parents à mettre des mots quand « les parents “ne parlent” pas l’évènement au risque que le silence, qui prend force de loi, garde ainsi enfoui le malheur advenu » et « les mots interdits génèrent, on le sait, la plus profonde des solitudes » (Gardou, 2012, p.14). Nombre sont les facteurs qui vont ainsi interagir dans le « roman familial » où l’un des enfants est en situation de vulnérabilité.
« Les uns […] dénient la réalité du handicap. Certains s’oubliant eux-mêmes, consacrent entièrement leur vie à leur enfant. D’autres s’immergent dans de fortes responsabilités associatives, professionnelles ou politiques […] Malgré ces stratégies adaptatives et ces comportements de mise à distance, les parents sont souvent exténués par l’accompagnement sans trêve de leur enfant handicapé. Leurs ressources vitales sont laminées. » (Gardou, 2012, p. 20-21).
Le retentissement sur la fratrie d’un enfant touché
Comme pour le diagnostic d’un parent, le diagnostic d’un enfant peut conduire au diagnostic d’un autre membre de la fratrie, permettant de supprimer le temps d’errance qui a été subi pour le premier diagnostic dans la famille. Mais la récurrence du diagnostic est le plus souvent d’une grande violence pour tous.
Si plusieurs de la fratrie sont touchés avec la même maladie, la prise de conscience de la maladie par l’enfant est favorisée : « Aurélien a eu son diagnostic à l’école primaire, on a un an de différence… J’ai très vite compris ce que j’avais et qu’il n’y avait rien à faire ». Mais son frère reconnait qu’être plusieurs ne résout pas tout !
Lorsqu’un des enfants décède de la même maladie, tous les mécanismes de défense peuvent se mettent en route : « Si c’est la même maladie, elle n’évolue pas toujours pareil ! » sinon c’est l’effondrement de l’autre enfant touché encore en vie. L’accompagnement médical et psychologique devient une donnée majeure pour soutenir l’ensemble de la famille.
La fratrie non atteinte d’un enfant atteint est dans une situation où les sentiments de culpabilité, de honte et de réparation se déclinent avec parfois beaucoup de violence (Scelles, 2007, p. 28). Quels sentiments de l’enfant non atteint pour cette sœur ou « ce frère qui respire toutes les forces » et réquisitionne toute l’attention et l’énergie de ses parents et grands-parents ? (Dupont-Monod, 2021) Agressivité, révolte, effondrement, détresse, culpabilité, sentiment d’abandon, honte, solitude, hyper protection du pair malade ou handicapé… Comment l’enfant lui-même doit-il s’adapter à la situation ? C’est ce que nous évoque le magnifique récit du roman de Clara Dupont-Monod (2021) où l’ainé s’adapte à son frère cadet qui présente un handicap majeur, et « en reste prisonnier » (Dupont-Monod, 2021, p. 67). La cadette résume la situation : « l’enfant avait pris la joie de ses parents, transformé son enfance et confisqué son frère ainé » (Dupont-Monod, 2021, p. 74).
L’enfant non atteint adopte des attitudes d’accompagnement et de soutien à sa fratrie. Parfois, il s’imagine même devoir consoler ses parents et tente de leur apporter le moins de soucis possible qui seraient normaux à son âge d’enfant devenu trop vite presque adulte. On connaît la charge des aidants mineurs au sein d’une famille (CCAH, 2019). Ces enfants ou adolescents se sentent souvent investis d’une responsabilité et de rôles trop précoces (Gardou, 2012, p. 29) et qui ne leur reviennent pas, mais qui peuvent aussi les aider à vivre la situation (Scelles 2007, p .28). Certains auteurs évoquent ainsi une « parentification » des enfants (Boszormenyi-Nagy, 1987).
On voit combien il peut être difficile pour l’enfant non touché de trouver sa place, tant dans la fratrie que dans la parentalité et toute la famille. Ces enfants doivent être accompagnés pour être le plus ajustés à leurs ressentis et leurs conséquences psychiques, soit à titre individuel, soit en groupe (CCAH, 2017 ; Negrini et Billy, 2023).
L’enfant ou l’adolescent touché et l’expérience prototypique
L’enfant peut être selon son âge très conscient du retentissement de « son » diagnostic sur le roman familial, même s’il ne le manifeste pas (Gardou, 2012 ; Zucman, 2011). L’attitude de ses parents et du reste de la fratrie, comme celle de l’entourage plus large, est fondamentale dans ce qui sera sa manière à lui de vivre avec la maladie.
Si un parent ou un adulte familièrement proche est touché, il grandit avec le modèle prototypique de l’assimilation de ce qu’est la maladie. Celle-ci se construit, d’après Groleau, Young et Kirmayer (2006), à partir d’une analogie d’expérience et non d’une connaissance théorique ou scientifique. Cette recherche est celle de l’autre semblable dans sa différence, « l’autre différent-comme moi », la « reconnaissance de soi en l’autre » porteur de la même maladie que soi. Cette reconnaissance pointe le sentiment d’être différent des autres, associé à l’angoisse de se « sentir tout seul au monde ». Rencontrer ou savoir que d’autres sont comme soi, si différents, rassure, et la reconnaissance d’un autre peut faire naître un sentiment qui rompt l’isolement. L’expérience est liée à la rareté des maladies étudiées. Pouvoir rencontrer quelqu’un qui a eu la même maladie que soi est une expérience en général banale. Ici, elle devient une expérience qui est fondatrice.
Catherine, touchée par une petite taille, nous évoque cette rencontre : « À 16 ans, j’ai fait ma première rencontre à cet âge avec des gens qui étaient comme moi ! […] C’était un week-end avec du médical, de la fête et des ateliers pour les parents qui ont un petit bébé pas comme les autres et qui se posent plein de questions… ». J’ai rencontré « quelqu’un en qui on se reconnaît, surtout quand notre maladie est plus rare que rare […] ça m’a aidée à pouvoir plus parler de la maladie et d’avoir des contacts avec les personnes non touchées par la maladie ».
Le premier lieu de reconnaissance est celui de la famille quand la maladie touche plusieurs membres de la même famille. Ce vécu familial entre différents membres demande une attention toute particulière portée sur les représentations que les patients de la famille peuvent se faire quant à leur évolution et leur pronostic.
La situation peut être rassurante alors que le même diagnostic est envisagé : « Ça m’a rappelé que mon père avait des problèmes de cervelet et quand je rentrais à la maison le week-end, mon père était de plus en plus malade, et lui avait un diagnostic d’ataxie cérébelleuse. Mais bon, je le voyais continuer de travailler, de planter ses poireaux, mais à genoux, il continuait de s’occuper de ses lapins, il semblait bien, je ne fus pas inquiet quand le diagnostic a été porté ».
La situation peut être angoissante : à l’évocation des tentatives de suicide récurrentes de sa mère, dont une le jour de ses 45 ans, sa fille me confiait : « Maman vient de me signifier, par son geste, qu’au-delà de cet âge il n’est plus possible de vivre avec cette maladie, je lui en veux beaucoup ».
Cette dimension prototypique peut se vivre dans d’autres lieux de socialisation. On peut noter le milieu médical, et tout particulièrement celui de l’hospitalisation. Corinne, qui devra avoir une intervention chirurgicale vertébrale identique à celle des adolescentes qu’elle rencontre au centre, nous exprime le sentiment ressenti à la vue de ce qu’elle pense devoir vivre : « J’avais vu un halo quand j’étais enfant et cela m’avait fait peur, j’étais impressionnée ».
Cette dimension se vit parfois dans les ateliers d’éducation thérapeutique destinés aux patients atteints d’une même pathologie. Ils sont invités dans l’atelier à partager leurs expériences et en ressortent très rassurés de constater et de découvrir que ce sont les mêmes mots qui sont utilisés par les autres patients, de diagnostic identique, pour décrire leur propre vécu.
La médiatisation de la télévision, par le biais du Téléthon ou d’émission grand public, peut aussi être le lieu de l’expérience d’une reconnaissance: « Quand Clotilde est passée à la TV avec “Ça se discute” et en expliquant qu’elle avait la cutis laxa, et là je me suis reconnue en elle par rapport à la peau, j’avais 30 ans. J’ai consulté et le diagnostic de cutis laxa a été posé. ».
Un autre lieu évoqué est celui des associations de patients qui fonctionnent beaucoup dans cette dynamique de la similarité, de la reconnaissance réciproque : « Chez certains de l’asso, on a les mêmes mains […] quand j’étais allée aux US, j’avais vu ces mains […] j’avais vu des traits similaires de la maladie ».
Le face-à-face avec l’autre différent-comme-moi permet de se sentir moins seul. Ce face-à-face avec l’autre qui soutient et accompagne la prise de conscience de la différence peut permettre aussi l’étayage d’une projection sur la vie adulte ou d’éventuelles capacités de grossesse : « Ce qui a été le plus important pour nous, c’était la première fois où l’on a rencontré un adulte ! On pouvait enfin projeter un avenir, on pouvait enfin se dire qu’elle avait des chances de devenir adulte, puisqu’avant on était dans le flou, on ne savait pas, on ne savait rien ». Cette rencontre permet de croire à un autre pronostic que celui qui a été annoncé initialement, comme si l’existence vivante incarnée par un autre, lui-même malade, prenait valeur de preuve scientifique.
Ces rencontres vont concourir à une reconnaissance mutuelle et aider à sortir de l’isolement en permettant de « trouver quelqu’un en qui on se reconnaît, surtout quand notre maladie est plus rare que rare […] ça m’a aidée à pouvoir plus parler de la maladie et d’avoir des contacts avec les humains ».
Cette dimension prototypique incite la personne atteinte d’une maladie rare à s’inclure dans le collectif de ceux qu’elle rencontre et qui sont différents-comme-lui. Ce collectif prend parfois la configuration de celui « d’une grande famille », expression utilisée lorsqu’un nouveau membre rejoint l’association internationale cutis laxa. À l’inverse, lorsqu’un patient décède, ceux qui ont la même maladie que lui, perdent avec lui une partie d’eux-mêmes et le vivent douloureusement : « c’est comme si une partie de moi venait de partir ». Cette mort rappelle et réactualise pour ceux qui sont encore là le risque vital de la maladie. Cette dimension est d’autant plus présente que la maladie est rare et que le patient se vit comme un cas isolé et éprouve une immense solitude. En période de grippe, il est totalement indifférent de rencontrer un autre, inconnu, touché par le même virus ! Alors que dans le cadre des maladies rares, cette reconnaissance va jusqu’au sentiment de reconnaître l’autre comme si c’était un membre de la famille que nous ne connaissions pas encore et que l’on a retrouvée.
Nominalement, ce n’est plus dans ce cas le patronyme qui permet de se reconnaître membre de la même « famille », mais c’est le nom de la maladie. Le lien génétique a sa place dans ce sentiment de reconnaître un membre de sa famille, mais c’est bien aussi la familiarité, la ressemblance soit de l’apparence soit du vécu qui permettent cette reconnaissance. Ce caractère prototypique propre aux maladies rares génétiques ouvre une voie à un échange possible, à une compréhension par l’autre qui est « différent-comme-moi » et qui est censé pouvoir comprendre spontanément ce que vit la personne malade.
Cette notion est à rapprocher de la pair-émulation, traduction du terme anglais peer-counselling, et définie comme le soutien par les pairs. Cette dynamique est notamment en œuvre dans les relations entre des personnes avec une ou des déficiences physiques ou mentales, et les personnes qui connaissent des situations semblables et qui recherchent les moyens d’accéder à une vie plus autonome (Gardien, 2017).
En conclusion, le parcours des personnes touchées par une maladie rare et leur errance, tant avant le diagnostic que dans la prise en charge, incite à proposer une médecine de l’accompagnement pour soutenir le travail d’adaptabilité de l’enfant, de l’adolescent ou du jeune adulte à sa condition.
Le caractère visible ou non de la maladie participe à l’isolement et à l’incompréhension sociale, vécus par les patients. Au cœur de cette expérience de solitude, insoutenable parce qu’existentielle, une mise en mouvement peut être repérée avec l’élaboration de solidarités très fortes.
Dans le cadre des maladies rares, la rareté s’articule avec la particularité de chaque maladie. Les possibilités diagnostiques par le médecin non spécialiste sont limitées parce que les connaissances médicales des maladies rares ne sont pas acquises dans une dimension générale, ce qui est le cas pour les maladies communes. La même difficulté existe sur le plan social où la personne atteinte d’une maladie rare génétique ne se reconnaît pas – et n’est pas reconnue – comme appartenant à la représentation généralement admise d’une personne malade.
La dimension singulière du vécu insiste sur le sentiment d’exclusion. Le patient touché par une maladie rare d’origine génétique vit une singularité éprouvante d’être soi-malade sans correspondre aux représentations habituelles d’autrui-malade. Les rencontres entre patients ayant la même maladie rare illustrent combien il est important de rencontrer un autre-rare-comme-soi, pour sortir de l’extrême solitude imposée par la rareté. La rencontre d’un autre ou d’autres différents-comme-soi participe alors à l’éthique de resubjectivation par la reconnaissance de soi différent. Le patient est ainsi reconnu par un autre qui partage avec lui la même différence, et qui fait corps avec lui. Le regroupement associatif de ces personnes malades est peut-être une tentative de se faire reconnaître et, par-là, d’acquérir une identité repérable, comme un groupe particulier avec ses caractéristiques propres.
La dimension générale de cette reconnaissance, tant médicale que sociale, n’est pas acquise, et c’est probablement une des visées éthiques que de tenter d’articuler la tension qui existe entre le vécu singulier et la dimension générale de la reconnaissance de la maladie dont le sujet est atteint.
Ces maladies rares bousculent beaucoup de repères et de représentations : les certitudes de la médecine, la dichotomie entre maladie et handicap, les représentations imaginaires du gène invisible, les savoirs partagés au-delà du seul savoir académique. Ces maladies sont pour la plupart sans possibilités thérapeutiques curatives. Les patients sont amenés à trouver la voie, très singulière, qui leur permettra de s’adapter à leur nouvelle condition de vie.
Ces patients invitent la société à mettre la fragilité au centre de ses préoccupations, à ne pas la cacher, mais à en reconnaître sa juste place qui n’est pas toute la place. Ceux qui vivent toute leur vie la différence, la maladie et/ou le handicap nous invitent à la bienveillance, ils sont les passeurs du vivre ensemble pour notre société.
Rares, mais solidaires, les patients expérimentent concrètement que c’est ensemble que la rareté est malgré tout vivable, dans des rapports nouveaux à la différence et à la fragilité. Une forte solidarité vitale se développe au sein des groupes d’entraide. Elle se concrétise par l’engagement dans le mouvement associatif qui associe le soutien entre ses membres, et le partage des savoirs afin de mieux comprendre et savoir gérer la maladie. Dans la rareté se dit l’une des dimensions universelles de notre humanité. Catherine Tourette l’exprime à propos des maladies graves et/ou chroniques : « ce travail de “maintien de soi en vie” doit être reconnu comme un travail qui contribue à la collectivité, puisque se maintenir en vie, c’est maintenir le vivant de la collectivité dans laquelle je suis » (Tourette-Turgis, 2014). Les personnes fragiles, vulnérables, malades ou en situation de handicap ont la capacité, par leur simple présence et leur combat, pour et dans la vie, de nous signifier que la perte et le manque ne sont pas le tout de l’homme. La personne malade possède des potentialités, des capacités jusqu’au bout de sa vie, même si elles s’amenuisent de plus en plus. Les patients dont le pronostic est évolutif développent souvent cette sensibilité, ce goût nouveau de la vie et des autres, appréciant le don de chaque rencontre, comme essentiel.
Les personnes touchées par une maladie rare génétique témoignent que, malgré l’épreuve, il est nécessaire d’ouvrir des possibles même si un diagnostic et/ou un pronostic semblent les interdire. Cette ouverture dispose à l’inattendu de la vie et à la créativité d’une façon de faire différente de celle annoncée, tant par la parole médicale prédisant l’avenir que par l’imaginaire de l’enfant parfait à naître. Le diagnostic et le pronostic concernent la maladie et non le patient qui n’est jamais réduit à ce qui lui est dit de sa maladie. Il est nécessaire pour la personne de les connaître, mais sans s’y enfermer. Au patient, la responsabilité de les vivre comme il le souhaite et comme il le peut, à condition de trouver à ses côtés l’étayage nécessaire pour exercer sa liberté d’être sujet.
La rareté de ces maladies pose des défis individuels, médicaux, collectifs, sociétaux. Des centres de diagnostics se sont multipliés (dans le cadre des plans nationaux maladies rares) pour offrir sur l’ensemble du territoire une sensibilisation à ces diagnostics spécifiques, et surtout un accueil de ces personnes en errance diagnostique, dès les prémices de la maladie, d’autant plus chez l’enfant. Les soins au long cours offerts aux patients orientent vers l’importance d’une médecine d’accompagnement pour soutenir tout le travail d’adaptabilité de l’enfant ou adolescent malade, afin qu’il trouve son équilibre vital. Cet accompagnement est le lieu où la médecine – même si elle n’est plus curative – n’en perd pas pour autant toutes ses potentialités de soins, permettant au patient de continuer à vivre le mieux possible. Il s’agit d’associer à la médecine basée sur les preuves objectives la médecine basée sur l’épreuve subjective, qui fait appel à la médecine narrative accompagnant la recherche de sens de l’expérience vécue. Cette médecine de l’adaptabilité ouvre sur l’éthique narrative et l’éthique du soin au long cours. De nouveaux espaces sont à inventer qui, certes, prennent en compte les besoins physiques, orientent les personnes vers les spécialistes de la maladie, prennent en compte médicalement les symptômes associés, les évolutions, les complications, mais proposent aussi des soins de mieux-être, des lieux de paroles, de « biographisation » personnelle ou collective (Decloitre, 1998 ; Delory-Momberger, 2013 ; Eméyé, 2016 ; Gardou, 2022 ; Julliand, 2011).
Les besoins de ces patients ne sont pas seulement médicaux. Ils en appellent aussi à un parcours de soins global qui soit coordonné, organisé, et politiquement financé. Les besoins qui apparaissent avec force dans le cadre des maladies rares révèlent et soulignent ceux des autres maladies chroniques : ils insistent sur le vécu du patient, son besoin de se redonner ses propres normes, son souhait d’être sujet du vécu de sa maladie et de son sens, son impérative nécessité d’être accompagné dans le cadre de soins holistiques et d’une médecine intégrative (Tolédano, 2022).
La survenue de la maladie bouleverse l’équilibre du patient et de sa famille, habitée des craintes de l’avenir et de la culpabilité de la transmission. C’est toute cette constellation qui a besoin d’être accompagnée pour que chacun retrouve sa place, dans cette juste présence intersubjective et dans toute la complexité secondaire à la présence de la maladie.
Ce long travail de la maladie qui vise à se retrouver, comme sujet vivant, peut s’enrichir d’un soi pour autrui, germe de la solidarité pour ceux qui, comme lui, vont connaître la même maladie. C’est alors que les sphères de la reconnaissance d’Axel Honneth (2000) prennent corps pour la personne malade avec d’autres, dans le cadre des associations de patients. Les sphères de la reconnaissance s’appliquent dans notre champ pour retrouver la confiance en un soi, qui a été mis à l’épreuve de la fragilité, le respect de soi avec les limites ou les déformations imposées par la maladie, et l’estime de soi par la solidarité et le soutien entre les patients qui se reconnaissent différents comme eux.
C’est cet équilibre, précaire, difficile à trouver et à entretenir entre l’enjeu individuel d’adaptabilité aux nouvelles conditions de vie avec la maladie et l’invitation à devenir patient pour d’autres patients rencontrés, qui illustre ce qui pourrait être une éthique de la rareté. L’incertitude et la complexité s’y conjuguent pour nous inviter à inventer de nouveaux chemins de vie avec la maladie, ensemble. Il s’agit alors de transformer l’annonce d’un pronostic dramatique en chemin de vie.
Bibliographie
Notes
- Maladie ophtalmique rare caractérisée généralement par une perte progressive de la vision centrale.
- Maladies héréditaires du tissu conjonctif caractérisées par une hyperlaxité articulaire, une légère hyperextensibilité cutanée, une fragilité tissulaire et des manifestations extra-musculo-squelettiques.
- Paraplégie spathique héréditaire.
- La cutis laxa (en latin « peau relâchée ») est une maladie génétique rare dont le principal symptôme visible est une peau ridée, relâchée ; les fibres élastiques de l’ensemble du corps étant dégradées, voire absentes. Elle touche aussi bien les hommes que les femmes et sa fréquence est mal connue. Néanmoins, le corps médical estime à moins de 1000 le nombre de cas dans le monde entier.
- Anomalie rare du tissu conjonctif d’origine héréditaire caractérisée par une hyperextensibilité de la peau, de larges cicatrices atrophiques et une hypermobilité articulaire généralisée.
- Maladie neurodéveloppementale rare, sévère, liée à l’X, caractérisée par une régression rapide du développement dans la petite enfance.
- Syndrome rare avec anomalies/troubles congénitaux multiples du neurodéveloppement.