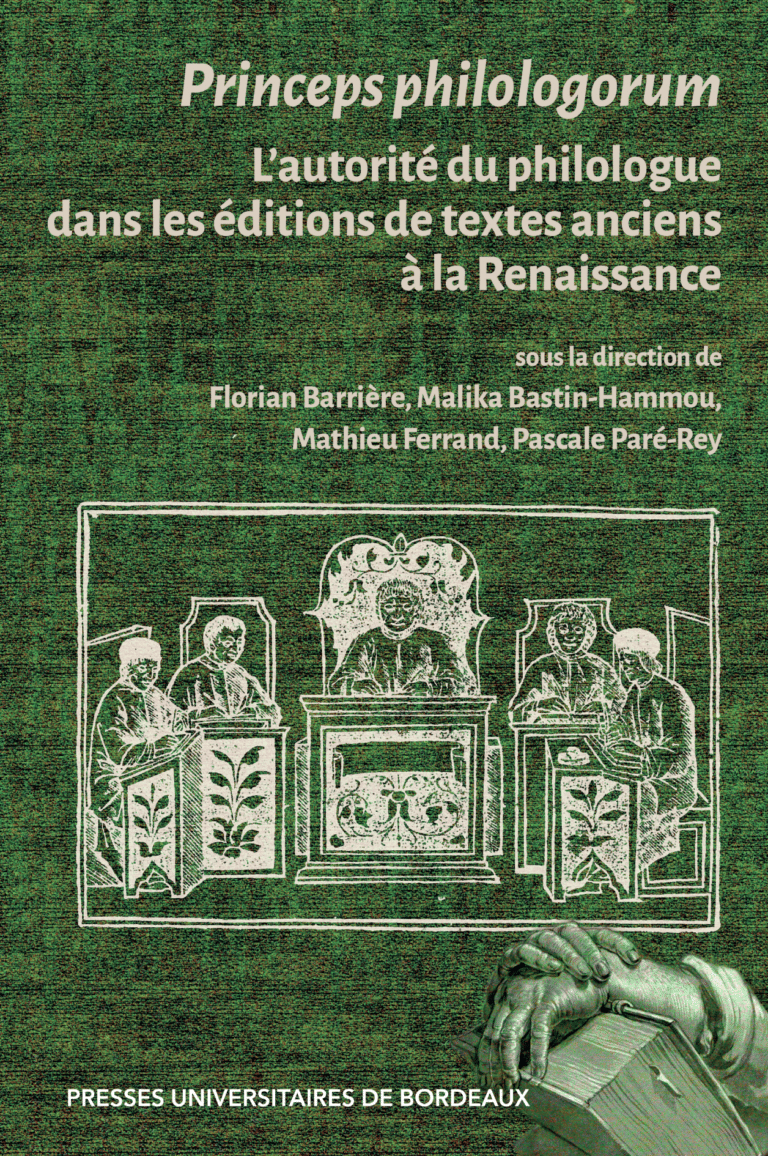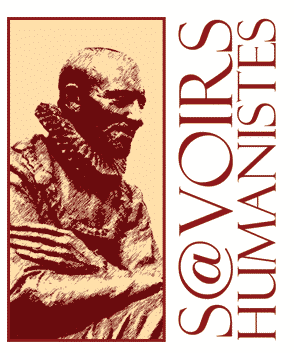Au XIXe siècle, âge d’or de la philologie moderne, une expression, d’abord associée à un humaniste, Joseph-Juste Scaliger (1540-1609)1, a cristallisé l’importance de la figure du philologue : Ulrich von Wilamowitz (1848-1931) a été dit « Prince des philologues » (Princeps philologorum)2. L’expression même visait à consacrer la primauté d’un philologue sur les autres mais l’attribution de ce titre à différentes personnes interroge. De fait, princeps, dans ce formulaire, revêt son sens superlatif (« le premier ») et il est étonnant que cette première place se trouve, finalement, relativisée par la détermination de plusieurs figures de philologues capables de porter ce titre. Nous ne nous risquerons pas ici à faire la liste de tous ceux qui l’ont reçu et nous contenterons de chercher à dégager la logique qui préside à son attribution, à l’aide de quelques exemples. Si l’archétype du princeps philologorum est Joseph-Juste Scaliger, l’expression connaît une certaine faveur au cours du XIXe siècle, lorsque la science philologique se déploie avec une ampleur remarquable, notamment dans le sillage de Karl Lachmann3 : outre Ulrich von Wilamowitz, sont qualifiés de princeps philologorum des érudits tels que Friedrich August Wolf4, Gottfried Hermann5, Theodor Mommsen6, Johan Nicolai Madvig7 ou encore Friedrich Wilhelm Ritschl8. La pratique s’est raréfiée au cours du XXe siècle, même si Jan Hendrik Waszink a été salué de ce titre en 1985 dans un volume du Jahrbuch für Antike und Christentum qui lui fut dédié. Dans chacun de ces emplois, le terme semble servir à couronner l’activité philologique d’un érudit, dont les travaux sont considérés comme fondamentaux pour la connaissance de l’Antiquité.
L’étude de l’usage du titre de princeps philologorum fait apparaître une caractéristique surprenante. Si le titre, lorsqu’il fut utilisé pour Scaliger, n’était accompagné d’aucune précision supplémentaire, le nombre plus important de principes au XIXe et au premier XXe siècle a conduit certains à ajouter une mention géographique : Friedrich Wilhelm Ritschl est ainsi appelé princeps philologorum Germaniae9 quand le byzantiniste Henri Grégoire est célébré comme le princeps philologorum Belgarum10. Ces variations autour de l’expression princeps philologorum ont pu concerner d’autres domaines que la seule philologie : ainsi Ulrich Wilcken a-t-il été salué comme princeps papyrologorum11. On parle aussi de princeps typographorum pour célébrer certains imprimeurs, comme Nicolas Jenson12 ou Robert Estienne13. Les lauriers que tresse la formule latine peuvent donc être destinés aux plus éminents personnages contribuant à la diffusion des textes anciens.
Mais les princes qui nous intéressent avant tout, dans le présent ouvrage, sont ceux des philologues. Si les deux principaux principes philologorum sont Scaliger et Willamowitz, cela nous conduit, étant donné l’étendue de l’érudition des deux savants, à nous interroger plus précisément sur ce que nous entendons par philologue. Nous voici confrontés à la diversité des sciences que l’on appelle communément du nom de philologie. Au-delà de son emploi à propos de l’étude diachronique et synchronique des langues, le terme est parfois utilisé pour désigner, dans un sens plus restrictif, les travaux qui ont pour objet l’édition critique des textes anciens, mais, historiquement, son sens a souvent évolué : Pascale Hummel indique que, malgré ces variations, la philologie reste marquée par un « esprit universaliste14 » et qu’il s’agit d’une science dont on considère souvent qu’elle est composée de multiples disciplines. Rappelons que Martianus Capella, dans son encyclopédie intitulée les Noces de Philologie et de Mercure, représente Philologie entourée de sept demoiselles d’honneur, qui doivent l’accompagner, à savoir Grammaire, Dialectique, Rhétorique, Géométrie, Arithmétique, Astronomie et Harmonie. De fait, dès l’époque alexandrine, apparaissent des figures d’érudits qui travaillent à la fois à l’établissement d’un texte type pour nombre d’œuvres anciennes mais aussi à leur élucidation, dans des commentaires qui envisagent aussi bien les dimensions littéraires et grammaticales des textes. À Rome, des grammairiens comme Ælius Stilo ou son élève Varron s’inscrivent dans cette tradition. Il en est de même pour les diorthotes de l’antiquité tardive15 et du haut Moyen Âge, tel le Sallustius auteur d’une souscription dans un exemplaire des Métamorphoses d’Apulée qui laisse entendre que son activité de révision a débuté dans le cadre d’un cours donné par un rhéteur romain16, ou pour les grands érudits de la période carolingienne, dont les travaux sont à plus d’un titre précurseurs de ceux des humanistes, sur lesquels notre attention se concentre dans le présent volume.
Cette dimension universelle de la philologie est conforme à la définition qu’Ulrich von Wilamowitz donne lui-même lorsqu’il estime qu’il s’agit d’un tout englobant les diverses approches des textes antiques17. C’est dans son sillage que nous avons jugé pertinent d’ouvrir largement, dans le cadre de cet ouvrage, le sens de philologue, en incluant dans les diverses contributions des études sur l’activité des imprimeurs, des traducteurs, des éditeurs et des commentateurs. À la Renaissance, le mot même de philologus est peu employé : il est largement concurrencé par d’autres expressions mettant l’accent sur l’érudition ou des pratiques plus spécifiques ou adjacentes (docti, eruditi, emendatores, interpretes …). Lorsqu’en 1533 Érasme, par exemple, adresse une de ses lettres à tous les philologues, Philologis omnibus18, le mot ne paraît que dans l’incipit ; dans le corps du texte, il préfère parler de grammatici, d’eruditi ou de studiosi. Au reste, la diversité de cette terminologie et la multiplicité de ces activités ne nous font pas courir le risque d’une dispersion des analyses ici regroupées : de fait, des figures comme celles de Josse Bade ou Robert Estienne suffisent à mettre en lumière la façon dont plusieurs de ces activités peuvent être exercées et incarnées par une seule personne. Bien évidemment, il pourra être judicieux de chercher à voir dans quelle mesure un érudit choisit de se présenter plus spécifiquement dans l’un ou l’autre de ces rôles selon qu’il souhaite mettre l’accent sur telle ou telle partie de son activité, mais il ne nous faudra pas perdre de vue la tension qui peut exister entre la façon dont un philologue conçoit son activité et le jugement de la postérité qu’implique l’attribution du titre de princeps, voire, simplement de philologue.
Philologie et paratextes
En 2009, un volume collectif sous la direction de Martine Furno posait à propos des premiers siècles de l’imprimé une question simple, mais problématique : « Qui écrit ?19 ». Il s’agissait alors de s’interroger sur la fabrique du livre et les différents acteurs du processus éditorial, dans ses dimensions matérielles et intellectuelles. L’idée était aussi de mettre en lumières ces petites mains que l’histoire néglige, à l’ombre des auteurs qui seuls ont laissé leur nom. Or, dès le XVe siècle, le philologue, entre auctores et mecanici, occupe, dans l’économie des volumes publiés, une place prépondérante. De fait, une part importante de la production livresque propose de redécouvrir les textes de l’Antiquité classique ; ceux-ci sont l’objet d’un intense travail de diffusion. C’est d’abord en Italie que la figure du philologue, héritier des grammatici médiévaux, se construit. Dans sa Cornu Copiae, à la fin du XVe siècle, l’humaniste Niccolo Perotti présente le philologus comme « amator verborum20 ». La définition étymologique demeure imprécise, mais valorise un certain rapport au langage que le philologue explore inlassablement. Si le mot lui-même, on l’a dit, est peu utilisé, le philologue devient une figure maîtresse de l’humanisme.
En 2005, le volume publié par Perrine Galand-Hallyn, Fernand Hallyn et Gilbert Tournoy proposait d’explorer la façon dont l’humanisme européen représenta la pratique et l’ethos que nous disons philologiques, dans la fiction et la théorie21. Notre volume s’inscrit dans le sillage des études alors proposées, mais entend se concentrer sur les paratextes des éditions savantes des textes antiques22. Ces paratextes nous semblent offrir en effet un champ fertile d’investigation : peu explorés jusqu’alors, ils donnent à voir et à penser, le plus souvent en latin (mais parfois en grec), le geste philologique au moment même où il s’accomplit. Les travaux d’Ann Blair, en particulier, sur l’« entour du texte » permettent aujourd’hui de mieux comprendre quels furent leur rôle et leur place dans l’élaboration matérielle et intellectuelle du livre savant23. Le paratexte, espace de « transaction » entre le livre et son lecteur24, est notamment le lieu où s’énoncent le projet et la méthode de celui qui publie. Il se décline en trois catégories principales, souvent poreuses : les écrits adressés mettent en scène l’éditeur et ses dédicataires dans un échange de bons offices ; les écrits théoriques prennent pour objet l’auteur antique et son œuvre, sous la forme bien connue de l’accessus ad auctores ; les outils de travail, enfin, comme les index ou encore les recueils d’excerpta ou de leçons, complètent les commentaires. Quand les épîtres liminaires disent et expliquent le geste du philologue, les gloses le montrent en train de se faire.
Dans ses paratextes, le philologue programme ainsi la réception du travail qu’il édite et commente, construit son ethos de savant, vante les mérites de son travail ou affirme sa compétence et sa méthode ; bref, il tente d’établir son autorité. Dès 2016, un volume s’attachait à montrer les liens qui se tissent ainsi entre paratextes et autorité, dans les éditions théâtrales des XVIe et XVIIe siècles25. Si le texte de théâtre pose des questions qui lui sont propres, parce qu’il se frotte par exemple aux autorités politiques qui surveillent son propos, la question de l’autorité nous semble tout aussi fondamentale dans les paratextes des éditions savantes, sous une forme très différente. Moins politique ou juridique qu’intellectuel, l’enjeu est ici de légitimer la figure même du philologue, mais aussi tel ou tel savant qui se confronte aux auctores antiques en même temps qu’à ses devanciers et contemporains.
Autorité et auctorialité
Selon Benveniste, l’auctoritas est « ce don réservé à peu d’hommes de faire surgir quelque chose et – à la lettre – de produire à l’existence26 ». L’auctor a donc ce « pouvoir des commencements » dont parle aussi la philosophe Myriam Revault d’Allonnes dans son Essai sur l’autorité27. Or, celui dont on reconnaît la faculté créatrice voit sa parole et ses actes lestés d’un caractère prépondérant. Ainsi s’articulent inextricablement les notions d’auctorialité et d’autorité.
Dès lors, l’idée même d’une autorité du philologue ne va pas de soi – qu’il puisse être reconnu comme « princeps » non plus d’ailleurs. Car il n’est d’auctores, au sens étymologique, ni même d’auteurs, au sens obvie, que des auctores anciens, qui seuls jouissent d’une authentique autorité, notamment parce qu’ils sont les seuls principes possibles, les premiers dans l’ordre du temps et des valeurs. Le philologue, lui, ne saurait se mettre qu’au service de l’auctor. Il veut donner à lire et comprendre les textes du passé, que d’aucuns disent corrompus, altérés par de multiples causes. Beaucoup de nos paratextes s’attardent sur cette question parce qu’elle permet d’expliquer et de fonder le travail philologique : l’ancienneté de l’œuvre, l’état des manuscrits mais aussi la négligence de ceux qui les ont transmis sont volontiers incriminés et justifient l’entreprise de restitution. Le travail philologique a donc une fonction ancillaire, qu’il assume au nom de l’autorité des textes et des auteurs publiés (souvent confondus, d’ailleurs, en un jeu métonymique récurrent). Le philologue ne peut prétendre au renom ni même à l’auctoritas, pas même à l’auctorialité, et de fait, longtemps, il n’a guère laissé de traces dans les manuscrits : le correcteur médiéval corrige sans le dire un texte et un auteur derrière lesquels il s’efface.
La situation, à la Renaissance, paraît de ce point de vue bien différente : le geste philologique s’affiche. L’imprimé et ses paratextes offrent un espace nouveau pour cela tandis que la large diffusion des volumes permet d’augmenter encore la visibilité du geste. Se mettent ainsi en place des habitudes éditoriales qui, pour être les héritières bien souvent de traditions manuscrites, n’en sont pas moins consolidées et pour certaines d’entre elles renouvelées. Or, la présence affichée du philologue – à tous les sens que nous prêtons à ce terme – dans les éditions imprimées, permise voire encouragée par les moyens techniques nouveaux, s’explique sans doute par le sentiment aigu et croissant d’une utilité sociale du travail philologique, qui affirme sa légitimité et sa noblesse face à l’épaisseur historique des textes transmis. Par le sentiment aigu, aussi, d’une responsabilité : corriger le texte, c’est prendre le risque de l’erreur, voire de la trahison du texte source et de son auctor ; c’est donc s’engager comme individu qui agit sur le texte, en le corrigeant, le modelant. C’est se faire auteur, un peu28.
Une autorité construite
Le présent volume n’aborde guère la question de la philologie appliquée aux textes sacrés ; mais soulignons que l’attitude d’Érasme corrigeant les Écritures est à bien des égards paradigmatique. Au nom de quoi Érasme, qui n’est pas véritablement théologien, peut-il prétendre corriger l’œuvre par excellence inspirée de l’auctor suprême – Dieu – sinon au nom d’une compétence technique toute humaine, et d’une certaine idée du texte, considéré comme matière vivante et historique, nécessairement soumise aux variations du temps et aux faiblesses des hommes ? Moins polémique, le problème n’est pas fondamentalement différent si l’on revient prudemment au domaine des lettres antiques : le rôle du philologue est majeur car l’enjeu est considérable – rendre leur voix aux œuvres des Anciens – et parce que le philologue peut se prévaloir d’une compétence scientifique avérée : donner à lire les textes antiques, les rendre présents en leur donnant un nouveau commencement, au nom d’une méthode capable de se justifier elle-même, telle est leur exigeante ambition. Toute proportion gardée, le philologue peut dès lors rivaliser avec les auctores antiques : sa vocation ancillaire est d’une telle importance qu’il peut en tirer un prestige certain, redoublant le geste premier de création qu’il prolonge et sauve de l’oubli.
Ainsi, l’autorité du philologue est rarement une donnée acquise. Elle est moins affirmée ou proclamée dans les paratextes qu’elle n’est construite par eux : il faut donc lire ces paratextes dans leur dynamique persuasive, qui ne se réduit pas à la dimension publicitaire et commerciale. La question de l’autorité suppose l’étude des stratégies rhétoriques, au sens large, mises en place par le livre – dans sa matérialité, dans son organisation, sa typographie, etc. – et par les textes – les arguments avancés, les méthodes exposées qui fondent une compétence et une science renouvelée. Ce faisant, on pourra apprécier aussi la dimension humaine du travail accompli, le degré d’investissement du je philologue, comme les hommages rendus ou les coups de griffes portés. Car le philologue n’est jamais seul ; l’appareil paratextuel donne à entendre une multiplicité de voix qui se succèdent, se répondent, s’entrechoquent. Ce n’est pas le moindre intérêt de ce corpus que de montrer en action cette communauté de savants, sodalitas traversée de rivalités mais aussi de fidélités, soumise aux difficultés du temps, à la nécessité de trouver un mécène, de s’assurer la protection des puissants. C’est aussi cette dimension humaine et sociale de la philologie, comme œuvre individuelle et collective, que le présent volume entend explorer.
In fine, une question demeure, qui subsume toutes les autres : qui fait l’œuvre publiée d’Euripide ou Tacite ? Euripide, Tacite, ou les philologues qui les servent ? En d’autres mots, à quelles conditions de l’autorité construite du philologue peut naître l’œuvre philologique d’un princeps philologorum ? À l’heure où les éditions numériques, l’open access notamment, posent à nouveau la question de la légitimité du travail d’édition dans son rapport avec l’auteur et l’œuvre, ces questions ne sont pas celles de quelques érudits soucieux de contempler dans le passé leur lointain reflet : elles sont, nous semble-t-il, d’une étonnante actualité.
Le volume articule trois parties aux frontières nécessairement poreuses. La première entend présenter les philologues au travail : les paratextes des éditions disent et défendent une méthode, soulignent l’apport décisif de travaux herculéens.
Au seuil des œuvres, l’enjeu est souvent d’établir l’autorité même du savant qui prétend transmettre et corriger les textes du passé ; la seconde partie du volume se concentre sur cette question et entend étudier les stratégies mises en œuvre pour fonder l’ethos philologique.
Enfin, savants du passés, collègues, amis et concurrents forment une communauté humaine traversée de bons ou de mauvais sentiments. L’aemulatio nourrit le travail de chacun, tandis que, dans son rapport à l’autre, le geste philologique définit peu à peu ses contours.
Notes
- A. Gudeman utilise l’expression pour rapprocher T. Momsen de Scaliger, qui apparaît ainsi comme la figure première du princeps philologorum (Gudeman 1909 : 240).
- L’expression apparaît notamment sous la plume d’Eduard Norden 1966 : 655.
- On considère que l’édition de Lucrèce de 1850 donnée par Karl Lachmann est celle dans laquelle sa méthode se déploie avec le plus de rigueur.
- Voir Bérard 1917 : 95.
- Fritzsche 1840 : praef. 1.
- C’est Franz Bücheler qui se serait adressé en ses termes à T. Mommsen, dans un télégramme, avant de lui décerner ce titre au cours du Congrès de Cologne en 1895. Voir Mayer 2005 : 64 n. 3.
- Perrot 1875 : 200.
- Collard 1881 : 393.
- Collard 1881 : 393.
- Leroy 1946 : 516.
- Canfora 2010 : VIII.
- Heinecke 1771 : 15.
- Voir à ce sujet la contribution de M. Furno dans cet ouvrage.
- Hummel 2000 : 59-100. Voir notamment Hummel 2000 : 94.
- Sur l’activité de ces érudits qui ont apporté nombre de corrections sur les textes anciens, dès la fin de l’antiquité, voir Reynolds et Wilson 2021 : 43-46 ou l’étude de Chiesa 2019 : 79-84.
- Firenze, Biblioteca Laurenziana, Plut. 29.2 f. 24v.
- Wilamowitz 1921 : 72.
- Érasme, Correspondance X, 2773.
- Voir Furno 2009.
- Charlet 2005 : 74.
- Voir Galand-Hallyn 2005.
- Ces paratextes savants sont l’objet d’étude du projet ANR IThAC, qui s’intéresse spécifiquement aux écrits consacrés au théâtre antique dans l’Europe de la Première Modernité ; voir : https://ithac.hypotheses.org/.
- Voir Blair 2021.
- Genette 1987 : 8.
- Voir Lattarico 2016.
- Benveniste 1969 : 150-151.
- Voir Revault d’Allonnes 2006.
- Voir Foucault 1969.