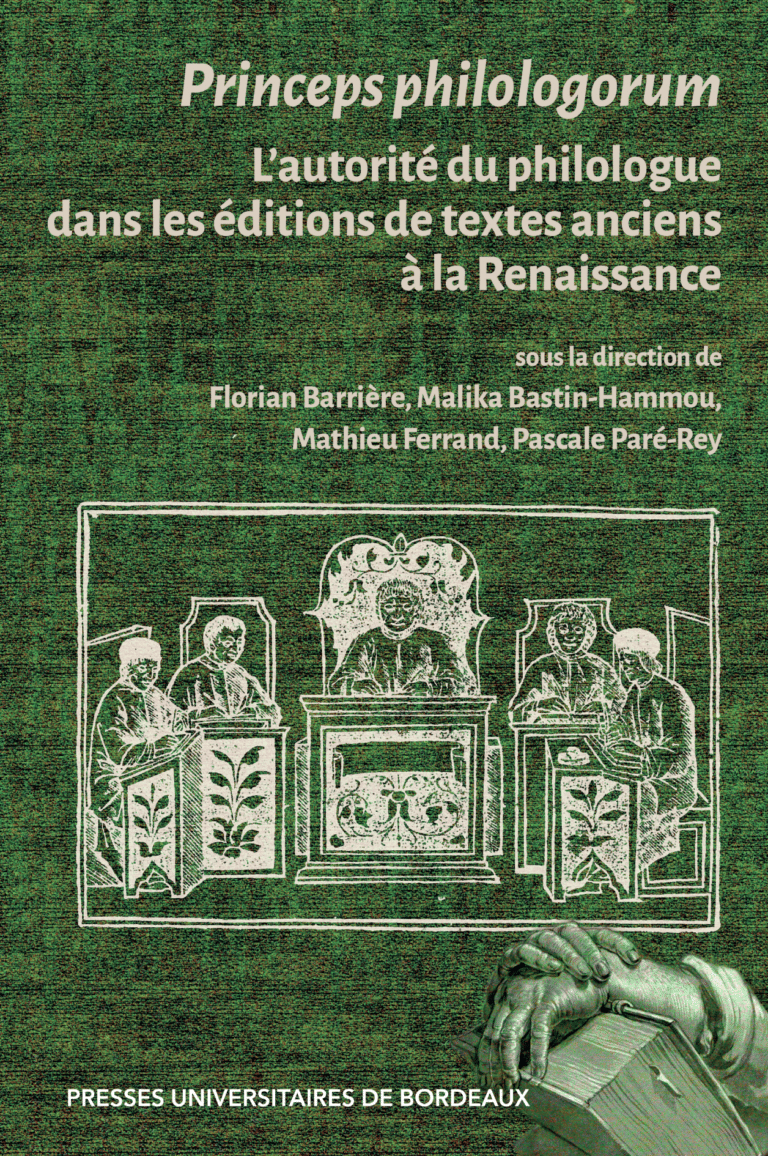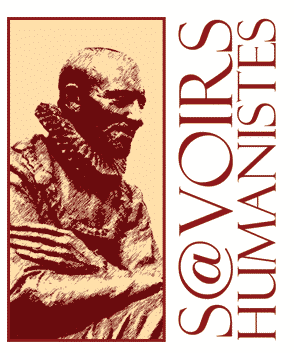Au terme de ce parcours, il semble désormais clair que le philologue, à la Renaissance, est une figure en construction. Les termes employés dans les contributions en témoignent : on y parle de doctes, de litterati, d’humanistes, d’éditeurs. Si l’on entend par « philologue » le savant qui établit un texte en recourant méthodiquement aux manuscrits les plus nombreux et en les hiérarchisant, alors la figure du philologue à la Renaissance est une figure émergente, qui se cherche et recourt à différentes stratégies pour définir et asseoir son autorité. Or cette construction ne va pas sans tensions. L’une des constantes de l’ethos du philologue est la revendication de modestie au regard de l’autorité de celui qu’il édite : mais comment, dès lors, affirmer son rôle et faire résonner son nom tout en se conformant à cette exigence de modestie ? Comment exhiber à la fois son nom et son souhait de rester dans l’ombre ?
De la rhétorique de la modestie à l’affirmation d’un travail novateur : l’exhibition du discours de la méthode
Nous pouvons juger aujourd’hui de la qualité d’un travail philologique en nous fondant en partie sur l’autorité qu’a eue telle édition. Il est remarquable que certains problèmes soulevés à la Renaissance agitent d’ailleurs encore la critique contemporaine. Mais ce qui nous intéresse dans ce moment de synthèse, c’est de voir comment les philologues ont eux-mêmes construit un discours sur leur identité de savants et sur le travail qu’ils estimaient devoir mener. Car c’est un des enseignements des paratextes que de livrer ce « discours de la méthode » : en exposant, expliquant, justifiant, leurs manières de faire, les philologues disent, voire exhibent, ce que sont, selon eux, les bonnes pratiques. Ce faisant, ils s’imposent comme des savants, dont les qualités sont louables mais ont aussi leurs revers. Et ce sont eux qui établissent certaines contradictions, en voulant imposer d’un côté une autorité qu’ils minorent de l’autre. Cette construction d’un ethos rigoureux, soigneux, érudit, contrebalancée par des protestations de modestie, évite volontiers la contradiction interne en passant par la mise en retrait de sa propre personne au profit d’un réseau de savants, dont le philologue fait partie et dont il partage, implicitement, les qualités. Les philologues se définissent enfin par les détours, entre promotion et autodérision : en usant d’images plaisantes qui rapprochent le philologue de tel personnage, de tel héros, ils s’inscrivent dans une tradition littéraire, voire ménagent leur entrée dans un patrimoine mythologique.
Un ethos de rigueur et d’érudition
Le plus souvent, même si certains n’en font pas état (comme les traducteurs d’Homère), nos érudits parlent de leur méthode : ils exposent leurs sources (Gessner), certes imprécisément (Bersman renvoie aux manuscrits mais ne précise pas lesquels), certes en écrasant la chronologie (Bersman encore), mais révèlent les matériaux (manuscrits, imprimés, éditions précédentes, débats philologiques, publications contemporaines, recueils d’annotations précédemment parus), les hommes (la famille pour l’édition de Plaute par Lambin fils prolongeant le travail de Lambin père, les amis, les cercles de sodalité, l’élite politique), les lieux (bibliothèques privées ou publiques) qui leur ont permis de mener le travail. Ainsi le philologue, en parlant de son travail, construit cet ethos de savant, d’érudit qui fait réflexion, a posteriori (dans les liminaires) ou au cours de son travail (dans ses commentaires), et donne à voir son autorité en même temps qu’il l’assoit. Ce sont donc de véritables « discours de la méthode » qui s’élaborent dans les paratextes, un exemple particulièrement représentatif étant la préface de Vettori qui ouvre son édition de l’Éthique à Nicomaque où il expose en détail sa conception du travail philologique (voir A. D’Angelo).
Justement, qu’est-ce alors qu’un bon philologue ? Peut-on en tracer un portrait unifié ? La réponse diffère selon qu’on adopte les critères contemporains ou ceux de l’époque : le philologue est-il celui qui édite le plus scrupuleusement possible ou celui qui se soucie aussi de transmettre le texte qu’il édite, une préoccupation majeure au XVIe siècle ? La réponse doit aussi être prudente, compte tenu du fait que les paratextes sont des lieux stratégiques d’autopromotion. Mais elle peut finalement être confiante, considérant que leurs auteurs poursuivent également un dessein scientifique, qui a pour but d’expliquer leur travail : Vettori est soucieux d’expliquer à ses lecteurs sa méthode, ses sources, ses difficultés, son choix de la vulgate ; Xylander expose de façon étonnamment moderne un état de l’art.
On ne peut répondre toutefois de façon univoque. Gessner, quoique qualifié d’« Atlas des travaux littéraires » par Estienne, est un bon exemple de la variabilité des points de vue, car il fut considéré, selon les éditions envisagées, comme un philologue exemplaire ou comme un tortionnaire maniaque et soucieux avant tout de proposer un classement par loci (voir D. Amherdt). À parcourir les textes, certains traits récurrents permettent tout de même de brosser un portrait cohérent : outre ce qu’ils disent de leur méthode, les philologues insistent sur les qualités de leur travail, sa nouveauté, le soin qu’ils y ont apporté, son exactitude ; ils éclairent leurs apports – ajout d’annotations, d’index, de notes critiques – et précisent leurs interventions – correction du texte parfois même après la publication ; et pour le grec en particulier, ils disent leur souci de la ponctuation, de l’accentuation, de la traduction. Se dégage ainsi une volonté d’apparaître particulièrement soigneux et scrupuleux, une aspiration à l’acribie, ce qui explique qu’un philologue se préoccupe également de la disposition du livre, critique ceux qui y contreviennent, comme les imprimeurs indélicats et/ou avares, les falsographi. Le soin et l’érudition vont jusqu’à la revendication de polymathia, c’est-à-dire la maîtrise d’un savoir vaste et diversifié (voir K. Bovier), assortie de la capacité à actualiser l’Antiquité.
Fait qui peut paraître surprenant aujourd’hui, certains éditeurs font dans la définition de leur travail une place non négligeable à la créativité : c’est la figure du philologue inspiré, voire du philologue poète. Pour Giovanni Pontano (voir V. Leroux), seuls les poètes sont capables d’éditer des poètes. Au rebours, certains philologues se targuent de s’appuyer prioritairement sur le manuscrit le plus ancien, le uetustissimus, et limitent la place de l’intervention ope ingenii (ainsi Vettori qui, dès son titre, annonce que son édition se fonde sur les manuscrits et non sur les corrections faites ope ingenii – voir A. D’Angelo). Entre les deux, des philologues comme Lambin ou Scaliger disent confronter différents manuscrits… mais ne le font pas toujours. Les deux grandes manières d’éditer révèlent à la fois des lignes de fracture entre écoles philologiques d’alors et des divergences avec les pratiques contemporaines. Rejetée par Vettori, la méthode ope ingenii est également critiquée par Modius, mais pratiquée par Muret et Scaliger (voir V. Leroux). Quant à celle qui procède ope codicis, elle n’est pas non plus pratiquée de façon uniforme ni comparable à aujourd’hui : Bersman assume le fait de ne pas avoir recensé les manuscrits et de s’en tenir à la recension de Poelman (voir F. Barrière et B. Chachuat).
Conjuguer impératif d’exigence et ethos de modestie
Ce souci de l’exactitude, qui confine à la maniaquerie, cette érudition qui s’étend jusqu’à la polymathie, sont tempérés, au moins dans le discours, par de fréquentes affectations de modestie. Toute une rhétorique de l’humilité est alors convoquée pour adoucir une figure qui pourrait paraître arrogante, voire agressive. Du côté des traducteurs, c’est implicitement et discrètement que l’affirmation de l’autorité se fait, et c’est en traduisant que le philologue se construit (voir C. Deloince‑Louette) ; plus explicitement, le traditionnel appel à l’indulgence qui ouvre tout travail dit à la fois la modestie mais aussi l’inquiétude du savant au seuil de livrer son travail à la vindicte du public : même Scaliger y sacrifie dans une de ses préfaces. Du côté des éditeurs, la discussion peut même être pacifique : c’est sur le mode du rapprochement et du refus du conflit que Bersman dit procéder et sa sélection des leçons et variantes, ses choix de conjecture témoignent d’un éclectisme assumé ; Vettori, quant à lui, fait dialoguer ses lectiones et sa propre édition, et Xylander procède à des corrections, loci similes, discussions contre ou avec ses pairs sans polémique non plus.
Le travail lui aussi est présenté sur un mode mineur : c’est un munusculum qu’offre Bersman, ce n’est que sous la pression des proches que le savant a décidé de publier, et non évidemment poussé par la haute idée qu’il se fait de lui-même et de son travail. On songe ici à Modius invoquant une forme de destin qui l’a conduit à publier. Mais en se mettant lui-même en retrait, il invoque d’autres figures d’autorité qui constituent son réseau (voir L. Claire). Cette exhibition d’un réseau de philologues reconnus permet de concilier mise en avant de soi et ethos de modestie. L’éloge du responsable de l’édition et même du fruit de son travail est reporté sur ce réseau et sa commande : c’est ainsi que procède Modius qui se met en scène non en s’exprimant à la première personne mais en se présentant comme le réceptacle d’injonctions venant d’un réseau reconnu (voir L. Claire) ; c’est aussi la démarche de Dousa qui doit composer avec le poids de l’héritage familial. Dans ce dernier cas, quand il s’agit d’une entrée dans la carrière, l’enjeu d’asseoir son autorité est d’autant plus important, alors qu’un Scaliger, mieux établi, n’hésite pas à critiquer son maître Turnèbe.
De la posture à la pratique
Quand les philologues veulent définir et construire à la fois leur identité et leur travail, ils passent souvent par des images frappantes, empruntées à la mythologie ou à la vie quotidienne. Ces images traversent les paratextes, qu’il s’agisse des textes préfaciels ou des commentaires. Une des plus fréquentes est la métaphore du philologue comme médecin (ne parle-t-on pas d’ailleurs de « curateur du texte » ?), qui guérit un corps malade (le livre, le texte, l’auteur édité), voire lui rend la vie, comme le revendique Dousa (voir S. Gaucher). Plus l’objet à traiter se trouve dans un état déplorable (sale, en morceaux, tel un navire disloqué ou un corps en fragments), mieux est justifiée l’intervention du philologue, qui se représente aussi, ou est représenté par son réseau, en forçat, en libérateur, en sauveur : Gessner se targue, tel un nouvel Hercule, d’avoir nettoyé les écuries d’Augias (voir D. Amherdt) ; Bersman arrache Lucain à la rouille et aux ténèbres (voir F. Barrière et B. Chachuat) quand Dousa, face au sparagmos de Lucilius, se voit en Esculape reconstituant Hippolyte (voir S. Gaucher). Mais qu’en est-il de la pratique ? Si Scaliger clame son souci de suivre le manuscrit le plus ancien – sans plus de précision – il adopte bien souvent, en réalité, les leçons de ses prédécesseurs et, comme Muret, mais sans s’en vanter, il fait des conjectures. Inversement, si Muret dit l’importance de la créativité du philologue poète, il n’abandonne pas pour autant toute rigueur. Comme Lambin, qui, lui, le reconnaît, ils consultent différents manuscrits.
Les lieux et les modalités de la construction de l’autorité
Cette mise en scène de soi a ses lieux et ses modalités de prédilection. S’il arrive que des notes manuscrites viennent compléter et corriger après coup l’imprimé, c’est avant tout dans les textes liminaires que se donne à voir la construction de l’autorité et, dans une moindre mesure, dans les commentaires. La matérialité de l’objet-livre y contribue elle aussi.
Les lieux
En amont de l’acte d’impression, l’architecture du volume en elle-même est un lieu d’exposition de l’autorité du philologue. La simple mise en parallèle du texte grec et de la traduction latine, dans les traductions d’Homère étudiées par Christiane Deloince‑Louette, pourrait être considérée comme une volonté de mettre sur un pied d’égalité le traducteur et le poète. Dans les éditions très architecturées de Gessner commentées par David Amherdt, composées de notes, d’explications, de renvois, d’index, d’indications des sources des citations, de numérotation pour les poèmes, se laisse voir un philologue désireux de faciliter la lecture des textes, mais aussi très conscient de sa valeur et de ses compétences. Kevin Bovier a observé semblable dispositif dans les Annotationes de Johannes Rhellicanus à César : la typographie, la mise en page, les indications du numéro de page et les renvois reflètent son organisation mentale et permettent au lecteur d’abord de circuler dans le volume, de saisir d’emblée de nombreux points, puis de construire un savoir plus approfondi. Ici la philologie s’expose telle une muséographie, et invite le lecteur, qui se sent autorisé et légitime, à visiter le livre.
Le seuil du livre est un lieu particulièrement stratégique. Philippine Azadian montre que la place de Turnèbe, imprimeur royal, varie sur la page de titre en fonction de la nature des éditions : si son nom et sa fonction figurent toujours dans l’adresse typographique, Apud Adrianum Turnebum typographus Regius, garant du travail philologique qu’il publie, elle distingue les éditions royales, avec marques, où le philologue s’efface derrière sa charge officielle, des éditions plus personnelles où le nom de Turnèbe est plus visible dans une « mise en page stratégique ». L’économie des pages de titre traduit cette oscillation entre affirmation et effacement, mais pour des personnages différents dans les éditions de Bersman examinées par Bénédicte Chachuat et Florian Barrière. Bersman figure au centre de la première page, tandis que d’autres savants sont cités… mais relégués en deuxième page : cette organisation traduit la posture faite à la fois de révérence et de distance de l’éditeur vis-à-vis des autres savants. La marque de l’imprimeur, par sa présence ou son absence, est significative ; elle est également signifiante. Martine Furno souligne combien le changement de celle de Josse Bade, qui se représente pressier en habit bourgeois et non en ouvrier, cherche à faire de l’imprimeur un personnage socialement acceptable.
À côté des organisations concertées des livres et des dispositifs d’entrée dans les volumes que sont les pages de titre avec leurs marques et leurs adresses, d’autres lieux contribuent à la construction de l’autorité. Les liminaires sont l’occasion pour les savants d’exhiber leur méthode, leur réseau, leur savoir. C’est encore Bersman qui, dans son très long proème, prend part à un débat érudit et se fait donc l’égal de ceux avec qui il dialogue ; qui, dans le bref ad lectorem, se montre destinataire des manuscrits qui ont été ses outils de travail ; qui, dans les épigrammes en son honneur, est dépositaire d’une gloire présente et future. Peut-être plus inattendues, les listes de variantes et les notes se révèlent pourtant moins neutres qu’on ne pourrait s’y attendre. Les discussions philologiques ne sont pas exemptes de marques de première personne, de jugement de valeur (chez Bersman, voir F. Barrière et B. Chachuat), d’un ton personnel qui met en valeur le jugement du philologue (chez Turnèbe, voir P. Azadian), particulièrement quand les variantes et corrections allient les méthodes ope codicum et ope ingenii.
Enfin les commentaires et les notes permettent de voir en acte une autorité toute en nuances. Les notes manuscrites de Gessner (voir D. Amherdt), consistant en des corrections et annotations, seront par la suite intégrées dans des éditions ultérieures et montrent combien l’autorité se construit sur le temps long. Au rebours, elles peuvent être le lieu d’une fragilisation de cette autorité. Ainsi, Martine Furno rappelle que Bade, quand il édite Budé, publie en manchette des notes ayant obtenu l’aval de l’auteur ; mais que d’autres, rajoutées sans son aval, ne peuvent figurer qu’en notes finales, ce qui montre la dépendance de l’éditeur vis-à-vis de l’auteur.
Les modalités
Cette autorité parfois malmenée se loge dans des interstices et se manifeste selon des modalités discrètes : l’utilisation de la première personne, on l’a vu, est un des moyens d’affirmation du philologue, dans les lettres dédicatoires, les préfaces, les avis au lecteur, où il prend la parole pour se présenter et présenter son travail. Mais l’utilisation de la première personne recouvre parfois des réalités plus complexes. Quand on lit « je » dans les traductions latines d’Homère (voir C. Deloince‑Louette), on peut comprendre que c’est le poète qui parle à sa muse, mais aussi entendre la voix du traducteur parlant à la sienne, se ménageant ainsi habilement une place au sein des artistes. Quant aux marginalia de l’édition de Lucilius par Franciscus Dousa, Sarah Gaucher nous met en garde : elles sont très souvent le fait de Janus Dousa (son père) ou de Scaliger, et il faut donc décoder qui est ce « je ». L’emploi de la première personne est en outre parfois si prudent que la persona de l’éditeur se retranche derrière d’autres instances. Ainsi, Lucie Claire montre un Modius qui s’efface derrière une sorte de destin qui s’impose à lui, derrière les manuscrits personnifiés dont il se fait le simple réceptacle, derrière les Muses, ou bien encore derrière l’autorité des lecteurs et d’autres plus savants que lui. L’usage du « je » est modalisé par des tours impersonnels, des affirmations atténuées, des aveux d’ignorance, et une critique de l’audace chez autrui, alors que le vocabulaire philologique est habilement manié par ailleurs.
Il n’y a en revanche pas d’ambiguïté dans les pièces qui ne sont pas du procurateur du texte mais le mettent à l’honneur : souvent des poèmes, comme l’épigramme en l’honneur de Bersman (voir F. Barrière et B. Chachuat) ; ou encore les paratextes fruits d’un travail collectif dans l’édition posthume de Lambin, louant ce dernier (voir M. Ferrand). Dans ces cas, des autorités autres brossent un portrait élogieux des compétences du philologue dans un dialogue orchestré par lui-même – dialogue alors peu modeste – ou par des éditeurs posthumes, auxquels revient la responsabilité de cette affirmation de l’autorité d’un tiers disparu.
S’affirmer : comitia criticorum et polémiques
S’affirmer face à d’autres figures proches dont on se détache progressivement : l’imprimeur et le traducteur
Si les éditeurs savent mettre en scène leur sodalitas, organiser l’éloge de leur fonction et élaborer, au sein de leurs travaux, la construction de leur propre ethos, ils ne sont pas moins soucieux de se distinguer d’autres érudits et d’autres fonctions proches de la leur, comme celle de l’imprimeur ou du traducteur. La publication des travaux des doctes suppose qu’ils suscitent l’intérêt de l’imprimeur et les doctes dépendent donc de son bon vouloir. Aux premiers temps de l’imprimerie, ce sont les doctes eux-mêmes qui se font imprimeurs, ces « learned printers » ou imprimeurs humanistes dont Alde Manuce est le modèle. Mais la profession d’imprimeur se spécialisant, on voit d’une part émerger une critique topique de l’imprimeur ignorant et mû par l’appât du gain, multipliant les fautes (les falsographi de Gessner) et d’autre part les doctes ne plus être en mesure, à quelques exceptions près, d’assurer la charge d’imprimeur et donc devenir dépendants d’imprimeurs moins valorisés qu’eux socialement mais puissants commercialement : le capital culturel et le capital économique entrent alors en conflit. Martine Furno montre ainsi, comment, progressivement, la figure de l’humaniste et celle de l’imprimeur se distinguent au cours du XVIe siècle dans l’aire francophone, en s’appuyant notamment sur les trois « learned printers » que furent Josse Bade, Adrien Turnèbe et Henri II Estienne. Son analyse des stratégies divergentes de Robert et Henri II Estienne, qu’elle qualifie de « derniers imprimeurs savants », montre bien la tension sociale et les déchirements personnels qu’engendrent cette évolution : Henri II Estienne s’en prend aussi bien aux imprimeurs avides qu’aux éditeurs prétentieux (Vettori) : il contrôle toute la chaîne.
Mais quand Henri II Estienne est déchiré par ce statut en construction, Adrien Turnèbe, lecteur royal en 1547 et imprimeur royal pour le grec à partir de 1552, joue de ce statut pour asseoir son autorité de philologue, notamment dans le cadre de polémiques savantes, par exemple avec Boidin et Ramus. Turnèbe est d’abord un docte, mais investi de la charge très valorisée d’imprimeur royal, il est doté d’un pouvoir dont il joue face aux autres doctes avec lesquels il est en conflit.
Quant au traducteur, s’il est souvent le premier à transmettre l’œuvre, il le fait volontiers aux dépens du texte ; mais, comme le montre Christiane Deloince‑Louette, dans la seconde partie du XVIe siècle, alors que s’affirme l’importance d’un texte fiable dont la traduction doit se faire le reflet, les traducteurs se font de plus en plus philologues, avant de se muer en commentateurs. C’est alors le commentaire qui prend le relais de la transmission de la matière homérique.
S’affirmer au sein d’une tradition continue : comment s’inscrire dans une tradition tout en revendiquant son apport
Une autre tension concerne la relation entretenue avec la tradition : les savants disent volontiers dans les paratextes la dette qu’ils ont envers leurs prédécesseurs ; mais s’ils publient, c’est bien pour apporter leur pierre, que ce soit de manière critique ou cumulative, à l’édifice philologique. La question se pose de manière particulièrement aiguë dans les familles de philologues, où le nom du père est à la fois un garant et une figure qu’il s’agit de dépasser, tout en se montrant un fils respectueux. Dousa non seulement affiche sa filiation mais publie les travaux de son père : comment, dans cette situation, faire entendre sa voix ? Sarah Gaucher montre que cela passe, dans ce cas, par une identification avec l’auteur édité.
De même que le fils doit se montrer pieux envers son père, les éditeurs s’efforcent de concilier un ethos de modestie qui est topique avec la critique des travaux de leurs prédécesseurs : Scaliger affiche ses principes, « ne pas nommer les vivants et respecter les anciens », mais en réalité il est sans doute l’une des plumes les plus acérées de son temps. Il est talonné par Modius qui, entrant dans la carrière, vitupère à tout-va, contre les imprimeurs et contre les éditeurs de Quinte-Curce, pourvu qu’ils soient morts. Lucie Claire montre bien ici comment le jeune philologue concilie un ethos plein d’humilité, soucieux de servir les textes avec rigueur, avec une rhétorique de l’invective qui atteint des sommets contre notamment Hutten, Érasme et Glaréan, qui lui donnent, dit-il, la nausée.
S’affirmer face à ses pairs : polémiques philologiques
Enfin, le philologue s’affirme au sein d’une communauté des philologues qui au mieux prend la forme d’une sodalitas, mais qui peut aussi être le lieu de violentes polémiques. Si certains font état d’une éthique – ne pas invectiver les vivants nommément, ne pas s’en prendre aux morts, faire preuve de bonne foi et combattre à coup d’arguments et non d’injures – la lecture de bien des paratextes, des commentaires mais aussi d’autres sources moins publiques révèle une concurrence féroce qui donne lieu, chez ces maîtres du langage, à des invectives aussi savoureuses que perfides. L’attitude la plus prudente pour désavouer le travail d’un collègue est sans doute celle adoptée par Scaliger vis-à-vis de l’édition de Properce par Muret, ou de Dousa vis-à-vis de celle de Lucilius par Estienne : ne pas citer le travail de son prédécesseur. La plupart du temps cependant, on se pose en s’opposant. Les savants français s’en prennent aux Italiens, qui ne manquent pas d’en faire autant. Scaliger, encore lui, se targue ainsi d’avoir expliqué Properce aux Italiens. Plus encore que la méthode, ce sont les soupçons de plagiat qui donnent lieu à de violents affrontements. Comme le rappelle Philippine Azadian, Turnèbe recourt ainsi au vocabulaire du vol pour accuser Bodin (usurpauit, furtiuis, furtiuarum). Mais il faut sortir des textes imprimés pour connaître le fin mot de l’histoire : dans ce cas, c’est Casaubon qui nomme Bodin, à la main, dans la marge de son exemplaire, et qui tranche en faveur de Turnèbe.
Conclusion
Les éditeurs de la Renaissance ont fait les frais de la philologie lachmanienne : comme ils s’en étaient pris à leurs prédécesseurs, ils ont été la cible d’attaques et leurs conjectures sont souvent tombées dans l’oubli. Pourtant, bien des conjectures qu’ils ont formulées se trouvent aujourd’hui dans les apparats critiques, sans qu’elles leur soient pourtant attribuées : c’est le cas de nombreuses variantes de Vettori, comme le pointe Agnese D’Angelo. Mieux : la méthode lachmanienne, juste retour des choses, est à son tour la cible de critiques et, comme l’ont montré Florian Barrière et Bénédicte Chachuat, l’attitude de Bersman face à la tradition du texte de Lucain qui consiste à ne pas hiérarchiser les manuscrits, après avoir été conspuée, est aujourd’hui considérée comme la mieux adaptée aux témoins dont nous disposons. Ce volume aura permis, on l’espère, de leur rendre un peu justice. Il a aussi, en replaçant ces philologues dans leur époque, cherché à mieux comprendre ce qui a pu un temps passer pour de la désinvolture, y compris chez de très bons éditeurs. Le souci, l’urgence presque, de transmettre des textes perçus comme un trésor miraculeusement sauvé mais abîmé par le temps, chez ces philologues qui étaient souvent aussi des pédagogues, explique et excuse sans doute en partie le « Martial castratus » de Gessner et sa manie des loci, évoquée par David Amherdt.
Il resterait maintenant à étudier plus systématiquement le fossé qui se creuse parfois entre ce que les philologues disent d’eux-mêmes et de leurs travaux et ce qu’ils font ; de confronter les principes à la pratique. Il serait aussi instructif d’élargir la focale et d’étudier cette figure émergente non plus seulement à travers ces textes publics que sont les paratextes et les travaux imprimés, mais en se penchant sur l’envers des paratextes : ce que les paratextes ne disent pas, ce que les savants n’écrivent pas publiquement et qu’ils gardent pour les annotations marginales et pour la correspondance privée. Les sondages effectués ici sont aussi savoureux qu’instructifs : débarrassés de l’ethos du savant modeste et rigoureux, les doctes s’y révèlent intarissables sur les travaux de leurs prédécesseurs et de leurs concurrents, rarement pour en faire l’éloge. C’est une histoire qu’il reste à écrire.