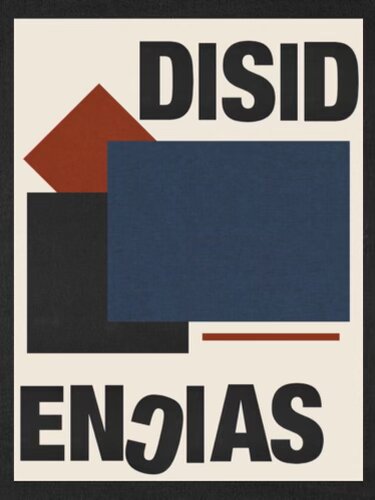La pensée libérale, si fortement ancrée dans la tradition idéaliste, n’a eu de cesse de situer le sujet au fondement du politique. Préalablement doté d’une nature bien définie, le sujet arrive dans l’arène politique avec un projet qui n’est que le reflet, ou le prolongement, plus ou moins abouti de cette manière d’être, cette essentialisation. Effrayé par sa propre méchanceté comme par celle de ses semblables, comme chez Hobbes, il consent de bon gré à aliéner sa souveraineté en faveur d’un pouvoir absolu qui lui garantisse, à tout le moins, la sécurité ; intrinsèquement mû par un désir de possession et de propriété, comme c’est le cas chez Locke, il s’emploie à élaborer toute une architecture politique vouée à la protection et la préservation de ses biens. La société néolibérale, quant à elle, a amorcé ce que Lordon dénomme “le tournant émotionnel”, qui porte à son comble cet individualisme théorique, “au risque de liquider définitivement tout ce qu’il y a de proprement social dans les sciences sociales, en voie de dissolution dans une sorte de psychologie étendue”1. Le sujet constitué facilite en ce sens la concrétion d’une politique qui se déploie dans la pure et simple représentation de l’essence subjective.
C’est pourquoi la remise en question de la figure du sujet, désormais conçu, non plus comme origine, mais comme effet, doit donner lieu à de profonds bouleversements dans le champ politique, le premier défi d’une politique antagoniste étant d’œuvrer à la production d’une subjectivité. À dire vrai, cet objectif a toujours été au fondement de la politique, qui n’a d’autre objectif que d’engendrer un sujet lui servant de fondement. Cependant, la stratégie déployée par l’idéalisme et le pouvoir constitué a surtout eu pour intérêt de faire croire au sujet qu’il est bien ce que l’on dit de lui, et qu’il ne lui reste plus, par voie de conséquence, qu’à s’accommoder de ce qu’il est ; à défaut de quoi il sera en contradiction avec lui-même et le monde. Socrate et Platon furent les premiers artisans de cette stratégie visant à désactiver toute forme de subjectivité antagoniste ; entreprise au nom de laquelle ils s’employèrent à transformer le “connais-toi toi-même” delphique en une arme aristocratique pour contrer la démocratie athénienne. Se demander alors, comme l’exige la philosophie systémique, si l’être humain est naturellement bon ou mauvais, pur ou corrompu, libre ou déterminé, impliquerait de croire que de telles déterminations pourraient être établies indépendamment de toute référence à un sujet incarné, et toujours déjà situé dans un moment social et personnel concret. Or, la tâche qui se trouve au fondement de tout projet politique matérialiste consiste dans la construction d’un sujet conscient de sa propre constitution, et qui comprenne que son auto-constitution est la tâche politique par excellence.
C’est pourquoi nous aborderons dans les pages qui suivent une série de questions décisives quant aux défis politiques qui attendent une telle subjectivité antagoniste.
La question de la liberté
Aborder la question de la liberté d’un point de vue matérialiste nous situe au-delà d’une réflexion sur les essences constituées, et exige au contraire la référence constante au milieu social et naturel dans lequel le sujet agit et se développe. Et pour mener à bien pareille tâche, difficile de trouver meilleur instrument que la pensée de Spinoza, où la liberté se trouve intrinsèquement liée à la connaissance exhaustive des déterminations auxquelles la réalité, comprise sous le concept de Nature, soumet le sujet. Dans une lettre adressée à Schuller, et rédigée en octobre 1674, Spinoza écrit :
J’appelle libre, quant à moi, ce qui existe et agit par la seule nécessité de sa nature […]. Vous voyez donc bien qu’à mes yeux la liberté n’est point dans le libre décret, mais dans une libre nécessité.2
Nombreux sont les passages où Spinoza critique l’idée de liberté telle qu’elle s’est répandue parmi ses contemporains. Ainsi pouvons-nous lirequelques lignes plus bas :
Voilà cette liberté humaine dont tous les hommes sont si fiers. Au fond, elle consiste en ce qu’ils connaissent leur appétit par la conscience, et ne connaissent pas les causes extérieures qui les déterminent.3
À quoi Spinoza ajoute, d’une manière on ne peut plus lapidaire, dans l’Éthique :
Ceux-là donc qui croient parler, ou se taire, ou bien accomplir quelque action que ce soit par un libre décret de l’Esprit, rêvent les yeux ouverts.4
Pour Spinoza, l’agir humain reste soumis aux lois de la réalité et ne peut en aucune manière s’y soustraire. À brûle-pourpoint, on pourrait penser qu’il s’agit là d’une approche qui neutralise d’emblée toute forme de liberté, si l’on s’en tient au discours que la tradition dominante a déployé à ce sujet. Soumis au réel, l’homme serait privé de liberté. Cependant, prendre acte de la soumission de l’homme aux lois et de la nature et de la société constitue, aux yeux de Spinoza, la condition sine qua non pour pouvoir commencer à penser la liberté. Ce n’est qu’en connaissant les règles du jeu que nous pouvons y jouer efficacement, voire, envisager la possibilité de jouer à un autre jeu. Spinoza nous propose ainsi deux outils susceptibles de nous aider à forger la liberté humaine. Le premier est la raison, qui nous fournit la connaissance relative au fonctionnement du réel. Or, ce n’est qu’à partir d’une telle connaissance exhaustive de la réalité, naturelle et sociale, qu’il nous est possible – insistons sur ce point – d’agir sur elle. Seule la connaissance scientifique de la nature rend possible un agir humain efficace. C’est en effet cette connaissance de la nature qui permet d’en orienter les potentialités au profit de l’humain, ou qui nous donne les clés nous permettant, d’une certaine manière, de la plier à notre convenance. Seule la formulation de la loi de la gravité, et la connaissance de ses effets, permet à l’être humain de la défier et de réaliser le vieux rêve d’Icare de voler dans les cieux. C’est pourquoi, dans le Traité politique, notre penseur écrit :
Je dis que l’homme est parfaitement libre en tant qu’il est conduit par la raison.5
Le deuxième outil au service de la réalisation de la liberté humaine conserve un lien étroit avec le premier. Spinoza considère en effet que l’homme est bien plus libre au sein de l’État que dans la solitude, c’est-à-dire en tant que membre d’un collectif plutôt qu’en solitaire6. L’équation spinozienne est d’une logique implacable, en ce sens que la raison, comme nous l’avons signalé plus haut, permet aux êtres humains d’entrer dans des rapports de composition au travers de pratiques communes, ce qui débouche sur l’accroissement de leur puissance et leur confère, par conséquent, une plus grande capacité, non seulement de connaissance de la réalité, mais aussi d’action sur elle. L’être humain isolé, même s’il est pourvu d’une connaissance du réel, se trouve quant à lui fortement limité dans sa capacité à agir sur le réel, et à articuler une praxis politique. Sa liberté demeure en ce sens limitée. Nous pourrions dire qu’il s’agit là d’une liberté contemplative, et comme telle, nécessairement soumise à la réalité. Au contraire, la composition des corps augmente leur puissance, et c’est à partir d’une telle liberté contemplative, et de la connaissance relative au fonctionnement de la réalité qu’elle nous procure, qu’il sera possible d’accéder à une liberté pratique, et d’entrevoir la possibilité de transformer la réalité. À cet égard, il nous semble à la fois opportun et judicieux de conclure cette référence à Spinoza par une citation de Marx, où se conjuguent les mêmes éléments relatifs à la liberté :
Dans ce domaine, la liberté ne peut consister qu’en ceci : les producteurs associés – l’homme socialisé – règlent de manière rationnelle leurs échanges organiques avec la nature et les soumettent à leur contrôle commun au lieu d’être dominés par la puissance aveugle de ces échanges ; et ils les accomplissent en dépensant le moins d’énergie possible, dans les conditions les plus dignes, les plus conformes à leur nature humaine.7
Dans ce corps à corps avec le réel qu’est la vie, le sujet isolé est voué à l’échec. Impossible d’imaginer une action, même la plus individuelle et personnelle, qui ne soit prise dans un réseau collectif permettant sa réalisation. Un simple geste, comme celui consistant à allumer la lumière, reste conditionné par une entreprise collective de production énergétique qui ne saurait en aucun cas être le fait d’un individu isolé. Le plus misanthrope des humains lui-même dépend, sans en avoir toujours conscience, d’un vaste réseau d’autres hommes et femmes qui garantissent son prétendu isolement individuel. Tous nos gestes quotidiens – s’habiller, manger, mettre en marche sa voiture, utiliser les transports en commun, ouvrir la douche, ou rédiger un texte – ne sont que le tout dernier maillon d’une vaste chaîne collective. Sans cette intense intersubjectivité au sein de laquelle se déploie notre existence, la vie se compliquerait à un point tel qu’il nous faudrait nous contenter de tâches propres à la simple survie. L’individualité et l’isolement nous plongent dans une profonde impuissance, en cela qu’ils relèguent notre liberté au rang de simple abstraction théorique, dénuée de toute efficace pratique. Inversement, la composition de nos rapports avec ceux des autres augmente notre puissance et nous prédispose, par conséquent, à la réalisation d’un certain nombre de pratiques ; en un mot, pareille composition nous rend libres. Libres et mieux préparés à affronter le réel, et, forts d’une véritable connaissance de ses règles et des ses lois, à le modeler dans le sens de nos intérêts.
Ce travail collectif doit ainsi avoir pour objectif de modeler les lois naturelles et sociales. La loi de la gravité ne peut être abolie, mais la collaboration humaine, notamment au travers de l’Intellect Général, permet de construire des artefacts qui, sous certaines conditions, sont capables de la contourner. De la même façon, et cette fois-ci d’un point de vue politique, l’action conjointe des sujets a la capacité d’engendrer de nouveaux horizons sociaux, susceptibles de déborder des univers constitués. Une politique constituante ne peut être élaborée que sur la base d’une action collective. Dans le champ politique, l’individu isolé ne peut guère espérer que la soumission à la légalité en vigueur, ou bien l’acceptation des conséquences découlant de sa désobéissance. En d’autres termes, seule l’action collective est en mesure de faire plier le pouvoir constitué.
Cependant, pareille politique constituante requiert une conception de la liberté qui ne soit pas le résultat d’un choix entre différentes options, mais plutôt une production de réalités nouvelles. L’ontologie matérialiste, dès lors qu’elle s’engage pour l’avenir, donne lieu à une ontologie de l’imagination, de l’invention. Le matérialisme, dont l’efficacité s’éprouve traditionnellement dans l’analytique du présent et du passé, devient trouble et peu compréhensibledès qu’il est question de préfigurer ou d’anticiper l’avenir. Le futur est l’espace de l’imagination, et c’est sans doute le philosophe Cornelius Castoriadis qui, mieux que tout autre, a su mettre en évidence les liens qui unissent imagination et politique. Il faut dire que l’imagination est sans conteste l’un des thèmes les plus négligés par la tradition philosophique systémique et critique. Les rares fois où l’imagination put sortir de l’oubli, elle fut (à l’exception notable de Giordano Bruno) immanquablement méprisée et accusée de produire de l’irréalité8. Car face au réel, et à ce qui est, l’imagination s’occupe de ce qui n’est pas. Castoriadis nous montre pourtant que les institutions constituant le monde social sont toujours le fruit d’une production, d’une création. Toute société, dans le processus de sa constitution, commence toujours par imaginer une architecture qui la différencie des sociétés passées, de sorte que la politique est bien affaire d’imaginaire et d’imagination:
On ne peut “expliquer” ni la naissance de la société ni les évolutions de l’histoire par des facteurs naturels, biologiques ou autres, pas plus que par une activité “rationnelle” d’un être “rationnel” (l’homme). On constate dans l’histoire dès l’origine l’émergence du nouveau radical, et, si l’on ne veut pas recourir à des facteurs transcendants pour en rendre compte, on doit bien postuler une puissance de création, une vis formandi, immanente aux collectivités humaines comme aux êtres humains singuliers. Il est dès lors tout à fait naturel d’appeler cette faculté de novation radicale, de création et de formation, imaginaire et imagination.9
Il convient en ce sens de distinguer ce que nous pourrions dénommer (pour reprendre la terminologie de Castoriadis) la “politique instituante”, qui promeut la nouveauté, et comprend les institutions dans leur devenir social, et la “politique instituée”, qui, au contraire, s’emploie à défendre et à éterniser un état des choses. Ou, pour le dire en des termes plus appropriés à la réflexion que nous menons, le “pouvoir constituant” et le “pouvoir constitué”.
La réflexion de Castoriadis s’ancre dans une conception ontologique où se fait jour une dimension de l’être qui est celle du pour-être,10 de l’être en tant qu’il est tourné vers le futur mais sans savoir encore ce qu’il adviendra. L’ontologie castoriadienne n’élude point la dimension du futur ni, par conséquent, celle de la “création ontologique”11. C’est pourquoi nous considérons, d’un point de vue matérialiste, que l’imagination est vouée à jouer un rôle de première importance dans le cadre de cette création ontologique. Une approche qui, par ailleurs, n’est pas si éloignée des réflexions conduites par Rosa Luxemburg à propos de la construction d’une société nouvelle :
Nous savons à peu près ce que nous aurons à supprimer tout d’abord pour rendre la voie libre à l’économie socialiste. Par contre, de quelle sorte seront les mille grandes et petites mesures concrètes en vue d’introduire les principes socialistes dans l’économie, dans le droit, dans tous les rapports sociaux, là, aucun programme de parti, aucun manuel de socialisme ne peut fournir de renseignement. Ce n’est pas une infériorité, mais précisément une supériorité du socialisme scientifique sur le socialisme utopique, que le socialisme ne doit et ne peut être qu’un produit historique, né de l’école même de l’expérience, à l’heure des réalisations, de la marche vivante de l’histoire, laquelle, tout comme la nature organique dont elle est en fin de compte une partie, a la bonne habitude de faire naître toujours, avec un besoin social véritable, les moyens de le satisfaire, avec le problème sa solution. […] Seule l’expérience est capable d’apporter les correctifs nécessaires et d’ouvrir des voies nouvelles. Seule une vie bouillonnante, absolument libre, s’engage dans mille formes et improvisations nouvelles, reçoit une force créatrice, corrige elle-même ses propres fautes.12
Cependant, si nous concevons le futur comme la concrétion de l’imagination, comme la production engagée par le travail imaginaire, il nous faut alors réélaborer notre propre conception de la liberté. Désormais, celle-ci ne peut plus être identifiée à la liberté élective, car nous ne saurions faire un choix à partir de ce qui n’existe pas encore ; bien au contraire, il sera question d’une liberté productive, impliquée comme telle dans la tâche de produire l’avenir. À cet égard, on doit précisément à Jesús Ibáñez d’avoir su distinguer ces deux types de liberté et d’avoir mis au jour leurs implications respectives.
Il y a différents niveaux de liberté. Deux d’entre eux retiennent tout particulièrement notre attention. […] Liberté de choisir parmi des alternatives données (de décision) et liberté de créer des alternatives (de distinction). La première est de l’ordre d’une lecture, tandis que la deuxième relève de l’écriture. Il est deux manières de consommer la Loi : le mode sémantique (lecture) et le mode pragmatique (élection). Dans une “société libre”, l’on trouve une liberté de lecture ou d’élection, mais non pas d’écriture : l’écriture (distinction) est l’affaire de ceux qui donnent les ordres, la lecture ou l’élection (la décision) celle de ceux qui les reçoivent.13
Liberté de “créer des alternatives”, de dépasser celles que nous offre le système, ces fausses alternatives qui, la plupart du temps, n’impliquent que des décisions superflues. S’il y a bien quelque chose qui caractérise le capitalisme de consommation, c’est précisément cette entreprise consistant à identifier la liberté au choix, et à en multiplier les possibilités. Pareille liberté, dont on dira avec Sloterdijk qu’elle ne consiste tout au plus qu’à devoir “choisir entre quatorze types différents de sauces pour assaisonner la salade”14, nous met dans la position délicate d’avoir à faire un choix entre les différents types de patates (à bouillir, à frire ou à rôtir) qui nous sont proposés dans les rayons du supermarché. Face à de tels choix qui reviennent toujours au même, à la reproduction de ce qui existe déjà, à l’inanité la plus crue, Ibáñez fait le pari d’une liberté qui rende le sujet capable de produire de la nouveauté, de parcourir son propre chemin. À cet égard, la parabole du maître zen, dont se sert souvent Ibáñez et qu’il emprunte à Bateson, constitue sans nul doute la meilleure manière de distinguer ces deux types de liberté :
Le maître bouddhiste soumet son disciple […] à l’expérience suivante : brandissant un bâton au-dessus de sa tête, il lui dit : “si tu dis de ce bâton qu’il est réel, je te frapperai avec ; si tu dis qu’il n’est pas réel, je te frapperai avec ; si tu ne dis rien, je te frapperai avec.” Le disciple ne saura sortir indemne de cette expérience tant qu’il s’en tiendra à son rôle de disciple, tant qu’il continuera à octroyer au maître le droit et de lui poser pareille question et de le punir quelle qu’en soit la réponse. S’il rompt le contrat d’apprentissage ; s’il ne respecte pas les règles du jeu sur lesquelles repose leur rapport, alors plusieurs alternatives s’offriront à lui : il pourra énoncer de nouvelles règles (comme la loi du plus fort, qui fera qu’il lui arrachera son bâton, qu’il le jettera, ou qu’il le cassera sur sa tête) ; il pourra également faire fi de toute règle (en les dissolvant par ses paroles, en tenant tête à son maître et en lui disant : “dis-donc crétin, c’est pas bientôt fini tes foutaises ?” , ou via un mouvement corporel, en lui tournant le dos et en s’éloignant en sifflotant).15
Pour que la liberté de production puisse se concrétiser, il est nécessaire d’en finir avec les espaces striés et balisés tels qu’ils sont produits par le pouvoir, et d’engendrer des espaces lisses et résolument neufs. En s’appuyant sur la terminologie deleuzienne, Ibáñez propose ainsi une pratique de destruction des sentiers battus et déjà tout tracés à même la réalité, c’est-à-dire de tous ces sentiers qui nous conduisent exactement là où le pouvoir le souhaite : à la croisée des chemins, en cet endroit précis où les directions possibles sont écrites et déterminées à l’avance, il incombe au sujet d’élaborer son propre itinéraire. Le sujet de la subsomption, sédentaire et constitué, ressemble en ce sens à l’eau contenue dans un récipient : une fois qu’elle en est expulsée, elle s’empresse aussitôt de suivre le chemin tracé par la canalisation, de couler conformément aux stries du sol sur lequel elle s’épanche. Au contraire, le sujet nomade, critique et constituant, est celui qui rompt la canalisation afin de transiter librement sur le territoire :
L’espace lisse est l’espace du hasard ou de la liberté, tandis que l’espace strié désigne celui de la volonté ou de la nécessité. L’espace lisse est l’espace des fluides non canalisés ou des solides informes ; l’espace strié, pour sa part, est l’espace des solides formés ou des fluides canalisés.16
La subjectivité collective
Cela fait déjà plusieurs décennies qu’on annonce l’obsolescence de la forme-parti comme mode d’organisation et d’élaboration de politiques à caractère antagoniste. Il n’en reste pas moins que ce problème persiste et fait continuellement obstacle à la prétention de mettre en œuvre d’autres manières de faire de la politique. En Espagne, Izquierda Unida17 se constitue à la fin des années 80 avec l’objectif avoué de constituer un mouvement politique et social pluriel, et profondément démocratique, où les décisions et l’élaboration programmatique (aussi appelée “élaboration collective”), devaient être définies de bas en haut. Mais en réalité, à de rares exceptions près, Izquierda Unida continua de fonctionner comme un parti politique classique, subordonné aux dynamiques institutionnelles et aux rythmes propres à la structure professionnelle de l’organisation. Récemment, Podemos18a prétendu développer à son tour une nouvelle forme d’organisation, où la démocratie et la participation occuperaient une place de choix. Mais il faut bien dire que, pour des raisons tenant pêle-mêle au calendrier électoral, à l’ampleur de la tâche ou à l’absence de volonté politique, on observe une dérive certaine vers les us et coutumes de la forme-parti traditionnelle. Il est vrai que les mouvements dits municipalistes ont réalisé de grandes avancées en matière d’organisation collective, mais ils font face aujourd’hui -notamment dans la gestion de certaines grandes villes- à un problème récurrent et particulièrement épineux pour qui entend mener une véritable politique démocratique : celui de la participation et de l’implication de tous les citoyen.ne.s dans le débat politique et la prise de décisions.
La forme-parti traditionnelle s’inscrit dans une histoire, et correspond à une certaine conception datée du sujet politique. Cette histoire est celle du XIXe siècle, où l’état précaire des communications et des transports faisait obstacle à l’existence de contacts prolongés et fréquents entre des militants souvent géographiquement très éloignés les uns des autres, ce qui explique aussi que les décisions étaient souvent prises par un petit noyau d’individusavant d’être répercutées en cascade vers les niveaux inférieurs de l’organisation. À quoi il faut ajouter une situation fréquente de clandestinité ou de répression, qui ne permettait pas le débat libre et ouvert, et faisait une fois de plus qu’un groupe restreint de personnes se retrouvait à devoir tracer les lignes directrices de l’action politique. Mais ce n’est pas tout : car la forme-parti traditionnelle est profondément ancrée dans une conception essentialiste du sujet politique ; conception en vertu de laquelle le parti est considéré comme l’expression organisée d’un sujet unitaire et doté d’une essence spécifique. En ce sens, le parti s’inscrit dans une logique de la représentation et de l’identité : il re-présente et exprime sur un mode collectif l’être de classe des membres qui le composent. D’où il s’ensuit une conception compacte et monolithique du parti au sein duquel la moindre divergence peut très vite apparaître comme une déviation ou une dissidence. La pluralité ne s’accorde pas – ou s’accorde mal – avec la conception traditionnelle du parti.
La forme-parti s’avère donc incompatible avec une anthropologie matérialiste, dont le point de départ, comme nous l’avons souligné au cours de ces pages, consiste à prendre acte de la différence subjective. Une différence qui doit être au cœur du travail de production d’une forme organisationnelle nouvelle, et résolument axée sur la pluralité et la diversité qui traversent le sujet politique antagoniste.
Cette nouvelle forme d’organisation sera plus horizontale, et aura à cœur de mettre en place un véritable partage des responsabilités qui devront être soumises à l’évaluation et à la révocabilité permanentes de l’ensemble des membres de l’organisation. On le sait, la verticalité et l’accaparement des postes de pouvoir constituent les maux les plus prégnants de la forme-parti traditionnelle, et leur remise en cause doit être au fondement d’une véritable alternative organisationnelle. Un problème d’autant plus complexe que l’immédiateté propre à nos sociétés médiatiques exige, de la part des organisations politiques, une réactivité et des réponses quasi-instantanées, ce qui, on le comprend, est plus facile à obtenir dans le cadre d’une structure centralisée et hiérarchisée. Mais on ne voit pas pourquoi une telle difficulté devrait supposer la fin ou l’abandon de toute réflexion.
Cette nouvelle forme organisationnelle – insistons sur ce point – devra impérativement articuler un principe d’horizontalité délibérative avec de nouvelles formes de représentation. La critique de la représentation est l’une des constantes des nouvelles formes d’organisation politiques, et elle exprime, de manière plus ou moins consciente, le soubassement anthropologique matérialiste auquel nous avons fait référence tout au long de cet ouvrage. Si la différence est constitutive des subjectivités et de leur manière d’être, il s’ensuit que la représentation est en soi vaine et impossible. Car seul est re-présentable ce qui se présente sous le signe de l’identique. Par conséquent, la représentation constitue une incohérence théorique du point de vue d’une anthropologie de la différence. Pour autant, l’abolition de toute forme de représentation au profit d’une dynamique entièrement délibérative ne serait pas viable. Comme le souligne Daniel Bensaïd :
À moins d’imaginer les conditions spatiales et temporelles d’une démocratie immédiate au sens strict – sans médiations – permettant que le peuple soit en permanence assemblé, ou encore une procédure de tirage au sort par laquelle l’élu serait censé remplir une fonction sans être investi d’un mandat, ni représenter personne, la délégation et la représentation sont inévitables.19
Les critiques que nous formulons à l’encontre de l’assembléarisme – ou l’assembléisme – ne sont pas aussi radicales que celles du Comité Invisible20, mais elles s’appuient sur le constat de l’absence, très souvent constatée, de véritables débats et confrontations pluralistes, et celui de la confiscation progressive de l’assemblée par un petit groupe hyper militant qui finit par s’approprier les décisions collectives. Or, la substitution d’un groupuscule de militants à un noyau dirigeant ne saurait constituer, à notre sens, une quelconque avancée. Rancière souligne d’ailleurs, non sans lucidité, que la lassitude constitue le motif plus souvent invoqué pour réclamer d’autres formes de représentation21. Quoi qu’il en soit, les processus de participation devront s’efforcer de recourir à des outils de communication favorisant des interventions plus nombreuses et diverses dans les débats, dans le droit fil de ce cyborg inversé et antagoniste auquel nous avons déjà fait référence. Il faut donc remédier aux insuffisances de l’assembléarisme par de nouvelles formules représentatives qui seront-elles-mêmes soumises à un contrôle collectif. Et par-dessus tout, il faudra veiller à éviter la propagation de ces deux cancers qui rongent toutes les organisations politiques : la professionnalisation et la perpétuation des politiques aux postes de pouvoir. La professionnalisation tend à générer des logiques et des mécanismes de défense d’intérêts propres qui se substituent le plus souvent à la défense de véritables principes politiques. Deux mesures pourraient permettre d’éviter pareil écueil: imposer la révocabilité des mandats, et fixer une période maximale d’exercice, ce qui était déjà le cas au sein de la démocratie athénienne, et qui fut également repris par une bonne partie de la tradition matérialiste, depuis Machiavel et Spinoza jusqu’à nos jours.
Autre trait distinctif souhaitable de cette nouvelle forme organisationnelle, une certaine plasticité, et la capacité à opérer des transformations constantes, à commencer par celles touchant à sa propre dénomination. A cet égard, il est surprenant de constater l’attachement quasi-viscéral à des noms ou des sigles, comme s’ils renfermaient la formule secrète de nos succès futurs. Nous avons ainsi tendance à oublier que les organisations -et surtout leurs dénominations- ne sont que de simples outils à mettre au service des fins que l’on aura fixées. C’est pourquoi l’agilité et la capacité d’adaptation aux changements doivent devenir le cœur de nos pratiques organisationnelles. L’apparition de Podemos a ainsi donné lieu à une myriade d’organisations (Ganemos, En Común, Mareas) qui ont toutes fait la preuve de leur capacité à marquer rapidement les esprits, et à s’installer au cœur des préoccupations citoyennes. Dans nos sociétés médiatiques, l’argument de la méconnaissance des citoyens ne peut plus être avancé pour s’opposer aux mutations nécessaires de nos organisations traditionnelles.
Différence et processus sont ainsi les deux concepts-clé qui doivent présider à l’organisation de formes politiques nouvelles. La différence, comme nous l’avons déjà souligné, doit rendre compte de la pluralité du sujet antagoniste, de ses multiples visages et facettes. Cette différence doit pouvoir être exprimée dans une proposition programmatique et, pour ainsi dire, dans un esprit commun face à la réalité. Un esprit affranchi de tout sectarisme et dogmatisme ; vices auxquels nous sommes trop souvent enclins. Si, comme nous avons tenté d’en faire la démonstration dans ce livre, il n’y a pas de vérité unique, mais bien plutôt des vérités multiples qui coexistent, prétendre imposer un seul et même mode de vie considéré comme correct est tout simplement dépourvu de sens. L’idée de processus requiert, quant à elle, la faculté de s’adapter constamment aux mutations du réel et de privilégier les formes qui nous conviennent le mieux. L’entrée en scène de Podemos a inauguré un processus de constitution de collectifs qui n’est pas encore clos. Et qui ne doit surtout pas l’être. L’événement Podemos a constitué un coup de semonce qui a rappelé au monde que les gens ordinaires peuvent à tout moment prendre part au processus de construction d’une organisation politique. Telle fut d’ailleurs, selon nous, le premier mérite de Podemos : celui de dire “nous sommes là”, et en même temps, “réunissons-nous sur tout le territoire”. Et c’est ainsi que les gens s’attelèrent à la tâche. Une tâche chargée d’immanence et d’engagement. Et une fois le travail engagé, une fois que les gens deviennent les protagonistes de leur propre histoire, il devient fort heureusement difficile de les y faire renoncer. Ceux qui, comme nous, réfléchissent à la question du pouvoir constituant, savent que cette formule doit également être appliquée à nos propres organisations. De même que Korsch soutenait qu’il est impératif d’“appliquer le matérialisme historique au matérialisme historique”22, il s’agit désormais, pour notre part, d’appliquer le pouvoir constituant aux organisations qui parlent de pouvoir constituant.
Le combat pour la démocratie
Le mot “Démocratie” est une parole de combat. Et c’est aussi ce qu’atteste son étymologie. Face à des formes classiques de gouvernement comme la monarchie, où le pouvoir fondé (archè) est celui d’un seul (mónos), la démocratie renvoie pour sa part à la force (kratos) que doit développer le peuple (dèmos) pour exercer le gouvernement et, peut-être, conquérir le pouvoir. Nous trouvons donc au cœur même de ce concept les traces d’un conflit. Conflit qui, de fait, parcourt l’histoire depuis ses origines grecques. Ainsi les avancées relatives au processus de démocratisation ont-elles toujours eu lieu au prix de conflits, le plus souvent sanglants, le dèmos, le peuple, ayant toujours été contraint d’arracher ses droits des mains de ceux qui les lui refusaient. L’Europe moderne a ainsi vu l’avancée laborieuse de la démocratie, d’abord sous des formes restrictives, censitaires, jusqu’à l’apparition progressive, tout au long du XXe siècle, du suffrage universel. Ce même suffrage universel est toujours tantôt conquis ou perdu (comme ce fut le cas en Espagne durant la Guerre civile) dans un contexte de conflit social aigu entre les classes dominantes et le peuple. Toutefois, la conquête du suffrage universel ne signifiera jamais la fin du conflit qui consistera, de la part du pouvoir, à n’avoir de cesse de désactiver la démocratie, et la vider de son contenu. Il parviendra de la sorte à conserver la formalité démocratique tout en neutralisant son effectivité, en la dépossédant du kratos, cette force qui lui est authentiquement propre. La haine de la démocratie, telle que la définit Rancière, se manifeste ainsi au travers de sa désactivation effective :
La nouvelle haine de la démocratie peut […] se résumer en une thèse simple : il n’y a qu’une seule bonne démocratie, celle qui réprime la catastrophe de la civilisation démocratique.23
Aujourd’hui, le combat pour la démocratie implique donc de reposer à nouveaux frais la question de son concept, et ce qui doit être compris sous le terme de “démocratie”. Contre le formalisme parlementaire stérile qui caractérise nos sociétés néolibérales, “démocratie” est pour nous le nom du pouvoir constituant et antagoniste. Si par démocratie il faut entendre la réalité que nous proposent des sociétés néolibérales où le pouvoir a déserté les institutions représentatives pour se retrouver aux mains d’instances qui se soustraient au contrôle démocratique, et œuvrent exclusivement au service des élites, alors il ne fait aucun doute que la bataille est perdue d’avance. Le combat doit donc commencer par une dénonciation sans appel de ces insuffisances dûment planifiées de la démocratie libérale, et par la récupération de formes institutionnelles véritablement démocratiques. Et c’est un combat qui s’avère crucial.
C’est pourquoi nous ne saurions partager la position défendue par Alain Badiou, selon laquelle la démocratie constitue l’emblème de la société néolibérale, “emblème” étant entendu comme “l’intouchable d’un système symbolique”24.Dans la mesure où le concept de démocratie est assimilé à celui de société capitaliste, le seul moyen pour lutter contre le capitalisme est, pour Badiou, de remettre en cause le concept même de démocratie. À notre sens, c’est la filiation platonicienne, au demeurant fort connue, de la pensée de Badiou qui permet de comprendre la virulence de ses attaques contre la démocratie, accusée de maux qui sont bien plutôt à mettre au compte du capitalisme et, plus concrètement, de sa forme consumériste et néolibérale. C’est ainsi que, pour Badiou, la démocratie se caractérise par le fait de promouvoir l’infantilisme et la bêtise sociale25, de telle sorte que “le pouvoir de nuisance de l’emblème démocratique est concentré dans le type subjectif qu’il façonne, et dont, pour le dire en un mot, l’égoïsme, le désir de la petite jouissance, est le trait crucial”26. Une critique que Badiou fait endosser au texte platonicien lui-même, où la démocratie est présentée en l’espèce d’un gouvernement entièrement soumis aux vils intérêts individuels, lesquels trouvent dans l’assemblée un lieu où s’exprimer. D’une manière totalement injustifiée, Badiou fait endosser à la démocratie ce qui ne sont que les caractéristiques propres à l’état social du capitalisme contemporain. Il ne fait aucun doute que nous vivons dans des sociétés infantilisantes et égoïstes, soumises aux impératifs de la consommation, pourtant, cette réalité ne découle pas de leur caractère démocratique, mais bien plutôt des stratégies néolibérales de construction de subjectivité. Badiou se trompe de cible et regarde le doigt au lieu de regarder la lune. Et tout cela dans le cadre d’un discours pétri de contradictions ; où la nécessité de miser sur le communisme -comme antithèse de la démocratie-, s’appuie sur l’affirmation selon laquelle être communiste est la seule manière d’être démocrate, ce qui revient à faire revenir par la fenêtre le concept qui avait été évacué par la porte27. Badiou récupère l’idée de communisme, démarche à laquelle nous souscrivons, mais c’est pour la relier à celle de dictature du prolétariat ; une position on ne peut plus problématique, notamment pour qui défend (et c’est bien son cas) la distinction opérée par Marx entre démocratie et dictature du prolétariat28.
Badiou se situe très précisément dans cette lutte pour le concept à laquelle nous faisions allusion précédemment. Tandis que Badiou jette l’éponge et cède à l’ennemi un concept aussi prestigieux que celui de démocratie pour lui préférer celui bien plus dévalué de communisme, ou de dictature du prolétariat, nous considérons, pour notre part, que le véritable enjeu est celui de la récupération et de la re-sémantisation du concept de démocratie. Comme le dit à juste titre Sousa Santos, il ne s’agit pas de chercher une alternative à la démocratie, mais de construire une démocratie alternative29.
Il ne fait aucun doute que pareille démocratie alternative appelle à son tour la construction d’une subjectivité alternative ; or, telle est bien la tâche à laquelle nous avons voulu contribuer tout au long de ce livre. Le dépassement de l’infantilisme et de l’égoïsme auxquels nous condamne le néolibéralisme consumériste, doit être l’un des objectifs-clé de tout processus de construction de cette démocratie alternative. En effet, ce n’est qu’à partir d’une participation intense, mûre et responsable –vis-à-vis du présent comme du futur – qu’il nous sera possible de redresser le cap de ce navire affolé et absurde auquel nous donnons le nom de monde.
Comment nous faut-il nous y prendre pour restituer au kratos du dèmos toute son efficace ? La question n’est pas simple, et nous y répondrons en posant dans un premier temps la nécessité d’ empuissantiser ce dèmos, en lui conférant les outils nécessaires à la prise de décisions. Une nécessité dont il importe de bien comprendre qu’elle s’inscrit dans des sociétés marquées par une participation politique et sociale très affaiblie, et dont la re-politisation ne saurait se limiter aux formes d’un hyper-activisme plébiscité par certains. Une démocratie véritablement alternative, vivante et vibrante, devra apprendre à combiner des formes de démocratie directe avec des formes de représentation qui, si lassantes soient-elles, demeurent, comme le rappelle Rancière30 toujours indispensables. On pourrait établir une analogie avec l’aporie d’une ontologie strictement matérialiste -prise dans la complexité et le devenir incessant du réel-, et l’impossibilité de trouver, dans le champ du politique, des formes de représentation capables de faire droit à une démocratie pleinement démocratique, où chaque sujet jouirait d’une participation pleine et entière aux décisions politiques dans tous les domaines le concernant.
C’est pourquoi une démocratie de la mutuelle compréhension comportera des formes de représentation qui devront être soumises aux normes strictes de révocabilité, de contrôle et de rotation des mandats.
Désir de multitude, désir de démocratie. Désir de reprendre le contrôle de notre destinée commune. Comme le souligne Frédéric Lordon, la politique consiste en un ars affectandi31, en une pratique d’incitation et de construction de désirs, de mobilisation d’affects et de production d’effets. Tel est le désir dont le capitalisme néolibéral et consumériste nous a dépossédé. Le capitalisme a assassiné la politique, et avec elle, bien évidemment, la démocratie. On pourrait dire, pour paraphraser Baudrillard, que c’est le crime parfait, nos sociétés ayant fait du corps sans vie de la démocratie leur emblème symbolique, comme dirait Badiou. Dénoncer ce crime et ne pas se contenter de l’entériner : tel est donc le geste initial qui devra présider à la production de cette démocratie antagoniste.
Notes
- Lordon, F., La société des affects, op. cit., p. 9.
- Spinoza, B., Lettres, p. 59. Disponible en ligne : https://philo-labo.fr/fichiers/Spinoza%20-%20Correspondance.pdf.
- Ibid., p. 60.
- Spinoza, B., Éthique, op. cit., p. 203.
- Spinoza, B., Traité politique, op. cit., p. 10.
- Spinoza, B., Éthique, op. cit., p. 352.
- Marx, K., Le Capital ; “Le processus d’ensemble du capital”, in Marx, K., Œuvres, tome II. Économie, II, Paris, Gallimard, pp. 1487-1488.
- Castoriadis, C., Figures du pensable. Les carrefours du labyrinthe VI, Paris, Seuil, 1999, pp. 93-97.
- Ibid., p. 94.
- Cabrera, D., Fragmentos del caos, Buenos Aires, Editorial Biblos, 2008, p. 23.
- Castoriadis, C., Figures de…, op. cit., p. 95.
- Luxemburg, R., “La révolution russe”. Disponible en ligne : [https://www.marxists.org/francais/luxembur/revo-rus/rrus4.htm]
- Ibáñez, J., El regreso del sujeto, Siglo XXI, Madrid, 1991, p. 142. Nous traduisons.
- Sloterdijk, P., Si Europa despierta, Valencia, Pre-Textos, 2004, p. 28. Nous traduisons.
- Ibáñez, J., A contracorriente, Madrid, Fundamentos, Madrid, 1997, p. 164. Nous traduisons.
- Ibáñez, J., Del algoritmo al sujeto, Madrid, Siglo XXI, 1985, p. 102. Nous traduisons.
- En français : la Gauche unie. Il s’agit d’une coalition politique formée en 1986 par différents partis de gauche et d’extrême gauche autour du Parti communiste d’Espagne. Dans l’actualité, son coordonnateur fédéral est Alberto Garzón. [NdT]
- En français : “Nous pouvons”. Parti politique progressiste fondé en 2014, dont le premier secrétaire général fut Pablo Iglesias. [NdT]
- Bensaïd, D., “Le scandale permanent”, in Ouvrage collectif, Démocratie, dans quel état ?, Paris, La Fabrique, 2009, p. 34.
- Comité Invisible, À nos amis, op. cit., pp. 58-60.
- Rancière, J., La Philosophie et ses pauvres, Paris, Flammarion, 2006, p. 204.
- Korsch, K., Marxisme et philosophie, Paris, Minuit, 1964.
- Rancière, J., La haine de la démocratie, Paris, La Fabrique, 2005, p. 10.
- Badiou, A., “L’emblème démocratique”, in Ouvrage collectif, La démocratie, dans quel état ?, op. cit., p. 10.
- Ibid., pp. 13-14.
- Ibid., pp. 11-12.
- Ibid., p. 17.
- Badiou, A., De quoi Sarkozy est-il le nom ?, Paris, Lignes, 2007, p. 122.
- Sousa Santos, B., “Globalización y democracia”, in Archipiélago 73-74, diciembre de 2006, p. 114.
- Rancière, J., La philosophie…, op. cit., p. 204.
- Lordon, F., Les affects…, op. cit., p. 44.