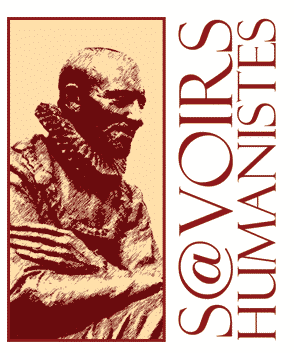« Apuleius, Lucianus, Lazarillus »1. D’où venait cette perception spontanée, chez les contemporains, d’une continuité entre les auteurs satiriques anciens et ce texte nouveau, inouï, qu’était le Lazarillo de Tormes ? Se poser cette question, c’est d’emblée s’intéresser à la forme, à la construction du medium littéraire, plutôt que de s’intéresser directement à la question du monde représenté, à la question sociale autour de 1550. On ne niera pas que l’apparition d’un lumpenproletariat urbain, fait de déracinés, d’aventuriers ou de marginaux voués à la précarité, a été une réalité d’époque, qui a suscité des écrits très divers sur les gueux : moralisateurs comme le Liber vagatorum allemand attribué à Thomas Murner (1512), comiques et ethno-linguistiques comme la Vie des mercelots, des gueux et des camelots française (1592), réformateurs comme l’Amparo de pobres de Cristóbal Pérez de Herrera (1598), avant les élaborations littéraires plus sophistiquées que sont les romans picaresques. Les approches socio-historiques de la littérature, depuis les études d’Antonio Maravall2 ou de Michel Cavillac3, ont prouvé maintes fois leur apport. Mais pour que cette réalité apparaisse, il fallait aussi qu’il y ait un changement de point de vue sur les marges sociales, peut-être imputable à des facteurs généraux comme les réformes religieuses (qui rendent la mendicité suspecte), ou à des bouleversements sociaux posant la question des origines et des effets de l’inégalité sociale. Il fallait encore, pour donner lieu au roman picaresque, que cet intérêt nouveau pour ceux d’en bas se traduise par une tentative d’adopter le point de vue du pícaro, du gueux, du rogue.
Notons le caractère réducteur de ces trois termes en ce qu’ils ramènent la problématique à celle de la misère, là où le monde picaresque est aussi celui des hombres nuevos, des parvenus, des upstarts, celui de la circulation sociale en somme : le propre du personnage picaresque est de tantôt profiter, de tantôt pâtir d’une mobilité sociale ascendante ou descendante, aussi imprévisible que la roue de la Fortune, et souvent illusoire (notamment dans les romans espagnols). Le problème du parasitisme social ne se posait pas uniquement dans l’univers de la rue et du bas peuple, mais aussi dans celui des cours et dans l’entourage des Grands, très critiqué par le vaste mouvement de la littérature anti-aulique de la fin de la Renaissance. Les véritables personnages picaresques ne fréquentent-ils pas des archevêques, des cardinaux ou des gentilhommes, tout comme des coupeurs de bourse, des aubergistes et des prostituées, constatant que les mêmes méthodes, telles le mensonge ou le vol, s’appliquent ici et là ?
L’ambiguïté des récits picaresques, jusqu’à Moll Flanders au moins (1722), tient à la fiction du récit auto-apologétique d’une première personne douteuse, cherchant à se justifier et à célébrer ce qu’elle prétend être ses réussites, tout en suscitant le rire, la perplexité, voire le malaise moral du lecteur4. L’énonciation ambiguë génère l’effet picaresque, car elle dépend d’une persona à la fois sympathique et louche, tantôt véridique et tantôt manipulatrice, admirable et insupportable. Et la génialité satirique des œuvres picaresques consiste à faire du personnage-narrateur d’une part la source d’un regard satirique acéré (et justifié) sur la société autour de lui, d’autre part la cible paradoxale de son propre discours, puisqu’il incarne par son comportement, nolens volens, les vices qu’il critique. Nous proposons d’identifier dans le Parasite de Lucien de Samosate le modèle ayant inspiré les premiers auteurs picaresques. De même que tout un genre moderne, le dialogues des morts, a découlé de l’imitation d’un texte privilégié de Lucien portant ce titre ; et de même que les Histoires véritables constituent l’hypotexte fondamental des voyages imaginaires et utopiques de la première modernité, il ne serait pas abusif de voir dans le Parasite le patron de l’énonciation picaresque (même si, concernant la variante féminine de la pícara, il faudrait aussi évoquer les Dialogues des courtisanes du même auteur).
Un modèle antique peut en cacher un autre : dans la composition rhapsodique du Lazarillo de Tormes, structuré par une succession de maîtres qui constituent autant de mauvaises expériences pour le personnage principal, on a souvent reconnu l’Âne d’or d’Apulée – métamorphose en moins, en tout cas dans le récit de 1554, continué différemment dans la Segunda parte de 1555 –, et quant à Lucien de Samosate, le récit parent intitulé Lucius, ou l’Ane, petit jumeau du grand récit apuléen5. Mais c’est encore une fois privilégier le narré, plutôt que l’instance narratrice. Ce qui a peut-être occulté l’importance du Parasite, c’est aussi qu’il n’est pas le plus diffusé des opuscules de Lucien à la Renaissance. Au regard d’autres textes aux thématiques comparables, comme le dialogue Hôtes à gages, qui pouvait parler au même public, son succès est modeste, comme l’ont constaté toutes les études sur la réception de Lucien6. Mais ce serait oublier qu’il a trouvé deux relais exceptionnels, à travers Leon Battista Alberti puis Érasme, sur lesquels nous nous arrêterons, de sorte qu’il faut considérer l’influence d’un triple modèle de l’énonciation parasitique – lucianesque, albertien et érasmien – dont le cumul s’avère décisif pour comprendre la genèse d’œuvres modernes comme le Lazarillo de Tormes de 1554 et la Primera parte du Guzmán de 1599, ou encore The Unfortunate traveller de Thomas Nashe (1594), qu’on peut tenir pour un comparant anglais viable (même si ce récit est resté une expérimentation sans suite directe).
Énonciations proto-picaresques
Évoquons tout d’abord le texte de Lucien de Samosate, qui n’est pas un récit, mais un dialogue nous situant au cœur d’une problématique propre au monde antique, celle des rapports entre les patriciens et leurs parasites. À son interlocuteur médusé et ironique, Tychiades, figure de Lucien dans son œuvre, un parasite nommé Simon apprend, au fil d’une savoureuse parodie de dialogue maïeutique (particulièrement du Sophiste de Platon), que son art est non seulement respectable, mais qu’il s’agit d’un savoir suprême : d’une part, il n’est besoin d’aucun effort pour pratiquer cette technè, contrairement à la géométrie, la médecine ou la musique ; d’autre part, elle peut rapporter gros, contrairement à la rhétorique ou à la philosophie, lesquelles deviennent l’objet d’un long parallèle satirique à la fin du texte, soulignant leur caractère inutile voire nuisible, ce qui renverse l’accusation de parasitisme. Le plaisir du texte réside non seulement dans les distinctions savantes entre les différentes parties de la parasitique, examinée de fond en comble, mais aussi dans ce paradoxe que le discours sophistique de Simon s’avère plus éloquent que celui de tous les rhéteurs, constituant une prouesse rhétorique (le parasite se révèle maître dans l’art de faire de la mouche un éléphant) ; voire plus sage que celui de bien des philosophes, le parasite réalisant concrètement, par son je-m’en-foutisme, l’idéal ataraxique auquel aspirent en vain ceux qui se tourmentent avec des idées. Ainsi, le parasite est plus épicurien, ou mieux épicurien qu’Épicure lui-même (Parasite, 11) :
Le plaisir, selon moi, c’est d’abord de ne pas être en proie à la douleur physique, ensuite d’avoir l’âme exempte d’agitation et de trouble. Or le parasite jouit de ces deux avantages, tandis qu’Épicure n’en a même pas un seul. En effet, celui qui s’interroge sur la forme de la terre, l’infinité des mondes, la grandeur du soleil, les distances célestes, les éléments primordiaux, qui se demande si les dieux existent ou non, qui se bat et se dispute sans cesse avec d’autres sur le but même de la vie, celui-là est en proie à des tourments non seulement humains mais cosmiques. Le parasite en revanche, considérant que tout est bien, assuré que les choses ne peuvent être meilleures autrement qu’elles ne sont, empli d’une sécurité et d’une sérénité parfaites, sans être effleuré par la moindre question de ce genre, mange puis dort couché sur le dos, pieds et mains détendus, tel Ulysse quand il quittait Schéria en bateau pour rentrer chez lui7.
Le parasite serait non seulement indispensable à table, puisqu’il réjouit son monde dans les banquets, mais très utile à la guerre, car bien portant physiquement. Lucien nous amuse lorsque Simon vante le talent requis par son métier, qui suppose de choisir avec discernement son patron de même que les plats les plus nourrissants ; il nous fait jubiler lorsque le parasite décrit son triomphe sur les maîtres, renversant le rapport de force entre client et patron. L’ironie est discrètement insinuée par l’interlocuteur, Tychiadès, qui suggère que le parasitisme est une forme de vol qui ne dit pas son nom (Parasite, 21). Quant à la dernière réplique du dialogue, Tychiadès annonce se convertir à l’art de son interlocuteur et vouloir suivre ses enseignements, menaçant le parasite d’être parasité à son tour…
Lucien avait ainsi établi le modèle d’un récit-aveu, auto-dénonciateur8. Auteur de la première traduction latine du Parasite (entre 1408 et 1418), Guarino Guarini, élève de l’intellectuel byzantin Manuel Chrysoloras, possédait une anthologie établie par Isidore de Kiev plaçant Le Parasite en tête de volume. Dans les vers liminaires de sa traduction, il invite son dédicataire à se délasser de ses soucis, offrant son texte s’offre comme un parasite faisant rire son auditeur à gorge déployée ; et le traducteur humaniste, maître de rhétorique, se campe lui-même en parasite divertissant son dédicataire :
[…] Je t’offre un parasite grec
Qui se présentera en bon latin
Et t’expliquera combien est beau son art.
Tu riras d’un rire sardonique en l’écoutant,
Et tu feras entendre des éclats d’hilarité bruyants9.
David Marsh montre à quel point ce modèle pouvait amuser dans les cours italiennes où les humanistes « vendaient » leurs services… non sans auto-dérision, ainsi que le suggère la comédie Catinia de Sicco Polenton (1419), qui fait de la rhétorique de taverne un exercice de style, en mettant en scène cinq buveurs, dont le héros éponyme, « vendeur de pot » de son état, rivalisant en éloges des plaisirs de la table, tout en critiquant l’inutilité des philosophes, avocats, médecins et doctes universitaires, incidemment désignés comme les véritables parasites, dans un renversement très lucianesque10.
Alberti était l’ami personnel de Guarino de Vérone. Son Momus, œuvre d’une complexité ébouriffante composée entre Rome et Florence (1443-1553), a joué un rôle matriciel dans la genèse du picaresque en raison de la traduction espagnole d’Agustin de Almazán (1553)11. S’il est bien un passage qui a inspiré l’auteur du Lazarillo de 1554, comme il a manifestement inspiré Mateo Alemán, c’est l’éloge paradoxal du vagabond par Momus, personnage éponyme de cette allégorie mythologisante. Momus pourrait être décrit comme une sorte de dieu picaresque, patron ambivalent du Blâme qui sème le trouble dans les cieux, maître malveillant de la calomnie, mais aussi héros de la libre-parole qui s’expose à la vindicte générale parce qu’il énonce la vérité. Par son ironie caractéristique, Momus captive l’attention des autres dieux, lors d’un banquet, en leur racontant sa descente chez les hommes au Livre II. Parmi les diverses conditions qu’il a essayées chez eux (idée probablement inspirée par un autre texte de Lucien, Le Songe, ou le Coq), Momus dit n’avoir apprécié ni celle de soldat qui lui a paru abominable, car sous la gloire attachée aux carrières militaires se cache la violence déchaînée et la loi du plus fort ; ni la condition de roi, vouée au souci car soit on trahit les autres, soit on est trahi ou menacé de l’être en permanence ; ni celle de marchand, dédiée à une cupidité méprisable ; mais bien celle de mendiant, ou de vagabond (erro)12. Le vagabond, en effet, n’est envié de personne, et il n’envie personne. Imitant étroitement le début du Parasite dans ce morceau de bravoure, Alberti prête à Momus un éloge de la facilité et de la perfection de cette « science », par comparaison avec la géométrie : elle s’apprend totalement et immédiatement, sans le moindre effort ! Le vagabond peut se targuer à bon droit de vivre de la sueur d’autrui : c’est lui le véritable roi, paradoxalement. Mieux, alors que les prédicateurs et les orateurs sérieux sont ignorés, le vagabond attire les foules amusées à lui, et sa faconde, due à l’ivresse, ravit ses auditeurs. Il se rit de tout, impassible alors que des catastrophes naturelles sévissent tout autour, ou que les autres s’activent par cupidité, navigant sur les flots, creusant des mines, calculant leurs gains. Alors que les princes se lancent dans des guerres sanglantes, bouleversant l’ordre du mode pour satisfaire leur ambition, plongeant les peuples dans la désolation, le vagabond reste parfaitement indifférent, continuant de rire. Rire du stultus, rire idiot, ou rire du sapiens, rire du sage pratiquant l’ironie ?
Alberti nous défie de choisir, ayant construit un chef-d’œuvre à double tranchant, un modèle d’éloge paradoxal. D’une part, l’éloge du vagabond est un véritable blâme, étant donné qu’il incarne par son irresponsabilité et son asocialité, proche de l’autarcie cynique, l’inverse de l’idéal de l’humanisme civique, et plus spécifiquement l’inverse des valeurs personnelles d’Alberti : on ne peut croire que ce dernier prône l’incuria, la negligentia, l’inoptia du vagabond, là où il chante partout ailleurs l’activité, le zèle, l’effort, y compris dans les lettres, qu’il comprend comme industria, non comme otium13. A fortiori si l’on traduit erro par mendiant : la stérilité et l’improductivité vantées par Momus ne sont-ils pas le propre des moines, méprisés par Alberti comme par de nombreux humanistes florentins ? Toutefois, comment dénier que l’indifférence du vagabond constitue la voie la plus courte pour atteindre une forme étonnante d’ataraxie philosophique ? Les railleries diogéniques de Momus envers ceux qui s’encombrent de lourdes toges, de breloques de valeur et d’autres artifices clinquants sont bien celles d’Alberti, de même que sa critique des princes et des marchands. Et comment le satiriste ne s’identifierait-il pas à ce personnage de clochard bouffon qui raille impunément, régalant son auditoire sans avoir de comptes à rendre ? Ce portrait du vagabond constitue par certains traits une mise en abyme du personnage de Momus, le picaro de l’Olympe, mais aussi de l’auteur Alberti ; par d’autres il en constitue l’antithèse14.
Alberti semble jouer tout au long de cet éloge sur la parenté entre le substantif erro (qui a donné le français hère), et le verbe errare, qui renvoie à l’erreur, autant qu’à l’errance. Erro : j’erre, je me trompe. L’équivoque interprétative est pareillement généralisée dans le Moriæ encomium d’Érasme, publié en 1511, modèle à bien des égards pour l’auteur du Lazarillo : par sa construction silénique et son usage axiologique du renversement paradoxal ; par la satire virulente des doctes, des puissants et des clercs ; mais surtout par son ambivalence énonciative. Le coup de génie d’Érasme est d’avoir situé l’éloge de la stultitia (folie ou idiotie), dans la bouche de Folie elle-même, ce en quoi il se distingue totalement des revues satiriques des états du monde et de la littérature du Narr antérieure (à la manière de Sébastian Brant). Le Parasite est mentionné parmi d’autres exemples d’éloges paradoxaux dans l’épître à Thomas More15, mais son rôle particulier de modèle a été reconnu par les critiques les plus avisés de l’œuvre d’Érasme16, en sus des spécialistes de la réception de Lucien17. C’est surtout dans la première section du texte que le thème parasitique éclate, lorsque Folie chante l’insouciance des idiots, des cocus, des ivrognes et de tous ses « petits fous », ses « gorets » profitant des plaisirs de la vie, « grassouillets et luisants », dont la joyeuseté positive s’oppose à la morosité des philosophes18. Le modèle moderne du bouffon de cour, équivalent du parasite ancien, introduit là encore une incidence métatextuelle, pour suggérer l’assimilation de la Moria au bouffon Érasme, qui amuse le monde avec son texte :
Ce qui est certain, c’est qu’il n’y a pas [de festin] agréable sans l’assaisonnement de la folie. C’est pourquoi, à défaut d’un convive qui fasse rire par sa folie, authentique ou feinte, on fait venir un bouffon à gages, ou l’on invite un parasite amusant, dont les saillies comiques, c’est-à-dire folles, chasseront le silence et l’ennui19.
Là où Érasme ne plaisante plus, cependant, c’est lorsqu’il entre dans la satire des véritables parasites : par exemple les soldats, objet d’une comparaison renversée qui avait débuté comme chez Lucien en louant la santé vigoureuse des parasites20. Mais ce sont aussi, au cœur de l’Éloge, les doctes, et bien sûr les princes, les clercs et les papes, les nouveaux Sardanapale qui se noient dans l’océan des biens prélevés sur les populations.
Le picaro pierre de touche
Les auteurs humanistes, on le voit, ont ajouté au comique du dialogue de Lucien un sentiment de scandale lié à leurs propres combats. On retrouve l’un et l’autre dans le Lazarillo de 1554, dont on ne peut pas douter qu’il émane d’un auteur aux valeurs érasmiennes attaquant la philautia régnant à tous les étages de la société, dans un clergé hypocrite et une noblesse devenue irresponsable comme dans le petit peuple oisif, vivotant de l’aumône convertie en industrie. Le rapprochement avec le Parasite, mais aussi avec la traduction espagnole du Momus s’impose. Dans son Momo hispanisé, Almazán traduit de manière intéressante erro par mendicante, tandis que l’art de parasiter loué par Momus est rendu par la famille de mots du substantif holgazán (paresseux, fainéant) et du verbe holgazanear (paresser)21. Dans l’épître dédicatoire, Momo est présenté comme un « bouffon libre et impertinent » (mofador essento y libre)22. C’est la langue même du Lazarillo qui s’élabore ici, alors que la notion de pícaro, quant à elle, n’était pas encore en usage au milieu du siècle. L’encadrement moralisateur du texte albertien, ne serait-ce que par les titres donnés par Almazán à certains chapitres, est par ailleurs notable. La fiction auctoriale de la pseudo-lettre de Lazare, et la vraisemblance extraordinaire qui résulte de la description du monde quotidien – deux choix poétiques forts de l’auteur du Lazarillo –, ont tendance à maquiller ces influences. Ils impliquent une transposition de l’énonciation parasitique : du domaine de la rhétorique, de l’érudition et de l’imitation virtuose des Anciens, on passe à celui de la réalité ordinaire, d’une situation sociale problématique et d’une actualité discrètement évoquée, mais comprise à travers le filtre humaniste qui était celui de l’auteur, dont l’identité nous échappe encore.
Oisiveté coupable, et comique, que celle de toute la société gravitant autour de Lazare, incarnée par son propre discours auto-complaisant. Valentín Núñez Rivera a bien montré la proximité de la rhétorique de Lazare avec les productions contemporaines d’éloges paradoxaux du cocu ou de l’âne, Lazare tenant un peu des deux23. Le pregonero se vante d’être parvenu à un oficio real, une charge honorable consistant dans le métier de crieur public, et il s’attribue un pouvoir extraordinaire, qui rappelle la manière dont le Simon de Lucien se décrit au centre du jeu social (Parasite, 13-23)24. Nul doute qu’une inspiration savante pouvait ici rencontrer d’autres modèles littéraires, par exemple théâtraux, ou la réalité des charlatans et autres bonimenteurs de la rue25. La malice satirique de l’auteur est perceptible : l’emploi de crieur est providentiel, car « profitable » (provechosa) tout en donnant le repos, les formules suggérant une ironie par rapport à la notion même de « charge royale » (oficio real)26. La maladresse oratoire de Lazare contrarie cependant le discours sur la noblesse du métier :
Je m’en suis si bien trouvé et j’exerce de si bonne grâce que presque tout ce qui touche au métier passe par mes mains, tellement que par toute la ville qui veut écouler son vin ou vendre quelque chose sait qu’il n’en tirera rien si Lazare ne s’en mêle27.
Et le parasite triomphateur s’avère parasité jusque dans son ménage par l’archevêque à qui il a vendu sa femme comme on vend un vin, criant publiquement son déshonneur, à son corps défendant…
Il en a été de même avec chacun de ses maîtres indignes, le comique résidant justement dans le renversement de situation : Lazare apprend à imiter chacun d’eux à ses détriments. L’aveugle hypocrite, qui tenait mille tours pour « faire cracher l’argent » (sacar el dinero), présenté comme sagace, et dont l’intelligence (ingenio) et la faconde, dignes du parasite de Lucien, suscitent la vive admiration de son petit émule28, avant que celui-ci n’engage contre lui le combat des grains de raisin et de la jarre, parasitisme contre parasitisme. Le prêtre de Maqueda fait figure de parasite absolu, lui qui impose l’austérité aux autres pour mieux se goinfrer d’une tête de mouton le dimanche. En écho à un fameux adage érasmien A mortuo tributum exigere (« Exiger d’un mort une contribution », A. 812), Lazare apprend sous sa houlette non pas à prier pour les morts, mais pour que les gens meurent, les funérailles étant l’occasion pour le personnel ecclésiastique de faire bombance29 ! Comparé à une couleuvre ou à un rat par le curé tout au long de leur guerre héroï-comique pour la pitance, Lazare apprendra à lui grignoter son pain… Et que dire de l’écuyer du traité III ? Lazare imagine déjà qu’il lui servira de la nourriture toute cuite, là où il lui faudra mendier le quignon pour le compte de ce maître, dont le discours sur l’honneur – ce « maudit honneur » (la negra que llaman honra)30 – dénonce une classe parasite, dans la lignée des plus virulentes diatribes tenues par les humanistes contre la noblesse de sang. L’écuyer se rêve louant ses services inutiles à un grand, jouant le « bouffon malicieux » (malicioso mofador) pour complaire31, mais son activité est incidemment comparée à celle des mendiants chassés de la ville à coups de fouet sur ordre des édiles32. Dans le discours antiphrastique qui conclut l’auto-promotion de Lazare, où il n’est question que de « provecho » et de « honra » , apparaît une ultime cible, comme le narrateur dresse un parallèle entre sa réussite et la gloire de Charles-Quint entrant dans Tolède, cet empereur « victorieux » dont il apparaissait clairement en 1554 qu’en se faisant le serviteur du Pape dans sa lutte contre les princes protestants, il avait fait office de cocu et d’âne tout à la fois, laissant le clergé catholique parasiter son empire, devenu une fiction.
Prenons un peu de recul. Le Lazarillo est une œuvre extraordinairement subtile, qui emprunte à des nombreuses sources, et l’on ne saurait en attendre une imitation claire d’un modèle précis. La fiction énonciative du quidam sans lettres, qui voulait faire parler de lui comme le ferait un empereur, reproduit bien le jeu du parasite Simon chez Lucien, dont l’éloquence et la logique sont trahies par des maladresses ou des vices de pensée évidents. Mais l’influence des textes d’Alberti et d’Érasme se cumule. Qu’en est-il du Guzmán de Alfarache paru quelques décennies plus tard (1599), dont l’énonciateur, gueux et théologien à la fois, est aussi un homme éduqué à l’université, pícaro mais savant en rhétorique, en latin et en grec33, par ailleurs extrêmement volubile ? Son éloquence est autrement plus convaincante que celle du pauvre Lazare, et ses réflexions morales, pour être troubles en raison de la contradiction avec son ethos, n’en sont pas moins pénétrantes. L’atalayisme de Mateo Alemán, ce regard jeté depuis une vigie morale sur les turpitudes du monde d’en bas, a été relié au discours ménippéen et cynique des dialogues olympiens de Lucien, comme Charon, ou les contemplateurs34. Mais de nouveau, la médiation de l’Éloge de la folie est décisive pour comprendre la genèse de ce discours paradoxal du pécheur-prédicateur, tout comme celle du Momo d’Alberti hispanisé par Almazán. En ouvrant son épître à Maria de Mendoza par l’image des silènes, le traducteur castillan assimilait le modèle albertien au modèle érasmien du discours modeste ou grotesque, mais en vérité socratique35 ; en définissant le Momus comme « fabulosa y poética historia », il proposait un genre nouveau dans des termes oxymoriques que reprend directement Alemán, présentant son roman comme « poética historia »36 ; et la réflexion poétique particulièrement riche du paratexte du Momo espagnol définit les conditions d’une « fiction rationnelle » (fición racional), et non « vaine », associant « plaisanteries gracieuses » (donosas burlas) et « morales profitables » (provechosas dotrinas), une poétique qu’Alemán mettra en œuvre37. Guzmán est un nouveau Momus, comme le montre une allégorie sur le Plaisir et le Déplaisir dans le style d’Alberti, où intervient le personnage au début de la Primera parte38 ; ou bien il est un autre Simon, le parasite de Lucien qui vante sa pseudo-réussite, devenue chez Alemán pseudo-réussite spirituelle du galérien intéressé par sa libération.
En effet, Mateo Alemán ne cesse pas d’être un « amigo de Luciano », selon la formule de Gracián39. Les manipulations rhétoriques font tout le sel du discours de Guzmán dès le chapitre inaugural, lorsque le personnage présente sa généalogie en claironnant son honneur, là où le lecteur s’amusera de ses embarras et de ses contradictions40. De même, plusieurs morceaux de bravoure rhétorique de ce roman, qui n’en manque pas, semblent s’inspirer assez directement de la comparaison favorable entre la parasitique et la géométrie au début du texte de Lucien. Le premier est l’encomium de la « science » dont Guzmán narrateur – le point est important, car c’est bien la persona de l’énonciateur qui assume ici un discours manipulateur – entonne un vibrant éloge : jouant sur un topos d’origine pétrarquéenne, il dresse cette « science » comme un rempart face à la fortune, alors qu’il évoque ses premiers larcins de jeunesse (I, ii, 7). Quelle est cette science qui permet de parer aux coups du sort ? Rien d’autre que la science de gueuserie, le vol en somme : « ce fut la seule que j’avais étudiée pour gagner mon pain »41. La comparaison immédiate avec la pratique de Démosthène, qui vivait de son éloquence, suggère a fortiori le doute sur le discours du beau parleur…
L’anti-science picaresque devient industrie à grande échelle lors du séjour à Rome à la fin du livre I. Un vibrant éloge de la charité, sur un ton grave et emphatique (« Tout vit en elle, et sans elle, tout meurt42 »), sème le doute : parce qu’elle est un signe d’élection, la charité serait le zéro multiplicateur du riche, qui lui permet d’augmenter ses chances d’aller au paradis43. C’est paradoxalement le riche qui a besoin de donner au pauvre dans l’économie catholique du salut ! L’idée semble adapter le texte de Lucien : « Le parasite donne de l’éclat au riche, mais pas le riche au parasite », Parasite, 58)44. Or, Guzmán narre comment ses fausses blessures provoquaient l’empathie d’un cardinal, qui donnait aveuglément. C’est ici, comme souvent dans le Guzmán de Alfarache, le récit qui commente le commentaire et en dénonce le caractère artificieux. Car il s’agissait de vivre de la sueur d’autrui, fait comprendre l’éloge de la douceur de vivre picaresque :
Nous étions pleins de mangeaille et de vin, et en parfaite santé. Nous menions une telle vie que les vrais sénateurs – et les vrais parasites [comedores] –, c’était nous. Bien que nous fussions moins respectés qu’eux, notre vie était plus reposante, meilleure et avec moins de tracas, et nous jouissions de deux libertés avantageuses qu’ils n’avaient pas et qu’aucun Romain n’avait non plus, pour noble qu’il fût. La première était la liberté de demander sans déchoir, et elle ne convient à aucun homme honorable […]45.
Mieux, Guzmán reprend le parallèle avec les rois, favorable au parasite indépendant et comptable uniquement de lui-même :
Donc, la liberté de demander n’est accordée qu’aux pauvres, nous sommes en cela semblables aux rois, et c’est un privilège signalé que de pouvoir le faire sans commettre de bassesse, comme cela le serait pour les autres hommes. Mais il y a une différence : les rois demandent au peuple pour le bien commun, alors que les pauvres ne demandent que pour eux-mêmes […]46.
Ce passage évoque autant l’éloge de l’erro par Alberti que celui du parasite-roi par Lucien (Parasite, 23). Alemán semble imiter plus étroitement Lucien lorsque Guzmán vante ensuite la plénitude des cinq sens dont jouit le picaro. Le « goût » ? Il n’y a point de marmite ou de plat que ne teste le gueux, point de cuisine qu’il ne visite. L’ouïe ? Il écoute librement autrui sans être surveillé, assistant à tous les négoces. Et ainsi de suite… Que dire du sixième sens, celui qui prédispose à reconnaître le visage cuivré des doublons ? Les mendiants en ont plein les poches, alors qu’ils se nourrissent à tous les râteliers…
On sait le contexte spécifique dans lequel s’inscrit ce pseudo-éloge : celui d’un véritable blâme de la mendicité, lié à un projet de réforme des institutions de bienfaisance formulé dans l’Amparo de los pobres de López de Herrera, auquel l’auteur du Guzmán souscrivait. Notre propos n’est pas ici de commenter l’enjeu politique de l’écriture alémanienne, mais de souligner comment l’imitation directe ou indirecte, via Alberti ou Érasme, de la rhétorique parasitique de Lucien en faisait, décidemment, le mauvais exemple à suivre pour les pícaros modernes…
Nashe ou l’autorité sens dessus dessous
La tentation d’un discours parasitico-satirique s’est concrétisée de manière particulière en Espagne, mais elle constitue une lame de fond européenne, presque parallèle à la riche littérature des traités anti-auliques et des menosprecios de corte, de laquelle il faudrait rapprocher les romans picaresques, non moins qu’on ne l’a fait avec la littérature sur la pauvreté. En France, Rabelais flanque Pantagruel d’un petit parasite bouffon, Panurge, qui égaye le récit par son éloge des dettes, chef-d’œuvre de parasitique (Tiers Livre, 1546, chap. 2-5), tout en faisant contrepoint au héros de la geste comique. Panurge, justement, reste un personnage secondaire sous le contrôle de l’esprit pantagruélique, et c’est bien la raison pour laquelle il n’y aura pas de roman picaresque à la française, du moins dans un premier temps. En Angleterre, un lecteur de Rabelais et de la traduction anglaise du Lazarillo47 met en scène le discours transgressif, hautement ambigu, du premier des rogues : Jack Wilton, héros, narrateur et auteur fictif de The Unfortunate traveller48. La violence verbale de ce personnage en fait un double de l’auteur satirique, Thomas Nashe à la plume acérée, célèbre en tant que controversiste découpant tout ce qu’il touche. De ce récit décousu, voire charcuté en plusieurs épisodes brutalement juxtaposés, on pourrait dire que la poétique de la décomposition à laquelle le soumet son écriture maniériste en fait une « anatomie » ménippéenne au sens de Northrop Frye. Les pérégrinations européennes du protagoniste se terminent sur une apothéose de cruautés, au cœur de la Rome papiste. Ce roman italien, qui concerne grosso modo la seconde moitié du texte, ne fait que prolonger les aventures de Jack Wilton en Flandres, en Angleterre et dans la vallée rhénane, où il avait affirmé sa vocation de parasite.
À qui avons-nous à faire ? Au « roi des pages »49 (king of Pages), qui se proclame plus loin « prince de[s] bourses »50 (prince of their purses), couronné « roi des ivrognes »51 (King of the drunkardes) une fois parvenu à la cour d’Angleterre. Jack est aussi un « Lord of Misrule »52, seigneur carnavalesque du désordre, épithète qu’il applique à un autre personnage mais qui lui conviendrait comme un gant, d’autant qu’il ne s’agit pas d’un aimable Falstaff, mais d’un opportuniste à la langue assassine, qui dresse un parallèle déroutant, dans les premières lignes, entre son ambition qualifiée de « politique » et le règne d’Henri VIII, « seul véritable sujet des chroniques »53 (the onely true subiect of Chronicles). La rhétorique de la chronique officielle, justement, tout comme celle des martyrologes protestants, se trouve brutalement parodiée tout au long de ces « actes et monuments stratagémiques »54 (stratagemicall acts and monuments) que le narrateur dresse à sa propre gloire. Ce règne de Jack renvoie une image troublante du pouvoir spirituel et temporel dans l’Angleterre d’Élisabeth Ire.
Cette ingéniosité qui s’auto-célèbre consiste surtout en paroles, comme le montrent les premiers épisodes, qui voient les « bourles » méchantes se succéder sur un mode quasiment démonstratif. Jack est un soldat de sa Majesté au siège de Tournais. Il ne trouve pas mieux, pour s’employer, que de faire croire au vendeur de cidre abreuvant les troupes que le roi le soupçonne d’intelligence avec l’ennemi, de sorte que le marchand s’enfuit, abandonnant ses tonneaux à la troupe. C’est Jack qui régale, gratuitement, punissant ainsi la cupidité du marchand terrorisé. De même avec un pauvre capitaine qu’il envoie espionner François Ier et qui se fait immédiatement prendre. Ses plots miment à petite échelle celles qui se jouent ailleurs en plus grand. Le discours du parasite châtiant les parasites est d’autant plus déstabilisant qu’il emprunte à la rhétorique providentialiste de l’époque, dont Nashe se moque tout particulièrement quand elle se retrouve dans la bouche de puritains, l’une de ses cibles favorites. Jack Wilton se déclare « fléau de dieu »55 (Gods scourge). Y a-t-il plus grand abus, qui ouvre la voie à la justification de tous les crimes et de toutes les malversations ? Le comportement opportuniste et profiteur de Jack Wilton, qui de « demi-soldat pour rire » devient un « martialiste convaincu »56, ne fait donc que refléter le parasitage des genres prestigieux par son discours déviant.
L’ouverture du récit sur une scène militaire, établissant un parallèle ironique entre le bonimenteur vicieux et la soldatesque ordinaire (ou avec le jeu des grands capitaines), n’a-t-elle pas été inspirée par le paradoxe du parasite-soldat posé dans la dernière partie du texte de Lucien, qui s’attache à prouver, en multipliant les références parodiques à la geste homérique, que les parasites sont supérieurs dans l’art de la guerre (Parasite, 40-51) ? Avec Jack Wilton, on est en apparence loin du bonimenteur scandaleux, mais inoffensif, qu’était Simon. De la part de ce mauvais sujet de la République des Lettres qu’était Nashe, pourfendeur de la pédanterie humaniste, et prototype du University Wit ressorti sans diplôme d’Oxford, on ne saurait attendre d’imitation au sens strict, d’autant que les premières traductions de Lucien en anglais sont postérieures. Il n’en est pas moins un auteur lettré, et son personnage, dans une section médiane du récit, va rencontrer précisément plusieurs de ses modèles, avec un effet métaleptique implicite mais évident. À Rotterdam, Jack croise Érasme : « Érasme semblait tellement détester le manque de jugement des princes, dans tous ses discours, et leur préférer les parasites et les fous, qu’il décida de nager dans le sens du courant et d’écrire un livre en l’honneur la folie »57. Pareillement, Thomas More apparaît au personnage de Jack Wilton. Or, voyant les principautés et républiques modernes corrompues, l’auteur de l’Utopia les avait, dit Jack Wilton, comparé à des « great piracies », aux domaines de pirates remportés par la violence et le meurtre, maintenues par la sédition et le sang, les lois n’étant rien d’autre qu’une conspiration des riches contre les pauvres58. Qui est le parasite alors ? Une vision si radicale semble quelque peu influencée par la troisième grande rencontre de Jack, celle de Corneille Agrippa, le magicien mais aussi le grand sceptique de son temps, dont la Déclamation avait poussé au plus loin la rhétorique anti-autoritaire, notamment dans son chapitre 80 « De la noblesse », mais aussi dans le surprenant chapitre 56 consacré à la « mendicité », prise comme un art59. Enfin, ce trio est complété en Italie par la rencontre avec l’Arétin60, l’écrivain mercenaire qui avait réussi à s’aliéner les grands d’Europe en les caressant par ses éloges ou en les menaçant par ses blâmes, passant du statut de « secrétaire des princes » à celui de « fléau des princes », retournant en somme la relation de dépendance entre le poète et ses mécènes. Ce que d’autres avaient rêvé, l’Arétin l’avait fait, devenant le parasite littéraire des parasites royaux (même s’il entre une grande part de fantasme dans ce mythe dont Nashe choisit de se faire le propagandiste).
Or, la position nouvelle d’auteur sans autorité61 adoptée par Nashe favorise la projection empathique dans ce double fantasmé qu’est l’aventurier Wilton. À l’instar de l’Arétin, Nashe aime se camper en bandit ou en rebelle des lettres, qui adresse à Lord Henry Wriothesley, comte de Southampton, une épître dédicatoire paradoxale, refusant de sacrifier à l’« aveugle tradition »62 (blinde custome) de l’éloge et du patronage. « Roi des pages », métatextuellement (puisque l’expression king of Pages constitue une équivoque manifestement intentionnelle), Nashe pipe les dés de la littérature et dérègle la machine de l’autorité. Son personnage, Jack Wilton, joue d’ailleurs à prendre la place de son maître, Lord Surrey – aristocrate oisif préoccupé par de vaines aventures sentimentales et de ridicules productions lyriques –, jusqu’à usurper son identité dans une section centrale du récit italien qui continue l’histoire du voyageur infortuné. Ce dernier se disculpe avec aisance, rhétorique aidant. « Je me réjouis que tu sois le singe de mon droit de naissance – car quel noble n’a pas son singe ou son bouffon ? », admet Surrey, « mais sois un singe sans entrave, débarrassé de ton courtisan »63. On ne saurait mieux dire l’aspiration de Nashe, et ses limites, par rapport aux fortunés de l’époque.
Conclusion : la littérature comme parasitisme utile ?
Si le français gueux, ou l’anglais rogue ne correspondent guère lexicalement à la notion de parasite, le castillan pícaro, encore perçu à la fin du XVIe siècle comme un néologisme à l’étymologie obscure et probablement multiple, se présentait sans doute comme un bon équivalent. Cela explique peut-être le choix de Mateo Alemán d’adopter ce terme populaire espagnol afin de désigner son héros Guzmán : « nuestro pícaro »64, « fils de l’oisiveté » (hijo del ocio)65. La puissance comique et satirique du modèle de l’énonciation parasitique, appliquée par Alberti et par Érasme à des circonstances contemporaines, inspire la création de ces figures de vauriens qui se donnent toute licence et toute autorité pour se poser en maîtres d’un monde corrompu, où chacun voudrait vivre aux détriments ou aux crochets des autres, du mendiant jusqu’au Pape, en passant par la noblesse courtisane. Aussi bien le pregonero de Tolède, Lazare, que le galérien sévillan, Guzmán, ou l’aventurier anglais, Jack, sont des exemples de la manière dont le modèle humaniste de l’énonciation parasitique a été transposé par les auteurs de romans picaresques modernes dans des contextes sociaux précis.
Chez chacun d’eux, comme chez Lucien, l’orateur parasitaire est aussi une figure de l’auteur lui-même, qui s’inscrit malicieusement au revers de son double failli, en faisant admirer positivement ses talents de bouffon littéraire. Les paratextes peuvent jouer le rôle d’interface, comme on l’a vu dans le cas de la dédicace de Nashe au comte de Southampton, où le désir d’indépendance, le refus de la soumission traditionnelle du lettré au mécène, trahit l’impulsion qui se développe dans le discours échevelé de Jack Wilton. Parasitisme pour parasitisme, la littérature se donne pour une échappatoire à l’aporie sociale décrite dans les récits. Un auteur comme Alemán partage les valeurs industrieuses d’Alberti, qu’il applique comme lui au monde des lettres ; mais il partage aussi, a fortiori, sa situation paradoxale de maître intellectuel cruellement dépendant de ses patrons. Chez Alberti, Momus, le parasite des grands et des dieux, le picaro céleste, est un vengeur satirique, mais un vengeur puni à la fin. Guzmán écrit depuis les galères, qui métaphorisent le livre dans lequel s’installe un auteur en vérité laborieux, attendant quelque grâce ou quelque coup de pouce venu d’en haut pour sa carrière, tout en entretenant une conscience coupable de sa propre inutilité. Le plus révélateur est encore l’auteur anonyme et génial du Lazarillo, qui exprime dans son dédoublement énonciatif, à travers le discours comique du crieur cocu, son propre désir de reconnaissance frustré, ses propres grimaces de lettré compromis au service de quelque archevêque ou de quelque empereur… Et si nos auteurs sont sincères, c’est dans leur conviction de faire œuvre de salut public par leur discours de dénonciation. Il peut y avoir des parasites utiles, dès lors qu’ils se déclarent symptomatiques.
Notes
- Antonio Lull (Lullius), Orationes, Bâle, Oporinus, 1558, p. 502.
- José Antonio Maravall, La Literatura picaresca desde la historia social (siglos XVI et XVII), Madrid, Taurus, 1986.
- Michel Cavillac, Gueux et marchands dans le Guzmán d’Alfarache (1599-1604). Roman picaresque et mentalité bourgeoise dans l’Espagne du Siècle d’Or, Bordeaux, Institut d’Études Ibériques et Ibéro-américaines de l’Université, 1983.
- Rappelons la leçon magistrale de Francisco Rico, La Novela picaresca y el punto de vista, Barcelone, Seix Barral, 1973.
- Michael Zappala, « The Lazarillo: Source –Apuleius or Lucian?– and Recreation », Hispanófila, 97, 1989, p. 1-16.
- Voir Keith Sidwell, Lucian of Samosata in the Italian Quattrocento, thèse de doctorat, Cambridge University, 1974, p. 17-18 ; Christopher Robinson, Lucian and His Influence in Europe, Chapel Hill, The University of North Carolina Press, 1979, p. 26-27 ; David Marsh, Lucian and the Latins. Humor & Humanism in the Early Renaissance, Ann Arbor, The University of Michigan Press, 1998, p. 152-155.
- Nous citons l’édition courante de Lucien, Œuvres complètes, éd. et trad. A.-M. Ozanam, Paris, Les Belles Lettres, 2018, p. 508.
- C. Robinson, Lucian and his Influence in Europe, p. 27.
- Nous empruntons cette citation à D. Marsh, « Guarino of Verona’s Translation of Lucian’s Parasite », Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, t. 56, 2 1994, p. 419-444 (p. 424) : Ego Grecanicum nunc parasitum / Affero qui se verbis Latii / Artemque suam quam bellissimam / Explicet ; ellum cape dicentem / Risum ridebis sardonicum, / Solves resonis ora cachinnis.
- Sicco Polenton, Catinia, éd. bilingue P. Baldan, Anguillara Veneta, Biblioteca Comunale, 1996.
- Voir Pierre Darnis, La Picaresca en su centro. Guzmán de Alfarache y las orígenes de un género, Toulouse, PUM, 2015, p. 60-64.
- Pierre Laurens traduit par clochard : Leon Battista Alberti, Momvs/Momus, éd. bilingue, Paris, Les Belles Lettres, 2019, p. 94-107.
- Voir les conseils laissés par Momus au prince, dans les dernières lignes du récit, ibid., p. 274-275.
- Voir Philippe Guérin, « L’éloge de l’erro dans le Momus d’Alberti, ou d’un art sans art », dans Maria Teresa Ricci (dir.), Journée d’études Otium. Antisociété et anticulture, mis en ligne sur « Nuovo Rinascimento » (26 août 2009), p. 6-21, https://www.nuovorinascimento.org/n-rinasc/atti/pdf/otium.pdf.
- Voir l’édition courante d’Érasme, Éloge de la Folie et autres écrits, éd. Jean-Claude Margolin, Paris, Gallimard, 2010, p. 52.
- Voir Anette Tomarken, The Smile of Truth: the French Satirical Eulogy and Its Antecedents, Princeton, Princeton University Press, 1990, p. 8-12 et p. 37-41. Walter Gordon, qui souligne l’importance de l’œuvre de Lucien pour Érasme, minore cependant le cas particulier du Parasite dans Humanist Play and Belief. The Seriocomic Art of Desiderius Erasmus, Toronto, Toronto University Press, 1990, p. 63-67.
- Voir Christopher Robinson, Lucian and His Influence in Europe, p. 166-197, qui note aussi l’influence du Parasite dans certaines des Colloques d’Érasme, comme Pseudocheus ; Christiane Lauvergnat-Gagnière, Lucien de Samosate et le lucianisme en France au XVIe siècle, Genève, Droz, 1988, p. 240.
- Érasme, Éloge de la Folie, XIV, p. 65.
- Ibid., XVIII, p. 70 : Illud certe constat, citra Stultitiae condimentum, nullum omnino suave esse ; adeo ut si desit, qui seu vera, seu simulata stultitia risum moveat, γελωτοποιών quempiam vel mercede conductum accersant, aut ridiculum aliquem parasitum adhibeant, qui ridendis, hoc est, stultis dicteriis, silentium ac tristitiam compotationis discutiat.
- Érasme, Éloge de la Folie, XXIII, p. 74-75.
- Leon Battista Alberti, La Moral y muy graciosa historia del Momo, trad. Agustin de Almazán, Madrid, Castro, 1598 (1553), l. II, chap. 7-8, p. 84-94.
- Ibid., « A la illustrissima doña María Mendoza » (n. p.).
- Valentín Núñez Rivera, Razones retóricas para el Lazarillo. Teoría y práctica de la paradoja, Madrid, Biblioteca Nueva, 2002.
- Notons que le pouvoir oratoire supérieur du bouffon, déjà souligné par Lucien (« Qui sait le mieux égayer les convives, l’homme qui chante et se moque, ou celui qui, sans rire, allongé dans une vieille cape regarde le sol comme s’il était venu à un enterrement, non à un banquet ? », Parasite, 51, Œuvres complètes, p. 522), est comparé favorablement par Alberti au sévère prêcheur revêtu de bure : les délires d’un clochard ivre sont pris pour les vaticinations d’un prophète (Momus, II, p. 104-105). À la suite, la Folie d’Érasme loue l’attrait oratoire du « crieur » ou « braillard » (clamator), dans un passage qui pourrait avoir directement inspiré l’auteur du Lazarillo et celui du Guzmán : « L’esprit de l’homme est ainsi fait qu’on le prend beaucoup mieux par le mensonge que par la vérité. Veut-on faire une expérience évidente et claire ? Qu’on aille écouter le sermon à l’église ; s’il est question de choses sérieuses, tout le monde dort, bâille, s’ennuie. Si le braillard, pardon, je voulais dire l’orateur, commence, comme il est fréquent, par quelque histoire de bonne femme, tout le monde se réveille, se redresse, est bouche bée » (Éloge de la folie, XLV, p. 101).
- Sur le Lazarillo, et dans une optique comparatiste plus générale, voir Ariane Bayle, Romans à l’encan. De l’art du boniment dans la littérature au XVIe siècle, Genève, Droz, 2009.
- Lazarillo de Tormes, p. 128.
- Romans picaresques espagnols, éd. et trad. Maurice Molho et Jean-Francis Reille, Paris, Gallimard, 1968, p. 50 ; Lazarillo de Tormes, p. 130 : « Hame sucedido tan bien, yo le he usado tan fácilmente, que casi todas las cosas al oficio tocantes pasa por mi mano; tanto, que en toda la ciudad, el que ha de hechar vino a vender, o algo, si Lázaro de Tormes no entiende en ello, hacen cuenta de no sacar provecho. »
- Ibid., p. 26.
- Ibid., p. 53.
- Ibid., p. 84.
- Ibid., p. 105.
- Ibid., p. 92-93.
- Mateo Alemán, Guzmán de Alfarache, éd. Pierre Darnis, Barcelone, Castalia Ediciones, 2015, « Declaración para el entendimiento deste libro » (n. p.).
- Voir Michel Cavillac, Guzmán de Alfarache y la novela moderna, Madrid, Casa de Velázquez, 2010, p. 9-11 ; Montserrat Jufresa, « Guzmán de Alfarache : un héroe con rasgos menipeos », Sátira menipea y renovación narrative en España: del lucianismo a Don Quijote, dans Pierre Darnis, Elvezio Canonica, Pedro Ruiz Pérez et Ana Vian Herrero (dir.), Córdoba, UCOPress / Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux, 2017, p. 217-228.
- L. B. Alberti, La moral y muy graciosa historia del Momo, « Agustín de Almázan al benigno lector » (n. p.).
- M. Alemán, Guzmán de Alfarache, « Declaración », p. 93.
- Nous reprenons les termes employés respectivement par Alexio Venegas dans les deux premières conclusions de son épître « Al benevolo y pio lector », qui suit le « Prohemio », et par Almazán dans l’épître « Al benigno lector », qui le précède (n. p.).
- M. Alemán, Guzmán de Alfarache, I, i, 7, p. 217-221.
- Baltazar Gracián, Criticón, éd. Alonso Santos, Madrid, Cátedra, 2004, III, 3, « La Verdad de parto », p. 605.
- Nous renvoyons à notre analyse, dans « La rhétorique dévoyée dans l’incipit du Guzmán de Alfarache : le narrateur sophiste et l’auteur moraliste », dans Pierre Darnis (éd.), Le commencement… en perspective. L’analyse de l’incipit et des œuvres pionnières dans la littérature du Moyen Âge et du Siècle d’or, CNRS-Université Toulouse-Le Mirail, 2010, p. 45-68.
- M. Alemán, Guzmán de Alfarache, p. 382 : « Por mi fe, hermano mío […] que era la ciencia que estudié para ganar de comer ».
- Ibid., I, iii, 4, p. 471.
- Ibid., I, iii, 6, p. 495.
- Lucien, Œuvres complètes, p. 395.
- M. Alemán, Guzmán d’Alfarache, éd. et trad. F. Desvois, Paris, Classiques Garnier, 2014, I, iii, 4, p. 271 ; ibid., p. 474 : « Andábamos comidos, bebidos, lomienhiestos. Teníamos una vida, que los verdaderamente “senadores” —y aun comedores—, nosotros éramos: que aunque no tan respetados, la pasábamos más reposada, mejor y de menos pesadumbre… y dos libertades aventajadas más que todos ellos ni que algún otro Romano, por calificado que fuese. La una era la libertad en pedir sin perder, que a ningún honrado le está bien [etc.] ».
- Ibid., p. 273 ; p. 477-478 : « Así que la libertad en pedir sólo al pobre le es dada. Y en esto nos igualamos con los Reyes, y es particular privilegio poderlo hacer y no ser bajeza, como lo fuera en los más. Pero hay una diferencia: que los Reyes piden al común para el bien común, por la necesidad que padecen, y los pobres para sí solos, por la mala costumbre que tienen ».
- The Pleasant Historie of Lazarillo de Tormes, Londres, H. Bynneman, 1576 [une première édition en 1568 aurait précédé].
- The Unfortunate Traveller, or the Life of Jack Wilton, Londres, T. Scarlet for C. Burby, 1594. Nous citons ci-dessous l’édition de référence The Works of Thomas Nashe, éd. Ronald McKerrow, Oxford, Blackwell, 1966, vol. II.
- « The Induction to the Dapper Mousier Pages of the Court », p. 208.
- Ibid., p. 210.
- Ibid., p. 228.
- Ibid., p. 210.
- Ibid., p. 209.
- Id. (il s’agit d’une référence aux Acts and Monuments du polémiste John Foxe, 1563).
- Ibid., p. 226.
- Ibid., p. 231 : « As at Turwin I was a demy souldier in [j]est, so now I became a Martialist in earnest. »
- Ibid., p. 245 : « Erasmus in all his speeches seemed so much to mislike the indiscretion of Princes in preferring of parasites and fools, that he decreed with himself to swim with the stream, and write a book forthwith in commendation of follie. »
- Ibid., p. 245-246.
- Ibid., p. 252.
- Ibid., p. 264.
- Voir Jonathan Crewe, Unredeemed Rhetoric: Thomas Nashe and the Scandal of Authorship, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1982, p. 65-89 ; Mihiko Suzuki, « “Signiorie over the Pages”: The Crisis of Auhority in Nashe’s “The Unfortunate Traveller” », Studies in Philology, vol. 81, 3, 1984, p. 348-371.
- The Works of Thomas Nashe, vol. II, p. 201.
- Ibid., p. 269 : « I am well pleased thou shouldest bee the ape of my birthright (as what noble man hath not his ape & his foole?), yet that thou be an ape without a clog, not carrie thy curtizans with thee ».
- M. Alemán, Guzmán, éd. P. Darnis, « Declaración para el entendimiento deste libro », p. 94.
- Ibid., « Elogio de Alonso de Barros », p. 97.