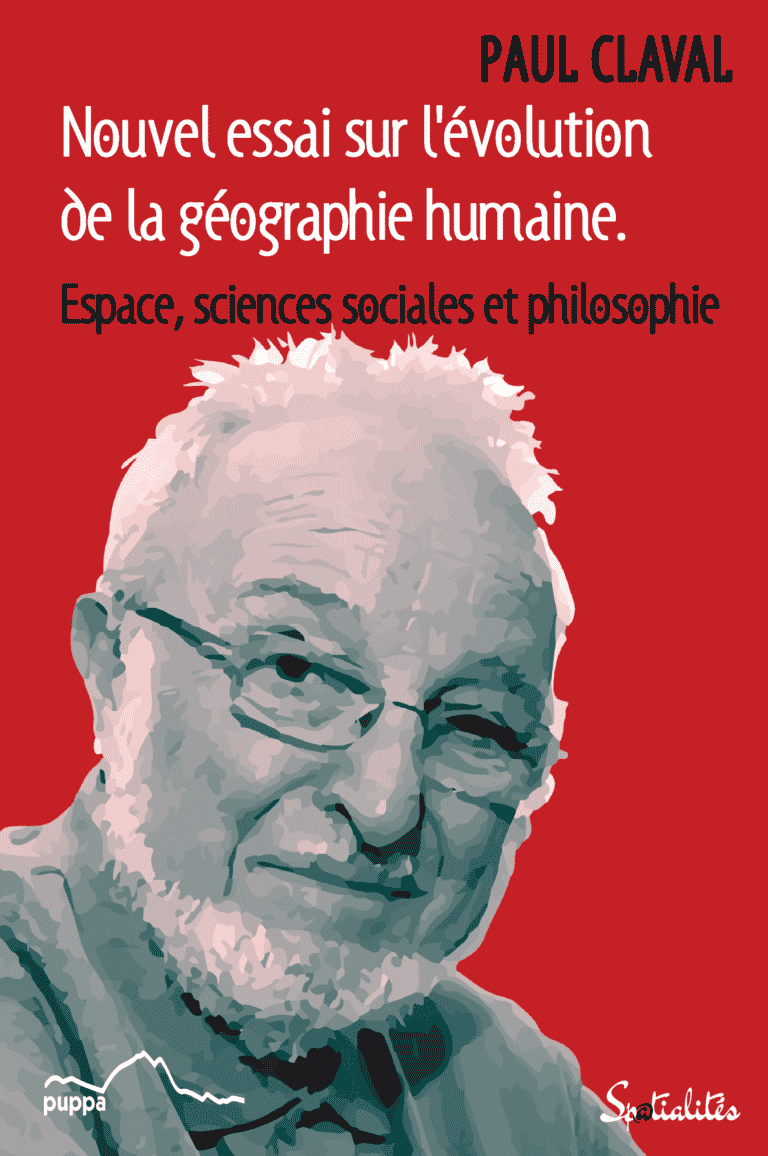L’approche poststructuraliste ne se distingue pas seulement de celles qui l’ont précédée par le tournant épistémologique qu’exploite la déconstruction et qui substituent aux sciences sociales empiriques celles qui sont fondées sur l’inconscient ou sur l’habitus. Grâce encore à Foucault, elle reconnaît à l’espace un rôle important dans la construction du social.
Pouvoir et dispositifs spatiaux chez Foucault
Les thèmes de recherche de Foucault se modifient dans les années 1970. L’attention qu’il porte aux formes que prennent les discours diminue. Il s’attache davantage à la sexualité, aux plaisirs qu’elle offre et à leur répression. Il met l’accent sur les formes de contestation que motive celle-ci. L’histoire de la folie et la naissance de la clinique lui ont appris que les formes élémentaires de pouvoir étaient souvent liées à la régulation des pulsions corporelles.
Ce que cette nouvelle perspective apporte, c’est l’idée que la prégnance des formes de pouvoir qui se mettent en place à ce niveau ne vient pas du discours qui les accompagne, mais dépend de quelque chose de plus matériel : les dispositifs spatiaux où elles prennent forme.
Les résultats de ces changements d’optique se lisent dans les ouvrages qu’il publie à partir de 1975, Surveiller et punir (Foucault, 1975) et le tome 1 de L’Histoire de la sexualité : la volonté de savoir (Foucault, 1976) en particulier.
Panoptique et dispositifs de surveillance
Foucault n’aborde pas le pouvoir comme le font d’habitude les sciences sociales car, pour lui, il est omniprésent dans la vie sociale. Au lieu de l’analyser à partir de ceux qui incarnent la société, la commandent et la dirigent, il se focalise sur sa réalisation finale mise en œuvre à travers des micro-dispositifs partout répétés ; à l’enfermement des fous en asile et des délinquants en prison s’ajoutent de plus en plus d’incessants contrôles. Le pouvoir prend des formes indirectes : il multiplie ses effets en se cachant ou en créant une menace qui pousse ceux qui sont sur le point d’enfreindre les règles à s’autocontrôler. Le vocabulaire qu’emploie Foucault est de ce point de vue très significatif : ce qu’il se plaît à analyser, ce sont les dispositifs mis en place pour diffuser et exercer partout des effets de domination. Il se soucie moins du recours systématique à la violence que des formes indirectes qu’elle prend avec la direction de conscience, le balisage des lieux, les jeux du regard et la surveillance. Le Panoptique de Bentham retient longuement son attention car il illustre parfaitement la logique des évolutions modernes.
« On en connaît le principe : à la périphérie, un bâtiment en anneau ; au centre, une tour, celle-ci est percée de larges fenêtres qui ouvrent sur la surface intérieure de l’anneau ; le bâtiment périphérique est divisé en cellules, donc chacune traverse toute l’épaisseur du bâtiment ; elles ont deux fenêtres, l’une vers l’intérieur, correspondant aux fenêtres de la tour ; l’autre, donnant sur l’extérieur, permet à la lumière de traverser la cellule de part en part. Il suffit alors de placer un surveillant dans la tour centrale, et dans chaque cellule d’enfermer un fou, un malade, un condamné, un ouvrier ou un écolier. Par l’effet de contre-jour, on peut saisir de la tour, se découpant exactement sur la lumière, les petites silhouettes captives dans les cellules de la périphérie. Autant de cages, autant de petits théâtres, où chaque acteur est seul, parfaitement individualisé et constamment visible. Le dispositif panoptique aménage des unités spatiales qui permettent de voir sans arrêt et de reconnaître aussitôt » (ibid., p. 201-202).
Ce qui compte, ce n’est pas le détail des formes, c’est leur agencement :
« De là l’effet majeur du Panoptique : induire chez le détenu un état conscient et permanent de visibilité qui assure le fonctionnement automatique du pouvoir » (c’est nous qui soulignons) (ibid., p. 202).
Avec le Panoptique, Bentham conçoit une prison qui réformera le caractère des détenus ; ceux-ci, placés sous le regard constant des gardiens, ne pourront plus cultiver entre eux leurs instincts criminels.
Le Panoptique doit être compris comme « le diagramme d’un mécanisme de pouvoir ramené à sa forme idéale : son fonctionnement, abstrait de tout obstacle, résistance ou frottement, peut bien être représenté comme un pur système architectural et optique : c’est en fait une figure de technologie politique qu’on peut et doit détacher de tout usage spécifique » (ibid., p. 276).
Le regard joue ainsi un rôle fondamental dans les dispositifs de pouvoir : la caractéristique la plus importante d’un espace, c’est sa transparence (ou son opacité), la facilité qu’il offre de tout voir, ou ce qui empêche de le faire. C’est la visibilité au double sens de possibilité de voir et d’exposition au regard d’autrui.
Foucault analyse aussi des dispositifs voisins du Panoptique, comme celui de la quarantaine, indispensable en cas d’épidémie pour fixer les populations et arrêter la propagation du microbe ou du virus faute de pouvoir l’enrayer autrement que par l’isolement. En cas de peste,
« [il faut] d’abord, un strict quadrillage spatial : fermeture, bien entendu, de la ville et du ‘terroir’, interdiction d’en sortir sous peine de la vie, mise à mort de tous les animaux errants ; découpage de la ville en quartiers distincts où on établit le pouvoir d’un intendant. Chaque rue est placée sous l’autorité d’un syndic : il la surveille » (ibid.).
Le principe est simple : transformer la ville en un gigantesque panoptique où chacun est situé, fixé et surveillé.
L’évolution contemporaine nous a accoutumés à une version modernisée de ces techniques : grâce à l’installation de caméras de surveillance, la police observe en permanence les artères d’une ville et y repère les embouteillages, les rassemblements et les mouvements inhabituels. En consultant les bandes qu’elle conserve, elle reconstitue les déplacements des individus suspects.
L’invention du Panoptique ne constitue qu’un élément dans une évolution générale :
« [On assiste à la formation] d’une technologie nouvelle : la mise au point de tout un ensemble de procédures pour quadriller, contrôler, mesurer, dresser les individus, les rendre à la fois dociles et utiles. Surveillance, exercices, manœuvres, notations, rangs et places, classements, examens, enregistrements, toute une manière d’assujettir les corps, de maîtriser les multiplicités humaines et de manipuler leurs forces s’est développée au cours des siècles classiques, dans les hôpitaux, à l’armée, dans les écoles, les collèges ou les ateliers : la discipline. Le XVIIIe siècle a sans doute inventé les libertés : mais il leur a donné un sous-sol profond et solide – la société disciplinaire dont nous relevons toujours. »
« La prison est à replacer dans la formation de cette société de surveillance » (ibid., quatrième de couverture).
La leçon est simple – et terrible :
« Sous la connaissance des hommes et sous l’humanité des châtiments, se retrouve un certain investissement disciplinaire des corps, une forme mixte d’assujettissement et d’objectivation, un même ‘pouvoir-savoir’ » (ibid.).
Surveiller et punir passionne les géographes auxquels il offre une théorie spatiale du regard administratif. Il suscite partout dans le monde des travaux sur les systèmes pénitentiaires. Plus largement, il montre le double visage du rationalisme moderne, qui fait de la liberté sa valeur suprême, et invente mille procédures pour la vider de son sens et asservir les hommes en commençant par leurs corps.
Du Panoptique à la surveillance généralisée
Si la réflexion de Foucault croise l’espace, c’est que, pour comprendre l’homme comme individu social, il faut partir de ce qui le relie à autrui – les sens, la vue, l’ouïe et les dispositifs où ils se déploient. Il convient de mettre l’accent sur le rôle du regard : celui que porte sur l’individu un observateur extérieur, ou celui qu’il porte lui-même sur ce qui se passe en lui.
Le dispositif visuel le plus simple est symétrique : deux personnes se rencontrent ; elles sont placées au même niveau et s’observent. Chacun note la tenue de l’autre, sa coiffure, son visage, la tension ou la détente qui s’y lit, le sourire qui l’éclaire ou la fatigue qui l’écrase. La conversation démarre. On s’inquiète de la santé de l’interlocuteur, de ce qu’il fait, de ses goûts ; on lui parle de soi. Le ton peut être amical, gai, sérieux, mais aussi brutal, inquiet, inquisiteur, dominant : tout dépend de l’état d’esprit des interlocuteurs et de leurs situations – le dispositif a des caractéristiques sociales aussi bien que spatiales.
La relation devient inégalitaire si l’un des interlocuteurs domine l’autre ou s’il le voit sans en être vu. Le panoptique ne fonctionne efficacement que si les fenêtres qui séparent la tour d’observation des cellules observées sont semi-transparentes : le prisonnier ne peut pas voir alors celui qui le garde et profiter du moment où celui-ci détourne son regard pour faire des gestes prohibés ou prendre une attitude hostile. Le surveillant s’absente-t-il ? L’observé ne le sait pas : la seule certitude qu’il ait, c’est qu’un regard peut le suivre à tout moment – ce que son comportement doit intégrer.
La surveillance est d’autant plus efficace que l’on en garde trace : le gardien consigne le comportement de celui ou de ceux qu’il épie. S’il est malade, un autre pourra ainsi le remplacer et profiter de ce qu’il a appris sur les détenus, les enfants ou les malades dont il a la charge. Ses rapports sont communiqués à la hiérarchie : celle-ci prend ainsi conscience des évolutions inquiétantes comme de celles qui sont positives. Des tendances générales se dessinent. La surveillance conduit à une réflexion et à la coordination des actions de redressement.
Foucault souligne le rôle des « dispositifs » imaginés pour organiser l’espace dans l’évolution sociale. Il le fait à un moment où des sociologues, des historiens, des géographes ou des urbanistes font des observations analogues. La création de sociétés étendues et le fonctionnement des formes politiques qui les coiffent (des États en particulier) reposent sur l’invention de quelques dispositifs-clefs : ceux de la cadastration, qui permettent de diviser et de mesurer les terres, d’avoir prise sur la vie rurale et de prélever une partie des récoltes ; ceux de l’écriture ensuite, avec laquelle on note ce qui est perçu, ce qui est entreposé et ce qui est redistribué : dans les cités de Mésopotamie comme en Égypte, l’émergence du pouvoir est liée au développement de l’arpentage et de la géométrie, à la mise au point de l’écriture, à l’invention de supports qui assurent sa conservation (la tablette d’argile) et son transport (c’est l’avantage du papyrus), et à l’apparition du scribe. Un pouvoir centralisé n’est possible que si ses détenteurs sont capables de doubler le réel d’un monde de papier sur lequel ils ont prise.
Les royaumes barbares qui succèdent en Occident à l’Empire romain souffrent de l’affaiblissement des moyens de surveillance centralisée : le nombre de ceux qui savent lire et écrire diminue ; sans l’Église, la disparition du texte serait totale. Au support commode et bon marché du papyrus se substitue le coûteux parchemin. À l’inverse, la reconstruction de pouvoirs centralisés est facilitée, à partir du XIIe siècle, par l’introduction du papier, une diffusion plus large de l’instruction et la mise au point de nouvelles techniques de lever de terrain – la triangulation se révélant plus rapide et moins onéreuse que l’arpentage traditionnel. Il y a surtout l’invention de l’imprimerie…
Ce que Foucault souligne, comme d’autres le faisaient déjà depuis des lustres, c’est le rôle des techniques dans la montée des formes de pouvoir centralisé : de l’Antiquité à l’époque moderne, Mann (1986) en fournit une synthèse quelques années plus tard.
Ce que Foucault ne voit pas, c’est combien l’évolution des techniques pèse aussi sur l’invention et la généralisation de dispositifs qui transforment la vie sociale sans être liés aux jeux du pouvoir. La maîtrise plus complète des matériaux de construction et des dispositifs d’éclairage, de chauffage ou d’aération bouleverse l’agencement des lieux habités. Aux murs s’ajoutent des cloisons plus légères, qui permettent de diviser les grandes pièces. Des couloirs sont introduits, qui remplacent les enfilades qui caractérisaient encore les bâtiments du XVIIe siècle : il devient possible de s’isoler ou de se retrouver à deux ou trois dans une pièce, comme de l’interdire à certains. De la Renaissance au XIXe siècle, la montée de la bourgeoisie est ainsi associée à une révolution de la vie privée qui transforme les pratiques familiales, rend possible l’intimité et modifie le statut de la femme et de l’enfant. Cette mutation gagne progressivement les classes moyennes à mesure que l’urbanisation progresse et que les revenus s’élèvent.
Les possibilités que l’évolution technique ouvre ainsi à la vie sociale ne vont pas toutes dans le sens de l’embrigadement, de la manipulation et du contrôle : elles vont aussi vers l’invention de nouvelles formes de comportement et l’émergence de nouvelles manières de mettre en œuvre la liberté. Les révolutions de la mobilité et des communications qui se succèdent depuis l’invention du rail et du télégraphe créent de nouveaux dispositifs qui diversifient prodigieusement les possibilités de vie sociale – et font disparaître certaines de leurs formes anciennes.
Foucault a perçu l’importance de ce champ, mais il ne l’a exploré que partiellement. En introduisant la notion de dispositif, il a souligné que celui-ci repose à la fois sur un agencement matériel et sur un savoir qui permet d’en tirer parti – c’est sa contribution la plus originale en ce domaine.
Foucault et les hétérotopies
Si Foucault se désintéresse du fonctionnement général des sociétés et du rôle de la plupart de leurs institutions (en dehors de celles qui génèrent des micro-pouvoirs), il insiste sur une de leurs dimensions généralement occultées : les hétérotopies qui les caractérisent. Il leur consacre une conférence en 1966, puis un texte en 1967, mais n’en autorise la publication qu’en 1984 (Foucault, 1984).
« [L’espace] était au Moyen Âge un ensemble hiérarchisé de lieux : lieux sacrés et lieux profanes, lieux protégés et lieux au contraire ouverts et sans défense, lieux urbains et lieux campagnards (voilà pour la vie réelle des hommes) ; pour la théorie cosmologique, il y avait les lieux supra-célestes opposés au lieu céleste ; et le lieu céleste à son tour s’opposait au lieu terrestre ; il y avait les lieux où les choses se trouvaient placées parce qu’elles avaient été déplacées violemment et puis les lieux, au contraire, où les choses trouvaient leur emplacement et leur repos naturel. C’était toute cette hiérarchie, cette opposition, cet entrecroisement de lieux qui constituait ce qu’on pourrait appeler très grossièrement l’espace médiéval : espace de localisation » (ibid., p. 1).
À cet espace de localisation, la révolution galiléenne a substitué l’étendue. Ce qui compte aujourd’hui, c’est « l’emplacement défini par les relations entre points et éléments. Formellement, on peut les décrire comme des séries, des arbres, des treillis ». Nous dirions : un espace tissé de réseaux.
Une chose étonne Foucault :
« Or, malgré toutes les techniques qui l’investissent, malgré tout le réseau de savoir qui permet de le déterminer ou de le formaliser, l’espace contemporain n’est peut-être pas encore entièrement désacralisé » (ibid., p. 2).
Notre espace est en effet fondamentalement hétérogène :
« L’espace dans lequel nous vivons, par lequel nous sommes attirés hors de nous-mêmes, dans lequel se déroule précisément l’érosion de notre vie et notre temps et notre histoire, cet espace qui nous ronge et nous ravine est en lui-même aussi un espace hétérogène. Autrement dit, nous ne vivons pas dans une sorte de vide, à l’intérieur duquel on pourrait situer des individus et des choses. Nous ne vivons pas à l’intérieur d’un vide qui se colorerait de différents chatoiements, nous vivons à l’intérieur d’un ensemble de relations qui définissent des emplacements irréductibles les uns aux autres et absolument non superposables » (ibid., p. 2-3).
Parmi tous ces emplacements, certains intéressent plus particulièrement Foucault :
« […] certains d’entre eux […] ont la curieuse propriété d’être en rapport avec tous les autres emplacements, mais sur un mode tel qu’ils suspendent, neutralisent ou inversent l’ensemble des rapports qui se trouvent, par eux, désignés, reflétés ou réfléchis. Ces espaces, en quelque sorte, qui sont en liaison avec tous les autres, qui contredisent pourtant tous les autres emplacements, sont de deux grands types » (ibid., p. 3).
Le premier nous est bien connu : c’est l’utopie, un double rêvé des sociétés de notre monde. Le second type est différent :
« Il y a également, et ceci probablement dans toute culture, dans toute civilisation, des lieux réels, des lieux effectifs, des lieux qui sont dessinés dans l’institution même de la société, et qui sont des sortes de contre-emplacements, sortes d’utopies effectivement réalisées dans lesquelles les emplacements réels, tous les autres emplacements réels que l’on peut trouver à l’intérieur de la culture sont à la fois représentés, contestés et inversés, des sortes de lieux qui sont hors de tous les lieux, bien que pourtant ils soient effectivement localisables. Ces lieux, parce qu’ils sont absolument autres que tous les emplacements qu’ils reflètent et dont ils parlent, je les appellerai, par opposition aux utopies, les hétérotopies » (ibid., p. 3).
Il existe des hétérotopies dans tous les groupes sociaux : elles les nient en un sens, mais ces enclaves leur sont consubstantielles tout en circonscrivant certains aspects dangereux ou subversifs de leur vie. Leur rythme n’est pas celui de la société alentour : il est hétérochronique. Distinctes de l’environnement qui les accueillent, ces poches en sont séparées, mais s’ouvrent sur lui selon des modalités diverses. Leur fonction est ou bien d’offrir un double illusoire de la société vraie, ou bien d’offrir un exutoire à ce qui est réprimé ailleurs.
Un exutoire ? Pas seulement ? Un lieu où les expériences généralement condamnées sont permises, un lieu de foisonnement et d’initiatives – un lieu où les artistes puisent souvent leur créativité. Des contre-utopies, mais qui jouent parfois un rôle positif aussi fort que celui de l’utopie. S’ils fascinent ceux qui vivent dans d’autres environnements, c’est qu’ils rendent sensibles une transcendance inversée – celle des fleurs du mal, aussi forte que celle du bien et des Lumières.
Les travaux de Foucault sont parallèles à ceux menés par d’autres disciplines – c’est en 1982 que Roger Brunet publie ses premières recherches sur les espaces aliénés et les antimondes (Brunet, 1981).
Pourquoi avoir attendu dix-sept ans avant de publier ce texte ? Foucault ne voit sans doute pas comment insérer les réflexions sur l’espace qu’il développe au cours des années 1960 dans les travaux qu’il mène alors : histoire de la folie et naissance de la clinique ; psychiatrie, économie et linguistique. Jamais il n’essaie alors d’appréhender la société comme un tout. En analysant les jeux du pouvoir et des réactions qu’il suscite, il rencontre cependant ces « contre-emplacements » qui permettent à l’illicite et au marginal de trouver un lieu où ce qui est prohibé ailleurs a droit de cité. Faute de pouvoir l’éradiquer, on le situe dans un ailleurs négatif, mais réel. C’est un des types de dispositifs spatiaux imaginés par les groupes humains. C’est alors que les hétérotopies finissent par prendre sens pour Foucault.
Ce qu’il découvre, c’est que l’espace dans lequel évoluent les sociétés n’est pas partout du même grain et n’a pas la même nature : pour le comprendre, il faut bâtir une ontologie spatiale. Foucault en éprouve le besoin à la fin de sa vie, lorsqu’il autorise la publication « d’hétérotopies », mais il ne l’explore pas. Il lui manque un outil : l’idée que l’espace social est toujours double, empirique et institué. Nous y reviendrons en évoquant le rôle des imaginaires de l’au-delà dans la genèse des valeurs que mobilise la vie sociale.