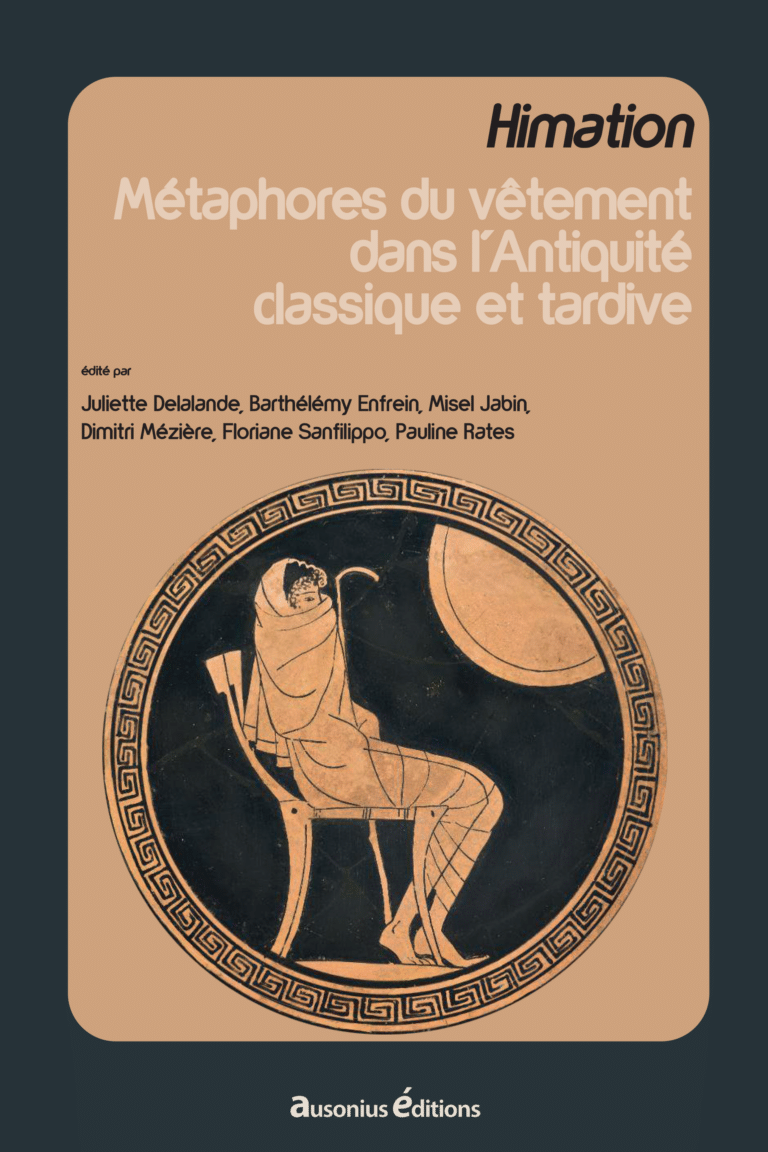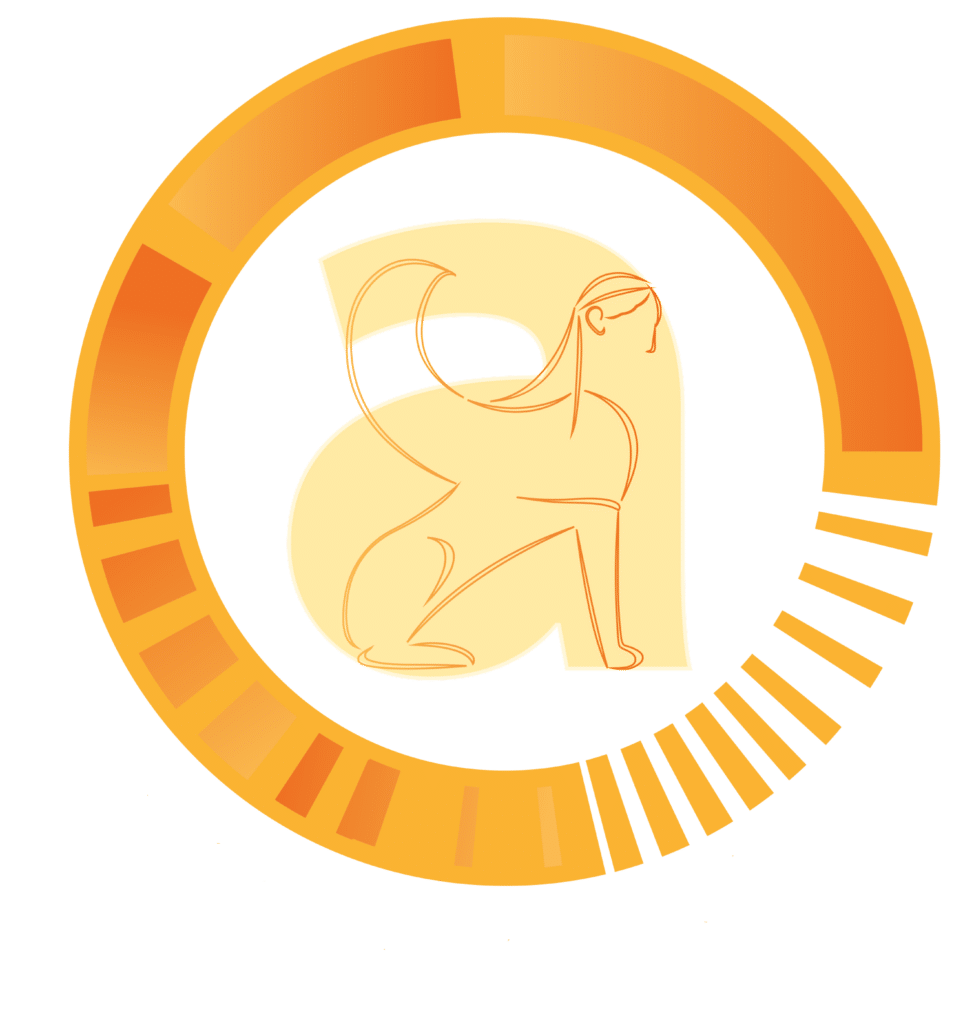Cet ouvrage est le fruit de deux ans de recherches, menées par le laboratoire junior Himation, qui a souhaité explorer la question des métaphores vestimentaires dans les textes antiques et jusqu’à la Renaissance. Il comporte une vingtaine de communications faites par des membres du laboratoire junior et par les intervenants, philosophes, philologues ou anthropologues, qui ont participé aux activités organisées par le laboratoire entre 2021 et 2023.
Le laboratoire et son point de départ
Le laboratoire junior Himation, créé en septembre 2021, a été financé par l’ENS de Lyon et par le laboratoire IHRIM pendant trois ans et ce sont ces institutions qui subventionnent la présente publication. Le projet a été porté par six doctorants aux parcours variés : deux philologues en poésie latine, Juliette Delalande (Sorbonne Université – Editta) et Dimitri Mézière (Sorbonne Université – Rome et ses renaissances), un philologue travaillant sur la patristique grecque et syriaque, Barthélémy Enfrein (EPHE-PSL & Ca’Foscari – LEM), deux philosophes de l’Antiquité : une spécialiste de Platon, Misel Jabin (ENS de Lyon – IHRIM), et une d’Augustin, Pauline Rates (ENS de Lyon – IHRIM), et une anthropologue de l’Antiquité, Floriane Sanfilippo (Université Bordeaux-Montaigne – Ausonius). Notre laboratoire a largement bénéficié de l’interdisciplinarité et du grand nombre d’espaces géographiques et temporels arpentés par ses membres puisque, d’une part, son objet, les métaphores vestimentaires, transcende les catégories génériques (on les retrouve autant dans des œuvres poétiques que philosophiques) et que, d’autre part, elles sont employées de l’Antiquité la plus archaïque à la Renaissance, autant chez des auteurs polythéistes que chrétiens. Pour bien saisir les enjeux de ces métaphores, il était nécessaire de les étudier sur le temps long, de repérer les invariants ou au contraire les évolutions conceptuelles qui leur sont associées, et d’étudier plusieurs textes – qu’ils soient philosophiques, théoriques, historiques, mais aussi poétiques ou théâtraux – qui en présentent des usages différents et des emplois nouveaux.
Le laboratoire junior Himation a organisé, au cours des années 2021-2022 et 2022-2023, huit séances de séminaire tenues à l’ENS de Lyon et à l’EPHE. Chaque séance a permis de donner la parole et de faire dialoguer deux ou trois orateurs, invités ou membres du laboratoire, et d’explorer une thématique, un emploi métaphorique particulier, un genre littéraire ou une époque. La première année, nous nous sommes concentrés sur les métaphores qui désignent le rapport entre l’âme et le corps et leur origine philosophique, tandis que la seconde a été consacrée aux métaphores vestimentaires appliquées à la création, à la fois littéraire et cosmique. Ce séminaire a été l’occasion de progresser dans la connaissance des métaphores antiques, tant sur le plan de leur fonctionnement que des contextes de leurs emplois et réemplois.
En complément des séances du séminaire annuel consacré aux métaphores du corps comme vêtement de l’âme (2021-2022), une journée d’étude intitulée “Habiller l’âme : métaphore vestimentaires du corps dans l’Antiquité” s’est tenue à l’ENS de Lyon le 20 mai 2022 à l’initiative du laboratoire junior Himation. En juin 2023, le laboratoire a par ailleurs coorganisé avec la Luxembourg School of Religion & Society une journée d’étude sur les vêtements du pauvre revêtus de plein gré.
Les articles regroupés dans ce volume, issus de nos différentes rencontres, sont représentatifs des conclusions auxquelles nous avons abouti après ces deux années de travail au sein du laboratoire Himation.
Notre constat de départ, celui qui a donné vie au laboratoire junior Himation,est qu’il existe une grande permanence des métaphores vestimentaires à travers les siècles, avec des emplois variés. Le vêtement sert à dire métaphoriquement ce qui cache ou ce qui dévoile, ce qui est élégant ou grossier (en termes de style ou de comportement moral), l’union ou la désunion – tant physique, sexuelle, conjugale que politique ou religieuse. La métaphore vestimentaire soutient aussi le langage philosophique et théologique lorsqu’il peine à désigner en termes purement théoriques une réalité abstraite, par exemple les rapports entre l’âme et le corps. Il a donc semblé utile de donner aux métaphores vestimentaires une place de choix dans l’étude que nous faisons des textes antiques, en leur accordant toute l’attention qu’elles méritent, sans les considérer ni seulement comme des ornements du langage (comme les définit la tradition rhétorique), ni comme des images éculées, qui seraient passées d’un texte à l’autre sans se renouveler et en perdant leur puissance évocatrice, ni même comme des tournures qui viendraient compenser les insuffisances du langage, en attendant que celui-ci évolue et s’enrichisse de termes précis pour formuler ce que les métaphores ne désigneraient d’abord que de manière approximative et imagée1.
Les recherches du laboratoire Himation n’auraient pas pu être conduites sans le travail conséquent mené ces dernières années sur l’histoire matérielle de l’Antiquité. À partir de sources textuelles, matérielles et iconographiques, de nombreux travaux d’anthropologues, de philologues et d’historiens ont mis au jour les dynamiques politiques, sociales et culturelles qui régissent l’habillement antique2. Ces études ont notamment éclairé la façon dont les normes pouvaient déterminer la confection, l’usage et la symbolique du vêtement sans lesquels il est difficile d’appréhender les métaphores vestimentaires employées par les Anciens. En France, les travaux de F. Gherchanoc et V. Huet, pour le domaine grec3, et ceux de C. Baroin et E. Valette-Cagnac4, pour le domaine latin, ont tout partièrement montré comment le vêtement, dans les sociétés anciennes, était, en lui-même, un langage reposant sur des codes sociaux, culturels et politiques. Ces études ont mis en lumière le fait que le vêtement constituait un marqueur d’identité et pouvait fonctionner comme un élément métonymique renvoyant à un statut socioculturel.
Ces acquis de la recherche permettent aujourd’hui de s’interroger sur les emplois métaphoriques de cet objet du quotidien dans les textes antiques, phénomène récurrent, mais qui a été peu investigué. Si la métaphore du texte-tissu et celle du tissage pour parler de l’activité poétique sont bien connues et ont été bien étudiées, les métaphores vestimentaires ont rarement fait l’objet d’une attention systématique. C’est là l’objectif que le laboratoire junior Himation s’est fixé.
Nous nous inscrivons aussi dans la lignée de nombreuses études, philosophiques, mais aussi cognitives5, qui ont, dans les dernières décennies, souligné l’importance des métaphores dans la formation et la formulation d’une réflexion, voire dans le renouveau de la pensée conceptuelle. La métaphore, pour certains philosophes, ne sert pas servilement le concept, mais lui est complémentaire et le rend intelligible. Ainsi, P. Ricoeur développe dans La Métaphore vive l’idée que ce procédé a une fonction rhétorique, mais aussi une fonction poétique qui nous permet de renouveler notre approche de la réalité en fournissant ce qu’il appelle une “vérité métaphorique” et en s’émancipant des catégories fixées par la pensée conceptuelle6. De même, H. Blumenberg, dont les écrits ont beaucoup nourri notre réflexion, a souligné l’importance d’étudier la métaphore pour elle-même, sans la considérer comme le stade préliminaire d’un concept encore en germe. Pour lui, certaines métaphores sont des “métaphores absolues” qui ne peuvent se résorber dans le concept et fournissent un excédent de sens qui, quoiqu’irréductible au concept, détient sa propre logique, que Blumenberg appelle la “logique de l’imagination”7. Ces deux philosophes, et leurs successeurs8, ont en commun de considérer la métaphore comme un moyen de décrire la réalité autrement que sous une forme conceptuelle. La métaphore permettrait d’approcher une vérité tout aussi valable et tout aussi nécessaire en proposant des parallèles et des ressemblances entre des éléments qui pouvaient paraître jusque-là très dissemblables. Cette idée est au cœur des interventions proposées pendant le séminaire du laboratoire Himation.
H. Blumenberg invite aussi à étudier les métaphores dans leur dimension historique : que des métaphores soient absolues n’implique pas nécessairement, en effet, qu’elles ne puissent être rectifiées ou remplacées par d’autres, au fur et à mesure de l’Histoire. Il montre qu’individuellement chaque métaphore ne peut être comprise que dans son contexte historique, une même métaphore pouvant prendre un sens extrêmement différent d’une période à l’autre. Il appelle donc de ses vœux une métaphorologie, une histoire des métaphores, qui ne soit pas linéaire, mais faite de ruptures et de reprises, de resémantisations et de déplacements. À sa suite, notre laboratoire junior a voulu étudier différents emplois des métaphores vestimentaires en tenant compte de l’évolution des emplois de ces métaphores dans le temps et des modifications des pratiques qui sous-tendent ces emplois. Pour cela, nous avons formulé une typologie que nous avons enrichie et affinée au cours des séances9.
Typologie des métaphores vestimentaires
Notre travail sur les métaphores vestimentaires dans l’Antiquité a commencé par un repérage et un classement de leurs différentes occurrences et de leurs sens dans de nombreux textes grecs et latins antiques, travail préliminaire ensuite enrichi et affiné au cours des deux années du séminaire Himation. Nous avons retenu quatre catégories assez larges de métaphores vestimentaires, qui s’appuient sur différentes réalités de l’habit, depuis le moment de sa confection, où les fils s’entremêlent, jusqu’à ses différents usages, en passant par les enfilages divers et parfois successifs.
Le vêtement envisagé dans son processus de fabrication : création, union, désunion
Un premier ensemble important de métaphores vestimentaires s’appuie sur le processus de fabrication du vêtement, le tissage. Contrairement à notre époque, où les techniques de confection des vêtements, en majeur partie mécaniques, sont connues d’un tout petit nombre de personnes et où l’on ne se vêt plus que très rarement d’habits qu’on a faits soi-même, les Grecs et les Romains avaient, dans l’ensemble, une bonne connaissance des étapes et des procédés de fabrication d’un vêtement, car le tissage était une activité du quotidien. Pour les Anciens, l’union des fils de chaîne et de trame était très concrète et pouvait donner lieu à un certain nombre de comparaisons et de métaphores. De même, le résultat du tissage était perçu comme le résultat d’une activité de création, au même titre que la poterie, la sculpture ou même la poésie, ce qui a alimenté dans les textes des rapprochements fréquents entre ces techniques. De nombreuses métaphores s’appuient sur ce processus de fabrication pour désigner soit la création, qu’elle soit cosmologique ou littéraire, soit l’union, politique, conjugale ou sociale.
Confection d’un vêtement et création du monde
La métaphore du vêtement peut être cosmogonique et cosmologique. La création du monde est tantôt pensée comme celle d’un immense vêtement. Ainsi, dans la théocosmogonie de Phérécyde de Syros (VIe s. a.C.), Zas tisse pour sa fiancée, Chtonié, un peplos, vêtement sur lequel il représente la terre. Cet habit est à la fois une image du monde en train de se former sous les mains habiles du dieu et le symbole du statut et des prérogatives futurs de Chtonié, qui, par le mariage, prend le nom de Gè10. L’action de tisser est donc associée à celle de concevoir et de créer l’univers tandis que le vêtement, le produit fini de cette double création vestimentaire et cosmogonique, représente à la fois le monde créé et la transformation de Chtoniè en Gè.
Tantôt, ce sont certains éléments cosmiques, notamment le ciel, qui sont désignés par des termes relevant du lexique vestimentaire. Ainsi, dans l’Hymne orphique à Zeus foudre, on lit : “déchirant la tunique céleste, tu lances la foudre blanche11”. La voûte céleste est bien présentée comme un habit et la foudre de Zeus, coup de tonnerre dans un ciel bleu, est semblable à une déchirure. Cette métaphore persiste durant toute l’Antiquité avec certaines remotivations. Par exemple, l’empereur Julien (331-363 p.C.), lorsqu’il fait l’éloge de la Mère des dieux, explique que celle-ci : “parmi toutes les autres grâces qu’elle octroya à Attis, le coiffa du bonnet étoilé12”. Le ciel n’est plus un manteau, mais reste un vêtement. La métaphore du bonnet permet de comprendre comment la voûte céleste tient au-dessus de la tête des hommes : elle est posée sur le chef d’une divinité. La métaphore demeure au fil des siècles pour expliquer le fonctionnement physique du cosmos. Le Pseudo-Denys l’Aréopagite, dont le texte est conservé en syriaque, écrit ainsi :
“Comment désires-tu prendre les livres des sphères des astronomes alors que tu ignores comment tourne le ciel et de quel côté, quels sont les lieux de passage du Soleil et ses portes, quels sont les vents qui font avancer sa sphère, comment tourne l’axe de (son) orbite […] jusqu’où va l’étendue du voile (qui recouvre) cet objet du ciel13.”
La métaphore n’est pas réservée au polythéisme et se trouve également chez les auteurs chrétiens. De physique, la métaphore devient métaphysique. Le geste du Créateur de l’univers se développe tout au long de l’Histoire en “couvrant” la terre et les hommes d’un vêtement :
“Tu as couronné (στέφανον) l’année de tes bienfaits et les collines seront ceintes (περιζώσονται) d’allégresse et les béliers des troupeaux sont habillés (ἐνεδύσαντο)14.”
La métaphore vestimentaire du cosmos peut symboliser les commencements des temps, mais aussi leur fin comme chez Jacques de Saroug (450-521 p.C.) :
“Quand va-t-il venir le glaive de la fin pour trancher
Et faire tomber
La toile qu’à partir du néant a tissé ton action ?
Quand sera-t-il devenu court le fil qui est sur toutes
Les œuvres,
Et quand feras-tu tomber le grand vêtement de toute la création ?
Quand sera-t-il achevé le manteau du monde et
Touchera-t-il à sa fin,
Et quand ton remzâ15 apparaîtra-t-il pour faire advenir,
Par l’accomplissement, la coupure de la trame ?16”
Tisser un texte littéraire comme un vêtement
Dès Homère, tissage et création poétique sont deux actions associées l’une à l’autre. Les déesses Calypso et Circé chantent en tissant dans l’Odyssée et Hélène, dans l’Iliade, “tisse un grand manteau double, aux couleurs éclatantes et y fait figurer les nombreux combats des Troyens dompteurs de chevaux et des Achéens vêtus de bronze”17. Elle représente ainsi sur un vêtement ce que le poète raconte dans ses vers et fait office de double du poète. De la même façon, plusieurs siècles après, les tisserandes ovidiennes des Métamorphoses, les Minyades, Philomèle, Arachné et Minerve, illustrent une partie de la poétique de l’auteur dans des tapisseries et se font ses porte-paroles.
Le poème lui-même est souvent conçu métaphoriquement comme un vêtement. Certains soulignent les similarités dans le processus de fabrication. Les poètes grecs lyriques “tissent”18 leur chant et tressent leurs hymnes comme des couronnes19. De même, quand un poète amoureux de l’Anthologie grecque écrit : “Tiens, prends, ma fiancée, ce bandeau que je t’apporte tout éclatant de l’or dont il est brodé20”, il est aisé de lire ce don dans une perspective métaphorique et métapoétique et de comprendre que ce bandeau éclatant des ors de l’amour est l’épigramme que le poète adresse à sa bien-aimée. Enfin, quand l’auteur de la Ciris, dans son proème, promet à Messala de lui tisser un jour un grand peplos orné de scènes épiques, il rend explicite qu’il s’agit, en fait de peplos, de lui écrire une œuvre au style élevé :
“Donc les combats de Pallas sont tissés (texuntur) en ordre, les grands vêtements (magna pepla) sont ornés des victoires sur les Géants et les terribles combats sont teints (pinguntur) avec de la pourpre sanguinolente. Celui qui fut mis à bas par une lance d’or, Typhon, y est ajouté, lui qui le premier, quand il gravissait les roches de l’Ossa pour atteindre le ciel, tenta de redoubler la taille du haut Olympe en y ajoutant la cime de l’Emathios. Tel le voile (uelum) qu’on apporte à la déesse lors de la cérémonie solennelle, tel celui que je voudrais broder autour de toi (intexere), jeune homme des plus sages, parmi les soleils pourpres et les pâles éclats de la lune qui parcourt l’univers sur son bige céruléen, dans de grands poèmes (magnis chartis) sur la Nature…21”
Dans la Ciris, la métaphore est double. D’une part, le poète est présenté comme un tisserand qui fabrique de grands poèmes à la manière des grands voiles de Minerve, d’autre part, la spécificité du vêtement, un noble peplos orné de motifs épiques, mais aussi d’astres, indique métapoétiquement le genre du poème envisagé et le style élevé qui y serait choisi. Son auteur s’inscrit en cela dans une longue tradition poétique, dans laquelle la finesse ou les motifs des vêtements, tels ceux qui ornent le manteau offert par Athéna à Jason dans les Argonautiques d’Apollonios de Rhodes22, sont révélateurs de la poétique, du style et des choix génériques de l’œuvre.
Union d’un groupe social à l’image des fils d’un vêtement
Une fois le vêtement fabriqué, les fils et les tissus qui le composent sont solidement unis les uns aux autres. Puisque le vêtement est le résultat tangible et robuste de divers éléments, alors il est le symbole par excellence de l’union. Les auteurs grecs vont d’abord s’en emparer pour dire l’union d’un groupe social ou l’union de la cité. On trouve notamment cette métaphore politique dans des textes grecs de la fin du Ve s. et du début du IVe s. avant notre ère. Dans Lysistrata, Aristophane fait déclarer à l’héroïne éponyme :
“D’abord, il faudrait, comme on fait pour la laine brute lavée dans un bain, après avoir enlevé le suint de la cité, sur un lit, à coups de trique, éliminer les méchants et trier les poils durs ; ceux qui s’agglomèrent et font touffes pour arriver aux charges, ceux-là les séparer à la cardeuse et arracher les têtes une à une ; puis réunir dans une corbeille la bonne volonté commune et générale, en mêlant et les métèques et, à l’étranger, ceux qui nous sont amis, et les débiteurs du trésor, de s’y mêler aussi. Et par Zeus, quant aux villes peuplées de colons de ce pays, il faudrait reconnaître que ce sont pour nous comme autant de brins de laine tombés par terre, chacun de leurs côtés ; puis prenant à toutes leur fil, l’amener ici, le réunir en une seule masse, en une grosse pelote, et avec celle-ci alors tisser un manteau pour le peuple (τῷ δήμῳ χλαῖναν ὑφῆναι)23.”
La confection du vêtement est ici la réalité concrète que l’auteur utilise pour manifester l’union du corps social, grâce à une métaphore filée qui va du traitement de la laine au produit fini. On trouve un emploi très similaire de cette métaphore dans un célèbre passage de la République de Platon, où le régime démocratique est présenté comme un vêtement bariolé qui suscite l’admiration de la foule, mais ne permet aucune harmonie24.
Cette métaphore vestimentaire du corps social, du cosmos d’une organisation humaine, est reprise également dans une perspective ecclésiologique. Le vêtement représente alors l’Église unie. Ce qui est remarquable avec cette métaphore ecclésiale, c’est qu’il en existe des représentations iconographiques à l’époque byzantine25. A contrario, contribuer à créer la division dans un groupe d’individus, par exemple en défendant une hérésie, peut être dit par la déchirure d’un habit.
À une autre échelle, le vêtement comme symbole de l’union est également utilisé par les auteurs antiques pour parler de l’union amoureuse, sexuelle et maritale, de manière avant tout métonymique26. Le vêtement est alors pensé à la fois dans sa confection, dans ses usages et sur le plan symbolique. La confection du vêtement, qui associe une trame et une chaîne, unies l’une à l’autre, peut représenter l’union de l’homme et de la femme. L’emploi d’un dais pour recouvrir les nouveaux époux lors de certaines cérémonies de mariage (probablement par association avec la couverture sous laquelle le couple s’apprête à partager sa couche) fait du tissu une métonymie de l’union conjugale. Enfin, le vêtement est symbolique, il peut, métaphoriquement, révéler le statut de vierge ou d’épouse d’une femme.
Le vêtement comme symbole du statut ou du comportement de celui qui le porte
La dimension symbolique et sociale du vêtement est centrale dans tout un ensemble de métaphores du vêtement. Celles-ci sont en effet un outil à la disposition de l’écrivain pour classer son personnage dans tel ou tel groupe de la société, d’autant plus que les sociétés antiques sont fermement hiérarchisées et codifiées. Les différents emplois de métaphores vestimentaires disent alors l’appartenance à une classe, renvoient à une identité de genre ou une identité professionnelle, signifient un rôle social, etc. Ces métaphores sont aussi une solution offerte à l’écrivain pour parler des âges de la vie et des rites de passage afférents. P. Schmitt-Pantel s’est par exemple intéressée au motif de la ceinture. Elle note que l’expression imagée “dénouer sa ceinture” est employée pour indiquer l’acte sexuel et surtout la perte de la virginité, car la nouvelle épouse porte une large ceinture après s’être délestée de son ancienne ceinture de jeune fille27. Dans l’Anthologie Palatine, de nombreuses épigrammes emploient cette ceinture dénouée comme métaphore du mariage ou de l’union sexuelle28. Cette métaphore est même tellement évidente que, dans certains poèmes, elle suffit à dire le lien marital qui unit deux personnes. Par exemple, dans l’épigramme d’Antipater de Sidon (seconde moitié du IIe s. a.C.), la métaphore seule fait comprendre que Théocrite est l’époux de la défunte qui répond au promeneur passant devant sa tombe :
“Ce tombeau qui te l’a élevé ?
— Théocrite, lui qui dénoua ma ceinture virginale29.”
De même, dans les Métamorphoses d’Ovide, quand la déesse Cérès cherche sa fille Proserpine à travers toute la Sicile, sans succès, c’est la découverte de la ceinture de Proserpine qui déclenche ses lamentations. La ceinture perdue matérialise le sort de la jeune fille, son rapt précipité et son viol30.
Par ailleurs, dans la littérature antique, de nombreuses métaphores associent un vêtement masculin ou féminin à une valeur morale ou à un style. Ainsi la toge est le signe par excellence de la citoyenneté chez les Romains, mais aussi de la virilité et de la masculinité. Tout accoutrement divergent peut être révélateur d’un autre positionnement vis-à-vis de la masculinité et des valeurs qui s’y rapportent. Macrobe rapporte ainsi un propos de Cicéron “se moquant de César qui ajustait sa toge de façon à ce qu’en faisant traîner un pan de celle-ci, il marchait comme un efféminé31.” La tenue négligée de César, présenté comme “mal-ceint” par Sylla, toujours d’après Macrobe32, est l’objet de critiques, car elle s’oppose à la gravitas et à la duritia attendues chez les magistrats de Rome et connote de plus métaphoriquement “le manque de masculinité sociale” de l’imperator33. On voit donc comment la métaphore vestimentaire permet chez les auteurs antiques de connoter le groupe social d’un personnage, étant donné que les femmes et les hommes, les citoyens et les esclaves portent des vêtements très différents, et d’affiner sa caractérisation. Celui qui porte des vêtements trop soignés ou trop raffinés sera considéré comme un efféminé tandis que celui qui présente une tenue négligée et tâchée sera regardé comme un homme sale, voire vicieux34.
Cette métaphore sociale et genrée qui associe certains vêtements aux caractéristiques morales de celui qui les porte n’est pas uniquement employée dans des portraits et des satires. La critique littéraire utilise aussi une telle métaphore pour désigner le style d’un auteur. Chez Quintilien, par exemple, l’éloquence est décrite des termes vestimentaires et genrés :
“Une parure (cultus) honorable et somptueuse apporte à l’homme, comme l’a dit un vers grec, la dignité ; mais une parure féminine et trop luxueuse n’orne pas le corps, elle met l’âme à nu. De même, cette élocution transparente et chamarrée de certains effémine les choses mêmes qu’elle habille de ses mots (quae illo uerborum habitu uestiuntur)35.”
La métaphore met ici en place tout un jeu d’opposition sur les genres féminin/masculin, mais aussi entre sobriété honorable et luxe honteux, et derrière cela entre valeurs romaines et barbarie, pour critiquer un style trop paré et donc efféminé.
Se dévêtir, se revêtir : une métaphore aux usages multiples
L’acte quotidien de passer un habit puis de s’en dévêtir est le cœur d’un certain nombre de métaphores qu’on peut qualifier d’existentielles.
Un nouvel habit, image d’une nouvelle vie
Sur un plan individuel, la métaphore du changement d’habit est adoptée chez les écrivains antiques pour signaler le changement profond d’une personne, pour témoigner, pour ainsi dire, d’une conversion. Le revêtement d’habits neufs est alors le signe visible d’une métamorphose du for intérieur. Cela se lit par exemple, dans la littérature juive du VIe siècle a.C., dans le livre de Zacharie :
“Et Ièsous s’était revêtu d’habits sales et il se tenait debout devant la face de l’ange. Et celui-ci prit la parole et s’adressa à ceux qui se tenaient debout devant sa face en disant : ‘Ôtez-lui ses habits sales !’ et il lui dit : ‘Voilà, je t’ai ôté tes fautes, revêtez-le d’une tunique longue’…36”
L’action de la divinité, représentée par l’ange, efface les fautes de Iésous et cette purification est marquée matériellement par le changement d’habits. Le revêtement d’un autre habit est le symbole d’une nouvelle vie37. C’est aussi ce qui est esquissé par la notation vestimentaire dans le Timon de Lucien, au moment où le protagoniste quitte la ville pour les champs et maudit ses semblables par misanthropie. Il s’exprime ainsi :
“Aussi à la suite de mes malheurs, je suis dans ce champ écarté où, revêtu d’une casaque de peau, je travaille la terre pour un salaire de quatre oboles et je philosophe avec la solitude et mon hoyau38.”
Signe d’un déclassement social, la casaque ressortit à la nouvelle vie de celui qui philosophe dans la frugalité, comme d’autres, à l’instar de Diogène, mettent leur manteau en double pour dire leurs opinions philosophiques. Cette transformation d’un état de vie manifesté par un nouveau vêtement se lexicalise au fil des siècles. Les auteurs chrétiens vont s’en emparer. Paul écrit ainsi : “Revêtez notre Seigneur Jésus Christ39” ou encore : “Vous tous en effet baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ40”. Revêtir le Christ, c’est devenir chrétien, c’est suivre les préceptes de Jésus et quitter ses anciennes attaches. Le Christ est comparé à un vêtement et la personne qui, par le baptême, s’en revêt métaphoriquement devient un fidèle. On a ici en quelque sorte une métaphore double. Ce genre de métaphore se cantonne plutôt aux textes philosophiques et théologiques, ou du moins aux textes à visée morale.
Mettre ou ôter un habit comme signe des émotions ressenties
Outre cet emploi, la métaphore du vêtement qu’on enfile ou qu’on ôte est aussi convoquée pour parler des émotions. Les Anciens peuvent ainsi revêtir divers sentiments ou états d’esprit. Théophraste passe à plusieurs reprises par le vêtement pour conceptualiser le type général d’un caractère, qu’il s’agisse de la poltronnerie ou de la parcimonie. Hérodote dans son Enquête remarque :
“En même temps qu’elle ôte sa tunique, une femme enlève aussi avec elle sa pudeur41.”
Cette réponse faite par Gygès à Candaule, qui l’exhorte à voir sa femme nue pour contempler sa beauté dans sa plénitude, manifeste une association nette entre pudeur et habits.
Ce sont également des mouvements de l’âme plus fugaces qui sont captés par la métaphore du vêtement. Ainsi, si le sommeil est un manteau dans les Bacchantes d’Euripide42, le chagrin peut lui aussi être exprimé par la métaphore d’un vêtement qui enveloppe le sujet, comme l’observe judicieusement D. Cairns43. Il est remarquable que dans de nombreux cas, cette métaphorisation des émotions dans une visée didactique permette de porter une réflexion morale sur celles-ci.
Le vêtement pour penser l’union de l’âme et du corps
La vision dualiste de l’anthropologie occidentale depuis l’Antiquité postule que l’individu est composé de deux entités : une âme et un corps. Des écoles littéraires, philosophiques et religieuses diverses ont pensé différemment les rapports entre ces deux substances. Une image revient souvent, celle du vêtement : le corps serait le vêtement de l’âme. Cette métaphore semble reposer principalement sur l’idée de couverture ou d’enveloppe qui correspond tant à une conception du vêtement que du corps. Souvent, il faut comprendre cette métaphore dans un sens négatif : le corps, à la manière d’un vêtement, occulte l’âme.
Influencé par les doctrines orphiques et pythagoriciennes, Platon reprend l’image du corps comme vêtement de l’âme et la complexifie en faisant de l’âme la tisserande de son, ou ses, corps. Cette métaphore est ensuite interprétée, discutée, modifiée, complétée, remotivée chez les héritiers de Platon, comme Plotin et Porphyre. Ce dernier, dans son Antre des nymphes, exprime cette conception de façon ramassée : “le corps est une tunique qui enveloppe l’âme”44. Cette tunique traverse les siècles au gré des avatars du platonisme et de ses descendants, dans le monde grec comme dans le monde latin, du IVe siècle a.C. jusqu’à la Renaissance.
Dans le monde chrétien, la combinaison de l’héritage dualiste et du nombre important d’évocations de vêtements dans le texte sacré font que cette métaphore du vêtement prospère pour parler de l’âme, de ses évolutions et de son union avec un corps. Les gnostiques prennent rapidement à leur compte cette imagerie, par exemple dans le fameux Hymne à la Perle des Actes de Thomas où le héros, retrouvant son habit royal, dit :
“Et soudainement, quand je vis le vêtement rendu pareil à moi comme si ç’avait été dans un miroir, je me vis tout entier sur le vêtement et par lui, je me reconnus et je me vis45.”
Chez les auteurs monothéistes, parfois il faut quitter l’habit pour retrouver une nudité, une pureté originelle, celle de l’âme seule. Mais l’Incarnation du Christ est aussi pensée et exprimée à l’aide d’une métaphore vestimentaire, dans laquelle le corps humain de Jésus incarné vient habiller son essence divine. C’est ainsi qu’on peut comprendre le prologue de l’Évangile de Jean : “Et le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous”. Tertullien utilise cette métaphore à des fins pédagogiques et écrit, pour faire comprendre le destin du fils de Dieu :
“Puisqu’il devait être homme réellement jusqu’à la mort, il devait revêtir la chair qui est vouée à la mort46.”
Toutefois, de telles métaphores engendrent au IVe siècle p.C des débats théologiques parce qu’elles sous-entendent que le corps, la partie humaine du Christ incarné, est quelque chose d’accessoire, de mobile, que le corps n’est pas essentiellement uni au Logos divin. Ces idées mènent donc à une christologie dualiste qui est considérée comme hérétique par l’Église et condamnée par les conciles œcuméniques d’Éphèse (431 p.C.) et de Chalcédoine (451 p.C.). Dès lors, la métaphore devient suspecte. Elle est par exemple raillée par Philoxène qui la met dans la bouche d’un adversaire nestorien :
“De la même façon qu’un roi revêt la pourpre, qui en elle-même est extérieure à l’hypostase du roi, de la même façon, Dieu revêt l’hypostase étrangère de l’homme et elle fut pour lui comme la pourpre47.”
Le vêtement conçu dans sa fonction d’occultation : voilement, dévoilement et révélation
Un quatrième et dernier emploi métaphorique dans les textes antiques repose sur la fonction d’occultation du vêtement qui cache, dissimule et voile ce qu’il recouvre. Cet emploi métaphorique du vêtement, comme l’a montré D. Cairns48, s’inscrit en grec dans un réseau plus large de métaphores du recouvrement organisées autour du verbe grec καλύπτειν. Selon le contexte, la métaphore vestimentaire peut détenir une acception tantôt positive, celle d’une enveloppe protectrice ou pudique, tantôt négative, celle d’un voile qui empêche d’accéder directement à l’objet, au concept ou à l’être convoité.
Envisagé dans sa fonction dissimulatrice, le vêtement peut notamment être employé pour évoquer la nature. La terre est ainsi fréquemment associée à un manteau qui cache ce qu’elle détient en son sein ou est elle-même dissimulée par une sorte de couverture49. La métaphore vestimentaire employée pour décrire cet élément naturel peut également servir à évoquer une émotion assignée la plupart du temps au genre féminin, la pudeur, alors que la Terre est elle-même souvent perçue par les Anciens comme une représentation de la féminité et de la maternité. D’une façon en partie analogue, la nuit est souvent assimilée à un voile ou à un vêtement qui enveloppe et dissimule. C’est pourquoi, grâce à ses voiles pudiques, la nuit est, dans les imaginaires antiques, le moment qui convient aux ébats érotiques50. On note ainsi que la métaphore vestimentaire exprimant l’idée de recouvrement peut non seulement décrire certains phénomènes naturels, mais tend également à refléter une conception anthropocentrée du monde dans la mesure où la vertu occultante du vêtement est associée à l’émotion humaine de la pudeur et où le voile empêche une connaissance pleine et entière du monde.
Comme le souligne P. Hadot dans Le voile d’Isis51, de nombreux discours philosophiques empruntent des métaphores vestimentaires pour dire leur conception du monde. L’impossibilité d’une connaissance directe de la nature par l’homme est ainsi présentée comme un voile dont la Nature personnifiée s’enrobe pour dissimuler ses secrets52. Suivant cette représentation, la connaissance de la nature procède par un dévoilement et la vérité, lorsqu’elle est totale, est nue. La métaphore d’une vérité nue (nuda ueritas) se trouve notamment exploitée par Lactance lorsqu’il cherche à opposer la vérité de Dieu aux discours des philosophes et de certains rhéteurs53. La vérité divine ne serait accessible qu’une fois l’habit et la parure, c’est-à-dire les artifices rhétoriques, mis de côté. À l’opposition entre vérité et mensonge, Lactance superpose ainsi une opposition entre nature et artifice. En ce sens, comme le relève Blumenberg, le vêtement est pris de façon négative en renvoyant à un masque, si ce n’est à un déguisement, qui dissimulerait l’être authentique54. Le dévoilement et la mise à nu consisteraient alors à retrouver une vérité originelle et sincère. Cette métaphore du dénudement comme accès à la vérité trouve un développement particulièrement important chez les auteurs néo-platoniciens. Les formes corporelles étant la résultante d’une succession d’enveloppes suivant un mouvement de dégradation, leur effeuillage apparaît, en théorie, comme la condition nécessaire pour accéder, suivant une dynamique ascensionnelle, à la nature divine et vraie du monde. Dans ce contexte, contrairement à la perception moderne qui tend avant tout à associer le nu à la sensualité voire à la débauche, le dénudement apparaît comme une métaphore hautement valorisée dans l’imaginaire néo-platonicien qui connut une réception importante de l’Antiquité tardive à la Renaissance. La métaphore du vêtement comme enveloppe dissimulatrice est toutefois marquée par une certaine ambivalence selon les contextes d’emploi : tantôt, le vêtement est considéré comme ce qui fait obstacle à la vérité, tantôt, il est envisagé comme une protection pudique, voire comme la seule manière de connaître le monde. Pour Philon d’Alexandrie, la nature échappe à la connaissance directe des hommes. Ceux-ci ne peuvent connaître le monde que de façon indirecte et voilée, dans les discours, par des allégories55. Le vêtement en vient alors à reprendre son sens métaphorique plus classique, que l’on trouve déjà dans les discours rhétoriques : celui d’ornement ou d’artifice. Si l’artifice rhétorique est, on l’a vu, fermement rejeté par Lactance au profit de la nuda ueritas, le recours au mythe et à l’allégorie est considéré par de nombreux autres auteurs, notamment néo-platoniciens, comme un moyen d’accéder aux vérités supérieures qui seraient inintelligibles si elles étaient appréhendées directement. Plus tard et de façon frappante, on note que le terme latin d’integumentum, qui désigne le “vêtement”, “l’enveloppe” ou le “voile”, prend un sens métaphorique pour désigner, dans le contexte de l’exégèse médiévale, les passages littéraires allégoriques qui dissimulent un savoir caché56. Le vêtement qui pouvait masquer une vérité devient ici, paradoxalement, ce qui permet de l’appréhender de façon indirecte.
Conclusion
Que retenir à l’issue de cette typologie et de nos deux années de réflexion ? D’abord, que la métaphore vestimentaire est dans l’Antiquité extrêmement souple et protéiforme. Elle est capable de dire tout aussi bien les vicissitudes de l’existence individuelle, les sentiments et les changements de vie, que ce qui est l’au-delà : l’Univers, la métaphysique, le métalittéraire. Elle s’adapte à tous les discours et à tous les genres. Au cœur de l’expérience quotidienne universelle, le vêtement est à la disposition de tous les écrivains pour exprimer, conceptualiser, sublimer leurs idées. Nous n’avons pas épuisé tous les textes, toutes les formes de la métaphore. Métamorphe, la métaphore vestimentaire est aussi voyageuse et n’est pas confinée à un espace précis. À la diversité des vêtements du monde répond l’abondance du vestiaire dans la vie des lettres.
Peut-on dégager de nos travaux une perspective historique, une chronologie de la métaphore du vêtement ? De la typologie qui précède, on retire l’impression que toutes les métaphores vestimentaires perdurent à travers les siècles et à travers les langues. Elles seraient alors comme une sorte d’invariant anthropologique. Cela tient pour une part à la réalité universelle et journalière du vêtement. Le fait que chacun soit comme le maître de son propre accoutrement et puisse le modifier à sa guise, au sein de normes sociales extérieures, peut d’ailleurs appuyer ce facteur de popularité de la métaphore vestimentaire. Mais ce succès est aussi, semble-t-il, le résultat de ses emplois dans des textes canoniques. La métaphore vestimentaire est consacrée, pour ainsi dire, par sa présence dans le corpus homérique puis chez les poètes lyriques – ce qui en fait une image de choix pour les poètes de la Grèce continentale à Rome en passant par Alexandrie – , et dans les œuvres de Platon, texte source avec lequel discutent tous les philosophes de l’Antiquité. Présente chez de telles autorités, il n’y a plus qu’à la réemployer, à s’y opposer, à la remotiver. Alors que la métaphore aurait pu être délaissée lors de la révolution culturelle que représente le passage au monothéisme, son utilisation dans le texte biblique lui assure une sorte de renaissance – le vêtement est tel un phénix. Son emploi dans l’Ancien Testament remotive son lien avec le thème de la création et les épîtres pauliniennes renforcent la possibilité d’utiliser l’image du vêtement pour aborder la question de l’essence de l’homme et de ce vers quoi il doit tendre. C’est pourquoi les auteurs chrétiens vont s’en servir sans avoir l’impression d’utiliser un procédé provenant de la littérature païenne. L’histoire des métaphores vestimentaires est donc intimement reliée à l’histoire du canon des grands textes de l’Antiquité grecque et romaine, ce qui leur assure une forte pérennité. Partant, l’histoire de nos métaphores ne connaît pas de grandes ruptures. Elle procède plutôt par accumulation, agglutination de ses différents sens qui l’enrichissent et l’approfondissent toujours davantage. Tout au plus pouvons-nous remarquer que le néo-platonisme s’est tout particulièrement servi de la métaphore vestimentaire dans le domaine cosmologique en remotivant le Timée platonicien. L’historicisation de la métaphore du vêtement tend donc à montrer qu’elle jouit d’une réception grandissante même si chaque auteur la diamante.
Ce volume offre une vingtaine d’études de cas, mais une synthèse des emplois des métaphores vestimentaires reste encore à écrire. Une des communications présentées ici offre une brève excursion chez les auteurs de la Renaissance occidentale, mais il serait sans aucun doute intéressant et fructueux de poursuivre les investigations dans l’espace et le temps et de suivre les formes que prennent les métaphores vestimentaires dans un monde dont les codes religieux, politiques, sociaux et même vestimentaires ont changé. On pourrait se demander s’il y a des moments et des endroits où la métaphore disparaît. Mais cela paraît peu probable. De célèbres épisodes hagiographiques, comme le partage du manteau de Martin de Tours, ou des récits courtois, comme le Roman de Tristan et Iseult, rythmé par les changements d’habits et les sentiments exprimés au moyen d’images vestimentaires, montrent que ces métaphores ne perdent pas leur puissance dans la littérature médiévale. Il n’est jusqu’à Montaigne qui écrive : “l’homme en tout et par tout n’est que rappiessement et bigarrure57”. En somme, il faudrait écrire une anthologie occidentale de la métaphore vestimentaire.
Notre chemin de ces deux années a été facilité et enrichi par l’aide de nombreuses personnes que nous voudrions remercier. Que l’ENS de Lyon et l’IRHIM trouvent ici l’expression de notre profonde gratitude pour nous avoir donné les capacités matérielles de mener à bien nos réflexions. Nous remercions aussi le LEM pour le soutien régulier qu’il nous a apporté. La gestion administrative de notre laboratoire a reposé sur les épaules de Carine de Tricaud, à elle va toute notre gratitude. Nos événements n’auraient pu se dérouler aussi bien sans le concours de celles et ceux qui ont modéré des séances ou des panels : Alberto Ambrosio, Christophe Cusset, Fabien Pepino et Nathalie Roelens. Nous leur adressons un grand merci.
Bibliographie
- Baroin, C. et Valette-Cagnac, E. (2007) : “S’habiller et se déshabiller en Grèce et à Rome (III). Quand les Romains s’habillaient à la grecque ou les divers usages du pallium”, Revue historique, n°643, 517-551.
- Baroin, C. (2012) : “Genre et codes vestimentaires à Rome”, in : Cassagnes-Brouquet, S. et Dousset-Seiden, C., Clio. Histoire, Femmes et Sociétés, n°36 : Costumes, 43-66.
- Batten, A. et Olson, K., éd. (2021) : Dress in Mediterranean Antiquity : Greeks, Romans, Jews, Christians, Londres/New York.
- Blumenberg, H. [1960] (2006) : Paradigmes pour une métaphorologie, Paris.
- Bodiou, L. et al. (2011) : Parures et artifices : le corps exposé dans l’Antiquité, Paris.
- Bowra, C. M. éd. (1961) : Pindari Carmina Cum Fragmentis, Oxford Classical Texts, Oxford.
- Brière, M. et Graffin, F., éd. (1980) : Philoxenus Mabbugensis, Dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo, Patrologia Orientalis 40, Turnhout.
- Buchon, J. A., éd. (1837) : Lactance. Institutions divines. III, in : Choix de monuments primitifs de l’Eglise chrétienne avec notices littéraires, Paris.
- Bulloch A. (2006) : “Jason’s Cloak”, Hermes, n° 134, 1 44-68.
- Cairns, D. (2013) : “Vêtu d’impudeur et enveloppé de chagrin. Le rôle des métaphores de ‘l’habillement’ dans les concepts d’émotion en Grèce ancienne”, in : Gherchanoc et Huet, éd. 2013, 149-152.
- Cairns, D. (2016) : “Clothed in Shamelessness, Shrouded in Grief. The Role of “Garment” Metaphors in Ancient Greek Concepts of Emotion”, in : Fanfani et al., éd. 2016, 25-41.
- Courbaud, E., éd. et Bornecque H. trad. (1930) : Cicéron. De l’orateur. Livre III, Collection des universités de France, Paris.
- Chambry, É. éd. et trad. (2015) : Lucien de Samosate, Œuvres complètes, Bouquins, Paris.
- Chambry, É., éd. et trad. (1934) : Platon. Oeuvres complètes, tome VII, 1re partie : La République. Livres VIII-X, Collection des universités de France, Paris.
- Cleland, L., Davies, G. et LLewellyn-Jones, L. (2007) : Greek and Roman Dress from A to Z, Londres/ New York.
- Coulon, éd. et Van Daele, trad. [1928] (1946) : Aristophane. Comédies. Tome III : Les Oiseaux – Lysistrata, Collection des universités de France, Paris.
- Cousin, J., éd. et trad. (1978) : Quintilien. Institution oratoire. Tome V : Livres VIII et IX, Collection des universités de France, Paris.
- Diggle, J., éd. (1994) : Euripidis Fabulae: Helena, Phoenissae, Orestes, Bacchae, Iphigenia Aulidensis, Rhesus, Oxford Classical Texts, Oxford.
- Dorandi, T., éd. (2019) : Porphyre, L’antre des nymphes dans l’Odyssée, Paris.
- Fairclough, H. R. éd. et trad. [1918] (2001) : Virgil. Aeneid: Books 7-12. Appendix Vergiliana, Cambridge (U.S.A.).
- Fayant, M.-C., éd. et trad. (2014) : Hymnes Orphiques, Collection des universités de France, Paris.
- Fanfani, G., Harlow, M. et Nosch, M.-L., éd. (2016) : Spinning Fates and the Song of the Loom: The Use of Textiles, Clothing and Cloth Production as Metaphor, Symbol and Narrative Device in Greek and Latin Literature, Oxford.
- Fuhrmann, F. (1972) : Plutarque. Œuvres morales, Tome IX, première partie – Propos de table, I-III, Collection des universités de France, Paris.
- Gherchanoc, F. et Huet, V. (2007) : “Pratiques politiques et culturelles du vêtement”, Revue historique, n°641, 3-30.
- Gherchanoc, F., Huet, V., Bodiou L., Mehl, éd. (2008) : Métis : S’habiller, se déshabiller dans les mondes anciens, n°6.
- Gherchanoc, F. et Huet, V. (2012) : Vêtements antiques : S’habiller, se déshabiller dans les mondes anciens, Paris.
- Goldlust, B. éd. (2021) : Macrobe. Saturnales. Tome II : livre II et III, Collection des universités de France, Paris.
- Hadot, P. (2004) : Le voile d’Isis. Essai sur l’histoire de l’idée de nature, Paris.
- Iribarren, L. (2018) : Fabriquer le monde. Technique et cosmogonie dans la poésie grecque archaïque, Paris.
- Irigoin, J., éd. (1993) : Bacchylide. Dithyrambes, Epinicies, Fragments, traduit par L. Bardollet et J. Duchemin, Collection des universités de France, Paris.
- Irigoin, J. et Waltz, P. (2003) [1929] : Anthologie grecque. Tome II : Anthologie palatine, Livre V, Collection des universités de France, Paris.
- Isebaert-Cauuet, I., éd. (2005) : Jacques de Saroug. Homélies sur la fin du monde, Les Pères dans la foi, 91, Paris.
- Kugener, A. (1907) : “Un traité astronomique et météorologique syriaque attribué à Denys l’Aréopagite”, in : Actes du XIVe Congrès international des orientalistes, Alger, 1905 II, 137‑163 .
- Lafaye, G. éd. et trad [1925] (2017) : Ovide, Métamorphoses. Tome I. Livres I-V, Collection des universités de France, Paris.
- Lakoff, G. et Johnson M. [1980] (2003) : Metaphors We Live By, Chicago.
- Legrand, Ph.-E. éd. et trad. [1932] 2022 : Hérodote. Histoires, livre I : Clio, Collection des universités de France, Paris.
- Mahé, J.-P., éd. et trad. (1975) : Tertullien. La chair du Christ, Sources chrétiennes 216-217, Paris.
- Mazon, P. éd. et trad. [1928] (2021) : Hésiode. Théogonie – Les Travaux et les Jours – Bouclier, Collection des universités de France, Paris.
- Mazon, P., éd. et trad. (1937) : Homère. Iliade. Tome I. Chants I-VI, Collection des universités de France, Paris.
- Olson, K. (2008) : Dress and the Roman Woman: Self-Presentation and Society, Abingdon.
- Olson, K. (2017) : Masculinity and Dress in Roman Antiquity, Londres.
- Poirier, P.-H. [1981] (2021) : L’Hymne de la Perle des Actes de Thomas, Turnhout.
- Ricoeur, P. (1975) : La métaphore vive, Paris.
- Riedel, W., éd. (1924) : Commentum Bernardi di Silvestris super sex libros Eneidos Virgilii, Greifswald.
- Robert, J.-N. (2011) : Les Romains et la mode, Paris.
- Rochefort, G. éd. et trad. (2014) : L’empereur Julien. Œuvres complètes. Tome II, 1re partie : Discours de Julien Empereur (VI-IX). A Thémistius – Contre Héracleios le cynique – Sur la mère des dieux – Contre les cyniques ignorants, Collection des universités de France, Paris.
- Rome, A. (1985) : “Clothing Imagery in Apollonius’s Argonautika”, Quaderni Urbinati di Cultura Classican, n° 21, 3, 29-44.
- Scheid, J. et Svenbro J. (1994) : Le métier de Zeus : mythe du tissage et du tissu dans le monde gréco-romain, Paris.
- Schibli, H. (1990) : Pherekydes of Syros, Oxford.
- Schmitt-Pantel, P. (2013) : “La ceinture des Amazones : entre mariage et guerre, une histoire de genre”, in : Gherchanoc & Huet, éd. 2012, 27-38.
- Waltz, P., éd., et Desrousseaux, A.-M., trad. [1938] (2002) : Anthologie grecque. Tome IV : Anthologie palatine, Livre VII, Épigrammes 1-363, Collection des universités de France, Paris.
Notes
- C’est la conception des métaphores que Cicéron formule dans le De Oratore (III.38.155).
- Batten et Olson 2021 ; Cleland et al. 2007 ; Olson 2008 et 2017 ; Robert 2011.
- Gherchanoc et Huet 2007 et 2012 ; Gherchanoc et al. 2008.
- Baroin et Valette-Cagnac 2007 et Baroin 2012.
- Lakoff et Johnson 2003.
- Ricoeur 1975.
- Blumenberg 1960.
- Nous pensons notamment à L. Iribarren, qui a participé au séminaire Himation en octobre 2022 et s’appuie, dans sa monographie consacrée à la technique dans les cosmogonies grecques anciennes, sur le concept de “schème”, en partie analogue à celui de métaphore absolue, pour désigner “un réseau thématique de paradigmes et métaphores rendant intelligible, dans le discours, une totalité à laquelle aucune intuition sensible ne saurait être adéquate” (Iribarren 2018, 23).
- Cette typologie s’appuie sur celles proposées par Scheid et Svenbro 1994 et Fanfani et al. 2016.
- Pherec. de Syros, F. 14, 68 et 73, in : Schibli 1990.
- Hymn. Orph., “Hymne à Zeus foudre” 19, 16-17 trad. modifiée de M.-C. Fayant 2014, 184.
- Jul. Orat. VIII, “À la Mère des dieux”, 5. Trad. modifiée de G. Rochefort 1964, 111.
- Ps.-Dion., Traité astronomique et météorologique II. trad. de A. Kugener, 185-186.
- Ps. 64, 12 sqq.
- Littéralement “signe de tête”. Chez Jacques de Saroug, le terme évoque une personnification de la pensée de Dieu. Il rassemble les capacités créatrices de la divinité : pensée, Parole, puissance.
- Jac. Sar., Hom., 192, 83 sqq., trad. I. Isebaert-Cauuet 2005, 111.
- Hom., Il., III, 125-127, in : Mazon 1937.
- Pind., Nem., IV, 44-46 ; Ol. VI, 85-87, in : Bowra 1961 ; Bacchyl., O. V, 9-10 et Dith. 19, 9-10, in : Irigoin 1993.
- Pind., Nem., VIII, 15 et fr. 169, in : Bowra 1961.
- Anth. gr. V, 276, trad. P. Waltz modifiée, in : Irigoin et Waltz [1929] 2003.
- Ciris, 29-39, in : Fairclough [1918] 2001.
- Ap. Rh., Arg. I.721-768. Sur ce passage, nous renvoyons ici à Shapiro 1980, Rose 1985 et à l’article de Christophe Cusset dans cet ouvrage, p.153-168.
- Ar., Lys., v. 574-586, trad. Van Daele, in : Coulon & Van Daele 1946 [1928], 145-146.
- Plat., Resp., VIII, 555b-562, in : Chambry 1934.
- Comme on le voit dans les représentations du Martyre de Pierre, que ce soit sur les miniatures de manuscrits ou sur les fresques des églises.
- Scheid et Svenbro 1994.
- Cf. Schmitt-Pantel 2013.
- Anth., Pal., V, 200, 217, 285 ; VI, 59 ; 201 ; 202 ; 210 ; 272 ; 276 ; VII, 164, 182.
- Anth., Pal., VII, 164, trad. Desrousseaux, in : Waltz & Desrousseaux [1938] 2002.
- Ov., Met., V., 464-473, in : Lafaye [1925] 2017.
- Macr., Sat., II, 3, 9 : Iocatus, in : Caesarem, qui ita toga praecingebatur ut trahendo laciniam uelut mollis incederet, trad. personnelle, texte de Goldlust 2021.
- Macr., Sat., II, 3, 9.
- Sur cette habitude vestimentaire de César et sa condamnation chez les auteurs à la suite de Cicéron, cf. Baroin 2012.
- Bodiou et al. 2011.
- Quint., Inst., VIII, 155, in : Cousin 1978.
- Za 3, 3-4, trad. modifiée de la Bible d’Alexandrie, 241-242.
- On pourrait aussi mentionner le revêtement post-lapsaire des feuilles de figuiers et des tuniques de peaux, métaphore d’une humanité qui déchoit et entre dans le monde de la matérialité et du devenir.
- Luc., Tim., VI, trad. Chambry 2015.
- Rm, 13, 14.
- Ga, 3, 14.
- Hdt., Hist., I, 8 : ἅμα δὲ κιθῶνι ἐκδυομένῳ συνεκδύεται καὶ τὴν αἰδῶ γυνή, trad. personnelle et texte tiré de Legrand [1932] 2022.
- Eur., Bacch., 384-385, in Diggle 1994.
- Cairns 2013.
- Porph., Antr., 14, 11 : χιτὼν τὸ σῶμα τῇ ψυχῇ ὅ ἠμφίεσται, in : Dorandi 2019.
- Actes de Thomas, “Hymne à la perle”, 76-77, trad. P.-H. Poirier, in : Poirier 2021, 341.
- Tert., De carne VI, 13 : Homo uere futurus usque ad mortem eam carnem oportebat indueret, cuius et mors, trad. J.-P. Mahé in Mahé 2008, 241.
- Philox., De Uno et Sancta Trinitate Incorporato et Passo I, 35, in : Brière et Graffin 1980, 15, 265.
- Cairns 2016, 29-31.
- Voir par exemple, Hes., Theog., 126-127, in : Mazon [1928] 2021, où le Ciel progéniture de la Terre l’enveloppe tout entière.
- Voir par exemple, Plut., Propos de table III.6.4, in : Fuhrmann 1972, 132.
- Hadot 2004.
- Hadot 2004, 78.
- Lactant., Inst., III.1.3, in Buchon 1837.
- Blumenberg 2006 [1960], 58.
- Voir, par exemple, Phil., De vit. cont., 78-79 et Hadot 2004, 62-64. Sur le lien entre le vêtement et le logos chez Philon, nous renvoyons à la contribution d’Anne Boiché dans ce volume, p. 211-224.
- Benard Silvestre, Commentum Bernardi Siluestris super sex libros Eneidos, 3, 11-15, in : Riedel 1924.
- Montaigne, Essais II, 20.