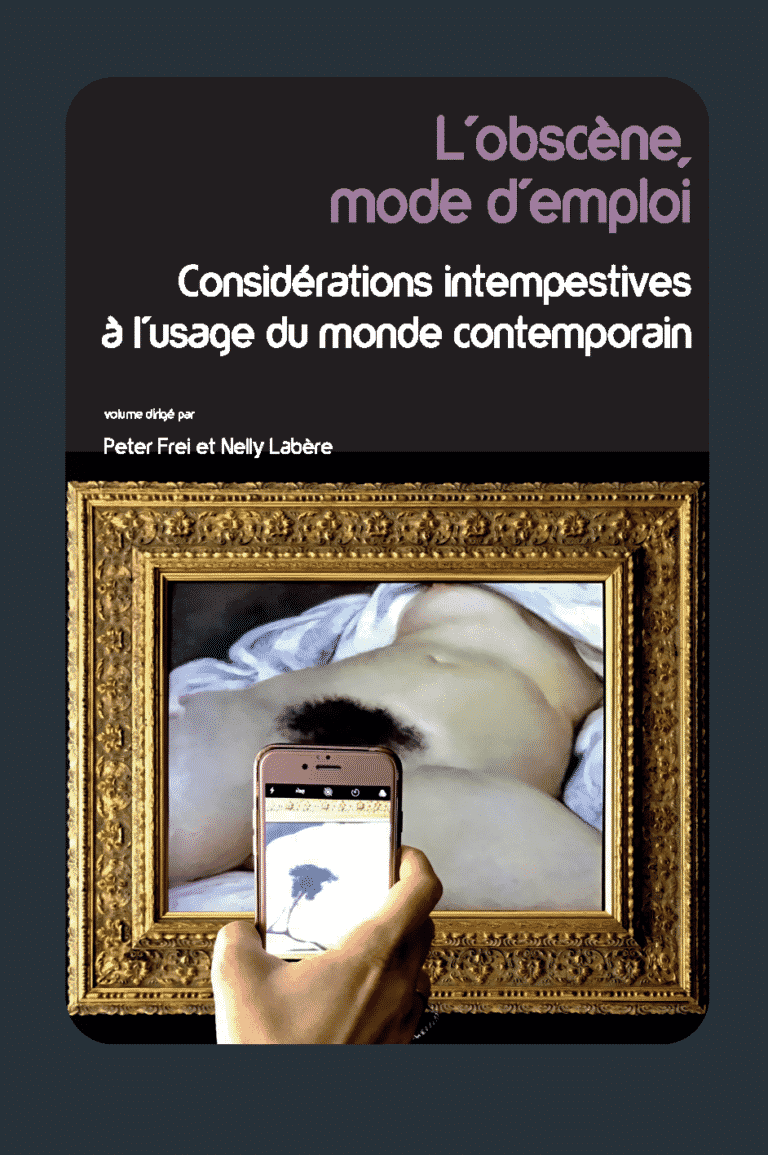L’obscénité1 ne figure plus, en apparence du moins, parmi les préoccupations des censeurs cinématographiques nord-américains contemporains. S’ils apparaissaient en bonne place dans les versions différentes du Production Code qui régulait l’industrie cinématographique aux États-Unis jusque dans les années 1960, le terme « obscène » et ses divers dérivés semblent avoir largement disparu du vocabulaire de l’organisme de régulation cinématographique à partir de 1968. Pourtant, si le mot a disparu, la notion demeure, évoquée sous des formes différentes allant de la périphrase à la litote. Cet article s’intéresse donc au « discours des censeurs » dans le champ cinématographique nord-américain. Il examine plus précisément les modalités et les raisons – notamment l’impasse de sa définition juridique – de cette éviction du terme « obscène » du vocabulaire des censeurs. Cette analyse vise à mettre au jour, entre le Hollywood « classique » et l’industrie contemporaine, la permanence masquée sous l’apparente libéralisation des mœurs et des représentations : une logique de polissage de la rhétorique censorielle, qui tend à éviter de nommer trop nettement ce qu’elle vise à prohiber. Mais aussi une évolution, manifestant que la censure, qui prend d’ailleurs désormais le nom de classification, se doit désormais d’avancer à visage couvert, en adoptant une rhétorique libérale bien différente de la prohibition et de la moralisation explicites qui régnaient aux temps du Code Hays. Le corpus mobilisé sera constitué pour l’essentiel des documents officiels de organismes de censure. Je commencerai par une partie générale visant à mettre en parallèle la période du Code de Production et celle qui a commencé en 1968 avec l’avènement d’un nouveau système. Puis j’examinerai, dans une deuxième partie, plus en détail les occurrences de la notion d’obscénité pendant la période du Code Hays, afin de dégager l’évolution des censeurs et, plus globalement, les connotations de la notion d’obscénité et sa difficile définition. J’en viendrai alors, en troisième partie, à l’analyse de la situation contemporaine dans le détail.
La fin de la censure ? Contexte et évolutions globales
Je vais donc, en premier lieu, dégager de manière générale les points qui relient ou opposent la période du Code de Production et la période contemporaine qui a démarré en 1968.
Comme l’écrit Olivier Caïra2 (15), lors de la première rédaction en 1930, la MPDAA3, l’association privée qui, aux États-Unis, se charge de la régulation des films, « se donne pour mission d’améliorer la condition morale de l’humanité. […] [P]lus qu’un divertissement, le cinéma apparaît comme une activité esthétique et normative ». L’emploi du terme « obscénité » dans le Code Hays doit donc être replacé dans une logique globale reposant sur l’existence d’un système de valeurs, évident et imposé, explicitement affirmé d’emblée, et entrainant de interdictions définitives. Un positionnement qui est également perceptible dans le style adopté, des formules injonctives, dans la référence à des « standards » posés comme allant de soi. Le Code de Production instaure, très explicitement, des hiérarchies et des interdictions. « Le caractère sacré de l’institution du mariage et du foyer sera préservé. Les films ne doivent pas suggérer que les formes les plus basses de relations sexuelles sont acceptées ou fréquentes4 ». Se dégagent ainsi une « bonne » et une « mauvaise » sexualité, posées comme telles indépendamment même des enjeux de représentation. Il en va de même pour ce que les rédacteurs nomment pudiquement les « scènes de passion » : « Les scènes de passion ne doivent pas être amenées lorsqu’elles ne sont pas essentielles à l’intrigue. En général, la passion excessive doit être traitée de telle sorte que ces scènes ne stimulent pas les éléments les plus bas et les plus vils5 ». Si les remarques consacrées à la « nécessité » de certaines scènes dans l’intrigue convoquent des questions d’ordre esthétique, l’accent est mis sur des jugements de valeur (« les plus bas et les plus vils »). Ces derniers (« passion excessive », par exemple) portent, non sur une représentation trop explicite, mais bien sur des comportements ou des émotions. Il s’agit d’interdire et non de réguler la représentation de certaines images ou thématiques. Certaines interdictions, comme de représenter « les organes sexuels des enfants », résonnent avec des inquiétudes contemporaines. D’autres portent la marque des préjugés raciaux ou puritains qui les sous-tendent. Ainsi de l’interdiction de ce que le Code nomme « miscegenation », ou « relations sexuelles entre races », ou de ce que les censeurs appellent la « perversion sexuelle ». Bien qu’elles soient reléguées hors-champ, exclues de la représentation, ces thématiques interdites ne sont pourtant pas qualifiées d’obscènes. Le jugement d’obscénité, qui comporte à la fois une dimension morale et une dimension esthétique, ne saurait en effet porter sur des thématiques interdites sans appel. L’« obscène » qualifie une représentation, et non un comportement ou un sentiment, il implique une réflexion sur le traitement stylistique d’un sujet. L’arrivée de la notion d’obscénité, et de certains termes voisins, sous la plume des rédacteurs du Code Hays, manifeste donc la coexistence de jugements d’ordre moral et de questionnements intégrant les choix de représentation, à travers l’idée de retenue et de bon goût.
La distinction entre l’interdiction absolue – qui rend, je l’ai dit, inopérante la notion d’obscène, puisque la représentation est évacuée – et la tolérance sous conditions, va évoluer progressivement au cours de la Période du Code Hays. En 1961, la préparation de films traitant de sujets jusqu’ici interdits, à savoir l’homosexualité et la « perversion sexuelle » entraine une modification du Code Hays dans le sens d’une indulgence croissante. « Le code Hays, constate O. Caïra, est amendé pour permettre l’évocation des “aberrations sexuelles” tant qu’elles sont “traitées avec circonspection, discrétion et retenue”6 ». Cet amendement du Code ouvre la voie à une logique selon laquelle c’est bien le traitement du sujet et non le sujet lui-même qui le désigne comme devant être interdit. Les enjeux se décalent alors légèrement de la moralité vers l’esthétique, du comportement moral vers l’image acceptable, selon une logique qui annonce les termes du débat contemporains. Notons que les trois conditions exposées par les rédacteurs du Code pour autoriser la représentation de ces sujets sensibles, circonspection, discrétion et retenue, peuvent être, sémantiquement, considérées comme sémantiquement à l’opposé de l’obscénité, qu’ils présupposent donc négativement. Elles indiquent la mesure, là où l’obscène fonctionne par l’excès, et le repli pudique, là où l’obscène suppose l’exhibition spectaculaire. En dépit de ces évolutions, cependant, le Code de Production reste une mécanique morale, visant ouvertement la régulation des mœurs autant que celle des représentations.
Les choses changent, sur le plan du discours, du moins, en 1968, avec le basculement d’un système de censure à un système de de cotations par âges, qui classe les films en quatre catégories, X, R, PG, et G. La catégorie X, la plus restrictive, interdit l’entrée dans les salles aux spectateurs âgés de moins de dix-sept ans. Elle sera rapidement chargée d’une connotation négative, qui subsistera malgré son remplacement, en 1990, par un nouvelle catégorie NC-17, censément moins associée au cinéma pornographique. L’arrivée du système de classification marquait la fin du « film familial », s’adressant à tous, et son remplacement par une segmentation des œuvres en fonction des publics7. Cette évolution concordait avec l’évolution de la Cour Suprême qui allait, à la même époque, établir le principe d’une obscénité variable selon les publics et réduire la sanction légale dirigée contre les œuvres obscènes à leur diffusion à un public mineur. En conséquence de cette évolution, les instances de régulation basculaient donc d’une logique moralisatrice autoritaire reposant sur un jugement de valeur absolu, à une autre logique, plus relativiste : il ne s’agissait plus de juger les œuvres, mais leur adéquation à un certain type de publics. Le souci des bonnes mœurs se voyait remplacé par une logique de protection des mineurs, ou plus précisément, pour reprendre le terme qui allait devenir récurrent dans les communications de la MPAA, de protection des enfants et d’information des parents. Apparue dès la « déclaration de principe du code d’autorégulation de l’industrie cinématographique » en 1968, ce « souci inquiet des enfants », qui ne cessera d’être répété jusqu’à aujourd’hui, fera de ces derniers, et de leurs parents, les prétextes du processus de régulation8.
Les stratégies de communication de la MPAA ont largement visé à présenter cette évolution comme la fin d’une ère puritaine et moralisatrice, et le début d’une époque libérale, en accord avec les évolutions de la société9. Jack Valenti, qui, devenu président de la MPAA deux ans plus tôt, avait présidé à cette transformation, a abondamment insisté sur la « fin de la censure » induite par ce changement, et mis l’accent sur la « liberté » que le nouveau système accordait, tant aux spectateurs qu’aux artistes. Toutefois, dès sa naissance et jusqu’à aujourd’hui, le nouveau système a beaucoup été critiqué, et souvent dénoncé, comme une censure économique, plus insidieuse mais tout aussi contraignante que l’ancien Code.
La réalité se trouve quelque part entre ces deux interprétations. Il est incontestable que la référence à un code moral et la condamnation de comportements et de mœurs, va s’effacer du discours officiel de la MPAA à partir de 1968. La logique ouvertement puritaine et morale a disparu du discours officiel des instances de régulation. Sur ce point également, les instances de régulation suivent le mouvement amorcé par les arrêts de la Cour Suprême10. « Kingsley versus Regent », en 1959, va détacher le jugement sur l’obscénité du jugement sur la moralité (ou plutôt, en l’occurrence, l’amoralité) des œuvres11. La question de savoir si une œuvre est ou non obscène, légalement, ne revient plus à s’interroger sur son degré de moralité. Autrement dit, la Cour ne jugera plus des comportements, mais des représentations. La dissociation ainsi établie sous-tendra tout le discours censoriel de l’industrie à compter de 1968 : toute référence à l’amoralité disparaitra du discours officiel des censeurs, ces derniers se focalisant, j’y reviendrai, sur des éléments liés à la forme et au degré d’explicitation.
Le document rédigé en 1968, lors de l’arrivée du système de cotation, en appelle certes aux « mœurs, à la culture et au sens moral de notre société12 », mais le ton employé y est nettement moins assertif que celui du Code, et surtout, l’idée centrale est celle de l’adaptation à une société qui change. Lorsque les rédacteurs écrivent que « l’artiste doit demeurer responsable et sensible aux standards de la société qui l’entoure13 », l’évidence morale qui imprégnait le code de censure est remplacée par une perspective plus modestement relativiste, invitant les artistes à « respecter les standards » pour éviter d’offenser le public – il ne s’agit plus d’injonctions assénées depuis une position surplombante, mais du souci, plus pragmatique, d’éviter de heurter de sensibilités. D’une discrimination entre « bonnes « et « mauvaises » représentations on évolue vers une opposition entre représentations « offensantes » pour certains spectateurs et les autres. L’anticipation de l’effet produit sur certains spectateurs se substitue au jugement de valeur.
Les termes qui pourraient évoquer, même implicitement, un jugement moral et la présence d’un système de valeurs affirmé de manière autoritaire et absolue vont ainsi disparaître du discours officiel de la MPAA après 1968. On ne trouve plus, par exemple, de référence à une « bonne » ou une « mauvaise » sexualité. On peut, en ce sens, considérer que d’un certain point de vue 1968 marque la fin du « puritanisme » dans sa version la plus manifeste et restrictive. La condamnation de la sexualité hors mariage disparaît, le rejet de certaines sexualités se fait moins frontal. Le terme de « perversion » se voit, par exemple, alors remplacé par celui d’« aberration » : le nouveau document exige « de la retenue et de l’attention pour les présentations qui traitent d’aberrations sexuelles14. » La formulation que je viens de citer manifeste les hésitations de ce nouveau système. D’un côté, une plus grande indulgence puisqu’il ne s’agit plus d’« interdire » mais d’exiger de la « retenue et de la délicatesse » pour certaines représentations, ainsi que la suppression du terme « perversion » pour désigner, par exemple, l’homosexualité ou certaines pratiques. De l’autre, une logique qui reste axiologique par la désignation d’« aberrations sexuelles », dont le contenu est laissé aussi vague et indéterminé que possible, et qui, s’il est moins marqueur de jugement moral que le terme de « perversion », continue de se référer à une norme implicite. Le terme de « pervers » ne sera plus, comme on le verra plus loin, utilisé dans les commentaires que dans certains cas extrêmes et cessera de fonctionner comme la périphrase effarouchée désignant l’homosexualité ; celui d’« aberrant », de même, n’apparaitra plus que pour désigner certains cas extrêmes
En outre, là où, comme je l’exposerai plus précisément en deuxième partie, le Code Hays oscillait entre l’énoncé de principes généraux et l’énumération détaillée de thématiques interdites, le nouveau système de classification ne fonctionne plus selon une liste de sujets interdits ou même sensibles. La MPAA se garde bien d’énoncer une liste de thématiques taboues ou interdites en soi, choisissant de ne faire porter ses « conseils » que sur le degré d’explicite de la représentation concernée. En d’autres termes, ce ne sont plus des comportements, que l’on juge, mais les représentations. Enfin, les termes axiologiques (bon/mauvais ; veul/noble, etc) vont se voir remplacés par des termes relevant, autant que possible, du descriptif, et modulés par des adjectifs d’ordre quantitatif (fort/faible), etc. La termes supposant un jugement de valeur directement exposé vont devenir rares.
L’effacement apparent de toute dimension de jugement moral explique la disparition du terme d’obscénité et de ses dérivés, remplacé dans le discours de la MPAA, par des variantes ou euphémismes que j’examinerai plus loin. En cessant d’utiliser le terme « obscénité » et les dérivés de ce dernier, les instances de régulation ont évité les difficultés auxquelles les juges de la Cour Suprême ont dû faire face. Dans la seconde moitié du vingtième siècle, les juges vont tenter de définir, pour la sanctionner, la notion d’obscénité d’une manière suffisamment objective pour la rendre universalisable, et suffisamment précise pour la rendre applicable. La prudente éviction du terme du discours de la MPAA me semble manifester à quel point le terme d’obscénité est difficile à séparer d’une dimension morale et moralisante, d’une condamnation au sein d’un système de valeur. Dans l’optique générale de l’organisation, donner le sentiment d’une neutralité descriptive reposant sur des constats objectifs et des analyses d’ordre quantitatif, le recours au terme « obscène », chargé de connotations axiologiques négatives et encore imprégné d’une dimension morale, aurait été dissonant.
J’ai essayé de dégager les grandes évolutions et différences entre la période de la censure et celle de la classification, afin de poser les contextes différents dans lesquels la notion d’obscénité apparaît, se définit puis disparaît du discours des instances de régulation cinématographique. Une fois retracées généralement les grandes lignes qui opposent ou unissent les approches « classiques » et contemporaines, je vais me recentrer sur la notion d’obscénité en étudiant séparément, de façon chronologique, la période du Code Hays et celle du système des cotations, la nôtre.
Évaluer et proscrire : les ambivalences du Code Hays
Quelle place l’obscénité occupe-t-elle dans l’arsenal censoriel du Code Hays (1930-1968), et quel territoire les rédacteurs du Code assignent-ils à cette notion complexe ? Je vais ici m’attacher à analyser et contextualiser plus spécifiquement les occurrences du terme dans les différentes versions du Code de Production. Un détour historique qui me permettra d’en délimiter plus nettement les connotations, à défaut d’en proposer une définition.
Le terme d’obscénité n’apparaît pas immédiatement dans les documents qui annoncent le Code Hays, et il ne sera, par la suite, utilisé qu’avec parcimonie par les censeurs, d’une manière qui, en outre laisse toujours extrêmement floue sa définition exacte. Deux textes ont précédé la rédaction du Code : la liste de 13 points, adoptée en 1921 énumérant les sujets inacceptables, et le document intitulé « Don’ts and be Carefuls », qui différencie les sujets interdits et ceux qu’il convient de traiter avec tact. D’autres termes qu’obscénité sont employés dans les « 13 points » pour délimiter les représentations autorisées de la sexualité : on y interdit les films qui « traitent du sexe de manière impropre », « la nudité », les « scènes d’amour prolongées et passionnées », « les intertitres ou la publicité salace », ou encore « les films montrant l’attraction sexuelle de manière suggestive ou incorrecte15. Dans les Don’ts and be Carefuls » de 1927, pas plus de mention d’obscénité, mais l’interdiction de « toute forme de nudité licencieuse ou suggestive », « toute référence à la perversion sexuelle », ainsi que « les relations sexuelles entre les races blanches et noires ».
On trouve, dans ces termes destinés à qualifier les représentations interdites ou périlleuses, des traits qui peuvent annoncer l’obscénité : le sème de l’excès (« prolongées »/ « passionnées » ), et celui de la « suggestion », qui évoque le caractère visuellement évocateur des représentations obscènes. Mais l’absence du terme « obscène » dans ces documents peut s’expliquer par le peu d’intérêt des rédacteurs pour la réception des œuvres. Comme l’ont analysé Jean-Loup Bourget et O. Caïra16, les premiers auteurs des documents censoriels sont soucieux d’établir une énumération factuelle et détaillée d’éléments interdits dans les œuvres. Une logique de « contrôle des contenus » binaire, qui limite au maximum la marge d’interprétation du censeur, la tâche de ce dernier consistant à cocher, et le cas échéant supprimer, les « ingrédients » interdits. Les premiers textes privilégient une approche binaire, permettant, sans tergiverser, par exemple, de sanctionner immédiatement la présence de « nudité » sans avoir à s’interroger sur sa fonction dans l’œuvre. À l’inverse, l’apparition de la notion d’obscénité présuppose, on le verra, la prise en compte d’une intention (du côté de l’auteur) et d’un effet produit (du côté du spectateur). Elle implique, en outre, de faire porter son attention non seulement sur les « ingrédients » du film évalué, mais sur la manière dont ces derniers sont utilisés, donc sur le traitement des thématiques. Autrement dit, la notion d’obscénité ne pourra apparaître qu’une fois intégrées des réflexions sur les représentations.
C’est donc dans la première mouture du Code Hays, en 1930, qu’apparaît la notion pour la première fois. Comme d’ailleurs des termes voisins, « indécent », « salace », ou « licencieux » par exemple, la notion semble, pour les rédacteurs du Code, relever de l’évidence et n’est accompagnée d’aucune définition. On pourrait dire que, plusieurs décennies avant la célèbre déclaration du Juge Brennan (« Je la reconnais quand je la vois »), les rédacteurs du Code utilisent la notion d’obscénité, et les termes adjacents, comme une évidence, implicite et autosuffisante. Une description trop précise viendrait rappeler mal à propos le fait que les censeurs s’exposent nécessairement à ces représentations qu’ils évaluent pour d’autres, et rajouter un degré de commentaire scabreux à la représentation évaluée. D’autre part, détailler les raisons de la censure ou de la classification peut conduire à souligner, paradoxalement, la part de subjectivité, donc de faillibilité, qui y rentre, les rend potentiellement contestables, ouvrant, potentiellement, le champ à la critique et à la contestation. D’autre part, un énoncé détaillé prête le flanc aux accusations et aux remises en cause. J’ai évoqué plus haut la concurrence, dégagée par O. Caïra et Jean-Loup Bourget, entre une logique de « contrôle des contenus », fonctionnant selon un système de listes d’interdictions détaillées. Cette logique prévaut dans la patrie du Code intitulée « applications particulières ». L’autre, qu’Olivier Caïra nomme « contrôle de la réception » et qui apparaît dans la partie du Code intitulée « Principes généraux », autorise davantage de vague dans la formulation, tout en laissant plus de marge de manœuvre et d’évaluation au censeur. Elle implique la prise en compte du traitement de tel ou tel sujet, et incite à un questionnement sur la réception. C’est en lien avec cette seconde logique, celle du contrôle de la réception, que la notion d’obscénité va prendre sens.
La complexité de son maniement et l’incertitude de son champ d’application dans l’esprit des rédacteurs du Code est d’abord, dans les différentes versions du Code jusqu’à 1958, révélée par la présence du terme à plusieurs niveaux. En effet, l’obscénité est à la fois une catégorie surplombante, et mentionnée au passage à l’intérieur d’autres catégories. Ce flottement taxonomique révèle les difficultés que rencontrent les rédacteurs du Code pour délimiter le territoire de l’obscénité. Les catégories parmi lesquelles apparaît l’obscénité sont les suivantes : I crimes contre la loi ; II Sexe ; III vulgarité, IV, obscénité, V grossièreté, VI, costume, VII danse, VIII religion, IX décors, X sentiments nationaux, XI intertitres, XII sujets repoussants). Et c’est à l’intérieur des catégorie « intertitres17 » costumes, et danses, que le terme apparaît.
Avant d’analyser ces occurrences explicites du terme, il est intéressant de confronter la notion d’obscénité aux termes, ou presque synonymes, employés dans le Code.
Relevons, d’abord, les termes qui se rapportent à la sexualité ou au désir sexuel : « dans la catégorie « sex », on trouve « lustful », dans la catégorie « costume », « lecherous », « licentious » et « salacious », « salace » est employé pour évoquer les intertitres, les photographies et les éléments publicitaires interdits18. Ces termes, qui impliquent une condamnation immédiate des représentations, sont souvent associés à l’idée d’excès ou à la gratuité. On voit que se combinent deux dimensions : l’une, morale, qui conteste la présence même de la sexualité, l’autre, esthétique, qui valorise la mesure et la nécessité dramatiques.
Parmi ces dernières, on peut commencer par la catégorie « sex », en premier lieu, puisqu’il peut sembler surprenant que les rédacteurs du Code n’aient pas fait de l’obscénité une sous-catégorie de cette dernière. La notion d’obscénité n’apparaît pas explicitement dans les développements autour de la catégorie « sexe ». Ceci s’explique partiellement par le fait que beaucoup des interdictions ou injonctions énoncées dans cette catégorie concernent des comportements ou des mœurs, et non des représentations, qui, comme le souligne Jean-Loup Bourget, offrent un « reflet fidèle, […] non seulement des principes, mais aussi des préjugés moraux, sexistes, racistes […] d’une société19 ». Parmi elles, le respect de l’institution du mariage, le rejet de l’adultère, la condamnation de la « perversion », et, jusqu’aux années 1950, l’interdiction de représenter les relations sexuelles entre Blancs et Noirs, l’allusion à l’hygiène sexuelle et aux maladies vénériennes, à la traite des blanches, les accouchements, et la vision des organes génitaux des enfants, plus tard, l’interdiction de représenter un avortement… Autant de sujets interdits sans appel, avant même tout enjeu visuel ou de mise en scène. C’est donc pour les sujets autorisés sous conditions, lorsque les censeurs se préoccupent de traitement, que l’on croise des enjeux qui évoquent, par antithèse, les connotations associées à l’obscénité. En premier lieu, la gratuité, par contraste avec ce que les censeurs appellent « nécessité », à propos des « scènes de passion », dont il est dit qu’elles « ne devraient pas être introduites lorsqu’elles ne sont pas essentielles à l’intrigue20 ». Vient ensuite la notion d’excès, lorsque le Code indique que « les baisers excessifs et luxurieux, les étreintes luxurieuses, les postures et les gestes suggestifs, ne doivent pas être représentés21. » Le terme « suggestif » annonce, j’y reviendrai, la notion paradoxale d’une obscénité « suggérée » seulement, le trait à retenir ici n’étant alors plus l’excès ou l’explicitation, ni la frontalité, mais bien la capacité d’une image ou d’un mot à faire surgir une vision lubrique dans l’esprit du spectateur. L’obscénité est en effet, de manière paradoxale, à la fois caractérisée en-deçà et au-delà du sexe. Au-delà, parce qu’elle suppose un excès au niveau de la représentation, un explicite excessif qui, pour cette raison-même, doit être sanctionné ou atténué. Mais aussi en-deçà du sexe, puisqu’à travers elle, sont majoritairement mentionnés des représentations ou des comportements qui évoquent le sexe plus qu’ils ne le représentent. C’est ce qui explique que les censeurs aient pu avoir évoqué l’expression, apparemment paradoxale, d’« obscénité suggérée ».
C’est bien l’obscénité qui est convoquée négativement dès lors que les documents censoriels préconisent, sous de termes divers, l’emploi de la retenue et de l’allusion. Ainsi, dès les premières versions du Code, on peut lire : « séduction ou viol. A. Ils ne devraient jamais être que suggérés, et ce, uniquement lorsqu’ils sont essentiels à l’intrigue. Ils ne doivent jamais être montrés par une méthode explicite22 ». Une logique que l’on retrouvera dans la version révisée de 1968, qui préconise l’exercice de « la retenue et du tact pour les présentations liées aux aberrations sexuelles23 ». Enfin, c’est la présence d’une intention et d’un effet qui évoque la notion d’obscénité : dès les premières versions du Code, on peut lire : « En général, la passion devrait être traitée de manière à ne pas stimuler les émotions les plus basses et les plus viles24. ».
Autre catégorie voisine de l’obscénité, après « sex », celle de la « vulgarité », qui néanmoins, sous la plume des censeurs, semble désigner les références au corps qui sont dissociées de la sexualité. La relative indulgence des censeurs du Code annonce l’indulgence contemporaine à l’égard de la comédie scatologique. Les rédacteurs établissent toutefois à cette occasion une différence entre les « sujets bas, dégoûtants, déplaisants » et les « sujets mauvais » qui rappelle, là encore, que la bonne représentation est celle qui qui respecte les limites du « bon goût » déterminées par les censeurs25. On retrouve ici une notion esthétique, mais, à la différence de ce qui se produit ailleurs (pour la sexualité, l’indécence, etc), elle n’a pas, dans ce cas précis, partie liée avec la morale.
Vient ensuite, catégorie également proche de l’obscénité, la catégorie « profanity », qu’on peut traduire par grossièreté ou… obscénité, mais entendues sur le plan verbal. Parmi les termes interdits dans la version du Code de 1949, on trouve plus particulièrement (mais pas seulement) ceux qui ont trait à la sexualité, ou des dénominations dénigrantes caractérisant les individus ciblés sous l’angle de la sexualité : citons, par exemple, « coureuse, vioque, nana, grue, cocotte, fesses, tantouze (au sens vulgaire), chaude (appliqué à une femme), Madam (au sens de maquerelle) ; salope ; plaisanteries sur les commis voyageurs et les filles de fermiers ; putain26 », etc. La différence entre ces « grossièretés » interdites qui figurent dans la catégorie « profanity » et l’interdiction, dans le Code, des termes dits « obscènes », semble être que le caractère dénigrant l’emporte sur la dimension d’évocation sexuelle.
Autre terme qui constitue un point de comparaison intéressant avec l’obscénité, la nudité. La distinction entre nudité « artistique » et usage obscène ou indécent du corps dénudé traverse l’histoire des arts bien en amont de ma période d’étude. Là où la nudité, du point de vue des censeurs, reste un critère facile à déterminer, donc à censurer si besoin, l’obscénité comporte, pour être établie, une part d’interprétation où entre en jeu l’évaluation de l’intention (côté producteur) et de la réaction (côté récepteur/spectateur). Toutefois, dès les premiers documents préludant au Code de Production, ce sont certains types de nudité qui sont interdits : dans les « Dont’s and Be carefuls » de 1927, les censeurs interdisent « la nudité licencieuse ou suggestive – réelle ou suggérée par des effets de lumière27 », mais aussi les allusions « lubriques ou licencieuses faites par les personnages à propos de la nudité28 ». Le fait de qualifier la nudité (« licencieuse, suggestive ») éloigne un peu la notion de sa neutralité objective et annonce les atténuations de son interdiction ; en outre, le terme de « suggestif » porte là aussi une connotation d’intentionnalité qui annonce des connotations associées, plus tard, à l’obscénité. Il s’agit non seulement des images mais les mots qui risqueraient de les faire surgir dans l’esprit des spectateurs.
Le Code de 1930 traite de la nudité29 à l’intérieur de la catégorie dédiée aux « costumes » et interdit catégoriquement la représentation du corps humain dénudé : « La nudité complète n’est jamais autorisée. Cela inclut la nudité présentée directement ou à contre-jour, et toute allusion, lubrique ou licencieuse, qui en serait faite par d’autres personnages dans le film30 ». Là encore, ce n’est pas seulement la vision de la nudité, offerte explicitement aux spectateurs, mais sa suggestion, qui est interdite par les censeurs, une rigueur qui manifeste la volonté, et analysée dans les travaux de Lea Jacobs consacrés au Code31, de prendre en compte non seulement les images mais l’empreinte qu’elles laissent dans l’imaginaire des spectateurs.
Le Code va assouplir quelque peu ses exigences concernant la nudité en 1939, pour le cas précis des documentaires ethnographiques, une évolution qui permet, là encore, de mieux comprendre quelle nudité est considérée comme périlleuse et donc, par ricochet, de délimiter les contours de l’obscénité. La nudité devient en effet alors tolérée pour
les scènes authentiquement filmées dans un pays étranger, montrant les indigènes […] si ce genre de scènes fait partie nécessaire et intégrale d’un film qui se contente de dépeindre exclusivement ce pays et cette vie indigène, à condition qu’aucune de ces scènes ne soit intrinsèquement répréhensible ni ne fasse partie d’un film produit par un studio ; et à condition, en outre, qu’aucun accent ne soit mis, dans aucune scène, sur les coutumes ou les accoutrements de ces indigènes, ou sur l’exploitation de ces derniers32.
Les critères qui rendent la nudité acceptable sont l’absence de mise en scène, la nudité devant être un « donné » et non une construction produite ad hoc pour l’enregistrement, et, d’autre part, l’absence d’emphase. On voit ici se dégager deux notions repoussoirs : l’exhibition intentionnelle et l’accentuation. En dépit de la neutralité impersonnelle de la formulation (« qu’aucun accent ne soit mis »), c’est bien le couple « exhibé – voyeur » qui est convoqué entre les lignes. La nudité interdite est celle qui est mise en scène volontairement, ou bien mise en avant et « exploitée33 » dans le but de faire effet sur les spectateurs. Cet amendement de 1939 marque le glissement d’une évaluation reposant sur un constat objectif binaire (nu/pas nu) à une logique plus subtilement interprétative.
Occasionnellement, l’intérêt pour l’effet produit peut même conduire les censeurs à rejeter des représentations allusives avec plus de vigueur que les représentations frontales, comme étant plus efficaces. Ainsi, même pour un paramètre aussi simplement constatable que la nudité, rentrent en compte l’intention et l’effet produit. La focalisation sur l’effet produit apparaît nettement dans la partie du Code intitulée « raisons des applications particulières qui Code stipule que :
« l’effet du corps nu ou demi-nu sur l’individu normal doit être pris en considération. La nudité ou semi-nudité qui n’est utilisée que pour ajouter un “frisson” au film rentre dans la catégorie des actions immorales. Elle est immorale dans son effet sur le public moyen. La nudité ne peut jamais être autorisée sous prétexte qu’elle serait nécessaire à l’intrigue. La semi nudité ne doit pas donner lieu à des exhibitions indues ou indécentes. Les tissus transparents ou translucides sont souvent plus suggestifs que l’exposition réelle34.
Plus que par la nudité, les censeurs sont d’emblée préoccupés par « l’exposition du corps humain ». Ainsi, dès le Code de 1930, on peut lire, sous l’entrée « costumes », « Les costumes destinés à permettre l’exposition indue ou les mouvements indécents pendant la danse sont interdits35 ». Le Code de 1934 déconseille les subtilités des scènes de déshabillage36, et la méfiance subsiste dans le premier document après 1968 où on peut lire : « L’exposition indécente ou indue du corps humain ne sera pas présentée » ; et ces recommandations survivent dans le document du nouveau système de cotation, en 1968, qui affirme : « L’exposition indécente ou indue du corps humain ne sera pas présentée37 ». La régulation de la nudité montre bien l’impossibilité d’un jugement binaire, dépourvu de toute considération subjective ancrée dans un code moral. De l’observation de la nudité, on glisse progressivement aux notions d’« exposition indue », puis, de là, à celle d’indécence et, enfin, à celle d’obscénité.
Et c’est bien la comparaison entre les notions voisines d’« indécence » et d’obscénité, qui me permettra d’achever ce tour d’horizon du vocabulaire des censeurs du Code Hays. C’est à l’intérieur de la catégorie consacrée à la danse qu’on trouve les deux termes juxtaposés. Le Code stipule que « les danses suggérant ou représentant des actions sexuelles ou une passion indécente38 », puis que « Les danses qui accentuent des mouvements indécents doivent être considérées comme obscènes39 ». Notons que les définitions respectives des deux termes par le Littré manifestent une proximité sémantique forte (indécent : « Qui manque de pudeur » ; obscène : « qui blesse ouvertement la pudeur ») différenciée par l’idée d’intentionnalité, voire de frontalité. Le Code condamne à la fois les « mouvements indécents » et les danses qui les « accentuent » ; l’« indécence » des mouvements et des danses est présentée comme une donnée objective, observable et identifiable, avant même l’intervention d’un jugement. Sous la maladresse de la formulation pointe une méfiance évidente envers ce qu’on pourrait appeler un dispositif spectaculaire, une situation d’exhibition et d’amplification. L’obscénité, en revanche, apparaît à la suite d’un acte d’évaluation (« doivent être considérées comme ») : le censeur admet ici implicitement, par l’usage d’une modalisation que l’obscénité réside dans l’œil de l’observateur.
Des quelques occurrences où elle est employée dans le Code comme de la comparaison avec d’autres termes voisins, il apparaît que l’obscénité est porteuse de significations contradictoires : elle est à la fois associée à l’idée d’excès, du « trop » montrer, les critiques dirigées contre elles allant alors dans le sens d’une défense esthétique de la litote et d’un style classique gommant tout ce qui n’est pas absolument nécessaire. C’est aussi par ce biais que l’obscénité est associée, de manière dénigrante, à l’idée de spectacle, de mise en scène, de performance, entendus au sens négatif d’« exhibition ». Mais elle est aussi parfois, étrangement, assortie de l’idée de « suggérer », qui implique au contraire qu’elle n’est pas « frontale ». Dans ce cas-là, il semble que le trait sémantique à retenir soit la manière dont la représentation, ou les paroles ou intertitres, jugés « obscènes », tendent à faire surgir dans l’esprit du spectateur des visions particulièrement évocatrices. Enfin, le dernier trait à retenir, d’ailleurs cohérent avec l’idée de « spectacle » évoquée plus haut, semble être celui d’une intention immorale de la part de l’auteur du spectacle. L’inexorable subjectivité attachée au jugement d’obscénité le rend contestable, raison qui explique sa disparition dans les textes contemporains de la MPAA, et son remplacement par des périphrases plus apparemment neutres.
La fin de l’obscénité ? Du déni au déplacement, stratégies discursives contemporaines
Le passage du système du Code au système de cotations en 1968 a, je l’ai dit, été accompagné par un changement radical du ton des instances de régulation, passées d’une tonalité rigoriste et moralisatrice à une rhétorique de la libération, modulée seulement par des « inquiétudes » pour les enfants. La MPAA a donc infléchi son discours pour s’abriter derrière la figure, sans cesse convoquée, des « valeurs familiales » et du « parent américain ». Il reste des allusions à l’obscénité dans la version du Code de 1968, qu’on peut considérer comme des scories de l’ère précédente ou manifestations d’une logique en transition. Ensuite, deux facteurs vont conduire les instances de classification nord-américaines à éviter d’employer le terme d’obscène. D’une part, les mésaventures de la notion sur le plan juridique, débouchant sur des tentatives succès pour trouver une alternative au principe de « l’intime conviction », permettant de définir nettement la notion d’obscénité. D’autre part, le fait que la MPAA se soit présenté comme aussi éloigné que possible de l’ancien ton moralisateur du Code de Production, choisissant de mettre en avant, au contraire, la neutralité de ses classifications, fondées sur des constats objectifs, des données quantifiables, et non sur des jugements de valeur. Toutefois l’organisme a continué à jouer un rôle de régulation dans la continuité du Code Hays, notamment par le biais de classements économiquement punitifs pour les films concernés. La désignation de certaines représentations de la sexualité comme de « mauvais objets », condamnables sur les plans à la fois esthétique et éthique, s’est poursuivie, mais sous d’autres formes. Ainsi s’est mis en place un mécanisme contradictoire, consistant à réguler tout en niant l’activité de jugement qui préside à cette activité.
En ce sens, le rapport de la MPAA à l’obscène peut se résumer par deux termes, qu’on empruntera à la psychanalyse : déni et déplacement. La seule occurrence du terme dans les documents récents des instances de régulation se trouve sous la forme négative : « Un film classé NC-17 est un film que, aux yeux du Bureau de Classification, la plupart des parents considéreraient comme trop adultes pour leurs enfants de 17 ans et moins. Aucun enfant n’y sera admis. NC-17 ne signifie pas «obscène» ou «pornographique» au sens commun ou légal de ces mots, et ne devrait en aucune façon être interprété comme un jugement négatif40 ». La dénégation opérée par la MPAA est révélatrice : dans les faits, le classement « NC-17 », le plus restrictif et celui qui a les plus lourdes conséquences économiques pour un film, a dans l’esprit de beaucoup d’Américains pris une connotation négative qui rappelle directement celles de l’obscénité. Notons, par ailleurs, que la juxtaposition des termes « obscène » et « pornographique » révèle ici un autre glissement, accompli notamment par le biais des décisions légales au sujet de l’obscénité : la restriction du champ de l’obscénité au seul domaine des représentations explicites, ou hardcore41.
Après 1968, la réticence des censeurs à nommer trop précisément leurs critères de jugement et à lister les images obscènes a augmenté. Toutefois la MPAA a été sommé de justifier ses interdictions, et c’est ainsi qu’à partir des années 1990, des commentaires ont accompagné le classement des œuvres
La liste des critères présidant au classement des films par catégorie de publics manifeste la validation par les instances du principe de l’obscénité variable selon les publics. Loin de la prolifération du Code de Production, les descriptifs accompagnant l’énoncé des catégories s’en tiennent à quelques termes simples et limitent au maximum la description des contenus interdits : « thèmes matures, […], nudité, sensualité, représentations d’activités sexuelle, activités adultes (c’est à dire, activités,que les adultes, mais non les mineurs, peuvent entreprendre en toute légalité42 »). À l’exception de la mention de la sexualité, les descriptifs obéissent à une logique tautologique qu’on pourrait résumer ainsi : sont interdits aux mineurs les thèmes qui ne conviennent pas aux adultes. On peut d’ailleurs relever que, si les rédacteurs du document reprennent la distinction opposant « nudité » et « nudité sexualisée » que l’on trouvait dans le Code, ils interdisent, dans dérogation possible, toute représentation de la nudité, quelle qu’elle soit, pour les œuvres classées « G » destinées à un public « général ». La distinction est opérée à l’occasion de la définition de la catégorie R « Un film classé R peut comporter des thèmes adultes, des activités adultes, du langage grossier, de la violence intense ou prolongée, de la nudité sexuellement orientée, de la consommation de drogue43… ». La catégorie la plus généraliste (« G »), consistant donc en l’équivalent actuel du « film pour tous », ou « film familial », rejoint les versions les plus rigoureuses du Code de Production, puisqu’elle interdit non seulement les « scènes de sexe » mais aussi la nudité : « Classé-G : pas de nudité, de scènes de sexe, ni de consommation de drogues44 ».
Les termes utilisés par la MPAA pour décrire les thèmes prohibés, notamment ceux qui concernent la sexualité, sont donc remarquablement restreints et uniformément dépourvus de toute connotation de valeur : on ne trouve plus d’adjectifs du type « salace », « licencieux », « luxurieux », etc. Ils consistent, soit en modulations autour de la sexualité, avec des différences de degré (fort/faible) ou de durée (bref/prolongé), soit en termes évoquant l’âge des spectateurs : « mature », « adult », sans plus de précisions. On trouve ainsi
sexualité ; contenu sexuel ; sensualité ; nudité ; sous-entendu sexuel ; forte sexualité ; sexualité et nudité ; brève nudité : brève sexualité ; fort contenu sexuel ; sexualité légère ; sous-entendu ; sexe et nudité ; sexe et nudité forts ; nudité partielle ; contenu, sexuel, brève nudité partielle, contenu sexuel cru, brève sensualité ; brève sensualité/nudité.45
On voit que la MPAA s’attache à demeurer aussi descriptive que possible et fait disparaître des commentaires accompagnant ses classements toute dimension axiologique. Tout au plus peut-on noter des différences de degré, et des termes qui rappellent l’esthétique de la litote chère au Code, mais aussi la méfiance face à la suggestion de sexualité « sous-entendu sexuel ». Le seul terme comportant une très légère connotation évaluative est « cru » (« crude sexuality »), qui rappelle la méfiance de la MPAA envers toute représentation trop directe.
Il serait inexact d’affirmer que les descriptifs de la MPAA ne comportent aucun terme à caractère axiologique. Il arrive, par exemple, que certaines représentations de la sexualité soient qualifiées de « perverses », mais le terme ne s’applique qu’à des cas plus spécifiques et particuliers qu’aux temps du Code – on peut citer, par exemple, les commentaires accompagnant Le Déshonneur d’Elisabeth Campbell46, qui porte comme mention, pour la version R, « graphic images relating to sexual violence including a strong rape scene, some perverse sexuality, nudity and language », la version classée R de 8 mm de Schumacher (« strong perverse sexuality and violence ») tout comme le thriller érotique Mercy (2000) (perverse sexual behavior », entre autres) – sans oublier le cas de Pink Flamingos, de John Waters, qui, sorti, dans les années 1970, fut reclassé NC-17 pour ce que la CARA qualifia pudiquement, sans l’expliciter davantage, de « wide range of perversions in explicit détail », ou, l’un des commentaires les plus détaillés fournis par l’institution, « strong, explicit, sado-masochistic sexuality » pour Tokyo Decadence. Outre « pervers », le terme « aberrant » est parfois employé pour désigner certaines sexualités, allant du sado-masochisme à des pratiques plus singulières. Ont ainsi été considérées comme « aberrantes », des œuvres comme Ma Mère, de Christophe Honoré, (2005), qu’il s’agisse de sa version NC-17 ou de la version coupée et classée R pour une sortie vidéo ; la version NC-17 de Matador, de Pedro Almodovar, sorti en 1983 mais reclassé NC-17, aussi en 2005 (« aberrant sexuality including violence ») , pour la version R de Crash, de David Cronenberg, en 1996,(« aberrant sexual content »). Les dialogues sont aussi concernés, dans Bent, de Sean Mathias, en 1997, par exemple, (« aberrant sexual dialogue »). Toutefois ne sont pas ces termes ouvertement négatifs qui valent aux œuvres les classements les plus restrictifs, mais des expressions plus neutres.
Pour trouver les termes qui sont venus « remplacer » le terme manquant d’obscénité, il faut donc regarder du côté des termes descriptifs, liés au champ du visuel, en particulier les deux adjectifs qui valent systématiquement aux films concernés un classement restrictif : « graphic » et « explicit ». Si, comme je l’ai exposé en deuxième partie, le terme « obscène » était ouvertement une condamnation morale et portait implicitement l’idée d’une dimension visuelle excessive, les termes employés par la MPAA, à l’inverse semblent ne porter que sur la dimension visuelle, mais se sont chargés implicitement d’une connotation négative. Le terme qui a le plus évidemment remplacé « obscène » est « graphic », et peut se traduire par « visible » ou appuyé. Son emploi manifeste le processus de glissement d’un terme qui condamne et juge (« obscène ») à un terme qui semble uniquement neutre et descriptif, tout en conduisant automatiquement à un classement restrictif, ce qui montre bien que l’apparente neutralité dissimule un jugement. L’adjectif « graphic » a des points communs avec « obscène » : il indique, lui aussi, un « visuel » qui aurait dépassé une certaine limite et peut, en outre, connoter l’idée d’une exhibition coupable : le « graphic », comme l’obscène, est ce qui excède la limite du visible, ce qui frappe parce qu’on en montre trop, que l’on dépasse les limites de l’information, du nécessaire, et bien sûr du bon goût. Il peut aussi, d’ailleurs, comme l’obscène avant lui, qualifier le verbal lorsqu’il fait surgir des images dans l’esprit du spectateur. Il en va de même du terme « explicit », qui, associé à la sexualité, vaut inévitablement aux films un classement NC-17 (un exemple parmi d’autres : La vie d’Adèle47, classé, en 2013, NC-17 pour « contenu sexuel explicite »).
À la différence du terme obscène, « graphic » et « explicit » peuvent, au premier abord, connoter, plutôt qu’une lubricité voluptueuse, une certaine froideur clinique, voire (tant pour le gore que pour le sexuel) physiologique. Une évolution qui reflète aussi une évolution des représentations qu’il s’agit de censurer, et de celles devenues acceptables. Interdites ou considérées avec suspicion, les représentations sexuelles montrant sans fioritures, de manière précise et « réaliste », l’acte sexuel Ainsi, bien entendu, que le cinéma pornographique, qu’on a souvent défini, après les analyses de Linda Williams48, comme une esthétique de l’hypervisibilité qui, sans pouvoir prétendre au « réalisme », se rapproche en revanche souvent du physiologique par son appétence pour les plans très rapprochés des parties intimes. C’est bien entre ou contre ces deux styles que se construit l’acceptable dans le champ de la représentation de la sexualité contemporaine aux États-Unis49. Aucune de ces deux esthétiques n’étaient en ligne de mire des rédacteurs du Code de Production, qui luttaient pour éliminer des représentations allusives jugées amorales, et non des représentations explicites au sens où on l’entend aujourd’hui. Les censeurs contemporains ne luttent pas, en revanche contre le « suggestif » même lorsqu’il est potentiellement amoral. La régulation contemporaine est moins moralisatrice puisqu’elle autorise des représentations de la sexualité subtilement aguichantes, délicatement stimulantes. En revanche on peut considérer qu’elle est tout aussi normative sur le plan de ce qu’elle impose comme représentation de la sexualité, entrainant un lissage des corps et des représentations tout aussi normatif. Il est devenu possible de représenter la sexualité, mais selon des normes strictes, bien qu’implicites, évitant à la fois l’intensité et l’intimité excessives. On peut étendre à bien des thèmes abordés ici la mise en garde de Linda Williams à propos de la représentation de la sexualité, contre la « grave erreur » que constituerait une vision linéaire, conçue comme « une avancée croissante vers l’explicite. »50
« Le contexte, ce qui se passe sur l’écran, et la manière dont un thème ou une scène sont décrits, voici les clés », a déclaré l’organisation. « La chose la plus importante est à quel point la nudité est prolongée et graphique, et la manière dont les parents la perçoivent51 ».
En conclusion de ce long parcours, quelques remarques sur le fonctionnement actuel des instances de régulation que ces réflexions autour du terme « obscène » ont permis de dégager. Tout d’abord relevons que si la MPAA n’a plus besoin de nommer l’obscène, c’est que le sigle NC-17, malgré les dénégations des régulateurs, en est devenu l’équivalent. On trouverait d’innombrables preuves de ce processus de synonymie et de la manière dont le public américain dans sa grande majorité a intégré le caractère honteux et stigmatisant du classement. On peut, à la suite de la chercheuse Jane M. Friedman, estimer que « certains producteurs sont privés d’une source de revenu appréciable pour une seule raison : parce qu’un classement a persuadé, à tort, certains journalistes qu’un film est obscène52. » Comme l’écrivait en 2012 un journaliste du Los Angeles Times :
Au fond, le débat autour du classement NC-17 pose la question de savoir ce que la société matérielle considère comme mainstream, qui est chargé de le déterminer, et quels sont les critères utilisés pour ce faire. […] Nombre d’adultes refuseront d’aller voir un film classé NC-17, convaincu qu’ils vont voir des cochonneries53.
Ces interprétations ont souvent conduit à considérer que la MPAA se livrait à une censure déguisée, dissimulant la continuité d’une évaluation morale derrière une apparente objectivité – c’est la conclusion régulièrement tirée par les critiques du système qui en outre, dès le début, et jusqu’à aujourd’hui, n’ont cessé de démontrer à quel point l’apparente neutralité était un leurre servant à dissimuler un processus normatif, y compris sur le plan moral. Mais ce processus s’abrite constamment, comme l’indique la citation placée en épigraphe de cette conclusion, derrière l’opinion supposée des parents (« la manière dont les parents la perçoivent »), une assertion répétée qui évite à la MPAA d’avoir à détailler trop précisément ses critères. En évoquant des représentations destinées à un public « mature » ou « adulte », la CARA se conforme à la logique juridique qui prévaut, renonçant à moraliser ou à introduire un jugement de valeur pour se contenter d’assigner une variabilité de réception selon l’âge. Cependant, la neutralité de la formulation n’empêche cependant nullement la subjectivité dans l’application. En outre, le terme « adulte » a pris des connotations négatives qui en font un quasi synonyme de « pornographique » et l’ont ainsi chargé de connotations assez proches de celles qui entouraient l’« obscène » d’antan. La citation en épigraphe soulève une autre question : celle de l’échelle d’évaluation d’une œuvre. On se souvient que, sur le plan juridique, il a été décidé par la Cour Suprême54 que c’était bien l’obscénité de l’œuvre entière qui était en jeu, et non celle de certains passages. De même, la MPAA affirme régulièrement que ses classements prennent en compte la totalité de l’œuvre et non des passages ponctuels, comme l’indique, dans la citation, l’insistance sur « le contexte », et, dans un passage des Rating Rules, l’assertion selon laquelle « En évaluant un film, le Bureau de classification évalue chaque film dans son intégralité55 ». Dans les faits, cependant, ce sont bien des passages ponctuels qui, jugés trop « explicites », valent aux œuvres des classements restrictifs, une logique qui aboutit à un retour en arrière, évaluant les œuvres sur la base de détails ou de fragments – en somme, une logique qui évoque, en plus insidieuse, l’ancien fonctionnement des listes. L’histoire de la censure n’est, décidément, pas linéaire.
Notes
- Bien que, comme le rappelle Melvin I. Urofsky, (The Warren Court: Justices, Rulings, and Legacy, Virginia Commonwealth University, Santa Barbara, California, Denver, Colorado, Oxford, England, 2001, p. 123) à l’origine « les affaires d’obscénité aient impliqué l’hérésie, le blasphème et les tracts antireligieux, à partir de la fin du dix-neuvième siècle les procès visant les documents obscènes concernaient presque entièrement la littérature à orientation sexuelle », et c’est bien au sens de « ayant trait à la sexualité » que j’entendrai le terme, comme l’ont fait les instances de régulation que je vais étudier ici.
- Olivier Caïra, Hollywood face à la censure, Discipline industrielle et innovation technologique, CNRS éditions, Paris, 2013, p. 15.
- Il s’agit d’une association, représentant les intérêts industriels des plus grands studios nord-américains. Elle s’appelait, lors de sa fondation dans les années 1920, MPPDA (Motion Picture Producers and Distributors of America) et prit le nom de MPAA (Motion Picture Association of America The Motion Picture Association) à partir de 1945.
- « The sanctity of the institution of marriage and the home shall be upheld. Pictures shall not infer that low forms ofs ex relationships are the accepted or common thing. » (Pour consulter les archives du Code Hays, [en ligne] http://digitalcollections.oscars.org/cdm/compoundobject/collection/p15759coll11/id/10866/rec/4[consulté le 02/11/22].
- « Scenes of passion. These should not be introduced except where they are definitely essential to the plot. […] In general, passion should be treated in such manner as not to stimulate the lower and baser emotions. »
- O. Caïra, op. cit., p. 167.
- Notons que la segmentation des œuvres par publics avait été envisagée dès la première rédaction du Code, qui évoquait la « distinction à faire entre les films destinés à une distribution générale et ceux qui étaient destinés à être utilisés dans les cinémas restreints à un public limité. » (A careful distinction can be made between films intended for general distribution, and films intended for use in theatres restricted to a limited audience.) Les rédacteurs spécifiaient que « des thèmes et des intrigues tout à fait appropriés aux salles restreintes seraient tout à fait déplacées et dangereux dans les autres ». Les rédacteurs du Code, anticipant même ce qui deviendra la norme après 1968, mentionnent la possibilité de « réserver les salles d’un cinéma généraliste et d’en contrôler la clientèle lors de la projection d’un film ciblant “seulement les adultes”, bien qu’ils jugent cette possibilité « plutôt insatisfaisante et seulement partiellement efficace. » (Note: The practice of using a general theatre and limiting it patronage during the showing of a certain film to “Adults Only” is not completely satisfactory and is only partially effective.) À cette occasion, les rédacteurs du Code distinguent les « esprits les plus mûrs, qui pourront aisément comprendre et accepter, sans qu’aucun tort ne soit causé, certains sujets, dans les intrigues, qui font aux plus jeunes un tort évident. » (« Themes and plots quite appropriate for the latter would be altogether out of place and dangerous in the former. However, maturer minds may easily nderstand and accept without harm subject matter in plots which do younger people positive harm. ») Les rédacteurs du Code suggèrent alors la création « d’un type de cinéma spécifique, destiné uniquement à un public adulte, pour des projections de ce type (avec des thèmes à problèmes, des débats difficiles et des traitements plus matures), (qui) permettraient d’offrir un moyen de diffusion, qui n’existe pas actuellement, pour les films impropres à une distribution générale mais autorisé pour les projections à un public restreint. » (« Hence: If there should be created a special type of theatre, catering exclusively to an adult audience, for plays of this character (plays with problem themes, difficult discussions and maturer treatment) it would seem to afford an outlet, which does not now exist, for pictures unsuitable for general distribution but permissible for exhibitions to a restricted audience. »).
- « a sensitive concern for children ».
- Voir, notamment, les déclarations de Jack Valenti à la Obscenity Commission, May 12, 1970. Voir aussi Variety, Nov. 17, 1971, citant Dr. Aaron Stern, Chairman, MPAA Code and Rating Administration), et Congressional Record: Proceedings and Debates of the .90th Congress, second session, Octobre, 11, 1968 to october 14, 1968, Volume 114, Part 24 United States. Congress, p. 31445.
- Melvin I. Urofsky, The Warren Court: Justices, Rulings, and Legacy, Virginia Commonwealth University, Santa Barbara, California, Denver, Colorado, Oxford, England, 2001, p. 123 seq.
- O.Caïra, op. cit, p. 161.
- « In furtherance of the objectives of the Code to accord with the mores, the culture, and the moral sense of our society. », cité dans Congressional Record, op. cit., p. 31445.
- « The artist remains responsible and sensitive to the standards of the large society ».
- « Restraint and care shall be exercised in presentations dealing with sex aberrations ».
- « No pictures showing sex attraction in a suggestive or improper manner will be represented ». Voir à ce sujet O. Caïra, op. cit. , p. 182.
- O. Caïra, op. cit., p. 96 et seq. ; Jean-Loup Bourget, op. cit., p. 30.
- « Titles which are salacious, indecent, obscene, profane or vulgar ».
- « salacious titles, stills and advertising must not be used ».
- Jean-Loup Bourget, Hollywood, la norme et la marge, ch. 4, « Le Code », p. 123-134. p. 126 pour la citation.
- « Scenes of Passion. […] should not be introduced when not essential to the plot ».
- « Excessive and lustful kissing, lustful embraces, suggestive postures and gestures, are not to be shown ».
- « Seduction or Rape a. These should never be more than suggested, and then only when essential for the plot. They must never be shown by explicit method ».
- « Restraint and care shall be exercised in presentations dealing with sex aberrations ».
- « In general, passion should be treated in such manner as not to stimulate the lower and baser emotions ».
- La citation précise est : « Le traitement des sujets bas, dégoûtants, déplaisants, mais pas nécessairement mauvais, devrait toujours être guidé par les exigences du bon goût, et l’attention requise aux sensibilités du public. » « The treatment of low, disgusting, unpleasant, though not necessarily evil, subjects should be guided always by the dictates of good taste and a proper regard for the sensibilities of the audience ».
- « Alley cat (applied to a woman); bat (applied to a woman); broad (applied to a woman) […], chippie; cocotte; fanny; fairy (in a vulgar sense), […] hot (applied to a woman); […] Madam (relating to prostitution); slut ( applied to a woman); traveling salesman and farmer’s daughter jokes; whore ».
- « any licentious or suggestive nudity – in fact or silhouette ».
- « …any lecherous or licentious notice thereof by other characters in the picture ».
- « nakedness will be banned ».
- « Complete nudity is never permitted. This includes nudity in fact or in silhouette, or any lecherous or licentious notice thereof by other characters in the picture ».
- Lea Jacobs, The Wages of Sin: Censorship and the Fallen Woman Film, 1928-1942, University of California Press, Berkeley, 1997. [1991]
- « Authentically photographed scenes photographed in a foreign land, of (sic) natives of such foreign land, showing native life, if such scenes are a necessary and integral part of a motion picture depicting exclusively such land and native life, provided that no such scenes shall be intrinsically objectionable nor made a part of any motion picture produced in any studio ; and provided further that no emphasis shall be made in any scenes of the customs or garb of such natives or in the exploitation thereof ».
- On peut relever que la notion d’« exploitation » va prendre une place croissante dans l’évaluation éthique des images et spectacles contemporains.
- « For, in addition to its beauty, the effect of the nude or semi-nude body on the normal individual must be taken into consideration. 3. Nudity or semi-nudity used simply to put a “punch” into a picture comes under the head of immoral actions. It is immoral in its effect on the average audience. 4. Nudity can never be permitted as being necessary for the plot. Seminudity must not result in undue or indecent exposures. 5. Transparent or translucent materials and silhouette are frequently more suggestive than actual exposure ».
- « Dancing costumes intended to permit undue exposure or indecent movements in the dance are forbidden ».
- « 2. Undressing scenes should be avoided, and never used save where essential to the plot ».
- « Indecent or undue exposure of the human body shall not be presented ».
- « Dances suggesting or representing sexual actions or indecent passion are forbidden ».
- « Dances which emphasize indecent movements are to be regarded as obscene ».
- « An NC-17 rated motion picture is one that, in the view of the Rating Board, most parents would consider patently too adult for their children 17 and under. No children will be admitted. NC-17 does not mean “obscene” or “pornographic” in the common or legal meaning of those words, and should not be construed as a negative judgment in any sense. » (Rating rules, p. 10.)
- Urovsky, op. cit., p 128.
- « mature themes, (…) nudity, sensuality, depictions of sexual activity, adult activities (i.e. activities that adults, but not minors, may engage in legally) » (Rating rules, p. 8)
- « An R-rated motion picture may include adult themes, adult activity, hard language, intense or persistent violence, sexually-oriented nudity, drug abuse or other elements, so that parents are counseled to take this rating very seriously. »
- « G-Rated: No nudity, sex scenes or drug use are present in the motion picture ». p. 9
- « sexuality; sexual content; sensuality; nudity; sexual innendo; strong sexuality; sexuality and nudity; brief nudity; brief sexuality; strong sexual content; mild sexuality; innuendo; sex and nudity; strong sex and nudity; strong sexuality and nudity; partial nudity; brief sexual references; teen sexuality; rape; brief partial nudity; sexual content, partial nudity; crude sexual content; brief sensuality; brief sexuality/nudity. »
- The General’s Daughter, Simon West, 1999.
- Abdellatif Kechiche, 2013.
- Linda Williams, Hard Core, Power, Pleasure, and the « Frenzy of the Visible », Pandora Press, Londres, Sydney, Wellington, 1990, p. 123.
- Je me permets ici de renvoyer à mon article, « Choisir sa Position : le cinéma mainstream face au pornographique », in : Grégori Jean et Bertrand Cochard, La sexualité en images. Regards croisés sur l’érotisation des corps, Hermann, 2018.
- Linda Williams, Screening Sex, Duke University Press, Durham, N. C., 2008, p. 11.
- « Famously secretive, MPAA pulls back the curtain on ratings – a little bit », Los Angeles Time, David NG, 29 octobre 2018.
- Jane M. Friedman, op. cit., p. 203.
- « At its core, the debate over NC-17 is a matter of what material society considers mainstream, who gets to make those determinations and what standards they use in doing so. » « High hopes, low notes for film world’s NC-17 rating », Steven Zeitchik, Los Angeles Times, 2012.
- Arrêt Roth vs United States, 1957, qui dispose qu’il y a obscénité lorsque « pour un individu moyen, appliquant les standards de sa communauté, le thème dominant du matériel considéré dans son ensemble en appelle à un intérêt lascif » (cité dans Melvin I. Urofsky, op. cit, p. 126).
- « In rating a motion picture, the Rating Board evaluates each motion picture in its entirety » (Rating Rules, p. 8).