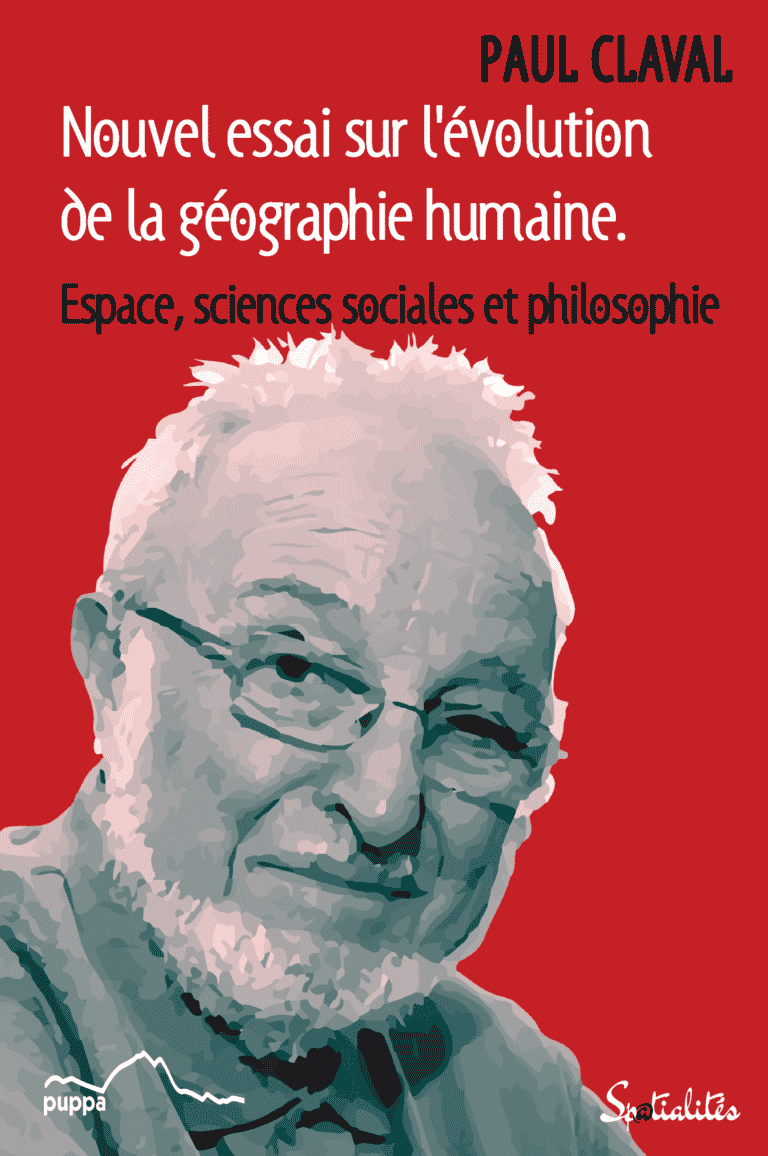Durant les années 1970, mes recherches visent à étendre à l’ensemble de la géographie humaine la prise en compte systématique du jeu de la distance dans l’organisation de l’espace. Jusque-là, notre discipline évoluait sans guère de relations avec les autres sciences sociales. C’est vers les sciences dures, mathématiques et physique, et les sciences naturelles, qu’elle se tournait pour formaliser ses fondements épistémologiques.
La situation change alors. Après avoir concerné essentiellement la linguistique, le structuralisme touche l’anthropologie dans les années 1950 puis fascine l’ensemble des disciplines de l’homme. Les critiques qui s’élèvent à partir de 1968 contre la géographie classique et la Nouvelle Géographie naissent des interprétations radicales que proposent les sciences sociales fondées sur l’inconscient : l’économie marxiste, la psychanalyse de Freud et certaines formes de la recherche linguistique, à la manière de Saussure. C’est sur les campus américains que ces courants se rapprochent et que s’impose l’idée que les recherches sur l’homme social n’ont de valeur que si elles sont critiques, ainsi que le professe l’École de Francfort. La fondation en 1969 de la première revue radicale de géographie, Antipode, témoigne de cette mutation.
Par suite de la circulation plus rapide des idées, il est désormais indispensable de situer l’histoire de la géographie dans un contexte élargi. La réflexion sur la culture et les systèmes de croyance s’approfondit rapidement. Je m’intéresse donc à la dynamique des sciences sociales. Celles-ci naissent de l’ébranlement que la Renaissance et la Réforme provoquent dans la pensée occidentale. Leurs contours se précisent aux alentours de 1800. Elles revêtent dès lors trois formes différentes, qui continuent à peser sur la manière dont elles sont construites et évoluent de nos jours. Le processus se déroule en deux actes.
Acte I. L’individu face au pouvoir,
ou La Boétie et l’invention de la liberté
Il y a des textes qui vous saisissent par une actualité qui ne se dément pas depuis des siècles : tel est le cas du Discours sur la servitude volontaire (La Boétie, 2006 [1576]) comme le désigne Montaigne qui révèle son existence en 1570 ; la propagande calviniste le mobilise et le publie en 1574 sous le titre du Contr’Un. La Boétie l’a écrit jeune – à 16 ou 18 ans dit Montaigne, à 22 ou 23, en 1552 ou 1553, lorsqu’il étudie le droit à l’Université d’Orléans, corrige Pierre Mesnard (1977). Le texte est court et animé d’un souffle puissant. Appuyé sur l’analyse d’exemples classiques, il porte la marque de l’époque – mais c’est aussi un moyen de parler de problèmes brûlants en prenant un peu de recul : l’humanisme de La Boétie n’est pas un simple paravent ; il dénonce un fait scandaleux et dont l’évidence est aveuglante, quoique personne n’ait osé le traiter avant lui :
« Pour ce coup, je ne voudrais sinon entendre comme il se peut que tant d’hommes, tant de bourgs, tant de villes, tant de nations endurent quelquefois un tyran seul, qui n’a de puissance que celle qu’ils lui donnent ; qui n’a pouvoir de leur nuire, sinon qu’ils ont pouvoir de l’endurer ; qui ne saurait leur faire mal aucun, sinon qu’ils aiment mieux souffrir que le contredire » (La Boétie, 1576/2006, p. 52-63).
C’est une situation intolérable, car la nature nous a fait libres :
« Il ne faut pas faire doute que nous ne soyons tous naturellement libres, puisque nous sommes tous compagnons, et ne peut tomber en l’entendement de personne que nature ait mis aucun en servitude, nous ayant tous mis en compagnie » (ibid., p. 58-59).
C’est par sa faute que l’homme est asservi, car il naît naturellement libre. Le « Discours » offre du coup une façon inédite de comprendre la philosophie, la religion et la politique, et de poser le problème de toute vie sociale.
La genèse d’une idée
Avec l’idée que l’homme est libre, ce texte offre une des avancées majeures de l’humanisme. Il a des antécédents et témoigne d’un contexte particulier. La fréquentation renouvelée de l’Antiquité conduit à considérer avec un certain recul la situation de l’Europe des XVe et XVIe siècles. Le stoïcisme, l’épicurisme ou le scepticisme, que l’on redécouvre, révèlent une réflexion oubliée sur la condition de l’homme. L’humanisme y puise une part essentielle de son inspiration et de ses idées – mais pas la conviction que l’homme est naturellement libre : pour Aristote, c’est un animal social qui peut être aussi bien libre qu’esclave. Les épicuriens sont les seuls à penser que la nature n’a pas pu le faire naître enchaîné.
L’idée que l’homme est naturellement son seul maître est davantage présente dans la philosophie médiévale. Pour les thomistes, c’est un animal social que Dieu a doté de raison pour qu’il s’en serve, soit capable de porter des jugements et de se diriger en conséquence. Le nominalisme va plus loin : contre une forme de scolastique qui fait du général et de l’universel le critère de l’intelligible, il rappelle que la Vérité n’est accessible qu’à l’individu, seul capable d’en acquérir l’intime conviction. Le savoir ne progresse que grâce à son libre-arbitre.
L’humanisme a des antécédents, mais c’est avec lui que le grand tournant est pris et que la pensée occidentale se différencie de celle des autres grandes civilisations en faisant de la liberté humaine et de ses conditions politiques et sociales un thème majeur.
Liberté humaine, pouvoir et société
L’humanisme est double, érudit et chrétien. Les deux sont souvent associés. À Orléans, La Boétie est l’élève d’Anne du Bourg, un humaniste qui optera bientôt pour le calvinisme, sera embastillé par Henri II, puis condamné à mort pour hérésie et supplicié en place de Grève, à Paris, en 1559.
Le supplice d’Anne du Bourg (et d’un certain nombre de ses coreligionnaires) provoque un premier mouvement de résistance chez les protestants français (El Kenz, 1997). Une décennie plus tard, le massacre de la Saint-Barthélémy donne une nouvelle vigueur à la contestation du pouvoir. C’est dans ce cadre que le Contr’un est publié. Les monarchomaques s’élèvent contre l’épouvantable tyrannie des princes chrétiens qui dénient à leurs sujets leur droit le plus fondamental : celui de pratiquer ce qu’ils estiment être la vraie religion. C’est dans ce cadre que le problème social est abordé philosophiquement. L’individu, qui est un être libre, est posé en premier. La société, représentée par le Prince, est une réalité seconde qui peut devenir porteuse du Mal grâce à la couardise complice des hommes.
Pour Thomas Hobbes, l’homme est un loup pour l’homme : frappé par le péché originel, il est naturellement mauvais. Pour sortir de l’état de violence qui en résulte, l’idée finit par s’imposer que la vie ne deviendra supportable que si tous renoncent par contrat à l’exercice de leur souveraineté individuelle, désormais dévolue à un seul. La servitude volontaire, qui choque à première vue, est l’unique condition de survie des êtres humains. Le Léviathan, l’État, qui la reçoit en délégation, exerce une autorité absolue sur ceux qui ont choisi de s’unir sous sa houlette.
Pour John Locke, l’état de nature est moins terrifiant. Par son travail, l’homme modifie son environnement ; les portions qu’il humanise lui appartiennent parce qu’une part de lui-même s’y trouve incorporée, mais l’envie le conduit à s’approprier les richesses au-delà de ce dont il a besoin. L’existence collective devient alors conflictuelle. Pour la pacifier, les hommes s’unissent : ils nouent entre eux un premier contrat qui les transforme en sujet collectif : le peuple ; celui-ci se lie alors par un second contrat avec un gouvernement chargé d’organiser la vie sociale en respectant les droits légitimes de chacun. Si le gouvernement faillit à sa mission, les hommes se trouvent déliés de leur second engagement, mais le premier subsiste : ils retrouvent le pouvoir collectif qu’ils avaient provisoirement délégué.
Pour Jean-Jacques Rousseau, l’homme n’est pas un loup pour l’homme. Il est naturellement bon : une vie de relation se développe donc dès l’origine. Avec elle, et comme dans le modèle de Locke, un moment vient où la propriété apparaît. Les instincts humains se trouvent pervertis : sans morale qui apprenne à tous à limiter leurs appétits, la poursuite des richesses entraîne inégalité et injustice. Le contrat social qui s’impose pour sortir de cette situation vise l’instauration d’une morale sociale, celle de la volonté générale, seule capable de construire une société où l’homme puisse s’épanouir sans asservir ses semblables.
Dans les trois cas, le récit du contrat social s’inscrit dans la même logique que le Discours sur la servitude volontaire, mais il en inverse la conclusion : l’asservissement à l’État auquel consentent les hommes leur garantit la sécurité et le maintien d’une sphère de liberté qui, sans cela, ne profiterait qu’à quelques-uns. La philosophie conçoit ainsi le problème de la vie collective comme celui de la socialisation de la liberté.
À l’époque des Lumières, les théories du contrat social font croire qu’il est facile à l’homme de remédier à l’asservissement sans limite qui prévaut trop souvent : il leur suffit de renoncer à une partie ou à la totalité de leur autonomie, ce qui leur évitera l’oppression et l’injustice. Pour y parvenir, ils n’ont qu’à renouer avec les principes du contrat qu’ils ont oubliés ou qu’on leur a cachés. L’émancipation naîtra naturellement du discours que répandent les Lumières.
La naissance de l’idéologie
La volonté de prendre pleinement en main leur destin conduit les hommes de la Renaissance à rejeter comme relevant de la Fable les ailleurs de l’immémorial et du mythe comme ceux de la Révélation. Problème : comment donner à des idées d’origine humaine et terrestre la force de ce qui paraît venir d’un ailleurs lointain, mystérieux et plus parfait que le nôtre ? En trichant, c’est-à-dire en inventant des aux-delàs situés sur terre, mais inaccessibles et mystérieux.
L’utopie me fascine depuis le début des années 1960. Elle est née en 1516 sous la plume de Thomas More ; celui-ci tire parti de la découverte récente de l’Amérique pour imaginer une île, Amoraute, située tout près des rivages des mers du Sud ; un voyageur, Hythloday, la décrit au narrateur à Anvers où ils se rencontrent. Techniquement, il ne s’agit pas d’une utopie si l’on entend par là un morceau de notre terre situé dans le futur, mais d’une Terre sans Mal, comme Hélène Clastres (1975) qualifie les contrées idéales dont les pagés tupi-guarani révèlent parfois l’existence à leurs peuples avant de prendre leur tête pour les y conduire. La Renaissance elle-même est née d’une réévaluation de l’Antiquité : ce passé n’est plus ressenti comme proche ; la conscience de son altérité et de sa valeur exemplaire s’impose : il se transforme en Âge d’Or.
Comme le montrent les historiens de l’utopie que sont Frank et Fritzie Manuel (1979), celle-ci achève de prendre le visage que nous lui connaissons à la jointure des XVIe et XVIIe siècles. Les Occidentaux disposent désormais de trois variétés d’ailleurs terrestres inaccessibles au commun des mortels et d’où peut émaner l’autorité des systèmes de pensée : un Âge d’Or du passé, une Terre sans Mal du présent ou une Utopie du futur.
Des lectures m’aident à comprendre comment ces ailleurs sont mis à contribution pour justifier les règles qui s’appliquent à notre monde. Françoise Choay (1980) explique ainsi comment, au XVe siècle, Alberti, le nouveau théoricien de l’architecture, s’inspire de Vitruve pour justifier les maximes de l’art de construire ; il remonte aux origines de l’humanité, au temps où les hommes construisaient leurs premiers abris, des cabanes soutenues par des perches ou des poutres : ce qui structure depuis lors les bâtiments, ce sont les colonnes qui les soutiennent plutôt que les murs.
C’est donc en insérant dans ses démonstrations de courts récits situés dans le temps indéfini d’un passé d’avant l’histoire que sont présentés, sous la forme de récits de bon sens, les principes qui doivent régir l’architecture. Françoise Choay montre que pour étayer les conceptions de l’aménagement des espaces construits, le procédé ne cesse d’être repris du XVe au XVIIIe siècle, depuis la formulation des nouvelles règles du beau jusqu’à leur révision par le néo-classicisme.
Avant même qu’ils ne donnent lieu à un ouvrage sur ce thème (Dumont, 1983), les travaux de Louis Dumont (1977) attirent mon attention sur le rôle ambigu des auteurs que l’on cite toujours comme les initiateurs des sciences sociales, Hobbes, Locke ou Rousseau. C’est par leurs théories du contrat social qu’ils se font connaître. Comme les architectes, c’est par le récit d’un événement dicté par la raison humaine qu’ils présentent leur thèse : la volonté d’arrêter la guerre de tous contre tous que mènent les hommes de nature pour Hobbes, celle de concevoir un gouvernement sage et qui garantisse les droits de propriété pour Locke et celle d’amender une société que l’invention de la propriété a pervertie selon Rousseau. Comme dans le cas des penseurs du nouvel art de construire, c’est en situant la signature du contrat dans une préhistoire ou dans un futur indéfini que les fondateurs des sciences de l’homme présentent leur conception de la société. Ils reprennent ainsi une des démarches qui sert depuis toujours à accéder à d’autres mondes : le recours à l’immémorial. Le récit de la signature du premier pacte n’est qu’un mythe. Comme l’a montré Claude Lévi-Strauss (1962) dans ses analyses des mythes amérindiens, il suffit parfois de modifier un élément du récit pour en transformer le sens. Tels que la voient Hobbes et Locke, la signature a eu lieu dans le passé ; pour Rousseau, elle n’est peut-être pas encore advenue et peut se produire à tout instant. Pour les deux premiers, le Covenant ramène la société à une vérité première. Pour le troisième, il lui donne comme modèle un monde à venir, ce qui lui confère une charge révolutionnaire. Telle est l’interprétation de la genèse des valeurs que je propose en 1980 dans Les Mythes fondateurs des sciences sociales.
La réflexion sur le contrat social constitue ainsi un tournant majeur dans l’histoire des systèmes de croyances qui donnent leur sens à la vie des hommes : les idéologies s’ajoutent – et se substituent largement – aux religions de l’immémorial et du mythe, à celles de la Révélation et aux métaphysiques qui cernent les traits de l’Être suprême.
La traduction politique des idéologies du progrès
Les philosophies du Contrat social installent l’idée que le progrès est à la portée de tous les groupes humains : il suffit pour cela que les individus délèguent correctement le pouvoir qu’ils détiennent à celui qui devient ainsi l’arbitre de leurs problèmes. Les trois formulations du contrat donnent naissance à trois modèles d’organisation politique. Dans la perspective ouverte par Hobbes, le pouvoir revient à un despote éclairé. Pour Locke, le peuple continue à exercer un contrôle sur celui qu’il a élu et maximise ainsi la liberté dévolue à chacun. Pour ceux qu’a convaincus Rousseau, le peuple assemblé veille à ce que la liberté de chacun soit conforme à la volonté générale, projet admirable mais qui sert trop souvent de caution à des régimes totalitaires.
La formule du despotisme éclairé n’a qu’un temps. Le siècle des Lumières fait du peuple le détenteur de la souveraineté et conduit à la mise en place de sociétés démocratiques dans un cadre national. L’idéal, c’est de participer collectivement au progrès dans le cadre d’un État-nation.
Un problème apparaît bientôt : pour l’individu, la liberté ainsi conçue ne doit pas être limitée au cadre national où il évolue : l’idée prévaut que c’est par la diffusion de la bonne parole et par le commerce que le bonheur peut s’étendre à l’ensemble de l’humanité. Chacun doit donc être libre de répandre ses idées à l’étranger et d’y procéder à des échanges avec qui il veut : il doit avoir le droit de s’y déplacer et de nouer des contacts à sa guise. Cela donne un nouvel élan à l’œuvre missionnaire – le monde protestant y participe pour la première fois à la suite de la fondation en 1795 de la London Missionary Society. L’extension à l’ensemble de la planète de la liberté de circuler, de diffuser ses opinions et de faire des affaires introduit en même temps une composante impérialiste dans l’idéologie libérale de l’État-nation.
Le troisième modèle d’organisation politique, celui qui est inspiré par Rousseau, est brièvement mis en œuvre au plus fort de la Révolution française ; il fédère à partir des années 1830 les mouvements socialistes, mais ne s’incarne vraiment dans des institutions qu’à partir de la Révolution d’Octobre. Il est alors interprété dans un sens totalitaire.
À partir de la Renaissance et surtout du XVIIe siècle, des esprits critiques renoncent à l’idée selon laquelle le monde meilleur dont les hommes ont besoin pour guider leur action et trouver le bonheur sur terre doit leur être dicté depuis un au-delà : ils remettent du coup en cause l’autorité des panthéons des religions animistes et celle du Dieu suprême de la Révélation. La métaphysique échappe jusqu’au XVIIIe siècle à cette condamnation et propose de remplacer le Créateur par un Être suprême – mais se préoccupe surtout de repenser le Cosmos.
C’est par une forme rajeunie du mythe que le meilleur des mondes est, dans un premier temps, bâti. Des récits nous font connaître des sociétés heureuses édifiées par les hommes : elles peuvent et doivent nous servir d’exemples ; elles se situent dans le passé (celui de l’Âge d’Or – l’Antiquité pour la Renaissance), dans le présent (une Terre sans Mal bien réelle et contemporaine, mais inaccessible au commun des mortels) ou dans le futur (une Utopie). À cela s’ajoutent bientôt les récits de la signature du contrat social que proposent Hobbes, Locke ou Rousseau : signé dans un temps indéterminé comme celui de l’immémorial, il s’agit d’un pacte d’où est né (ou d’où naîtra) une vie sociale harmonieuse et heureuse. De la plume de ces initiateurs surgissent à la fois les premières idéologies et les premières ébauches des sciences sociales et politiques modernes (Claval, 1980 ; 2008b).
Concevant désormais la pensée religieuse et ses substituts comme des facteurs instituants, il m’apparaît que les sciences sociales en général et la géographie en particulier doivent leur accorder plus d’attention. C’est d’autant plus indispensable pour notre discipline que la pensée normative repose sur la topologie de l’espace réel et des espaces imaginés – nous y reviendrons plus bas.
La philosophie cesse du même coup d’apparaître comme une discipline première, indépendante des autres et qui en tire le droit de porter des jugements sur elles. Elle repose largement sur la géométrie imaginée des rapports entre les espaces vécus et leurs doubles spéculatifs. Je porte donc un regard différent sur la réflexion philosophique et sur sa branche épistémologique.
De telles positions posent évidemment problème. Je ne me contente pas d’accorder de l’importance à la pensée religieuse ; je montre que l’idéologie, la forme nouvelle de croyance propre à la modernité, n’en est qu’un avatar laïcisé. Les travaux de sociologie de Shmuel Eisenstadt (1982 ; 2003) et ceux d’histoire des religions de Harvey Whitehouse (2004) me confortent dans cette conviction. En soulignant la fragilité des fondements de l’idée de progrès, qui inspire la civilisation occidentale depuis trois siècles, je contribue à la déconstruction de celle-ci qui est alors à l’œuvre.
Lorsque la pensée scientifique prend une forme plus rigoureuse, aux alentours de 1800, ces récits qui flottent dans une histoire imaginaire perdent leur crédibilité ; les idéologies ont besoin de nouveaux supports.
Acte II. L’individu face à la société :
Bentham, Kant et Comte
Plusieurs mutations dans la pensée occidentale interviennent à la fin des Lumières. L’échec de la Révolution française remet en question l’idée que la société est née d’un pacte dont il suffit de respecter les termes pour qu’elle fonctionne harmonieusement. Comme le souligne Robert Nisbet (1966), on découvre que la vie collective ne se construit pas par décret. C’est une réalité complexe qu’on ne peut améliorer que si l’on a compris la manière dont elle fonctionne, de la même façon qu’on n’agit sur la nature que si l’on connaît ses lois. Cela se traduit par quatre inflexions majeures : (i) la naissance de sciences sociales empiriques ; (ii) la révolution copernicienne que Kant fait subir à la métaphysique, désormais capable de justifier l’idée de progrès ; (iii) l’élaboration de sciences sociales de l’inconscient, qui naissent comme contrepoint matérialiste de l’idéalisme allemand ; (iv) le projet d’Auguste Comte de prolonger la réflexion philosophique sur ordre et progrès en construisant une science nouvelle de l’homme social (la sociologie).
Trois formes de sciences sociales cohabitent dès lors.
L’éclosion de sciences sociales empiriques
Le mouvement de création des sciences sociales débute par l’économie : les physiocrates inventent les comptabilités territoriales ; grâce à Adam Smith, on comprend que la régulation de ce domaine d’activité peut être assurée par le marché.
Ces nouvelles idées doivent beaucoup à l’empirisme qui domine la réflexion philosophique britannique depuis le milieu du XVIIe siècle et qui trouve son expression la plus connue dans l’utilitarisme que définit Jeremy Bentham à la fin du XVIIIe. Les décisions que prennent les hommes dans le cadre ainsi défini sont rationnelles. Cette première science sociale empirique a donc la particularité de traiter directement des choix des acteurs puisque ceux-ci sont rationnels et peuvent être reconstitués par quiconque est informé des problèmes qu’ils ont à résoudre.
Dans tous les autres domaines, les recherches empiriques sur l’homme social se heurtent à une difficulté majeure : il n’est pas possible d’observer ce qui se passe dans la tête des gens. On peut évidemment les interroger, mais rien n’assure que leurs réponses soient sincères. L’attitude positive du savant lui interdit par ailleurs de s’attacher à ce qui est subjectif. C’est donc uniquement à travers les manifestations extérieures de l’activité humaine que la connaissance peut avancer. Les documents qui en témoignent sont multiples : les démarches à suivre pour les interpréter le sont aussi. Nous connaissons le passé social à travers les textes et inscriptions qu’il nous a laissés ou à travers les traces matérielles des activités d’autrefois : ainsi se définissent l’histoire, qui travaille à la fois sur des écrits et sur des ruines, et la préhistoire, qui ne dispose que des secondes – cependant que les démarches de l’archéologie sont communes aux deux disciplines. La géographie humaine mesure l’emprise des hommes sur la terre en analysant les paysages qu’ils modèlent et les artefacts qu’ils mobilisent. L’ethnologie – l’anthropologie des pays anglophones – s’attache aux peuples sans écriture et aux masses paysannes des sociétés historiques. Les sciences politiques observent les effets sensibles des jeux de pouvoir et leur expression dans les mouvements d’opinion dont témoignent les élections.
Le souci d’étudier le social conduit ainsi à la naissance d’une pluralité de disciplines scientifiques à fondement empirique.
La révolution copernicienne de Kant :
la métaphysique garante du progrès
De la science newtonienne, David Hume retient un point essentiel : la démarche scientifique est fondamentalement inductive ; elle ne prétend pas atteindre l’essence des choses et se borne à mettre en évidence les lois qui les régissent.
Immanuel Kant sort de son dogmatisme rationaliste à la lecture de Hume et de Rousseau : la « révolution copernicienne » qu’il mène alors en philosophie souligne les bases et les limites des savoirs scientifiques ; de même que l’illustre astronome avait établi que c’était la Terre qui tournait autour du soleil en non l’inverse, Kant montre que c’est le sujet, et non pas l’objet, qui est au centre de la connaissance (Var. Auct., s.d.). L’homme ne perçoit du monde que les phénomènes. Grâce aux catégories dont est doté a priori son esprit indépendamment de l’expérience, il est capable d’élaborer des concepts en partant des observations, d’imaginer les processus qui lient les faits et de proposer une explication que la confrontation avec le réel entérine.
« L’ordre du monde n’est pas dans le monde lui-même, mais dans l’entendement humain qui dicte à l’expérience ses principes a priori. Avant Copernic, nous cherchions l’ordre du monde dans le spectacle sensible du monde ; après Copernic, nous nous défions des apparences, l’entendement ne se laisse plus ‘tenir en laisse’ par les apparences : il construit lui-même des lois qu’il vérifie ensuite par une expérience effectuée non dans la nature, mais dans le laboratoire qu’il a lui-même conçu » (Darriulat, 2007).
L’esprit humain y parvient dans la mesure où il accède à une dimension qui excède celle de l’empirie : Kant la qualifie de transcendantale.
Depuis Aristote, la métaphysique spéculait sur Dieu, sur la substance, sur l’un : pour Kant, ses conclusions sont sans valeur puisque aucune évidence sensible ne peut les corroborer. La connaissance de principes dépassant les limites possibles de toute expérience, est-elle chimérique, ce qui condamnerait toute métaphysique ? Non répond Kant dans la Critique de la raison pratique : la liberté de choix éthique dont jouit l’homme fonde toute vraie morale. La Critique de la faculté de juger fait de l’esprit l’arbitre du goût : elle fait naître l’esthétique et justifie l’activité artistique. La possibilité que possède l’esprit d’atteindre l’universel lui ouvre l’absolu qui naît des dimensions transcendantales de l’esprit. Kant construit ainsi une nouvelle métaphysique, propose une morale de la responsabilité et initie l’esthétique moderne.
La philosophie idéaliste allemande reprend ces thèmes et ne cesse de proposer de nouvelles variantes de la révolution copernicienne (une rupture épistémologique, dirait-on aujourd’hui) à laquelle Kant vient de procéder. Celle qu’élabore Fichte est axée sur les dimensions transcendantales de la liberté, celle de Schelling sur la puissance de la Nature. Hegel retrace l’aventure de l’Esprit et les ruses qu’il met en œuvre pour conduire l’humanité à prendre pleinement conscience de ses possibilités.
La métaphysique renouvelée par la révolution copernicienne que Kant lui fait subir modifie considérablement la portée de celle-ci : elle devient, parallèlement aux idéologies, la garante des philosophies de l’histoire et du progrès.
Des ruses de la Raison aux sciences sociales de l’inconscient
Une autre façon de concevoir la connaissance du social se développe au XIXe siècle dans le sillage de l’idéalisme hégélien. La lecture progressiste qu’il offre de l’histoire séduit nombre de jeunes intellectuels radicaux, mais ils récusent son idéalisme : pour eux, le monde est guidé par des forces autrement plus puissantes parce qu’elles sont matérielles.
Comment ancrer un autre monde dans une démarche scientifique ? Sur quoi repose la vérité que Marx entrevoit depuis Le Manifeste communiste ? Il met vingt ans à en formuler la preuve « scientifique », qu’il expose dans le Livre 1 du Capital. L’entrepreneur qui rémunère ses salariés les paie au prix du marché – une transaction semblable à toutes les autres pour les économistes de son temps. La concurrence que se font les travailleurs fait que dans les circonstances normales, les sommes qu’ils perçoivent sont juste suffisantes pour leur permettre de survivre. Leur travail est incorporé dans les articles que fabriquent l’entreprise et qui sont vendus. Il est alors rémunéré à un niveau supérieur. La seconde transaction est, pour l’économiste de l’époque, tout-à-fait semblable à la première. Marx soutient que ce n’est pas le cas, ce qui explique le prix supérieur qui y est attribué au travail : la différence entre eux est accaparée par l’entrepreneur sans que personne ne mette en doute son honnêteté.
La thèse qu’expose Karl Marx dans le Livre 1 du Capital est qu’il existe deux niveaux dans les processus économiques en jeu : le niveau que retient la théorie libérale, qui est celui des apparences, et celui que révèle la prise en compte de la valeur-travail : une partie de la réalité économique échappe à la conscience. Le rôle de la démarche dialectique mise en œuvre par Marx, c’est de la dévoiler. Le capitalisme conduit à l’exploitation du travailleur sans qu’en aient conscience celui-ci, l’entrepreneur qui le rémunère et le commun des mortels. C’est parce que la théorie marxiste révèle ainsi, de manière « scientifique », ce qui échappe à l’économie libérale, qu’elle peut conclure à l’iniquité consubstantielle du capitalisme et le condamner en bloc. C’est parce qu’elle met en évidence les contradictions que celui-ci recèle qu’elle peut prévoir sa fin inéluctable et l’instauration d’une société d’où l’exploitation de l’homme par l’homme aura disparu : les individus échapperont alors à l’aliénation qui leur a trop longtemps interdit de se réaliser.
C’est par la mise en évidence d’un inconscient de l’économie que Marx parvient ainsi à ancrer l’idéologie révolutionnaire du progrès dont il est porteur sur des bases « scientifiques ».
Qu’il y ait, dans les réalités auxquelles nous sommes confrontés, des processus qui échappent à notre attention, c’est une évidence. C’est en les révélant que le chercheur fait avancer le savoir. Encore faut-il que sa démonstration soit impeccable. On sait que la théorie de la valeur travail aboutit, dans bien des domaines, aux mêmes résultats que l’économie libérale, mais ce n’est pas le cas de la théorie de l’accaparement de la plus-value par le capitaliste (Robinson, 1971).
Les supports de l’idéologie moderne changent ainsi dans le courant du XIXe siècle : on passe d’une version assez fruste du mythe à la mise en évidence, grâce à des procédures scientifiques en apparence sophistiquées, d’une réalité qui montre comment fonctionne vraiment le monde et ce qu’il faut faire pour l’amender.
Je fais état de cette seconde forme de justification des idéologies occidentales dans Les Mythes fondateurs des sciences sociales et souligne qu’elle peut alors tirer parti des trois domaines où se développent au XIXe siècle des théories scientifiques de l’inconscient : celui de l’économie, avec Karl Marx, celui des comportements humains, avec la théorie du refoulement de Freud, et celui de la langue avec Ferdinand de Saussure. Je n’exploite alors que partiellement cette voie. Je lui accorde plus d’attention en 2008 dans Religions et idéologies, et signale que la critique des idéologies du progrès qu’elles étayaient est en train de faire naître une autre façon d’imaginer d’autres mondes sur terre : ce n’est plus dans l’inconscient des processus sociaux que l’on cherche la vérité, mais dans la méconnaissance des dynamiques naturelles, comme le montrent les différentes formes d’écologisme qui fleurissent depuis plus d’un demi-siècle.
L’interprétation de la société en termes d’inconscient reste longtemps minoritaire et quelque peu marginale. Je n’entreprends que récemment l’analyse des formes qu’elle prend dans le monde postmoderne et poststructuraliste.
La sociologie d’Auguste Comte
ou la philosophie continuée par d’autres moyens
Les théories du contrat social sont des avatars modernes du mythe. Il était donc inévitable que l’on cherche à donner des bases plus solides aux nouvelles croyances. Le XVIIIe siècle consacre le triomphe définitif de la science. Auguste Comte pense assurer pour l’éternité la foi en un avenir éclairé en proposant la loi des trois états (théologique, métaphysique et scientifique ou positif) par lesquels serait passé l’esprit humain dans son développement. Ce qu’il propose n’a évidemment rien d’une loi scientifique, mais le mouvement est lancé.
L’échec de la Révolution française remet en question l’idée que la société est née d’un pacte dont il suffit de respecter les termes pour qu’elle fonctionne harmonieusement. Le développement d’un savoir spécifique s’impose en ce domaine ; reprenant un terme créé dans les années 1780 par l’abbé Sieyès (Guilhaumou, 2006), Auguste Comte (1798-1857) le nomme sociologie en 1839.
Ce qui enchaîne les hommes, ce n’est pas la tyrannie d’un seul, mais le poids d’une société dont l’inertie est immense. La question de la liberté est ainsi posée d’une autre manière. Ce n’est plus la puissance d’un seul et la couardise des autres qui la menacent. C’est la société qui oppresse les individus. À quelles conditions son organisation doit-elle répondre pour permettre leur accomplissement ? Le problème philosophique fondamental n’est plus politique (le rapport de l’individu au Prince) mais social (le rapport de l’individu au groupe).
Pour Auguste Comte, l’âge théologique est illustré par le Moyen Âge et l’âge métaphysique correspond à l’Ancien Régime. L’âge positif fait suite à la Révolution ; c’est le temps de l’industrie.
Durant la première phase de cette évolution, l’esprit cherchait l’explication du monde en transfigurant les choses par le fétichisme, en les divinisant dans le polythéisme puis en faisant du Dieu unique du monothéisme le principe ultime. L’âge métaphysique situe les clés du réel dans l’abstraction de la métaphysique. Le positivisme renonce à spéculer sur ce qui n’est pas sensible. Au lieu de se focaliser sur la cause des choses, il établit les lois qui les régissent, permettent de les prévoir et éclairent l’action.
La pensée devient positive et prend une forme scientifique. Une hiérarchie des disciplines se met en place. Elle va des plus simples aux plus complexes, des mathématiques à la sociologie en passant par l’astronomie, la physique, la chimie et la biologie. Les deux derniers niveaux, biologie et sociologie, ont pour caractéristique de s’attacher à des réalités complexes – elles traitent d’organismes – qu’on ne peut comprendre à partir de leurs éléments : le tout y est plus grand que la somme des parties.
Comme le note Raymond Aron :
« Aux yeux d’Auguste Comte, dans l’humanité réelle, l’homme individuel n’est qu’une abstraction. La sociologie est donc l’équivalent positif des philosophies qui prétendaient connaître l’ordre moral. Étendant à la psychologie et à la politique la méthode positive, elle transforme la philosophie en science. Science suprême qui commande le système entier : car la loi des Trois États [jointe] à la loi du classement hiérarchique des sciences domine et l’histoire des sciences qu’elle éclaire et les sciences actuelles – dont elle explique la forme, épure les méthodes et annonce l’avenir – et l’histoire de l’humanité qu’elle synthétise et la psychologie de l’homme qu’elle résume » (c’est nous qui soulignons) (Aron, 1928, reproduit dans Leboyer, 2026).
Pour Auguste Comte, la vie sociale implique un lien moral qui unisse les hommes. Au cours des âges théologique et métaphysique, il était assuré par la religion ou par la philosophie. Celles-ci disparaissent à l’âge positif. Le rôle de la sociologie n’est pas seulement de mettre en évidence les lois qui dominent le devenir de l’Humanité. Il est de fabriquer le ciment moral dont ont besoin les hommes : la sociologie doit mettre en place une religion de l’Humanité.
La sociologie telle que la conçoit Auguste Comte est une science singulière : prolongement de la philosophie, elle doit combler grâce à ses enseignements normatifs le vide que crée le passage au monde positif. Elle donnera ainsi un sens aux sociétés du futur, y fera régner l’ordre et y assurera le progrès.
Le triple faisceau de disciplines du social
À la suite de la Révolution française, on découvre que ce qui bride la liberté des individus est plus profond que le pur exercice du pouvoir politique : c’est le poids des réalités sociales. Cela met fin aux Lumières et conduit à une reformulation du problème fondamental de l’humanité : ce n’est plus celui des relations de l’individu et du pouvoir, mais celui de l’individu et de la société.
Cela provoque une remise en cause générale des savoirs sur l’homme. Le problème n’est plus de comprendre la genèse du pouvoir, mais d’explorer les pesanteurs du social.
(i) La première réaction est d’étendre au domaine social les démarches empiriques qui ont fait leurs preuves dans l’analyse du monde physique et naturel. La diversité des documents qu’elles exploitent explique qu’une pluralité de disciplines soit nécessaire pour mener à bien ce projet.
(ii) Kant repense la philosophie pour l’adapter à des réalités nouvelles. La métaphysique rénovée qu’il propose ne nous apprend rien sur l’Être suprême, mais montre que les qualités transcendantales de l’esprit humain lui permettent d’atteindre l’absolu et de mener à bien un processus de civilisation qui débouche sur le progrès.
La version hégélienne de l’idéalisme allemand montre que les ruses de la Raison conduisent les hommes à prendre conscience de leur condition et à assumer directement leur destin. Pour Marx, ce sont des forces matérielles qui échappent à la conscience des hommes qui façonnent leur devenir. Une seconde famille de sciences sociales, celles de l’inconscient, se forme ainsi.
(iii) Comte juge la philosophie incapable de rendre compte des réalités actuelles, mais propose de lui substituer une science globale qui serait axée, comme la philosophie, sur l’analyse des rapports entre l’individu et la société – ou, dit autrement, sur les conditions pour que soient réunis ordre et progrès.
C’est donc à la mise en place d’un triple faisceau d’approches du social qu’aboutit l’Acte II de la modernité sociale.