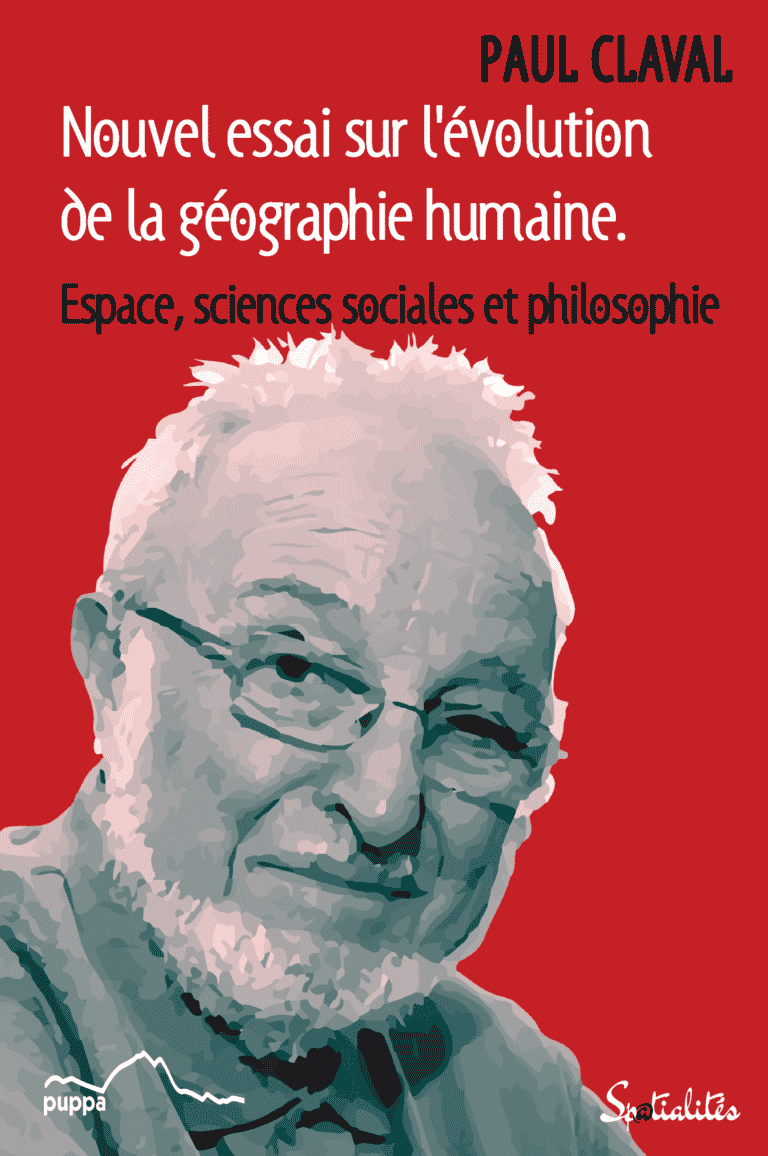J’ouvre, en 1964, mon Essai sur l’évolution de la géographie humaine par ces lignes :
« Il existe un malaise de la géographie actuelle : je l’ai éprouvé comme tout autre ; j’en ai tant parlé avec mes collègues que j’ai fini par avoir l’impression de me trouver enfermé dans un cercle vicieux de propositions et de déductions. J’en serai resté là si je n’avais pas essayé d’enseigner à des étudiants l’histoire de la pensée géographique » (Claval, 1965, p. 9).
Je poursuis quelques lignes plus loin :
« Petit à petit, j’en arrivai à l’idée que nos doutes proviennent du conflit entre deux conceptions de la géographie : une manière de voir traditionnelle que j’ai appelée classique, tournée plutôt vers le passé et la reconstruction régionale, et une interprétation prospective, qui n’est pas encore sûre de ses voies, mais qui joue un rôle grandissant dans les recherches actuelles » (ibid.).
Je n’aborde pas de la même façon ces deux moments de la discipline. Le premier appartient au passé. Je n’ai pas vécu sa genèse. C’est à travers les textes que je l’analyse. La seconde est en train de se structurer : je participe à son émergence. Mon expérience compte beaucoup dans ma manière de l’appréhender. C’est d’abord celle des doutes et des tentatives pour surmonter le malaise dont je suis témoin lors de mes études et dans les années qui suivent.
Les limites de la géographie classique
Certains chercheurs prennent conscience des limites de la géographie classique durant l’entre-deux-guerres. Comme me le confie Jean Gottmann en 1972, Demangeon cherchait alors à en affermir les bases. La réussite de L’Empire britannique (Demangeon, 1922) tenait, pour lui, à la mise en œuvre d’un certain nombre de principes qui donnaient de la cohérence à l’action coloniale de ce pays : Demangeon avait dès lors considéré que c’est en analysant les faits de psychologie collective que l’on parviendrait à comprendre l’aventure de la modernité et les formes différentes qu’elle avait revêtues selon les peuples. Georges Hardy publie La Géographie psychologique en 1939. Demangeon lui consacre un compte-rendu féroce (Demangeon, 1940) : la réaction de Demangeon, m’explique Gottmann, vient de ce que Hardy n’a pas compris ce que la psychologie peut apporter à la géographie et qui a trait aux représentations collectives. Dans son œuvre, quelques remarques, en témoignent ; ainsi en 1927 :
« Depuis plusieurs siècles, il circule dans l’économie britannique un principe de vie qui règle les formes de travail, oriente la production et façonne les groupes humains : c’est l’esprit commercial. Tous les genres de vie du peuple britannique portent son empreinte : il a véritablement déterminé l’évolution de l’agriculture et l’évolution de l’industrie. Procédés de culture, produits du sol, paysages ruraux, condition des classes agricoles, rien n’est plus la pure émanation de la terre ; tout a subi l’influence de causes extérieures au pays » (Demangeon, 1927, p. 238).
Dire que tous les genres de vie britanniques reflètent un même esprit commercial, c’est constater qu’ils ne sont plus capables d’expliquer à eux seuls la diversité régionale du pays ; Demangeon en tire la conséquence : dans les deux volumes de la Géographie universelle (Demangeon, 1948) qu’il consacre à la France, il renonce à utiliser la méthode régionale.
Disciple de Demangeon, Jean Gottmann propose dès 1947, de repenser la géographie humaine. Interpréter en termes environnementalistes l’enracinement des groupes sociaux constitue pour lui une erreur : le lien à la terre n’est pas écologique ; il naît des iconographies, c’est-à-dire des représentations que les gens se font du milieu où ils évoluent (Gottmann, 1952). La réinterprétation que propose ainsi Gottmann n’est que partielle – elle ne remet pas en cause la démarche régionale, qu’il emploie encore dans Virginia at midcentury, publié en 1955 et à laquelle il ne renonce que dans la seconde moitié de Megalopolis, en 1961.
Max. Sorre et Pierre George sont, de leur côté, sensibles à l’inadéquation de la notion de genre de vie aux réalités d’un monde devenu plus complexe parce que plus industrialisé et urbanisé – mais ils n’arrivent pas à en imaginer de substituts adéquats. Max. Sorre (1948 ; 1953) se contente de remarquer que la notion ne peut plus s’appliquer qu’à des ensembles restreints (parler d’un genre de vie des cheminots garde un sens). Pierre George (1950) propose de recourir aux catégories socio-professionnelles de l’INSEE ; elles prennent en compte la diversification des activités, mais ne fournissent que des données agrégées sur leur localisation, ce qui limite leur intérêt géographique.
Vivre les apports de l’économie dans les années 1950 et 1960
Bon nombre de géographes français sentent ainsi à l’époque que leur outillage n’est plus adapté au monde qu’ils observent, mais aucun ne trouve de moyen de sortir de l’impasse. Les solutions sont proposées à l’étranger, aux États-Unis et en Suède en particulier. Elles tirent parti de l’engouement que connaît alors une branche longtemps mineure de la science économique, l’économie spatiale née au XIXe siècle en Allemagne ; elle y reste largement confinée jusqu’à l’entre-deux-guerres, où elle gagne la Suède.
Je fais une expérience parallèle à celles que mènent ces pionniers du renouveau en me plongeant dans l’économie.
Macroéconomie, microéconomie et circulation de l’information
Aussitôt l’agrégation passée, je me tourne vers l’économie. Celle-ci jouit d’un statut supérieur à celui de la géographie. Je me passionne pour les problèmes de développement et d’aménagement, auxquels la discipline que l’on m’a enseignée ne préparait guère. John Maynard Keynes est au faîte de sa gloire : la discipline a subi, à partir des années 1930, une mutation dont on parle beaucoup ; elle a conduit les gouvernements à dresser des comptabilités nationales, à mesurer la richesse globale de leurs pays et ce qui en revient en moyenne à chacun de leurs citoyens. L’écart entre les mieux servis et les plus démunis va, d’un pays à l’autre, de 1 à 100 : le problème de l’inégal développement devient, du coup, prioritaire. Le chiffrage de l’épargne et de l’investissement renseigne sur les capacités de croissance.
La macroéconomie m’attire donc beaucoup ; je la découvre à travers les ouvrages de Paul Samuelson (1957) et Raymond Barre (Barre et Teulon, 1997). Les techniques de la comptabilité territoriale commencent à s’appliquer à l’échelle des régions et des villes : elles paraissent de nature à éclairer ce qui se passe à ces échelles comme elles viennent de le faire au niveau des nations. Je suis donc attentivement le mouvement des idées en ce domaine.
C’est par l’économie spatiale que j’en viens à la microéconomie. Elle a une dimension géographique plus immédiate : Claude Ponsard (1955) me fait découvrir les travaux de Johann-Heinrich von Thünen, d’Alfred Weber et de Walter Christaller, ainsi que la systématisation de leurs résultats proposée par August Lösch : de quoi bâtir la géographie économique sur de nouvelles bases, comme je décide de le faire en février 1958. Mais la discipline m’apprend bien autre chose. L’espace qu’elle appréhende est structuré par des flux : déplacements de personnes, transports de marchandises et paiements, ce à quoi je m’attends ; elle insiste plus encore sur les transferts d’information, qu’il s’agisse de nouvelles ou de connaissances. La régulation de la vie économique dépend de la transparence ainsi assurée, puisque celle-ci conduit les agents économiques à prendre des décisions informées et rend possible leur ajustement par les marchés ou les organismes centraux de planification. L’espace prend ainsi une autre dimension : pour les groupes sociaux, l’éloignement constitue (ce que tout le monde savait) une protection contre les voisins malveillants, les armées ennemies ou les épidémies dévastatrices et un obstacle à la circulation des marchandises et des personnes ; il rend aussi difficile l’harmonisation des décisions.
Je commence par tirer parti de la microéconomie pour restructurer la géographie économique (Claval, 1962), puis en fais autant pour la macroéconomie (Claval, 1968). Je ne peux que constater que les comptabilités territoriales n’ont pas tenu leurs promesses, mais que le dynamisme économique résulte dans une large mesure de ce que l’on désigne comme des économies d’échelle et des économies externes. Les premières naissent, pour l’essentiel, de l’utilisation systématique de sources d’énergie concentrée et de machines ; elles rendent compte de la dynamique de la croissance des secteurs primaires et secondaires. Les secondes proviennent de ce que les coûts de transfert des informations sont très faibles en certains lieux et dans certaines circonstances, ce qui a un impact considérable sur la créativité des laboratoires et des entreprises qui y sont localisées et y favorise la concentration de nombreuses activités, celles du secteur tertiaire en particulier. Je découvre ainsi le lien entre progrès technique, circulation des informations et dynamiques économiques.
L’effort que je mène ainsi durant une quinzaine d’années pour me familiariser à l’économie me permet d’élargir considérablement la conception que je me fais de l’espace et d’y mesurer l’importance des flux d’information. La cybernétique que m’a fait découvrir mon beau-frère au début des années 1950, est axée sur ce domaine. Je prends ainsi conscience du rôle de la communication dans la structuration du territoire et dans les dynamismes économiques. J’attire aussi l’attention sur un fait négligé par les économistes : les coûts intermédiaires de commutation (Claval, 1977a) pèsent autant sur l’acheminement des informations que les coûts intermédiaires de tri et groupage sur celui des marchandises – notion essentielle pour comprendre la dynamique des lieux centraux.
La monnaie, l’utilitarisme et l’unification du champ
L’économie m’apprend d’autres choses encore. Elle analyse la production, la distribution et la consommation de biens matériels et de services. L’unité de ce domaine ne va pas de soi : dans les sociétés premières, l’échange de produits alimentaires, de certaines matières premières (le silex ou l’obsidienne par exemple) et des premiers objets fabriqués peut reposer sur la compensation immédiate d’un bien par un autre – sur le troc. Il n’en va pas de même pour les services : le sorcier qui prédit l’avenir ou le guérisseur qui soigne ne peut attendre de ceux qu’il aide un service équivalent à celui qu’il rend. C’est donc à des compensations décalées dans le temps que donnent lieu les services : elles lient les personnes dans la durée, au lieu de les laisser libres de toute obligation future. L’unification du champ économique résulte de l’introduction d’un moyen de compensation universel : la monnaie. C’est grâce à elle que des prix se forment et que la régulation de l’économie peut devenir autonome grâce au mécanisme du marché.
L’introduction des prix simplifie les choix des acteurs économiques : ceux-ci évaluent l’utilité qu’ils tireront de l’objet qu’ils désirent acheter et se décident en fonction du prix à payer. La science économique se fonde sur cette base utilitariste : les décisions relatives à l’échange reposent sur l’avantage subjectif que procurera l’objet acheté et sur le prix auquel on peut l’acquérir ; elles sont rationnelles : en tant que consommateurs, les agents économiques n’ont d’autre but que de maximiser leur utilité ; en tant que producteurs, ils ne visent qu’à maximiser leurs revenus, qu’il s’agisse de rentes, d’intérêts, de profits ou de salaires.
L’économie contourne ainsi l’impossibilité de connaître directement les mécanismes intellectuels et les décisions qui en découlent puisque celles qu’elle étudie sont rationnelles et donc compréhensibles et prévisibles de l’extérieur. Il est en outre possible – jusqu’à un certain point – de les traiter mathématiquement.
J’en retiens une leçon : comme l’économie, toutes les sciences sociales ont plus de facilité à traiter des décisions rationnelles que les autres, puisqu’il leur suffit de connaître les situations auxquelles font face les agents qu’elles observent pour comprendre leurs choix. Leurs stratégies de recherche en sont marquées.
Certains économistes jugent exagérément simplificatrice l’hypothèse de la rationalité des décisions économiques et introduisent d’autres approches : Karl Polanyi (1944) donne le signal en opposant aux économies de marché les économies de don et celles de prélèvement et redistribution. Ces mouvements m’intéressent – je rends compte par exemple des travaux consacrés aux économies des sociétés d’ethnologues (Claval, 1971) – mais je n’en fais pas état dans les textes de géographie économique que j’élabore : pour moi, l’apport spécifique de l’économie résulte de sa focalisation sur la rationalité des choix.
Emprunts à l’économie spatiale et utilisation
de nouvelles méthodes statistiques
C’est fort de cette expérience directe de l’économie que je participe à l’émergence de la Nouvelle Géographie et que j’en deviens, je pense, le premier historien.
Ce que proposent les ouvrages de Hoover (1948), de Claude Ponsard (1955) et de Walter Isard (1956) dans les années d’après-guerre, c’est une synthèse de ce qu’enseigne l’économie spatiale sur la localisation des activités agricoles, industrielles et de service. Les géographes apprennent ainsi à analyser le rôle de la distance et de l’éloignement dans la production, l’échange et la consommation des richesses : c’est par le domaine économique que commence la modernisation de la géographie classique. De 1955 à 1960, elle est largement menée par de jeunes chercheurs installés à l’Université de l’État de Washington à Seattle : William Garrison et Bryan J. L. Berry (1958) entre autres. Pour vérifier sur des cas concrets les résultats de l’économie spatiale, ils mobilisent un ensemble de techniques mathématiques et statistiques adaptées aux problèmes géographiques – analyse factorielle ou théorie des graphes par exemple. C’est de leur mise en œuvre que vient le sentiment de plus en plus répandu que la Nouvelle Géographie s’oppose radicalement à la géographie classique. Edward L. Ullman (1954), qui est en bonne partie à l’origine de la nouvelle école mais la conçoit avec un certain recul, remarque justement qu’elle traite d’un aspect présent dans la géographie humaine dès sa naissance, mais qui a été négligé : celui de la circulation.
L’idée que les emprunts à l’économie spatiale conduisent à un renouveau de la géographie humaine s’impose partout au début des années 1960. Pour Edward Ullman comme pour moi (Claval, 1964), ce renouveau est plutôt lié à l’exploitation d’une composante jusque-là négligée de la géographie classique qu’à une rupture totale. Pour nombre de chercheurs, qui associent recours à l’économie et mise en œuvre d’outils méthodologiques plus puissants, c’est grâce à ces derniers que la discipline devient réellement scientifique. À la suite d’un article rédigé par un géographe autrichien réfugié aux États-Unis, Fred K. Schaeffer (1953), ce renouveau est interprété comme la rupture avec l’exceptionnalisme1 qui caractérisait jusqu’alors la géographie humaine. Celle-ci doit enfin emprunter la voie commune à toutes les disciplines telle qu’elle a été définie par le néo-positivisme logique de l’École de Vienne dans les années 1920 et le début des années 1930. C’est la thèse que défend William Bunge en 1963, celle qui justifie le nom de Nouvelle Géographie que donne Peter Gould (1969) à ce nouveau courant en 1968.
À l’utilisation des modèles de Johann-Heinrich von Thünen (1825 ; 1852) pour la distribution annulaire des activités agricoles (résultats étendus à l’espace urbain par William Alonso, 1964), d’Alfred Weber (1909) pour la localisation des industries et de Walter Christaller (2006 [1933]) pour les activités de service, s’ajoutent de plus en plus des emprunts à la macroéconomie. L’emploi des comptabilités territoriales, qui paraissait offrir une piste intéressante pour mesurer le dynamisme des ensembles régionaux ou nationaux, se révèle décevant par suite de la grande instabilité des flux. D’autres aspects de ces recherches se révèlent plus féconds : les équipements productifs et les économies d’échelle qu’ils génèrent expliquent à la fois la croissance rapide des activités de transformation et leur accumulation en un nombre restreint de points ou de régions. Les infrastructures de transport et de communication et les économies externes qu’elles font naître sont à l’origine de la polarisation des activités dans les lieux centraux propices à l’échange des informations.
De nouveaux protocoles de collecte des données géographiques apparaissent. La division du travail s’est accélérée avec l’urbanisation et l’industrialisation. Pour comprendre la société, on ne peut se contenter de données spatialement agrégées : il faut savoir où chacun se trouve et ce qu’il fait à chaque instant. Torstein Hägerstrand (1970) s’inspire des techniques qu’utilisent les chorégraphes lorsqu’ils notent les mouvements des danseurs pour retracer les déplacements des individus dans l’espace et dans le temps – les collègues anglophones qualifient sa façon de concevoir la discipline de time geography. Pour parvenir au même but, je propose de procéder à l’élaboration de budgets temps-espace pour l’ensemble des populations (Claval, 1973).
La nature de l’espace économique
Pour la Nouvelle Géographie, l’économie est tournée vers l’échange, si bien que l’espace l’intéresse au premier chef par la circulation des biens, des hommes et des informations qui y prend place. La distance apparaît comme un obstacle qui freine ou interdit les mouvements ; il faut vaincre cette résistance ; on n’y parvient pas toujours sans dommage pour ce qui est transféré : des marchandises sont perdues, détruites ou détériorées ; les voyageurs encourent des fatigues et des dangers ; une partie des nouvelles ou des données que l’on veut transférer se perd en route. Pour réaliser un déplacement, il faut accepter de payer pour l’énergie dépensée, pour l’amortissement des infrastructures, pour celui des supports d’informations ou des véhicules utilisés et pour s’assurer contre les risques encourus.
On distingue ainsi : (i) des coûts de conditionnement, de chargement ou d’émission au départ, (ii) des coûts de déplacement (directs, en énergie dépensée, ou indirects, liés à la détérioration des biens transportés ou à la perte d’une partie de l’information contenue dans les messages), (iii) des coûts de transbordement (pour les biens et les personnes) et de commutation ou de changement de partenaires (pour les informations) et (iv) des coûts de réception. Au total, les charges de transport du bien ou d’acheminement de l’information s’ajoutent aux frais de production : la demande faiblit en conséquence en fonction de l’éloignement.
Pour simplifier leurs raisonnements, les économistes se placent d’abord dans le cas où l’espace oppose la même résistance au mouvement en tout lieu et pour toute direction – on le dit alors isotrope. Dans ce cas, l’accessibilité diminue régulièrement en fonction de l’éloignement ; l’espace se structure en anneaux concentriques.
La réalité est plus complexe : les hommes ouvrent des sentiers ou des pistes, aménagent des chaussées, construisent des routes ou des autoroutes, mettent en place des voies ferrées. L’espace ne se présente plus comme une surface homogène – comme une plaine de transport, disent les économistes. Il est structuré par des réseaux qui permettent de faire voyager à moindres frais personnes, biens, informations ou moyens de paiement. Le réseau est articulé autour de sommets : les lignes y convergent ou s’y croisent ; c’est là qu’interviennent les changements d’itinéraires, les transbordements ou la commutation d’un partenaire à un autre. L’organisation rationnelle et la concentration de ces opérations en diminuent le coût et augmentent l’attractivité de ces lieux centraux.
L’espace qu’explore la Nouvelle Géographie apparaît comme le complément de celui qu’analysait la géographie classique : au lieu de s’attacher à l’étendue, on met l’accent sur les flux qui la parcourent, sur les lignes qui les canalisent et sur les réseaux qu’elles constituent. Les lieux centraux vers lesquels convergent les lignes et où elles se croisent, jouissent d’une attractivité particulière, due aux économies qui naissent de leurs installations de transbordement, triage et groupage des biens, ou de celles qui assurent la commutation rapide et efficace entre les partenaires qui échangent des informations ou entre les branchements qui les joignent.
Les réseaux constituent l’armature économique de l’espace. Les trafics se concentrent sur les itinéraires les mieux équipés car les coûts de transport y sont plus faibles. Les lieux de contact attirent les décideurs car les informations disponibles y sont plus variées et plus facilement acquises ; y accéder y revient moins cher. Les marchés où se prennent les décisions qui régulent la vie économique s’y fixent.
Au lieu de mettre l’accent sur l’étendue, sa diversité naturelle, la manière dont la société la met en valeur et dont elle la dote de droits de propriété et de limites, la recherche s’attache aux réseaux, aux lieux centraux – ou aux aires centrales – qui les structurent et aux activités qu’ils attirent. Ce que l’on retient de l’espace, ce n’est plus seulement la fécondité plus ou moins grande des environnements qu’il offre, mais l’accessibilité plus ou moins forte des lieux qui le composent.
Mai 1968 : un changement de contexte épistémologique
Le contexte intellectuel dans lequel vit la France – et dans une large mesure, celui qui caractérise l’ensemble de l’Occident – après 1945 est fortement marqué par la guerre et par la condamnation des fascismes, celle du nazisme en particulier à cause de la Shoah ; il l’est aussi par le triomphe de conceptions de la science mises au point dans le monde germanique de l’entre-deux-guerres, et par les mutations que le conflit a entraîné dans les méthodes mises en œuvre par la recherche.
1. Les savants du XIXe siècle se réclamaient de l’une ou l’autre de deux grandes familles de conceptions de la démarche scientifique. Pour les positivistes, les faits dictaient directement aux savants les lois qu’ils mettaient en évidence. Pour les kantiens et néo-kantiens, la réalité profonde des noumènes échappait à l’observateur, qui ne percevait que les phénomènes que révélaient ses sens. L’esprit construisait ensuite, à coup de concepts, d’hypothèses et de théorie, une explication. On confirmait sa validité en la soumettant à l’expérience.
La réflexion sur les progrès de la physique fait évoluer les positions à partir de 1900. Cela aboutit, dans l’entre-deux-guerres, à la formulation en Autriche et par le Cercle de Vienne, d’une version beaucoup plus élaborée du positivisme : elle reconnaît la place de l’esprit dans l’élaboration des interprétations – et intègre ainsi une partie de l’apport kantien – et insiste sur la phase ultime de vérification – ou dans la version voisine proposée par Karl Popper, sur la résistance des résultats aux épreuves visant à montrer qu’on peut les réfuter.
L’impact des idées du Cercle de Vienne demeure pour l’essentiel limité au monde germanophone jusqu’à l’arrivée des nazis. L’exil des chercheurs autrichiens vers le monde anglophone assure la diffusion de leurs idées à l’échelle de la planète. Le néo-positivisme logique doit s’appliquer à toutes les sciences : c’est parce qu’elle mobilise des techniques quantitatives pour établir des lois universellement valables que la Nouvelle Géographie est considérée comme une vraie science, et que la géographie classique, qui faisait la part belle à la démarche régionale, est condamnée comme exceptionnaliste.
2. L’École de Francfort connaît un destin parallèle à celui du Cercle Viennois. Elle naît sous la République de Weimar et rassemble des sociologues qui essaient de redonner aux recherches sur la société le caractère disruptif qu’elles avaient à l’époque des Lumières : ils veulent renouer avec la tradition critique de la science.
L’arrivée des nazis force également ces chercheurs à l’exil. Leurs enseignements exercent une forte influence sur les courants radicaux. Elle se manifeste surtout à l’occasion des agitations de 1968. Les jeunes chercheurs sont nombreux à critiquer violemment le conservatisme de la géographie classique et de la Nouvelle Géographie.
3. La guerre a eu des effets profonds sur la recherche, celle qui vise à la production de nouvelles armes, bien sûr, mais celle aussi qui accélère leur production ou permet de les employer plus efficacement. Il en va ainsi de tout ce qui a trait à la préparation des débarquements ou à la réalisation des bombardements : la logistique s’appuie de plus en plus sur des algorithmes pour organiser et maîtriser les flux. L’emploi de méthodes statistiques et mathématiques ne pourrait-il pas être utile dans l’ensemble des sciences de la société, comme le suggère Lévi-Strauss (1955) ?
4. La guerre favorise parfois les rencontres entre des spécialistes de domaines qui s’ignoraient jusque-là. C’est ce qui arrive à New York, où Lévi-Strauss et Roman Jakobson sont l’un et l’autre réfugiés. L’idée de transposer les méthodes structuralistes de la linguistique à l’ethnologie germe alors. Elle s’épanouit dans les années 1950 (Lévi-Strauss, 1958). Elle balaie en quelques années l’ensemble des sciences de l’homme, avant d’être attaquée, à la fin des années 1960 : l’approche par les structures rend en effet difficilement compte des évolutions.
Les versions radicales
de la Nouvelle Géographie économique
La Nouvelle Géographie connaît un succès fulgurant du milieu des années 1950 à 1970 : elle balaie le monde en quinze ans. D’autres modes la détrônent alors : la discipline est une science du concret, des lieux, et pas seulement de l’entité abstraite que constitue l’espace ; des courants phénoménologiques se mettent en place ; les discussions sur l’apport du structuralisme et sur la théorie des systèmes se multiplient.
Les géographes souvent désignés comme radicaux (radical geographers) estiment qu’une discipline scientifique digne de ce nom doit dénoncer les tares et les injustices de la société, ce que ne font ni la géographie classique, ni la Nouvelle Géographie. Ils se réclament fréquemment du marxisme (Harvey, 1973), mais ont de la peine à trouver dans les textes fondateurs de celui-ci de quoi inspirer leur critique. Les contradictions du capitalisme ne l’ont pas conduit à la ruine ; il n’a cessé d’évoluer depuis le début du XIXe siècle. Dans les pays industrialisés, la condition ouvrière s’est améliorée. Le marxisme ne paraît pertinent que lorsqu’il dénonce l’inégal développement et la misère du Tiers Monde.
Henri Lefebvre (1972) est le premier à mettre en évidence ce qui paralyse géographiquement le marxisme en montrant comment Marx élimine progressivement la ville de son champ d’analyse : donner une charge révolutionnaire à une théorie qui prend en compte l’étalement spatial de la vie économique est impossible ; une révolution doit tout balayer d’un coup, alors que la dispersion des hommes et des activités ralentit la diffusion des innovations et donne un caractère progressif aux évolutions. Dans « Le marxisme et l’espace » (1977), je souligne ce qui prive ainsi dès le départ la pensée de Marx d’applications géographiques.
David Harvey est conscient du problème. Il en propose une solution en 1982, dans The Limits to Capital. Sa relecture du Capital ne l’amène cependant pas à remettre en cause ce qui est au cœur de la doctrine marxiste : l’entrepreneur se conforme aux règles du marché ; il rémunère le travail de ses salariés à sa valeur d’échange (qui tend à se limiter à ce qu’il faut pour assurer leur reproduction) et le revend, incorporé dans le produit, à sa valeur d’usage qui est supérieure : il empoche cette plus-value, source de ses profits. Il faut toute la subtilité de la pensée de Marx dans le livre I du Capital pour dévoiler cette réalité, qui reste cachée aux yeux des intéressés eux-mêmes ; il existait jusque-là un inconscient de l’économie, dont le mystère est enfin levé : les travailleurs sont exploités. Malgré ses performances, le système capitaliste est condamnable et doit être combattu pour le remplacer par un autre.
David Harvey ne réintroduit pas l’espace dans la genèse du capital, mais dans les effets que celui-ci induit une fois en place. L’industrie démarre. Pour maximiser leurs profits, les entrepreneurs s’installent au point où sont minimaux les salaires qu’ils versent et les frais de transport de l’énergie, des matières premières, des pièces détachées ou des sous-ensembles dont ils ont besoin. Les foyers où se fixent les nouvelles activités se transforment ainsi en régions industrielles à coup d’indurations spatiales – de spatial fixes, écrit Harvey. Les équipements industriels se multiplient ; des routes, des voies ferrées, des logements sont construits ; l’activité productive entraîne de la pollution contre laquelle il convient de lutter. Les syndicats obtiennent des augmentations de salaire. Tout devient plus cher : la logique capitaliste, qui avait attiré les entreprises en un point, finit par les en détourner.
David Harvey vient de la Nouvelle Géographie économique, dont il est un des théoriciens les plus en vue dans les années 1960. Il emprunte à l’économie et à la géographie économique libérales la mécanique de l’accumulation des équipements et de leurs effets à terme ; il en convient lui-même :
« Dans une certaine mesure, cette ligne d’argumentation est parallèle à la théorie classique de la localisation […]. La différence principale réside dans le fait que les travaux de celle-ci s’efforcent surtout d’identifier un équilibre spatial, alors que les processus d’accumulation du capital sont perçus comme perpétuellement en expansion et, par conséquent, nient de manière permanente la tendance à l’équilibre » (Harvey, 2010, p. 121).
Ce que développe donc David Harvey, ce n’est pas une théorie marxiste, c’est la greffe sur celle-ci d’une version de la Nouvelle Géographie économique modifiée dans la mesure où les processus d’accumulation du capital y « sont perçus comme perpétuellement en expansion ». Le monde qu’ils créent n’évolue pas vers l’équilibre mais vers la dramatisation des tensions.
Les recherches sur le rôle de l’induration spatiale (le spatial fix) dans la dynamique des sociétés contemporaines se révèlent surtout fécondes dans le domaine urbain et dans celui de l’aménagement du territoire, comme en témoignent les travaux de David Harvey lui-même (1985a ; 1985b 2003) ou de Kevin Cox (2020 ; 2021). Henri Lefebvre souligne que l’extension progressive de l’accumulation capitaliste à tous les domaines de l’activité productive et de la vie transforme profondément l’étendue terrestre : il parle en ce domaine de production de l’espace (1974), une expression qui, prise au sens propre, est absurde, mais met en évidence la mutation profonde que la modernité fait subir aux usages et à l’organisation de la surface terrestre (Claval, 2020a, p. 213-236).
La publication de Limits to Capital soulève l’enthousiasme chez nombre de géographes radicaux, mais dix ans plus tard l’ouvrage est l’objet de critiques virulentes par une partie des chercheurs de gauche : c’est que les thèses qu’y soutient Harvey présentent les mêmes défauts que l’ensemble de la Nouvelle Géographie économique (indifférence à l’environnement ou aux inégalités de genre), dont elles ne constituent qu’une variante.
Une plongée fondatrice dans l’anthropologie
Le mouvement de rénovation initié dans les années 1950 ne disparaît pas après1968 ; il embrasse désormais l’ensemble de la géographie humaine, mais ne fait plus la une de l’actualité. Je participe activement à ce mouvement.
Je m’étais passionné pour l’économie à partir de 1955. Je découvre l’anthropologie au début des années 1960 et lui consacre une part croissante de mes lectures. Ma contribution à la construction d’une Nouvelle Géographie Humaine tient beaucoup à cette plongée.
L’attention portée aux représentations
et à des mécanismes sociaux oubliés ailleurs
Un certain nombre de grandes monographies de l’anthropologie sociale britanniques sont traduites en français au cours des années 1960. Par certains traits, elles me rappellent les études régionales des géographes ; elles en différent aussi. Adolphus Elkin (1965) [1935] dévoile les sociétés aborigènes de l’Australie, l’extraordinaire complexité de leurs systèmes de parenté, la richesse de leurs mythes, le temps du rêve auquel ne cessent de se référer leurs membres et leur enracinement dans des environnements qu’elles n’ont guère modifiés qu’en multipliant les incendies.
La vie des Nuer étudiée par Edward Evans-Pritchard (1968) [1937] est basée sur l’élevage, une situation souvent analysée par des géographes, mais le livre offre un tableau extraordinairement nuancé des qualités du bétail mises en évidence par ce peuple. Sans aucune autorité centrale, cette société segmentaire dispose cependant de mécanismes qui empêchent les conflits de s’étendre. Elle fait preuve d’un dynamisme considérable.
Les Argonautes du Pacifique occidental de Bronislaw Malinowski (1963) [1922] relatent les longs circuits sur lesquels transitent les biens de prestige, la kula en particulier, dans les mers qui avoisinent la pointe orientale de la Nouvelle-Guinée ; l’ouvrage analyse les systèmes d’obligations qu’ils génèrent et la manière dont ils contribuent à l’équilibre des tribus impliquées. Les Jardins de corail (Malinowski, 1974 [1935]) décrivent une agriculture tropicale sur brûlis semblable à celle que les géographes font alors connaître en bien d’autres parties du monde, mais l’ouvrage en présente les paysages de manière plus vivante et souligne la valeur symbolique de la principale culture, celle du taro, et le prestige dont bénéficient ceux qui en récoltent les plus imposantes et les plus belles racines.
Une réflexion fondamentale sur la culture
Comme la géographie, l’anthropologie repose sur un travail systématique de terrain, mais il est mené dans une perspective différente. Quelques dates ont marqué profondément la réflexion en ce domaine. Dans Primitive Culture, en 1871, Edward Tylor propose la première définition moderne de la culture :
« La culture, ou civilisation … est cet ensemble qui inclut la connaissance, les croyances, l’art, la loi, la morale, la coutume et toutes les autres aptitudes ou habitudes acquises par l’homme en tant que membre de la société » (Tylor, 1871, p. 1).
La culture est ainsi le bagage qui socialise les hommes et leur permet de vivre dans un environnement anthropisé et dans un milieu social qui a un sens pour eux.
Je tire beaucoup de l’analyse fouillée du mot culture proposée en 1952 par Alfred Kroeber et Clyde Kluckhohn (1952), et de celle tout aussi intéressante consacrée en 1930 au terme voisin de civilisation et publiée sous la direction de Lucien Febvre (1930). Pour Ralph Linton (1968) [1936], l’interprétation de toute société implique l’élaboration d’un modèle de l’homme et d’un modèle de la société qui soient compatibles : l’éducation différente que reçoivent les gens peut ainsi les préparer à jouer des rôles dont la complémentarité assure le fonctionnement sans heurt de la société – interprétation alors fréquente des sociétés apparemment sans histoire qu’étudient les ethnologues. L’explication est évidemment datée, mais l’accent sur les comportements individuels, les institutions sociales et les mécanismes qui assurent leur adaptation mutuelle me paraît fécond.
Oralité et écriture
Les anthropologues s’intéressent par priorité aux sociétés premières où domine l’oralité. Les folkloristes s’attachent plutôt aux couches populaires des sociétés traditionnelles : la plupart des membres de ces dernières ne savent ni lire ni écrire, mais les milieux où ils évoluent sont encadrés par des élites féodales, des bourgeoisies foncières ou commerciales et des administrations – milieux où l’on sait manier la plume. Ces chercheurs ne manquent pas de s’interroger sur l’influence que l’oralité et l’écriture exercent sur les dynamiques culturelles.
L’oralité pure enferme les groupes dans des espaces fragmentés et dans des temps très ramassés. Les enfants sont fascinés par les pratiques de la vie quotidienne comme par les gestes qu’ils voient autour d’eux ; ils les imitent et les assimilent en même temps. La parole complète et explicite ce qui leur est transmis, et ceci, dans les mêmes espaces de voisinage. La culture se transmet donc sans mal, mais localement.
Dès que la parole intervient, la mémoire se trouve socialisée, mais il n’existe pas encore de support qui permette de donner une forme matérielle et durable à ce qui se dit. Les temps connus par les membres d’un groupe s’étendent au-delà de ce qu’ils ont eux-mêmes vécus, mais s’arrêtent là où se termine ce dont les anciens ont été témoins. En-deçà de ce passé mémoriel nécessairement court, rien ne permet de bâtir une histoire ferme : on entre dans l’immémorial, un temps d’avant le nôtre ; ses contours sont flous parce qu’ils ont été sans cesse revus et transformés par ceux qui en ont transmis le souvenir. C’est dans ce contexte que s’élaborent les mythes.
Dans les sociétés historiques jusqu’à l’imprimerie, à la diffusion de la lecture et de l’écriture et à l’avènement de la modernité, la situation est différente. La plus grande partie de la population ne sait ni lire, ni écrire et reçoit toujours l’essentiel de sa culture de ce qui peut s’observer et s’entendre sur place : il en va ainsi des pratiques de la vie quotidienne et de la plupart des techniques productives ; c’est également le cas d’une partie de ce qui donne un sens à la vie et qui vient de croyances ancrées sur un immémorial demeuré vivant. Mais l’écriture donne aux élites accès à des formes de croyances révélées qui s’opposent aux leçons que continuent à charrier les mythes toujours présents dans les classes les moins instruites. Elle rend possible le développement de techniques de communication et de commandement qui assurent l’encadrement d’espaces étendus et de populations nombreuses.
Des travaux comme ceux de Jack Goody (1986 ; 1994) explorent ainsi l’impact de l’oralité et de l’écriture sur la vie sociale et invitent à poursuivre des recherches de même type sur les effets des bouleversements contemporains des techniques de communication.
L’institutionnalisation de la société
La géographie économique ne retient qu’une des facettes de la vie des groupes sociaux : la production, la distribution et la consommation des biens et des services. Elle ne prend en considération que deux séries d’acteurs : les producteurs (qui se transforment en entrepreneurs et en salariés lorsque le travail se concentre dans des ateliers ou des usines) et des consommateurs ; les individus peuvent jouer, selon les moments, l’un ou l’autre de ces rôles. On ne retient d’eux qu’une caractéristique : la rationalité de leur comportement.
La vie sociale se déroule en fait dans des organisations diverses (Maquet, 1970) : au sein de la famille, les individus se partagent le travail, les décisions et les responsabilités pour assurer la reproduction des générations, la production de multiples biens, l’éducation des enfants et les soins aux personnes âgées ou aux malades et handicapés ; les gens s’associent pour assurer plus efficacement certaines tâches en coopérant. Des rapports inégaux s’instaurent entre les castes ou les ordres de certaines sociétés ; les puissants sont entourés d’une clientèle qu’ils emploient, exploitent et protègent ; dans les systèmes féodaux, les suzerains peuvent compter sur le dévouement de leurs vassaux et le travail de leurs serfs.
Dans le monde moderne, les travailleurs sont intégrés comme dirigeants, techniciens, employés ou ouvriers dans des bureaucraties (Weber, 1971 [1921-1922]) (les sociologues utilisent aujourd’hui le terme, moins critiqué, d’organisations) (Etzioni, 1966 ; 1968) ; une part essentielle de la production des biens et des services provient des entreprises, le terme par lequel les bureaucraties sont connues dans le monde des affaires ; sous la forme d’administrations, elles mettent en œuvre les mesures prises par l’État et informent les gouvernants des problèmes que connaît la société.
Les institutions politiques assurent au Prince le monopole du recours à la violence physique (on parle alors de l’exercice du pouvoir pur), mais s’appuient tout autant sur l’autorité que la population lui reconnaît.
Les relations ainsi concernées permettent aux sociétés de fonctionner : cela explique qu’elles soient dotées d’un statut officiel : elles sont institutionnalisées. Elles doublent ainsi d’un réseau social le réseau de voies de circulation du monde physique. Les relations ainsi socialisées se trouvent facilitées : les participants partagent les mêmes codes et se soumettent aux mêmes règles ; ils savent d’avance ce que l’on va leur demander et quel type de réponse y apporter ; ils sont souvent en confiance ; le long des chenaux que constituent les relations institutionnalisées, les informations voyagent mieux ; les déperditions en ligne sont plus faibles que lorsque les relations s’établissent entre des personnes indépendantes. Les rapports qui s’établissent dans le cadre des réseaux humains institutionnalisés se réalisent d’égal à égal ou sont hiérarchisés. La circulation des informations bénéficie ainsi de conditions privilégiées.
Du renouveau de la géographie économique
à celui de la géographie humaine
Les relations institutionnalisées permettent aux groupes humains de tirer parti de l’environnement, de se reproduire, d’assurer hygiène et santé comme de distribuer revenus et richesses, mais leurs membres ne partagent pas les mêmes vues sur la gestion des tâches et le partage des bénéfices. Ceux qui occupent les mêmes places se heurtent aux mêmes problèmes : les intérêts qu’ils ont en commun en font des collectivités virtuelles ; celles-ci se transforment en classes lorsque leurs membres entrent en communication et prennent conscience de ce qui les unit, comme le montre le texte bien connu du Dix-huit Brumaire de Louis-Napoléon Bonaparte de Karl Marx : il y montre que la masse des paysans français, durement exploitée, rêve d’un changement, mais ne le réalise pas faute de transparence :
« Il n’existe entre les paysans parcellaires qu’un lien local et […] la similitude de leurs intérêts ne crée entre eux aucune communauté, aucune liaison nationale, ni aucune organisation politique » (Marx, 1969 [1852], p. 85).
Les groupes humains sont ainsi structurés par deux familles de relations : les relations institutionnalisées assurent production et reproduction ; les relations de classe opposent ceux dont les intérêts divergent. Les premières font fonctionner les groupes ; les secondes expriment les tensions qui naissent de leur marche et poussent à les amender et à les restructurer.
La vie des groupes humains ne repose pas uniquement sur l’échange. Dans la famille, dans les associations et dans les autres formes de relations, la conduite n’est pas automatiquement dictée par l’intérêt égoïste de chacun ; elle l’est aussi par des sentiments de solidarité. Au pouvoir économique qu’assure la possession des moyens de production s’ajoute les jeux de la force physique et de l’autorité. Ce que les gens attendent de la vie sociale, ce n’est pas seulement l’accès aux richesses et l’exercice de la puissance ; c’est la reconnaissance par autrui de ce qu’ils sont et qu’ils font, et le statut qui en résulte. L’éloignement n’affecte pas de la même façon les relations économiques, les relations de pouvoir pur (qui exigent une surveillance constante de la population), celles d’autorité (qui réduisent les coûts de contrôle, mais exigent un fort investissement dans l’éducation), la coopération volontaire au sein des associations ou les diverses formes de relations inégalitaires des sociétés traditionnelles.
Comme la Nouvelle Géographie économique, la Nouvelle Géographie humaine appréhende l’espace comme structuré par des lignes et des points de rencontre et de convergence ; il est architecturé en réseaux. Ce qui est nouveau, c’est que la distance y joue à la fois comme obstacle physique et comme dimension culturelle. Les réseaux sociaux s’appuient sur les voies de transport et les lignes de communication, mais y juxtaposent les effets de proximité, d’éloignement ou de coupure qu’introduisent valeurs partagées ou oppositions viscérales.
À la sphère de la société civile, dont les relations institutionnalisées excluent le recours à la force physique s’oppose le système politique, qui la coiffe, dispose du monopole du recours à la violence ainsi que de l’autorité que lui vaut son mode d’institution. Aux réseaux hiérarchisés de la vie politique, du monde féodal, des relations de caste et de clientèle s’opposent les rapports égalitaires des associations et, dans une certaine mesure, de l’échange.
La distance ne se mesure plus seulement en dépenses d’énergie, en fatigue et en coûts. Elle pèse moins lorsque la confiance règne, ce qui allège les coûts de surveillance ; elle devient un obstacle dirimant lorsque la méfiance s’installe et que tout incite à se défier de la parole ou des actes d’autrui.
Qu’elle soit purement économique ou plus largement humaine, la Nouvelle Géographie accorde donc une place essentielle à la distance dans son analyse de la distribution et de l’activité des hommes à la surface de la terre ; elle insiste corrélativement sur les réseaux qui les rapprochent et sur les lieux où se nouent leurs rapports. En prenant en compte les jeux du pouvoir politique, elle souligne la différence fondamentale entre société civile et système politique. En signalant le rôle que tient aussi la quête de statut dans les processus sociaux, elle montre qu’on ne peut comprendre la vie sociale sans faire une place aux processus culturels. La Nouvelle Géographie humaine se montre nettement plus sensible aux dynamiques sociales que ne le faisait la géographie classique – mais faute d’outils pour analyser la culture, elle reste à la surface des choses. L’approfondissement de la discipline doit se poursuivre.
La Nouvelle Géographie humaine met en évidence la diversité des architectures sociales, jusque-là négligées (Claval, 1973) ; elle construit l’analyse politique sur des bases qui ne la réduisent pas aux structures étatiques, les seules, jusqu’alors, prises en compte (Claval, 1978) ; elle conduit à l’élaboration d’une théorie cohérente des villes comme lieux assurant la maximisation des interactions sociales (Claval, 1981).
Note
- On qualifie ainsi l’idée selon laquelle la géographie, à la différence des autres sciences, ne chercherait pas à établir des lois générales, et s’attacherait à souligner la différenciation régionale de la terre. On exprime aussi ce même thème en opposant les démarches nomothétiques et celles qui sont idiographiques.