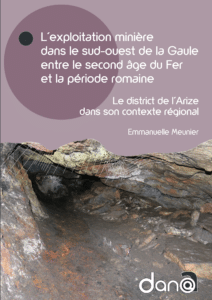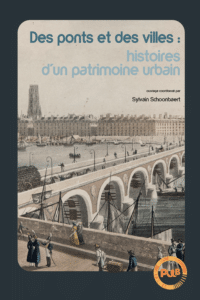UN@ est une plateforme d'édition de livres numériques pour les presses universitaires de Nouvelle-Aquitaine
Lieu d'édition : Pessac
Les vestiges miniers des Atiels sont situés au sud-ouest du hameau du même nom, en rive droite du Pézègues (fig. 119). Ils font partie d’un ensemble plus large comprenant un atelier de traitement du minerai de cuivre, au pied de la mine, et un atelier de réduction du fer, dans le hameau.
La mine de Rougé est celle qui se trouve à la plus haute altitude parmi toutes celles que l’on connaît dans ce district, entre 680 et 690 m d’altitude (fig. 51). Elle n’a fait l’objet que d’une reconnaissance au début du XXe siècle, alors que des travaux de plus grande envergure sont menés dans la mine proche de Fagnou (pour zinc et cuivre), dans laquelle il n’y a pas de vieux travaux (fig. 47).
Plusieurs inventaires des richesses minéralogiques des Pyrénées réalisés aux XVIIe et XVIIIe siècles nous sont parvenus et donnent quelques indications sur les mines en activité ou abandonnées à ces époques.
Situé au centre du département actuel de l’Ariège, le massif de l’Arize se situe dans le Séronais, entre la haute montagne et la plaine dans un axe sud-nord et entre les vallées du Salat (Couserans) et de l’Ariège (Pays de Foix) suivant un axe ouest-est (fig. 39).
par Rui Ramos Loza
Les grands aménagements du centre-ville de Rennes ont commencé au XVIIIe siècle, avec comme enjeu de développement urbain la connexion entre la ville haute et la ville basse. Le XIXe siècle aura été marqué par l’édification de murs de quai en maçonnerie, construits pour canaliser la Vilaine et assainir la ville.
par Mathieu Cardin
Les grands aménagements du centre-ville de Rennes ont commencé au XVIIIe siècle, avec comme enjeu de développement urbain la connexion entre la ville haute et la ville basse. Le XIXe siècle aura été marqué par l’édification de murs de quai en maçonnerie, construits pour canaliser la Vilaine et assainir la ville.
par Emmanuel Mary
C’est en s’interrogeant sur son devenir de « ville moderne des années 1950 », de ville maritime et industrialo-portuaire, que la construction patrimoniale de Saint-Nazaire a émergé.
Le pont de pierre, à la fois organe de fonctionnement indispensable de la ville de Bordeaux et véritable icône de son patrimoine, va faire l’objet de travaux qui sont rendus nécessaires aujourd’hui par des désordres structurels.
Le pont transbordeur de Martrou, réalisé par Ferdinand Arnodin, est construit entre mars 1898 et juillet 1900. Utilisé jusqu’en 1967, il est remplacé par un pont levant puis par le viaduc de l’estuaire en 1991.
Ville théorisée qui doit son existence à l’arsenal maritime implanté à partir de 1666, sur la rive droite de la Charente, Rochefort a exclu, lors de sa fondation, toute idée d’ouvrage d’art qui permettrait le franchissement du fleuve.
Les villes et les cours d’eau engendrent des ponts dont il est ensuite intéressant de suivre attentivement les destinées. Cela invite à se pencher sur la diversité des modalités de leur patrimonialisation et sur quelques questions que celle-ci soulève.
Depuis 1822, seuls cinq ponts ont été construits sur la Garonne à Bordeaux ; les ponts sont donc rares et précieux. À Bordeaux, la largeur de la Garonne – près de 500 mètres – ; la force des courants et des marées ; les eaux boueuses et les vases mais aussi la puissance commerciale du port de la Lune ; ont longtemps effrayé les hommes qui se sont contentés de franchir par des bacs la « mer » de Garonne, comme on l’appelait autrefois.