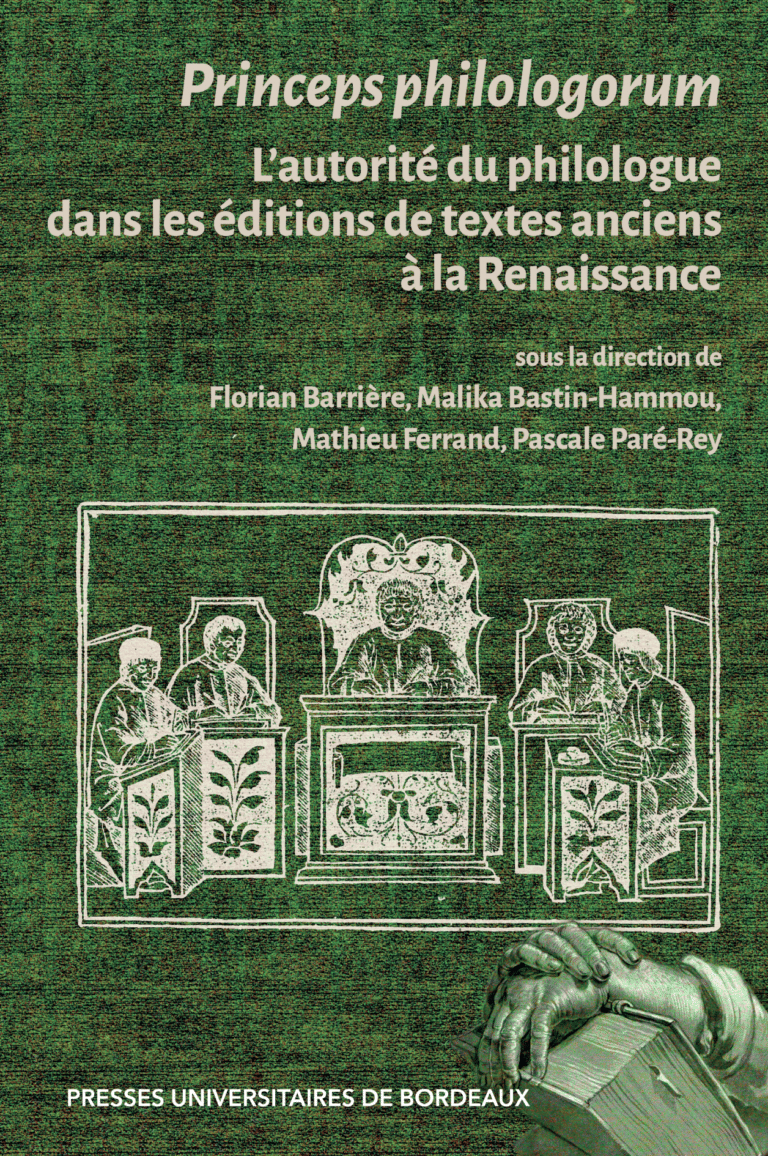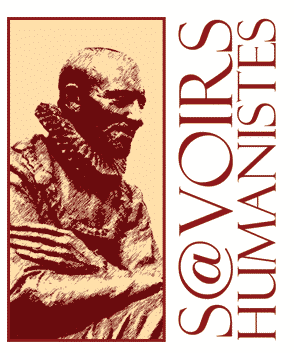La question de la place sociale des imprimeurs, notamment les plus érudits d’entre eux ayant des liens avec le monde académique, reste encore peu étudiée en histoire du livre pour le XVIe siècle1. À cette époque, par exemple, une édition de texte classique n’est pas seulement, comme à partir du XVIIIe siècle et de l’ère de la philologie moderne, l’édition du procurateur scientifique, mais plus essentiellement celle de l’imprimeur ou du libraire qui la financent, et qui en pilotent les choix matériels et intellectuels.
Les termini post quem (1503) et ante quem (1598) choisis pour la présente étude sont ceux de la première impression de Josse Bade dans son propre atelier parisien, et de la mort de son petit-fils Henri II Estienne, à Lyon : ces deux bornes ont limité mes explorations à la presse savante de l’aire géographique francophone, Genève comprise du fait de la présence des Estienne dans cette ville à partir de 1551. J’ai exploré trop brièvement d’autres sources documentant l’activité de quelques imprimeurs hors de ce périmètre pour en tirer une analyse sérieusement argumentée, mais les sondages que j’ai pu faire dans la précieuse correspondance de Christophe Plantin par exemple me semblent soutenir les hypothèses présentées.
Je m’appuierai donc sur quelques documents de base, comme l’inventaire des publications de Josse Bade par Philippe Renouard, l’édition récemment parue des préfaces de Guillaume Morel et Adrien Turnèbe, et l’ensemble des préfaces de Robert I et Henri II Estienne, ainsi que quelques autres textes de ces deux imprimeurs. Ces documents, qui sont loin d’être exhaustifs sur le livre savant en Europe au XVIe siècle, ont permis l’élaboration de premières pistes de réflexions, qui pourront être complétées.
En guise de contextualisation : vue cavalière des rapports entre la publication d’un livre savant et le monde académique
L’édition d’un livre savant suppose de multiples acteurs dont les rapports complexifient la fabrication de l’objet, sa distribution, sa vente, et donc son trajet depuis la presse jusqu’au lecteur.
Entre les lieux de production du texte et le monde académique, notamment celui de l’université, les liens sont nombreux depuis toujours, avant même l’ère de l’imprimé. À Paris, vingt-quatre libraires, qui ont dû faire preuve de leurs capacités professionnelles et de leur solidité financière, sont choisis par les recteurs des différentes nations de l’université pour être libraires-jurés : ils forment une élite de la profession qui a pour charge première d’assurer la disponibilité des textes étudiés dans les cours de l’université ou produits par ses enseignants. Cette fonction, l’officium librariatus, qui comporte, en compensation d’une contrainte de production, de nombreux avantages matériels et fiscaux, perdure du manuscrit à l’imprimé : l’université se doit de contrôler la production des textes dont elle impose la lecture, mais aussi d’en assurer l’accès au lectorat captif de ses étudiants. Elle crée ainsi une catégorie de libraires eux-mêmes captifs, qui ne peuvent que dans une moindre mesure produire pour leur propre compte, mais qui trouvent avantage à la vente ainsi assurée de leurs livres2.
Cependant, dans les années 1520-1525, l’explosion du marché du livre savant, hors de la sphère purement académique, vers la bourgeoisie commerçante urbaine et la noblesse de robe notamment, limite les avantages de ce statut qui perd de son intérêt et de son prestige, puisque toute une partie du lectorat potentiel ne se soucie plus de se fournir exclusivement chez ces libraires. Les plus âgés d’entre eux, à ce moment, pour la plupart formés au siècle précédent, déplorent alors la perte de compétence intellectuelle de leur profession, et la baisse de la qualité matérielle des livres3 : plaintes qui réapparaîtront lors de la crise de l’imprimerie parisienne et lyonnaise des années 1570-15804. Entre temps, le métier de typographus a considérablement évolué, mais la constante de la thématique souligne combien la publication d’un livre érudit est un enjeu intellectuel et social non seulement pour son auteur, mais également pour celui qui a la charge de sa réalisation matérielle.
Les lieux de production du livre savant deviennent au XVIe siècle des points de passage obligés pour les doctes formés ou en cours de formation. Dans les villes de moyenne importance, l’atelier de l’imprimeur, parfois lié au collège dans la seconde moitié du siècle, est un lieu de sociabilité pour les régents et érudits locaux où se tissent les sodalités que l’on voit ensuite à l’œuvre dans de nombreux paratextes5.
Ces doctes sont aussi mis à contribution pour le fonctionnement même de l’officine : matériellement, tout atelier a besoin de correcteurs, quel que soit le type de livres produits. Lorsqu’il s’agit de livres érudits, en latin, en grec ou en hébreu, ces correcteurs ne peuvent venir que d’une élite formée, et le milieu académique en est un grand pourvoyeur, à des niveaux divers de compétence. Comme le fait remarquer Malcom Walsby, le correcteur n’était pas le mieux payé de l’atelier6 : le compositeur et les pressiers reçoivent un meilleur salaire, reflet de leur plus grande importance dans la fabrication du livre. C’est la raison pour laquelle, hormis quelques situations devenues légendaires, comme le lien tissé entre Érasme et Froben, les correcteurs sont souvent des jeunes gens, peut-être payés en nature, c’est à dire en livres, comme cela a été établi pour Beatus Rhenanus, correcteur pendant ses études à Paris chez Jean Petit et Henri I Estienne7.
Mais il arrive aussi que ce travail de correction débouche sur une collaboration plus pérenne entre le fabricant du livre et le docte, où le rôle de ce dernier prend plus de poids dans la vie de l’officine. En effet, le monde du livre a besoin, dès ses débuts, de responsables éditoriaux. Comme le dit M. Walsby, entre l’incunable et le milieu du XVIe siècle, « le livre est passé du statut d’un nouvel objet lancé sans structures commerciales établies à celui d’une commodité régulée »8, ce qui revient à dire qu’une fois finie la période de l’expérimentation technologique, la production de livres devient une activité qui pour être viable doit être construite et réfléchie, tout particulièrement dans le domaine de la production du livre érudit : elle devient un vrai métier.
L’homme qui construit un projet éditorial, le publisher pour employer un mot anglais qui n’a pas d’exact équivalent sans confusion possible en français, n’est pas toujours le maître imprimeur qui donnera sa forme au livre. Là encore, le monde académique ou savant seconde les ateliers : Jacques Gohorry, juriste, avocat, médecin, est l’ombre conseillère de la librairie de Jacques Kerver à Paris, et poussera celui-ci à l’impression des traductions d’Alberti ou de l’Hypnerotomachia Poliphili par Jean Martin, ou de Columelle par Claude Cottereau. Ces traductions répondent aux attentes de la clientèle de Kerver, noblesse de robe, grands propriétaires, avides de se cultiver et de lire des textes auxquels seule une traduction peut leur donner accès. Dolet joue le même rôle pour Sébastien Gryphe, après avoir été un de ses correcteurs, de même que Josse Bade pour Jean Trechsel à Lyon, là encore en ayant été correcteur en un premier temps, puis pour Jean Petit à Paris. Dans tous les cas, les relations qui s’élaborent entre ces hommes sont complexes, jouent sur plusieurs registres, intellectuel, social, et personnel : par exemple, après la mort de Trechsel, Bade, qui visait la reprise de l’atelier et n’a pu l’obtenir, part à Paris mais épouse une des belles-filles de Trechsel, construisant ainsi une sorte de filiation qui légitimera l’ouverture d’une officine propre quelque temps plus tard.
Chez les libraires ou libraires-imprimeurs, le publisher a donc un rôle de pivot entre les doctes qu’il contacte ou qui le contactent pour être édités, et l’imprimeur qui réalise le livre. Mais lorsqu’il est ainsi en relation avec d’autres savants, il agit du point de vue de l’imprimeur ou du libraire pour que le projet éditorial soit utile à l’officine, et il n’agit pas pour le docte : par exemple, dans la construction d’une édition d’un texte classique, le publisher peut décider de l’accompagner d’un commentaire, existant ou suscité. Mais l’auteur de ce commentaire, s’il est vivant, a peu de pouvoir décisionnel : il ne décidera ni des modalités de mise en page de son texte, ni des autres commentaires qui peut-être entoureront le sien, ni de la publicité qu’on fera, ou pas, à son travail, et qui sera sans doute proportionnelle à sa notoriété ; au mieux, l’auteur du commentaire donnera son avis, qu’on dirait aujourd’hui consultatif. Pour dire les choses autrement, le docte qui est publisher dans un atelier ne travaille pas en priorité pour ses pairs : il est bien au service d’une entreprise, avec laquelle il a passé un contrat.
Mais il arrive aussi que l’imprimeur soit en même temps et libraire, et publisher, et savant ou philologue, c’est à dire qu’il se trouve en mesure de décider pour lui-même et pour son entreprise de la publication de son propre travail savant. Dans l’analyse de ces cas, il convient de distinguer ceux, majoritairement dans la première partie du XVIe siècle, où le savant devient imprimeur, et ceux, en général postérieurs, où un imprimeur intellectuellement formé dans l’atelier ou dans le milieu typographique met sous presse son propre travail érudit. Le décalage chronologique des deux situations, l’une étant plus fréquente avant l’autre, n’est pas anodin : il reflète l’évolution même du métier de typographe et ses conséquences sociales pour ceux qui l’exercent.
Le philologue est l’imprimeur : enthousiasmes et désillusions
Le modèle quasi mythique, et quasiment de son vivant de ce que j’appellerai ici l’humaniste-imprimeur, est Alde Manuce.
D’abord « humaniste vagabond » comme le dit M. Lowry, enseignant, lettré, protégé du seigneur de Carpi, il s’installe à Venise en 1490, s’associe avec l’imprimeur Andrea Torresani et imprime ses premiers livres en 1494-1495. Or, selon M. Lowry, il est difficile de démêler les raisons qui ont poussé Alde à abandonner une carrière d’enseignant « honorable, sinon spectaculaire », ainsi que « les protections nécessaires à un lettré de second rang » qu’il avait pu obtenir, pour embrasser une activité hasardeuse et épuisante comme Alde le reconnaît lui-même. Matériellement « Alde n’avait nul besoin de devenir imprimeur », et M. Lowry penche plutôt pour un faisceau de traits personnels : une obsession intellectuelle pour le langage, ses évolutions, son bon usage et la transmission de celui-ci ; des convictions éducatives fortes sur le pouvoir formateur de la lecture des auteurs ; et un sentiment de plus grande efficience pratique à faire œuvre de transmission par l’imprimerie que par l’enseignement9.
Le travail d’historien de M. Lowry sur la figure d’Alde est précieux car il s’affranchit de l’hagiographie : l’immense réputation qu’ont valu à Alde ses impressions soignées et ses réussites commerciales ont fait oublier qu’il était, dans sa première vie, un intellectuel bien formé, mais pas plus, si je puis dire, que tant d’autres auteurs de grammaires latines qui ont fleuri durant tout le siècle. Il faut donc croire que c’est bien l’enthousiasme et la foi dans l’outil imprimerie qui l’ont poussé à quitter sa vie de litteratus pour devenir un mecanicus : ce basculement se fait pour lui sans déclassement social, et apparemment, sa gloire a été décuplée par cette activité mécanique. La carrière du lettré serait sans doute restée plus obscure sans le choix de changer de vie, et d’apposer son nom d’imprimeur sur « des » livres devenus ainsi « ses » livres, largement diffusés en Europe.
La trajectoire d’Alde Manuce me servira de point de vue pour envisager trois cas français d’humanistes-imprimeurs dans le cours du siècle, ceux de Josse Bade, Etienne Dolet et Adrien Turnèbe. Humanistes-imprimeurs, et non l’inverse, puisque comme Alde ces trois hommes ont une formation académique, dont ils tirent une première profession de lettré, philologue ou enseignant, avant de se lancer dans une entreprise commerciale propre d’imprimerie. J’interrogerai rapidement ces trois parcours du point de vue de leurs motivations, de la réussite de l’entreprise, et de l’enjeu social qui y est, explicitement ou non, associé.
Josse Bade est, dans sa première vie, un enseignant de province, à Valence et à Lyon, sans qu’on sache vraiment ce qui l’a poussé, après des études à l’université de Louvain et un séjour en Italie, à commencer sa carrière académique dans la récente université d’une ville secondaire, puis à passer dans un centre urbain plus commercialement attractif, mais sans université. Peut-être a-t-on ici en germe un goût personnel plus tourné vers l’emporium que vers le gymnasium, termes qu’il emploie pour désigner ces deux villes en 149910. Apparemment l’activité nouvelle, commerciale et intellectuelle, que l’imprimerie apporte à Lyon dans les dernières années du XVe siècle convient aux aspirations de Bade qui, en complément de ses activités pédagogiques, travaille comme correcteur, puis comme publisher, pour Jean Trechsel, comme nous l’avons évoqué plus haut. Il y publie ses propres œuvres pédagogiques, somme toute assez modestes si on les compare aux productions d’auteurs comme Politien ou Érasme : il fournit plusieurs éditions du Doctrinale d’Alexandre de Villedieu, diverses œuvres grammaticales de son cru et accompagne plusieurs éditions de classiques de notes ou commentaires familiers, c’est à dire d’explications linéaires pour un lectorat en cours d’apprentissage. Mais sa place dans l’atelier, et sans doute la compétence qu’il y acquiert dans la gestion de l’entreprise deviennent suffisamment grandes pour qu’il souhaite prendre la suite de Trechsel à la mort de celui-ci. Déçu de n’y être pas parvenu, les intérêts de Trechsel étant passés à sa seconde épouse et aux fils de celle-ci, qui perpétueront l’atelier lyonnais, il épouse néanmoins la belle-fille de Trechsel, Hostelye Philippes, et part à Paris pour continuer à son compte cette triple activité d’enseignant, publisher et imprimeur11. À ce stade, le parcours de Bade ressemble en tout point à celui d’Alde : comme le Vénitien, il bascule dans la vie mécanique aux environs de 40 ans ; les occupations de l’imprimeur, en volume, prennent alors le pas sur celles du lettré, et il fonde une maison d’imprimerie qui se transmet à son fils. Le renom qu’il y gagne est supérieur à celui qu’avait l’enseignant valentinois ou lyonnais.
Mais Bade fréquentait le milieu des ateliers plus directement et depuis plus longtemps que Manuzio ; peut-être est-ce la raison pour laquelle il semble avoir été, pour certains, plus mecanicus que doctus, sentiment qui a pu le pousser lui-même à tenter, fût-ce discrètement, de conserver un éthos de lettré. Je présenterai trois exemples de ce que je pense être les traces de ces tiraillements. En 1514 puis 1516, Bade publie le De Asse de Budé, accompagné de notes explicatives, placées pour certaines dans des manchettes le long du texte, et pour d’autres ajoutées en fin de volume, dans une liste précédée d’un avertissement Jodocus Badius Lectori qui explique ce double appareillage12. Bade expose qu’il a perçu l’utilité de telles notes pour des lecteurs peu aguerris en latin, notes qu’il a donc élaborées dans les manchettes des premiers cahiers, pour autant que lui-même avait compris les difficultés du texte. Mais il n’a pas épuisé la matière : l’absence de l’auteur et de son aval pour ces notes en a retardé certaines, que Bade imprime donc a posteriori, à la fin, alors qu’il est dans l’impossibilité de revenir sur la composition des premiers cahiers13.
Dans ce texte, Bade se pose lui-même en philologue et pédagogue : il prend la parole à la première personne, glisse ce qui peut être une once de reproche envers l’auteur et son manque de confiance, et soigne une image d’imprimeur à la fois respectueux de son grand auteur, et capable d’être l’intermédiaire intellectuel entre un texte difficile et son lectorat. Ce rôle de passeur comporte une part de vraie ou fausse modestie devant le grand auteur savant, et une ostentation de compétence mise au service des lecteurs. Cette compétence est intellectuelle (Bade donne des explications et annote les passages difficiles), et technique, car il s’agace peut-être aussi du manque de prise en compte par Budé des impératifs matériels de la presse (on ne revient pas sur une series chartarum terminée). Or cette insouciance de Budé est peut-être la marque du doctus, alors qu’en parallèle le souci matériel exprimé par Bade est la marque du mecanicus, et un autre incident vient confirmer toute la difficulté de cette situation.
En effet, en 1528, Érasme place, dans le Ciceronianus, une comparaison entre Bade et Budé, égrenée dans la longue liste des auteurs concourant désespérément pour le titre de meilleur cicéronien. Je n’entrerai pas ici dans les interprétations littéraires ou idéologiques de cette querelle, qui ont déjà été faites de manière pertinente avant moi14, mais je reprendrai le dossier de ce court passage dans la perspective qui m’occupe.
Ce texte comporte deux versions : celle de 1529 semble égratigner plus vivement Budé que Bade, mais les deux sont identiques dans le regard qu’elles portent sur la place de Bade dans la république des lettres.
Le dialogue entre Bulephorus et Nosoponus est formulé ainsi en 1529 :
B. – Quid si Iodocum Badium ?
N. – Istum citius admiserim in hoc laudis certamen quam G. Budaeum, nec infeliciter omnino
cessit conatus Badio ; adest illi facilitas non indocta, felicius tamen cessurus,
nisi curae domesticae reique parandae studium interrupissent otium illud Musis amicum,
huius laudis candidato necessarium, utcumque Guilelmus Budaeus eximiis uariisque dotibus
suscipiendus est15.
B. Et Josse Bade ?
N. Je l’admettrais plus vite dans ce concours que Guillaume Budé, et l’effort ne réussirait
pas mal du tout à Bade. Il a une facilité qui n’est pas sans érudition, mais il réussirait
plus facilement si les soucis domestiques et le soin de s’occuper de son entreprise
n’interrompaient pas cet otium ami des Muses, nécessaire au candidat à notre prix ;
quoi qu’il en soit, Budé peut être accepté du fait de ses dons remarquables et variés.
Le sort fait à Bade me semble plus intéressant ici que celui fait à Budé : ce qu’Érasme dit clairement, mais assez habilement pour ne pas le formuler tout à fait, c’est que Bade est doté de capacités intellectuelles acceptables, sans être fulgurantes (facilitas non indocta), mais qu’elles ne seront jamais assez travaillées parce que Bade fait du commerce, negotium qui le prive de l’otium nécessaire à la figure de l’intellectuel.
Les amis de Budé, qui ont alimenté la brouille a posteriori, n’ont pas manqué de le comprendre et de le faire savoir : P. Renouard cite une redoutable lettre de Germain Brice à Érasme en août 1528, où après avoir remarqué que quoties de doctis sermo inter doctos incidit, de Badio οὑδείς λόγος, il ajoute : Illi, quod non inficiaris, quaestus tantum, non eloquentia scopus est16 (« chaque fois que, entre savants, la conversation tombe sur les savants, sur Bade, rien. Son but est le profit seulement, non l’éloquence, et d’ailleurs tu ne le nies pas »). On ne peut pas faire glose plus exacte, et plus explicite socialement, de l’habile formule érasmienne. Bade l’avait sans doute lui-même compris : compenser ce déclassement est peut-être une des raisons qui le poussent, en 1530, à produire une nouvelle marque pour son atelier, où le pressier, qui tient le barreau de la presse, et lui ressemble peut-être, comme le pense Renouard17, est représenté en habits bourgeois, et non plus en costume d’ouvrier : il s’agit bien en même temps de garder au docte son appartenance à une catégorie sociale supérieure à celle du travail mécanique, et de faire de l’imprimeur un personnage socialement respectable.
Dans la même perspective d’analyse, je mentionnerai brièvement quelques points des expériences d’imprimeurs d’Etienne Dolet et Adrien Turnèbe. Dolet, jeune et très brillant savant, se trouve en 1538 au firmament de sa gloire intellectuelle : il a sans doute été correcteur chez Sébastien Gryphe à Lyon, puis, ayant reçu de François Ier, en 1539, un extraordinaire privilège d’auteur l’autorisant à imprimer de manière protégée pendant dix ans ses propres œuvres et celles des auteurs modernes qu’il choisirait, il se lance dans le commerce de la librairie, en attendant de trouver les fonds nécessaires et l’associé financier qui lui permettra d’ouvrir un atelier d’imprimerie, en 154018. Or les deux entreprises commerciales de Dolet, celle de la librairie comme celle de l’imprimerie, ont été un échec : l’impression de Marot en 1538 est, selon Guillaume Berthon, « un fiasco » et l’atelier d’imprimerie ne vivra que deux ans, avant sa mise en gérance et sa faillite lorsque Dolet est condamné en 1542. Mais si l’on en croit les commentateurs de ce parcours malheureux19, cette condamnation n’est pas la seule cause de l’échec. Dolet semble n’avoir jamais été accepté de ses pairs en commerce : trop brillant, trop prétentieux, bardé d’un privilège exorbitant qui le rend plus jalousé que courtisé, cela d’autant plus qu’il l’exhibe avec orgueil, tout montre qu’il n’est pas du même monde, et que son statut de literatus l’éloigne des mecanici. Cette situation tient probablement aussi au temps qui passe, et au fait que le métier d’imprimeur se technicise et se spécialise, prend sa place dans la société et exige désormais des compétences de corporation qui lui donnent une identité et le rendent, pour beaucoup, aussi respectable que celui du docte enseignant.
Le dernier exemple que je considérerai est celui d’Adrien Turnèbe. Brillant étudiant de la faculté des Arts, enseignant dans divers collèges et à l’université de Toulouse, Turnèbe succède à Jacques Toussaint comme lecteur royal pour le grec en 1547 et forme nombre d’humanistes de cette génération, dont Montaigne. En 1551 il est nommé imprimeur royal pour le grec, succédant à Robert I Estienne exilé à Genève, et s’associe avec Guillaume Morel, imprimeur issu d’une formation corporative dans l’atelier de Jean de Loys, pour exercer cette charge.
Or, en 1555, Turnèbe cède à Morel les fontes des grecs du Roy qu’il a obtenues de Charles Estienne, et abandonne l’imprimerie, pour ne plus exercer que la tâche de professeur de philosophie grecque : Morel devient lui-même imprimeur du roi pour le grec, et se charge de toutes les réalisations matérielles de l’imprimerie. En mai 1560, Turnèbe explique ainsi son choix à Camerarius dans une lettre en grec20 : « Pour ce qui est d’éditer des livres, voilà bien deux ans que j’ai condamné sans appel l’art typographique : j’y ai renoncé, car c’était une perte d’argent, de temps et de santé. Maintenant c’est Morel qui a la haute main sur les types royaux21 ». Dans la mesure où l’entreprise de Morel ne périclite nullement après le départ de Turnèbe, on peut conclure que le rejet de celui-ci est bien lié à l’activité elle-même, où Turnèbe n’est pas à sa place : pour le dire autrement, Turnèbe reconnaît, me semble-t-il, qu’imprimeur est un métier, autre que celui de literatus. Contrairement à d’autres doctes, il ne semble pas que cet échec ait nourri chez Turnèbe un quelconque dédain social de l’activité mécanique.
En 1564, immédiatement après la mort de Morel, il rédige en effet une dédicace à Charles IX en tête de l’édition de Cyprien, préparée par G. Morel, et imprimé par G. Desbois. Ce texte, qui déplore l’état de confusion dans le royaume généré par les guerres de religion, est aussi une supplique au roi pour qu’il confirme à la veuve et aux enfants de Morel la pension que François Ier lui avait octroyée. Il revient avec admiration sur le travail de l’imprimeur et son importance éducative et culturelle :
Gulielmus Morelus rem magni et animi et impendii susceperat accomodatissimam ad horum temporum caliginem discutiendam lumenque veritatis hominibus veluti praelucendum, antiquissimos quosque ecclesiae scriptores Graecos et Latinos emittere.
Guillaume Morel avait entrepris une tâche demandant un grand courage, et un grand revenu ; cette tâche était particulièrement apte à dissiper les ténèbres de notre époque et à faire briller la lumière de la vérité pour les hommes : il s’agissait de donner au public tous les plus anciens pères de l’Église, en Grec et en Latin.
Mais la mort de cet homme, qui s’est tué à la tâche pour une transmission savante des auteurs, horum auctorum eruditioni immortuus (« mort pour enlever leur rudesse aux auteurs ») laisse sa famille sans ressources et couverte de dettes que Turnèbe demande au roi de lever, car elles ont été contractées pour le bénéfice de la république des lettres (non nequitia, sed studio de republica bene merendi22).
Qu’on doive ou non ajouter totalement foi à une épître dédicatoire éminemment rhétorique, ce texte nous éclaire sur la situation non plus d’un philologue-imprimeur, mais d’un imprimeur-philologue : même lorsque son travail intellectuel et matériel est reconnu par un savant, cela ne change en rien sa situation sociale d’homme mécanique et de négociant, responsable d’un atelier d’imprimerie dont les finances sont souvent précaires, quelle que soit la réputation de l’atelier. La philologie ne nourrit pas l’imprimeur, et le risque d’une impression hasardeuse, et ruineuse, est constant.
L’imprimeur est le philologue : une impossible reconnaissance ?
Comme l’a montré Ann Blair23, le livre savant est le lieu de prédilection, voire d’invention, du paratexte. Les éditions de textes classiques sont particulièrement le lieu de tels moments de rhétorique : sauf dans le cas de textes scolaires réimprimés maintes fois en petit format, ces éditions, parce qu’elles sont destinées à un marché extrêmement concurrentiel dès les années 152024, sont accompagnées de différents seuils destinés à protéger les acteurs du livre, et à attirer les lecteurs. Les textes dédicatoires à la recherche d’un protecteur ou financeur sont complétés de « romans philologiques » retraçant les étapes de l’édition et d’avertissements au lecteur sur la nouveauté, le soin et l’exactitude mis à lui fournir un instrument de travail dont il tirera profit – ce qui justifie son prix, parfois assez élevé.
Quand le philologue est l’imprimeur, comme Bade ou Turnèbe, sa position comme auteur du « roman philologique » du texte est confortable : il a parfaite légitimité à présenter la nouvelle édition. Par exemple, l’année suivant sa nomination comme imprimeur royal, en 1552, Turnèbe dédie à Pierre de Montdoré, bibliothécaire du roi, son édition du traité de Plutarque Sur le premier froid, suivie de sa propre traduction du texte en latin. La lettre qui justifie cette traduction s’ouvre sur une discrète figure de prétérition (Ego uero si tantis de rebus sententiam meam ueterum auctoritati interponere ausim, « Pour ma part, si j’osais donner mon avis au milieu de l’autorité des anciens sur de si grands sujets ») mais dont le premier mot est Ego, et la phrase qui présente la décision de traduire est assertive, à la première personne, établissant une connexion directe entre le philologue-imprimeur et l’auteur ancien :
feci libenter ut quem ea de re commentarium Plutarchus relinquerat in Latinum conuerterem25.
de bon gré j’ai fait en sorte de traduire en latin le commentaire que Plutarque avait laissé sur ce sujet.
Mais l’imprimeur formé dans la corporation et dont les capacités sont souvent les mêmes que celles du doctus académique, est beaucoup moins à l’aise lorsqu’il intervient lui aussi dans le « roman philologique ». Peu, dans la génération des années 1530-1560, se sentent légitimes au point d’écrire comme Turnèbe le fait dans le texte précédent. La dédicace que G. Morel offre à J. Spifame en tête de son commentaire sur le De finibus de Cicéron, imprimé en 1545 sur les presses et à la demande de son maître d’imprimerie Jean Loys, semble fabriquée à souhait pour diagnostiquer un syndrome de l’imposteur. Elle regorge d’expressions insistant sur l’imperfection intellectuelle de Morel26 : locos Oratorum, Philosophorum, Poetarum non paucos ante mihi non satis cognitos intellexerim (« je comprenais des passages des orateurs, des philosophes et des poètes dont beaucoup auparavant ne m’étaient pas assez connus »), sur le manque de polissage de son travail : nec dubito me plura reperire potuisse si plures libros excutere diligenter vacasset (« et sans aucun doute j’aurais pu trouver plus d’éléments si j’avais eu le temps de mettre au jour plus de livres »), et enfin sur le caractère privé de ce travail et sur le « piège » dans lequel Jean Loys l’a pris pour l’obliger à publier ses réflexions :
perpetua hominis exspotulatione uictus, cogor […] sub incudem reuocare ; inuito […] mihi ; praeclusis omnibus qua possem elabi tergiuersationibus ; urget […] ne ullus recusationi locus esset
vaincu par la demande sans fin de cet homme, je suis contraint de mettre le texte sous presse ; […] alors que je ne le voulais pas […] ; une fois coupées toutes les tergiversations par où je pouvais m’échapper […] ; il me presse pour qu’il n’y ait plus de place au refus
Certes, ces formules sont topiques et on rencontre ce type d’argument dans maintes préfaces du XVIe siècle à nos jours : mais je ne pense pas qu’elles soient ici uniquement topiques, ni uniquement liées à la jeunesse et à l’inexpérience de Morel. Le sentiment d’illégitimité d’un mecanicus qui n’a pas été formé à l’université et qui se charge d’un travail de literatus était sans doute fondé, et on le retrouve chez d’autres personnages de la période, tout aussi brillants que Morel, et tout aussi peu « académiques ».
J’ai déjà montré ailleurs pourquoi Robert I Estienne, rapidement après le début de sa carrière d’imprimeur, publisher et éditeur de textes classiques, revendiquait son statut mécanique plutôt que de se définir comme pair des grands érudits de son temps, auxquels pourtant il avait peu à envier27. S’entourant en effet de l’aide explicitement revendiquée de son beau-père Josse Bade, et s’appuyant sur son nom, le jeune Robert, en 1529, dissimule son ethos de philologue sous la figure d’un amicus doctissimus qui serait intervenu sur le texte de Térence qu’il publie ; le voile est le même pour l’édition des Familiares de Cicéron en 1530 puis, pour les classiques latins, Estienne cesse de travailler lui-même sur le texte, préférant imprimer des éditions portant le nom de grands universitaires, comme P. Vettori pour l’édition complète de Cicéron de 1538-1539. Estienne reprendra le travail philologique ouvertement lorsqu’il pourra le faire avec une patente sans ambiguïté, c’est à dire celle de la commande royale : on voit réapparaître discrètement Estienne philologue à la fin de la préface de l’édition d’Eusèbe de Césarée en 1544, qui ouvre les impressions faites avec les grecs du roi et les manuscrits grecs de la bibliothèque royale28. Le travail philologique est cependant revendiqué sans discontinuité sur le texte sacré, et il n’est plus question sur ce point de se dissimuler derrière un amicus quidam doctissimus, à la fois parce que la revendication confessionnelle importe à Estienne, et ensuite parce qu’elle a ses dangers : il était sans doute impensable pour lui de les faire courir globalement à toute l’officine, sans en revendiquer seul la responsabilité.
Cet effacement volontaire de sa persona savante devient l’honneur de sa vie de typographe29. Outillé de la seule connaissance présentée comme nécessaire à l’exercice de l’ars typographica humaniste, c’est à dire la connaissance précise des langues anciennes qui lui permettent une lecture exacte du texte sacré, Robert Estienne se construit un ethos d’imprimeur-philologue en restant à la place sociale où Dieu l’a mis : celle du mecanicus exerçant un negotium, et non du literatus à qui l’otium est nécessaire comme le rappelait Érasme dans le Ciceronianus. Mais cette humilité, construite aussi sur une foi réformée rigoureuse qui mène le chrétien à l’acceptation confiante du destin voulu par Dieu, sola gratia, n’est pas l’apanage de tous, ni de toutes les générations. Henri II Estienne, fils de Robert et petit-fils de Josse Bade, tempérament inquiet et déchiré, exerçant essentiellement dans la période difficile des guerres de religion, ne peut se faire à l’idée que son savoir, acquis dans la maison de son père, donc de façon corporative, n’ait pas la même reconnaissance que celui des docti issus du monde académique et reconnus par lui.
Le jeune Henri, avant la mort de son père, voyage en 1553 en Italie et y rencontre Piero Vettori, qu’il va visiter en tant qu’étudiant, comme un maître. Lors de cette visite, Vettori confie au jeune homme la publication des tragédies d’Eschyle, éditées par lui-même : il fournit à Henri un manuscrit portant le texte et les variantes qu’il souhaite voir imprimer, et attend fort longtemps la réalisation de son édition. Un volume de celle-ci lui parvient enfin en 1557 : le jeune imprimeur, fraîchement installé à Genève en parallèle de l’atelier de son père, a entrepris une série de publications de textes grecs, revenant aux classiques que son père a abandonnés pour ne plus se consacrer qu’à l’édition du texte sacré et d’œuvres spirituelles. Mais l’édition d’Eschyle n’est pas sans surprendre Vettori : elle ajoute après le texte collationné par lui tout un matériel philologique propre à Estienne, notamment des notes de sa part et d’autres variantes de texte. Dans un long texte explicatif Henricus Stephanus lectori, le jeune publisher et imprimeur et philologue ne se cache d’ailleurs pas d’avoir parfois imprimé d’autres leçons que celles que Vettori avait choisies30 :
Si quando in alio libro lectionem diuersam loco poetae congruam inueni, etsi deerat libri huius Victoriani consensus (quippe cum eam ex illo adnotatam non haberem) non dubitaui in contextum eam recipere et alteram quam nemo non mendosam esse iudicasset in calce libri adnotandam seruare31.
Toutes les fois où j’ai trouvé dans un autre livre une leçon différente, mais conforme au passage du poète, même en l’absence de consensus avec le livre de Vettori (surtout quand je n’avais pas cette leçon dans ses annotations), je n’ai pas hésité à accepter cette leçon dans le texte ; l’autre, si personne n’avait jugé qu’elle était fautive, je l’ai gardée en note à la fin du livre.
Vettori, sans surprise, jugea que le jeune homme avait outrepassé la mission d’impression qu’il lui avait confiée : lui-même et ses amis, dans leur correspondance, fustigent ensuite la pédanterie du jeune homme, son caractère difficile et son orgueil. Les annotations d’Estienne sont rejetées en bloc sans qu’aucun ne prenne la peine de les réfuter précisément : or elles ne sont pas toutes vides de sens, et on peut se demander si le mépris affiché par le doctus ne tient qu’à une juste colère devant la légèreté avec laquelle son travail a été traité, ou au sentiment d’être remis en cause par un homme mécanique qui se hausse au-dessus de sa condition – la seconde raison nourrissant probablement la première.
Quelques années plus tard, en 1569, Henri Estienne rédige et imprime l’Artis typographicae querimonia, De illiteratis quibusdam typographicis propter quos in contemptum uenit. Ce texte allégorique de 156 vers en distiques élégiaques donne la parole à l’ars typographica, qui fustige ceux qui, faute de doctrina, l’ont amenée à subir le mépris des hommes de bien. Elle récuse notamment le fait d’être responsable en elle-même des stupidités qu’elle véhicule : c’est l’imprimeur ignorant, et le mauvais usage qu’il fait de son outil, qui est méprisable, non l’imprimerie en elle-même :
Si chartas nunc ergo meas, si prela typosque, /instrumenta operis quotque ministra mei / Turba indocta malos indocte uertit in usus / Num merito in partem criminis ipsa uocer32 ?
donc, mes papiers, mes presses et mes fontes, tous ces outils serviteurs de mon œuvre, si aujourd’hui une foule sans culture les prend sans culture en mauvais usage, mérité-je d’être moi-même citée comme participant au crime ?
De plus, la Querimonia est précédée d’un texte d’Estienne qui renchérit sur le manque de connaissances des typographes de son temps, et où l’auteur construit en creux, à partir du personnage ridicule de l’imprimeur ignorant qui ne comprend pas ce qu’il imprime en latin, ou porte aux nues un correcteur qui saura trois verbes grecs, son propre ethos d’imprimeur philologue, savant à l’égal des savants, soucieux des textes des Anciens et de leur valorisation.
Mais les imprimeurs magnifiques sont ceux du passé : à la suite de la Querimonia, Estienne rédige et imprime une série de tombeaux honorifiques, en grec et en latin, intitulée Epitaphia doctorum typographorum. Parmi ces ombres des grands hommes, on trouve, à l’origine de tout, Alde Manuce ; puis Josse Bade, parens librorum plurimorum qui fuit (« celui qui fut le père de tant de livres »), puis quelques français et allemands, dont Adrien Turnèbe et Guillaume Morel, mis sur le même pied33. La série se termine sur 15 épitaphes, 6 en grec et 9 en latin, pour Robert I Estienne. L’avant-dernière représente son père en typographe du roi égal au roi lui-même, voire dépassant ses espérances, et la dernière déplore la mort du typographicae princeps celeberrimus artis, mais lui accorde la vie éternelle partout où vivent les Muses, dans un texte où apparaît trois fois le mot otia, au pluriel pour des raisons métriques, et dont le distique final mérite citation : At tu, posteritas, nostro gratare labori, Per quem pinguia sunt otia tibi parta (« Mais toi, postérité, rends grâce à notre labeur, qui a produit pour toi un otium fertile »). Prince des typographes, donc homme mécanique, son père gagne l’éternité dans la vie du literatus : je ne suis pas certaine que Robert aurait été entièrement d’accord sur cette persona posthume que lui prête son fils, mais elle résume l’idéal auquel ce dernier voulait prétendre pour lui-même.
Au fil du siècle, une inversion des pouvoirs ?
Au début du XVIe siècle, les textes philologiques liminaires des humanistes-imprimeurs sont très similaires, dans leurs formulations, à ceux dont les humanistes « tout court » sont les auteurs. Josse Bade écrit, dans l’épître dédicatoire de son édition et impression de 1507 du Doctrinale d’Alexandre de Villedieu, épître adressée eruditis cultiorum litterarum praeceptoribus (« aux précepteurs érudits des lettres les plus ornées ») : Haec omnia feci : dempsi, adieci, mutavi34 (« J’ai fait tout cela : j’ai enlevé, j’ai ajouté, j’ai modifié »).
Mais qui parle ici ? Le philologue qui a travaillé le texte du Doctrinal, le publisher qui a décidé de refondre le manuel, ou l’imprimeur qui l’a mis en livre ? Lorsqu’il travaille comme philologue, Bade ne dissocie pas les différents moments qui mènent de l’activité intellectuelle à sa réalisation matérielle, sans doute parce que cette activité peut encore se penser comme un tout, un même métier aux mêmes buts : que celui qui a le pouvoir décisionnaire sur l’établissement du texte soit aussi celui qui œuvre à sa réalisation et sa diffusion matérielles ne déclasse pas socialement le doctus de son statut d’intellectuel, ou du moins ne rend pas encore la situation ambigüe.
Le texte philologique d’un learned printer, une trentaine d’années plus tard, n’est pas exactement du même registre et amène à une autre analyse. Robert Estienne, en 1540, imprime une nouvelle édition de la Bible latine, dont il a assuré lui-même l’établissement du texte. Dans une longue adresse liminaire Christiano lectori (« au lecteur chrétien »), il détaille et explique son travail dans toutes ses parties, comme le montre l’extrait suivant :
Iam vero quod ad nostras Annotationes pertinet, illas ut olim in marginibus interioribus Bibliorum nostrorum non excudimus, quod ob copiosissimam et utilissimam accessionem, tomos suos sibi priuatim et separatim poscerent : quarum vt aliquod specimen edamus, breui tibi pariet nostra officina totum Pentateuchum, annotationibus haudquaquam pœnitendis cultum et belle instructum, quo frueris uteris interea dum in alios quoque Veteris testamenti libros, annotationes tibi concipimus et elaboramus. Cæterum nequid prætermittamus quod ad lucem et ornamentum nostrorum Bibliorum faciat, hic locus mihi opportune exigere videtur, vt varia illa compendia quibus vetera exemplaria designauimus, tibi explicemus ne eorum obscuritas legendis nostris Bibliis nauseam tibi contrahat35.
Mais pour ce qui concerne nos Annotations, nous ne les avons pas, comme précédemment, imprimées dans les marges intérieures de notre Bible, car, du fait de leur très copieux et très utile accroissement, elles réclameraient des tomes propres, individuellement et séparément. Pour en publier un échantillon, notre atelier te donnera rapidement un Pentateuque complet, travaillé et bien outillé d’annotations dont on ne doive pas se repentir, dont tu jouiras et useras pendant que nous concevons et élaborons pour toi des annotations aussi aux autres livres de l’Ancien Testament. Et pour ne rien négliger qui soit lumière et ornement de notre Bible, c’est ici le lieu opportun de t’expliquer les différents sigles par lesquels nous avons désigné les exemplaires anciens, pour que leur obscurité ne te donne pas la nausée à la lecture de notre Bible.
Sans entrer dans le détail des enjeux confessionnels de ce texte, il me semble intéressant d’y souligner la présence à parité des éléments philologiques (description des annotations, des supports utilisés pour l’établissement du texte) et des éléments matériels liés à sa réalisation. Le vocabulaire concret de l’imprimerie (in marginis interioribus, excudimus, tomos, officina36 ) y voisine avec celui de l’élaboration du texte (annotationes, vetera exemplaria ici, et «delectus ueterum lectionum, contextum Hebraicum et Graecum, libri archetypi, ad veritatem lectionis indagandam et deligendam dans d’autres passages, soit « annotations », « exemplaires anciens » ; « choix des leçons anciennes », « contexte Hébreu et Grec », « exemplaires de copie », « recherche et choix de la vérité de la leçon textuelle »37) ; enfin l’expression concipimus et elaboramus souligne les deux aspects, conceptuel et matériel, du travail entrepris. Il s’agit bien de concevoir un travail de l’esprit, avant de lui donner forme matérielle par le labor mecanicus. Si Robert Estienne fait apparaître clairement les processus matériels d’élaboration du texte que Bade englobait dans un seul discours pouvant valoir pour toutes les phases de fabrication du livre, c’est parce que sa formation intellectuelle s’est faite dans la corporation et qu’il n’entend pas l’oublier, et parce que la partie technique de son métier a pour lui autant de poids que l’autre.
Plus même, peut-être : le typographus doctus, savant aussi savant que les savants, a sur eux l’avantage d’être imprimeur, c’est-à-dire d’avoir entre les mains un redoutable pouvoir de vie ou de mort sur les textes. Henri II Estienne le dit habilement dans la Querimonia, quand il évoque en termes de puissance la tyrannie que les mauvais imprimeurs exercent sur les textes antiques qu’ils assassinent : Quid enim aliud est, obsecro, hanc in illos scriptores potestatem eiusmodi hominibus permittere quam gladios furiosis in manus tradere38 ? (« Qu’est-ce d’autre, je vous prie, de donner ce pouvoir sur ces écrivains à des hommes de cette sorte, que de mettre des épées dans les mains de fous furieux ? »). Il suffit d’abonder dans le sens de cette question rhétorique pour prendre la mesure de ce pouvoir parfois mortifère : comme avec le texte de Vettori, in fine l’imprimeur érudit a le pouvoir de façonner le travail philologique du savant à sa manière et de l’éditer à ses propres fins.
Une sorte de « mise au pas » des brillants imprimeurs philologues devient alors nécessaire, dans une répartition claire des rôles matériel et intellectuel qui met chacun, mecanicus et literatus, à sa place exacte socialement. Mais le mecanicus, s’il accepte cette place, sait également quel est son pouvoir réel. Un exemple de cette situation peut être perçu à travers les liminaires de l’édition de Démosthène imprimée par Jean Bienné en 1570. Cette édition de Démosthène achève une entreprise commencée par Guillaume Morel en 1560, et qui n’avait pu être menée à bien du fait des guerres civiles puis de la mort de l’imprimeur. Jean Bienné, qui a épousé la veuve de Morel et repris l’atelier, parvient à terminer ce travail avec Denis Lambin comme éditeur scientifique. Le texte de Démosthène est précédé de trois liminaires : une longue épître, en grec, de Lambin au roi Charles IX, qui loue l’œuvre royale de soutien à l’édition des textes depuis François Ier ; une autre épître de Lambin en latin, Lectori « Au lecteur », qui détaille les étapes philologiques de l’édition du texte, et une troisième, en latin également, de Jean Bienné au lecteur qui rapporte les étapes matérielles de la fabrication du livre.
Lorsque Lambin évoque pour Charles IX le travail de Morel, il le désigne comme τυπογράφου βασιλικοῦ, ἀνδρὸς πένητου μέν, ἄλλως δὲ οὐ πονηροῦ, μᾶλλον μέν οὖν σπουδαίου, καἱ τέχνης τυπογραφικῆς ἐμπειροτάτου39 (« imprimeur du roi, un homme pauvre mais sans méchanceté, bien plutôt plein de zèle, et très habile dans la technique de l’imprimerie »). Il me semble qu’ici le grec permet de mettre Morel à sa place requise dans la société par la faveur royale : il est homme mécanique, et le πένητος μέν, ἄλλως δὲ οὐ πονηρός est sans doute le mieux qu’on puisse faire pour lui en écho à un καλός κἀγαθός qui qualifierait un homme bien né.
Lorsqu’il passe au latin et décrit les notes philologiques que Morel a laissées sur Démosthène, Lambin en loue la qualité et le nombre, détaille les multiples supports et lectures sur lesquels l’imprimeur s’est fondé, mais précise que ces notes étaient « confuses et dans un tel désordre qu’il n’était pas facile de voir à quoi elles correspondaient ». Il a donc accepté le travail demandé par Jean Bienné malgré ses multiples occupations et a suivi la voie ouverte par Morel40. La fin du texte passe pour l’essentiel à la première personne et à la justification d’une précédente édition de Cicéron par Lambin qui a été critiquée.
Enfin, lorsque Jean Bienné prend la parole, il retrace exactement les mêmes étapes de son point de vue d’imprimeur, mais le changement d’ordre dans la présentation en fait tout le sel. Il évoque d’abord dans le registre de l’hyperbole épique l’indispensable travail de Denis Lambin41, puis, cela fait, glisse du présent au passé, de Lambin à Morel, dont il détaille le travail avec précision et louange, en le présentant comme le socle de la réalisation présente :
cum igitur Dionysio Lambino huius editionis absolutae magna gratia debeatur, tum Gulielmo Morelio mortuo nulla satis ampla laus tribui potest, qui primum hoc opus orsus est42.
Mais tandis qu’une grande reconnaissance est due à Denis Lambin qui a terminé notre édition, aucune louange assez grande ne peut être attribuée à Guillaume Morel, le défunt, qui le premier a entrepris ce travail.
Le dernier paragraphe énumère les signes diacritiques qui, dans les marges ou le texte, permettent d’identifier les parties et les sources du travail de Morel : sigles de α à θ pour désigner les huit manuscrits retenus pour établir le texte, mode de lecture de l’appareil de notes, en marge et finales, errata. Autrement dit, juste avant que le lecteur n’entre dans la lecture de Démosthène, celui qui lui en donne la clé est bien l’imprimeur, qui rappelle également que l’essentiel du travail philologique a été fait par un autre imprimeur. Sans remettre en cause la personne, le prestige et la place de Denis Lambin, professor regius, Jean Bienné signale ici discrètement mais fermement que sans lui, Bienné, et sans Morel, tout cela ne serait pas. Lambin a mis en ordre le travail de Morel que Bienné offre au lecteur : chacun sa place, mais Bienné sait rappeler que cette édition de Démosthène est celle de Morel, et la sienne, sûrement plus que celle de Lambin.
Henri II Estienne également a été reconnu comme philologue, même s’il ne l’a peut-être pas perçu aussi clairement qu’il l’aurait voulu. Lorsqu’en 1583 le jeune Sponde publie chez Episcopius à Bâle son commentaire à Homère, il le fait en s’appuyant sur l’édition d’Henri II Estienne de 156643, édition où Estienne a été à la fois philologue, établissant le texte sur les dix-huit éditions antérieures et un manuscrit, et imprimeur-libraire. Or toutes les fois que dans son commentaire Sponde cite Estienne, il le cite comme philologue, sur son établissement du texte ou ses commentaires44, mais il n’évoque jamais la partie mécanique du travail. La reconnaissance du philologue est donc acquise, mais il est difficile de savoir si cet oubli de la part typographique aurait été satisfaisant aux yeux d’Estienne lui-même.
De ces déchirements peut-être insolubles pour Henri Estienne entre l’otium et le negotium, nous avons un dernier témoignage dans l’Ephemeris d’Isaac Casaubon, son beau-fils, qui, venant d’apprendre sa mort, lui rend cet ambigu hommage :
nuntius affertur mihi de obitu charissimi capitis et quondam clarissimi, Henrici Stephani. Lugduni obiit ὀ μακαρίτης, procul domo, tanquam aliquis ἀνέστιος, qui domum Geneuae amplam habebat ; procul ab uxore, qui uxorem matronam castissimam habebat ; procul a liberis, qui habebat quatuor adhuc superstites. Dolendum : dolendum ac quidem impensius, quod nulla necessaria de caussa ὀ μακαρίτης domo aberat. Homunculi quid sumus, cum recogito, mi Stephane, mi Stephane, ἐξ οἵων εἰς οἶα ? Tu, qui poteras inter ordinis tui homines primas sine controversia tenere, maluisti deiici, quam stare. Tu, qui opes a patre tibi relictas amplissimas habuisti, maluisti istas amittere quam servare. Tu, qui a divino Numine excitatus fueras, ut literas praesertim Graecas unus omnium optime intelligeres, ut ornares, maluisti alia curare, quam τὴν Σπάρταν κοσμεῖν45.
La nouvelle m’a été apportée de la mort de ce cher Henri Estienne, lui qui fut un jour si célèbre. La chère âme est mort à Lyon, loin de chez lui, comme un vagabond, lui qui avait à Genève une maison spacieuse ; loin de son épouse, lui qui avait pour épouse la plus chaste des matrones ; loin de ses enfants, lui qui en avait encore quatre vivants. Il faut s’en attrister, et vivement, car la chère âme était parti de chez lui sans aucune raison nécessaire. Que sommes-nous, faibles humains, lorsque j’y pense, mon Estienne, mon Estienne, D’où, vers où ? Toi, qui aurais pu tenir sans conteste la première place parmi les hommes de ton rang, tu as préféré en être jeté bas plutôt que d’y rester ; toi, qui as eu une très vaste fortune, laissée par ton père, tu as préféré la perdre que la conserver ; toi qui avais été suscité par une divinité pour comprendre mieux que tout autre les lettres, et le grec particulièrement, tu as préféré t’occuper d’autre chose, plutôt que prendre soin de Sparte.
On peut certes lire ce texte, ce que fait Hélène Cazes, comme la preuve vibrante qu’Henri Estienne fut essentiellement un humaniste, c’est à dire essentiellement un intellectuel, lui donnant ainsi la reconnaissance du philologue qu’il réclamait46. Mais il me semble que, lu en son contexte historique, ce texte écrit par un doctus issu du monde académique et de l’université, qui plus est d’un fervent protestantisme, dit que tout le malheur d’Estienne a été qu’il n’a pas su rester à sa place, et que dans cette forme d’hybris sociale, il a perdu et sa position de docte doué, et sa position de typographus princeps, et sa position matérielle de bourgeois au patrimoine assuré par son père. Que Casaubon ait été le beau-fils d’Estienne et l’ait aimé, cela transparaît dans son indulgence à inculper de la faute la nature humaine plus que la personne de son beau-père : mais le regret « tu qui poteras inter ordinis tui homines primas sine controversia tenere », (« Toi, qui aurais pu tenir sans conteste la première place parmi les hommes de ton rang »), me semble être la marque de l’irréductible écart entre le literatus, ennobli de son otium, et le mecanicus, entaché de son negotium, quels que soient les biais habiles que certains mecanici, comme Bienné, savent mettre en œuvre pour rappeler leur existence et leur pouvoir.
Notes
- Ces imprimeurs érudits ou savants, passés parfois par l’université mais plus souvent éduqués dans l’atelier comme on le verra, sont désignés en anglais par l’expression learned printers. Elle me semble plus juste et plus précise que tout autre tournure française, et je l’emploierai désormais.
- Voir Dorez 1906 et Parent-Charon 1996.
- Voir Claerr à paraître.
- Crise générée à la fois par les guerres de religion et des grèves d’ouvriers ; voir Walsby 2020a.
- Sans revenir sur l’atelier de Gryphe à Lyon, celui de Guillaume Rivière à Arras par exemple, dans la seconde moitié du siècle, est très représentatif de cet univers et de ces croisements entre imprimeurs et érudits locaux. Voir Furno 2023.
- Walsby 2020b : 30.
- Bernard-Schweitzer à paraître.
- Walsby 2020a : 6.
- Lowry 1989 : 67-75, notamment : « on comprend encore moins son choix d’une activité hasardeuse alors qu’il était au sommet de sa carrière d’enseignant. […] Sa carrière avait été honorable, sinon spectaculaire. Il avait conquis l’attention de ses supérieurs, le respect de ses pairs, et surtout avait su obtenir les protections nécessaires à un lettré de second rang. » Lowry 1989 : 67 ; « mais quand nous lisons dans la première préface d’Alde “au lieu de mener une existence calme et paisible, j’ai choisi une vie de labeur et de peine”, et que nous songeons aux ressources de son protecteur, nous nous retrouvons devant le même problème. Alde n’avait nul besoin de devenir imprimeur » Lowry 1989 : 68 ; « au premier abord, Alde peut apparaitre comme un antiquaire passionné et perspicace […] qui, ayant passé une bonne partie de sa vie à acquérir des compétences précieuses, finit par ressentir le besoin de les communiquer » Lowry 1989 : 69 ; « Alde n’eut jamais rien d’un critique textuel, et ce ne fut certainement pas sa compétence dans ce domaine qui le poussa à devenir imprimeur », Lowry 1989 : 70.
- Préface à l’édition du Persii familiare commentum, Lyon, Nicolas Wolff, 1499 : Persii […] familiarem explanatione, quam […] et in Valentino perquam celebri gymnasio, et in Lugdunensi clarissimo emporio ac litterarum olim iam confugio […] praelibaueram, « un commentaire familier de Perse, que j’avais effleuré et à Valence, dans son collège si bien fréquenté, et à Lyon, place marchande très illustre et depuis longtemps refuge des lettres ». (Sauf mention particulière, les traductions des textes latins et grecs me reviennent). L’université de Valence a été créée en 1452, et n’avait donc pas quarante ans quand Bade y arrive, en 1488 ou 1489.
- Renouard 1908 : t. 1.
- Sanchi 2020 : XVIII-XXIX.
- G. Budé, De Asse, Paris, Bade, 1514, f. CXCIIIvo : « Jodocus Badius lectori. Quoniam intelleximus hujus operis lectionem negotia multis in locis exhibere iis qui non satis exercitati in lingua latina sunt, operæ pretium me facturum putavi si glossemata quaedam et scholia adnotarem in marginibus, ad sublevandum legentium laborem ; id quod fecisse mihi videor quantum quidem assequi intelligentiam potui, nisi quia transmittenda quædam esse duxi et conjecturae relinquenda, ut quisque pro captu exaudiret quas plane indicari enarrarique non debent, et quia sero hic mihi animus incessit ; nam in prioribus quaternionibus quaedam explicanda censui, nec tamen adscribenda duxi, autore operis (qui tum aberat) non connivente, quae, serie chartarum nunc tamen mutata sed litterario ordine in indice reponenda, his adiecimus, non quidem omnia, sed quae difficiliora visa sunt ». (« Nous avons compris que la lecture de cet ouvrage présentait des difficultés en de multiples lieux pour ceux qui ne sont pas assez exercés dans la langue latine ; j’ai donc pensé que je ferais œuvre utile si j’annotais le texte de quelques gloses et scholies dans les marges, pour alléger la peine du lecteur ; et je crois avoir fait cela autant du moins que j’ai pu suivre la compréhension du texte, à ces exceptions près que j’ai pensé devoir laisser de côté certains points et les laisser à la conjecture, pour que chacun, selon ses capacités, entende les choses qui ne doivent pas être montrées et expliquées explicitement, et que cela m’est venu à l’esprit tard. En effet, dans les premiers cahiers, j’avais pensé que quelques éléments devaient être expliqués, sans toutefois les annoter, car l’auteur, qui alors était absent, ne fermait pas les yeux sur ce point. Ces éléments, maintenant que l’ordre des feuilles a été modifié, mais organisé selon l’ordre alphabétique dans l’index, nous les ajoutons aux premiers : pas tous cependant, mais ceux qui paraissent les plus difficiles »).
- Voir Katz 2013.
- Érasme, Ciceronianus, Bâle, Froben, 1530 : 368-369. Il est intéressant de voir que dans son édition de 1971, P. Mesnard a du mal à admettre qu’Érasme ait pu ainsi dévaloriser Budé au profit de Bade : « On ne voit pas comment Guillaume Budé (1468-1540), leader de la Renaissance française et représentant glorieux de l’humanisme juridique, pouvait avoir été assez impertinemment sacrifié à Bade Ascensius, alors que dès la 1ère éd. (Ms A) on le reconnaissait doué (eximiis variisque dotibus). » (Mesnard 1971 : 671 note 6). Lequel Bade, par la reconnaissance d’une « facilitas non indocta », aurait reçu d’Érasme « un brevet d’humaniste, mention assez bien » (Mesnard 1971 : 671 note 5). Incrédulité qui relève peut-être de la sodalitas académique à travers les siècles, et d’une prévention sociologique vis-vis de l’imprimeur ?
- Renouard 1908 : t. I, 27.
- Renouard 1908 : t. I, 38 et 45.
- Voir Clément 2012, et sa bibliographie générale sur les différents aspects du personnage.
- Berthon 2012 : 325-344 ; Morisse 2012 : 381-402.
- Astruc 1945 : 222.
- Traduction C. Astruc. Sur Turnèbe et Morel, voir Barral-Baron et Kesckemeti 2020.
- Barral-Baron et Kesckemeti 2020 : 408-409.
- Voir Blair 2021.
- Walsby 2020b : 187-197.
- Barral-Baron et Kesckemeti 2020 : 345.
- Barral-Baron et Kesckemeti 2020 : 81-89.
- Furno 2014 : 102-105.
- Furno 2008.
- Furno 2017 : 264-267.
- Tous les éléments de ce travail philologique de Vettori ainsi que ses démêlés avec Estienne ont été étudiés par Raphaële Mouren dans sa thèse, non publiée. Je remercie son auteur de l’avoir mise à ma disposition. Pour la publication de l’Eschyle voir Mouren 1994 : 142-197.
- Henri Estienne, postface à l’édition d’Eschyle, 1557 ; voir Boudou, Cazes et Kesckemeti 2003 : 27.
- Henri Estienne, De artis typographicae querimonia, Genève, 1569 : f. a2ro.
- Henri Estienne, Epitaphia doctorum typographorum autore Henrico Staphano typographo, dans Artis typographicae querimonia, Genève, 1569. Les épitaphes sont imprimées dans une troisième partie de l’ouvrage, avec une première page ornée, dont les cahiers sont signés a.i à c.ii. Les typographes auxquels Henri Estienne rend hommage sont : Alde Manuce (une épitaphe grecque, une latine, f. a1ro-vo) ; Josse Bade (une épitaphe grecque, deux latines, f. a2ro) ; Conrad Bade (une épitaphe grecque, une latine, f. a2vo) ; Conrad Neobar (trois épitaphes grecques, une latine, f. a2r ro-vo) ; Jean Loys (Lodoicus Tiletanus) (une épitaphe grecque, une latine, f. a4ro) ; Adrien Turnèbe (une épitaphe grecque, une latine, + une épigramme grecque et deux épigrammes latines f. a4 vo –b.1vo) ; Guillaume Morel (une épitaphe grecque, une latine, f. b2ro) ; Jean Oporin (une épitaphe grecque, une latine, f. b2vo) ; et Robert Estienne (cinq épitaphes grecques, neuf latines, f. b3ro–c1vo). Sur le f. c2ro, Henri Estienne ajoute deux épitaphes, l’une grecque et l’autre latine, d’Érasme pour Jean Froben : une manière discrète de signaler quel était son modèle lorsqu’il rédigeait ces épitaphes, et combien le modèle a pu être surpassé.
- Renouard 1908 : t. II, 12.
- Boudou et Kesckemeti 2009 : 142. La suite du texte présente les sigles désignant les exemplaires consultés pour l’établissement du texte, manuscrits ou imprimé.
- « dans les marges intérieures », « nous avons imprimé », « tomes », « atelier ».
- Boudou et Kesckemeti 2009 : 140.
- Henri Estienne, Artis typographicae Querimonia, Genève, 1665, f. 3ro.
- Barral-Baron et Kesckemeti 2020 : 298.
- Barral-Baron et Kesckemeti 2020 : 303-304 : « Ego quamuis in aliis rebus a me institutis occupatissimus homini amico […] deesse nolui » (« pour moi, bien que je fusse extrêmement occupé dans d’autres entreprises, je n’ai pas voulu manquer […] à un ami »)… « Ac scholia quidem illa quae propter Morelii obitum immaturum, erant adhuc confusa et perturbato ordine collocata ita ut quo pertinerent non facile quivis interdum cerneret suo quoque loco digessi et in ordinem redegi » (« mais ces notes, du fait de la mort prématurée de Morel, étaient confuses et dans un tel désordre qu’il n’était pas facile de voir à quoi elles correspondaient ; je les ai classées chacune à sa place et les ai remises en ordre ») ; « […] in contextu enim Demosthenis recognoscendo, viam mihi iam a Morelio praemonstratam secutus sum » (« dans la reconnaissance du texte de Démosthène, j’ai suivi la voie ouverte pour moi naguère par Morel »).
- Barral-Baron et Kesckemeti 2020 : 306 : « auxilium ab aliis nobis petendum esse existimauimus » (« nous avons estimé qu’il nous fallait demander de l’aide à d’autres ») ; « […] cum ad eum confugissemus, et ab eo petivissemus ut nobis tanto oneri ferundo imparibus opem ferret […], ille […] nobis operam suam pollicitus est » (« alors que nous nous étions réfugiés après de lui [Lambin], et lui avions demandé de l’aide, car nous n’étions pas à même de porter un tel poids, il nous promis son concours ») ; « […] nisique quasi quidam Hercules Atlanti defesso in partem laboris successisset, profecto, ut ingenue fatear, tantam negotii molem perferre non potuissem» (« et si, quasiment, une sorte d’Hercule n’avait pas pris sur lui une partie du travail en faveur d’Atlas fatigué, sans aucun doute, pour être sincère, je n’aurais pas pu supporter une telle charge de travail »).
- Barral-Baron et Kesckemeti 2020 : 306.
- Deloince‑Louette 2018 : t. I, 385 note 177.
- Sponde cite douze fois Estienne, et ne s’écarte que deux fois des choix philologiques de ce dernier, en Iliade, V, 150 (Deloince‑Louette 2018 : t. I, 385) et Iliade, XVI, 689 (Deloince‑Louette 2018 : t. III, 831). Il lui rend de plus clairement hommage en Iliade, XIII, 448 : « idque non plane idem uir obseruauit. Cui pro istis ut et pro multis praetrea, debet illi multum res literaria » (« Henri Estienne n’a pas fait de mauvaises observations sur ce point. Pour cela et pour bien d’autres choses, la littérature lui doit beaucoup. ») Traduction Chr. Deloince‑Louette, dans Deloince‑Louette 2018 : t. III, 659.
- Russel 1850 : 67-68 (IIII Non. Feb. 1598). Le dernier membre de phrase en grec est une allusion à un proverbe, ici cité de façon tronquée, Σπάρταν ἔλαχες, ταύταν κόσμει « Tu as reçu Sparte, prends en soin », c’est à dire « prends soin de ce que tu possèdes ». Le proverbe est notamment cité chez Plutarque, De tranquillitate animi, 464e-477f, ou De exilio, 599a-607f. On le trouve également chez Érasme, Adages, 1401.
- Boudou, Cazes et Kecskemeti 2003 : XLVIII.