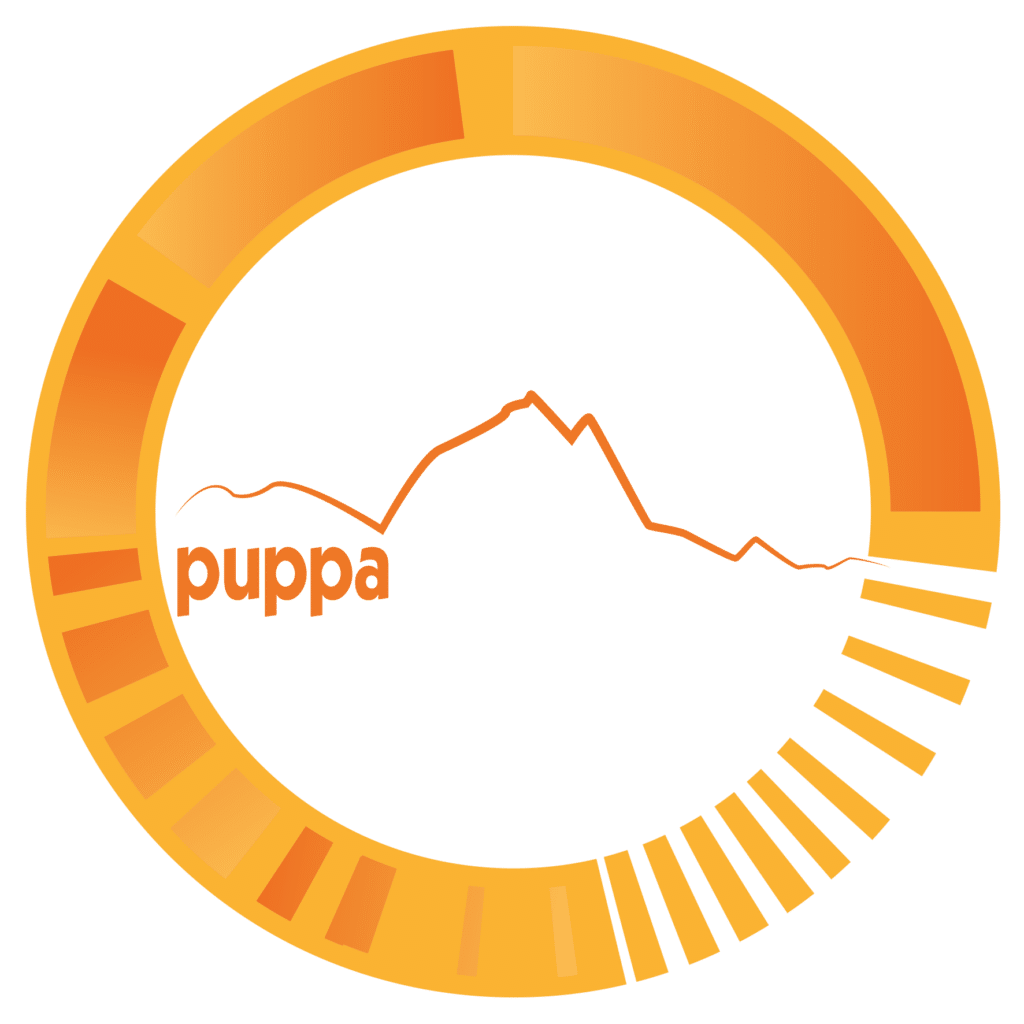Les spécialistes des mondes anciens ont toujours plaisir à apprendre des nouvelles de leurs contemporains. Surtout lorsque ces nouvelles leur enseignent que les dits « mondes anciens » continuent à être présents dans le travail des artistes vivants. La première constatation que le lecteur pourra tirer de la lecture du remarquable travail d’inventaire réalisé par Tiphaine Besnard, c’est que la présence de l’Antiquité dite classique est perceptible dans un nombre d’œuvres considérable, beaucoup plus important que ce que l’on aurait pu imaginer étant donné l’effacement progressif de la culture gréco-romaine dans la formation scolaire depuis l’Après-guerre. Si l’Antiquité a déserté les programmes, elle semble s’être maintenue dans les imaginaires. Sous quelle forme ? C’est à cette question que l’ouvrage que le lecteur s’apprête à lire s’efforce de répondre. Et la réponse n’est ni simple, ni univoque.
Il est frappant de constater que les « œuvres sources », pour reprendre le terme utilisé par l’auteur, citées plus ou moins allusivement par les artistes contemporains, peuvent être ramenées à une poignée. Elles sont désormais bien moins nombreuses que celles que l’ouvrage de Francis Haskell et Nicholas Penny avaient naguère rassemblées : il s’agissait des quelques statues antiques (moins d’une centaine), généralement romaines, que les érudits et les artistes, de la Renaissance au début du XIXe siècle, mentionnaient le plus souvent. Ce nombre se réduit aujourd’hui à une dizaine, un top ten des célébrités lapidaires. Certaines toutefois, telles que la Vénus de Milo, reviennent ad nauseam. Tiphaine Besnard montre aussi que ces références se limitent aux périodes classiques (les Ve et IVe siècles av. J.-C.) : les arts orientaux, égyptiens, minoens, étrusques, l’archaïsme grec – pourtant très en vogue avant guerre – ont presque totalement disparu. Sans doute la diminution de la place de l’Antiquité dans les savoirs contemporains y est pour quelque chose, mais l’essentiel est ailleurs. Les artistes actuels font volontairement appel à une culture largement partagée (sinon vraiment populaire), en revenant de manière presque obsessionnelle aux mêmes œuvres. Ils semblent vouloir « épuiser » ce corpus à force de répétition, le vider de sa substance. La lettre de l’œuvre disparaît au profit de ce à quoi elle est réputée renvoyer. Elle est réduite à n’être plus qu’un signe, une référence lexicalisée comme on parle de métaphore lexicalisée pour une figure de style dont la portée sémantique s’est estompée à l’usage. Ce n’est pas pour elle-même que l’Antiquité fait référence, mais pour ce qu’elle représente.
Les arts orientaux ou préclassiques n’ont été découverts et valorisés qu’assez tard. Les critiques d’art français du milieu du XIXe siècle qualifient encore les artistes qui s’inspirent de l’art grec archaïque, tels les néo-grecs regroupés autour de Jean-Léon Jérôme, de « peintres étrusques » (ce n’est pas un compliment !) ou, comme Baudelaire, d’artistes « pointus ». En revanche, l’art classique, celui des sculpteurs de la fin du Ve et du IVe s. av. J.-C. (de Phidias à Praxitèle), connu essentiellement par des copies d’époque romaine en marbre, a constitué un point de repère constant pour l’art européen depuis la Renaissance. Dès lors, l’Antiquité, ramenée à ces œuvres emblématiques, est à la fois l’origine et le marqueur d’une identité comprise comme proprement européenne. Citer l’Antique s’est donc se colleter à une tradition, pour la rejeter ou la revendiquer, à une culture européocentrée jugée hégémonique dans le discours artistique et tenue pour responsable de l’invisibilisation des autres formes d’art – qu’elles soient populaires ou extraeuropéennes. Le débat n’est pas neuf et, déjà, les artistes européens des XVIIIe et XIXe siècles ont entretenu un rapport ambivalent et tourmenté avec les modèles antiques. Le corpus rassemblé par Tiphaine Besnard donne à réfléchir. En raison de ce qu’il fait apparaître : la forte présence de l’Antiquité chez nombre d’artistes américains ou asiatiques. En raison aussi de ce qui n’apparaît pas : on est frappé par l’absence de l’Antiquité chez les artistes du monde arabe – alors que des vestiges gréco-romains sont bien visibles dans le Maghreb et au Moyen-Orient – et chez les artistes africains. Les effets d’hybridation culturelle paraissent tenir une place nodale dans les œuvres de quelques artistes dans la mesure où ils permettent d’interroger une forme d’impérialisme culturel occidental dont l’omniprésence de l’Antiquité est l’un des emblèmes. La greffe ou l’adjonction d’un élément culturellement hétérogène, en brisant l’intégrité formelle et esthétique de l’œuvre originelle, pose le problème d’un (im)possible métissage ou celui, corollaire et contestable, d’un universalisme esthétique. C’est à coup sûr l’œuvre de Xu Zhen qui incarne le plus visiblement ce mécanisme.
Si certains ignorent délibérément l’Antique, d’autres s’y confrontent vigoureusement. Tiphaine Besnard dresse une typologie édifiante des diverses formes de manipulations que les artistes font subir à l’œuvre source. Il en ressort une véritable grammaire du martyre que l’on pourrait résumer à quelques gestes simples : mutiler (fragmenter, briser, réduire, effacer) ; augmenter (colorier, greffer, agrandir) ; transposer (d’une matière ou d’un support à l’autre). L’une des interventions les plus fréquentes consiste à greffer du vivant ou du contemporain sur l’Antique : insertion d’un visage ou d’un fragment de visage contemporain, coloration de l’épiderme de la statue, corps vivant photographié dans la pose d’une œuvre antique, adjonction de vêtements contemporains.
Le processus consiste à confronter la statue et ce qu’elle incarne aux yeux des spectateurs (statisme morbide, académisme ?) à une forme d’actualisation. Ce désir, ironique ou non, de convoquer la vie en faisant intervenir un élément hétérogène et contemporain, afin, semble-t-il, de mettre à distance le modèle antique, rejoint paradoxalement un topos récurrent de la pensée esthétique des Anciens : celui de l’œuvre vivante, prête à s’animer, à se mouvoir ou à respirer. Cette idée a été largement déclinée dans la littérature ancienne pour mettre à l’épreuve la notion complexe de mimésis, de représentation de la réalité. On serait parfois tenté de penser que les artistes contemporains ont voulu prendre au pied de la lettre ce lieu commun pour mettre en évidence son inanité ou pour tenter, au contraire, de le « remotiver ».
Dans une grande majorité des exemples recensés, l’« œuvre source », le modèle antique, est repérable. Mais que se passe-t-il lorsque n’intervient aucun élément identifiable comme antique ? Qu’est-ce qui fait « Antiquité » ? En quoi peut-on dire que les photographies de Kiuston Halle, par exemple, font référence à l’Antiquité, si ce n’est leur titre ? Si certains artistes procèdent par accumulation de citations, d’autres s’abstiennent de toute allusion. L’œuvre de Cy Twombly en est l’exemple le plus éminent : l’Antiquité n’est convoquée que par les mots ; cette évocation des mondes anciens ne débouche sur aucune imagerie (ni pastiche, ni citation). Il semble que le spectateur soit invité à réactiver un monde qui n’est plus accessible à la figuration et qui n’existe plus qu’à travers les traces graphiques des affects de l’artiste. Antiquité désormais infigurable. Monde à la fois définitivement perdu et entièrement à ré-imaginer.
Le fragment occupe une place majeure dans la production des artistes contemporains. Fragments de statues, fragments d’architecture, traces graphiques ou photographique, empreintes, reflets. Ces différentes manières de convoquer une Antiquité fragmentée, en voie d’effacement, semblent traduire une impossibilité d’accéder à une forme de complétude, celle d’une certaine idée de la beauté. Même si les recherches de Tiphaine Besnard montrent que les modèles gréco-romains restent, pour quelques artistes qui ne se reconnaissent ni dans les formes, ni dans les supports contemporains, la « valeur refuge » d’une démarche réactionnaire, l’Antiquité n’est plus accessible à beaucoup que sous la forme de vestiges. L’incomplétude des formes renvoie à une béance que plus rien ne semble pouvoir combler. À certains égards, les artistes contemporains s’inscrivent dans une esthétique des ruines qui traverse l’art occidental depuis la redécouverte de la statuaire et de l’architecture antiques par les humanistes.
Pourtant, les artistes « néo-néo », comme les désigne Tiphaine Besnard, se distinguent de leurs prédécesseurs « néo-classiques » ou « néo-grecs » par le fait qu’ils semblent reporter leur attention sur le contexte de la découverte des débris de l’Antiquité. En d’autres termes, nombre d’entre eux s’intéressent davantage au statut d’« objet archéologique » des oeuvres antiques qu’à leur dimension esthétique. Les conditions de leur exhumation, la fouille archéologique, paraît exercer une véritable fascination qui peut aller de la grosse machinerie quasi « hollywoodienne » de Treasures from the Wreck of the Unbelievable de Damien Hirst, qui perpétue un imaginaire naïf du « trésor », aux effets de brisures ou d’usure (Daniel Arsham ou Christophe Charbonnel), d’entassements, de salissures (Pascal Kern) ou de confrontation avec les ruines véritables (Igor Mitoraj). Ces artistes se situent à mi-chemin entre émerveillement de la découverte et regret de la perte. Avec Daniel Spoerri (le Déjeuner sous l’herbe) le processus d’enfouissement et d’exhumation prend le pas sur le fruit de la découverte et n’entretient plus de lien qu’avec un passé en devenir. Les conditions mêmes de l’exposition muséale des objets-vestige suscitent également la réflexion : chez Vanessa Beecroft, par exemple, où les corps vivants, patinés ou non comme des statues de bronze ou de marbre, sont disposés parmi les sculptures ou exhibés comme des sculptures.
Les liens que tisse l’art « néo-néo » avec l’Antiquité sont, dans la majorité des cas, indirects. C’est moins aux œuvres antiques elles-mêmes que les artistes renvoient qu’à leur figuration : les photographies de Wilhelm von Gloeden plutôt que la statuaire antique (Oleg Maslov et Victor Kuznetsov), l’imagerie cinématographique (Pierre et Gilles), la reproduction (moulage, photographie) plutôt que l’original (seul Francesco Vezzoli semble parfois oser s’emparer d’un fragment authentique de sculpture antique). Ce constat semblerait confirmer que les artistes actuels s’intéressent moins à l’Antiquité pour elle-même qu’à sa trace, son sillage dans l’histoire des arts. Contrairement à quelques-uns de leurs prédécesseurs, ils se soucient peu d’exactitude archéologique ou d’« héritage ». L’Antiquité peut encore fasciner par ce qui résiste en elle, ce qui cherche à demeurer caché. L’intérêt porté à la démarche archéologique ne dit peut-être pas autre chose : l’objet antique doit toujours être exhumé de sa gangue opaque de terre avant de pouvoir être réinterprété. La familiarité que beaucoup ont cru entretenir avec les Anciens n’est sans doute qu’une illusion. Un critique du XIXe siècle, qui n’était pourtant pas un chantre de la modernité, ne disait pas autre chose lorsqu’il invitait les visiteurs du Salon de 1851 à se méfier des « néo-grecs » : « Il faudrait qu’ils s’abstinssent de ces extravagantes imitations d’un monde si loin de nous ; ou plutôt s’ils étaient ces érudits patients, ils sauraient si bien l’impossibilité où nous sommes de faire revivre, même par la forme, ces temps évanouis, qu’ils se garderaient de perdre leur temps à les évoquer inutilement ; ou du moins, fidèles aux traditions des grands maîtres, ils se feraient – fantaisie pour fantaisie – un monde antique à leur usage1 ».
L’ouvrage que publie Tiphaine Besnard est une somme. Et pourtant, à l’heure où s’écrit cette préface, sont certainement en train de voir le jour de nouvelles œuvres dans lesquelles l’Antiquité entre pour une part. Les lecteurs potentiels de ce beau travail y trouveront tous leur profit : non seulement les spécialistes de l’art contemporain, mais les artistes eux-mêmes, engagés à réfléchir sur leurs pratiques ; les spécialistes de l’Antiquité également, car, lorsque l’auteur mêle à la production artistique actuelle les reconstitutions des archéologues, elle invite à s’interroger sur la part d’imaginaire et de créativité qui entre dans une démarche réputée scientifique.