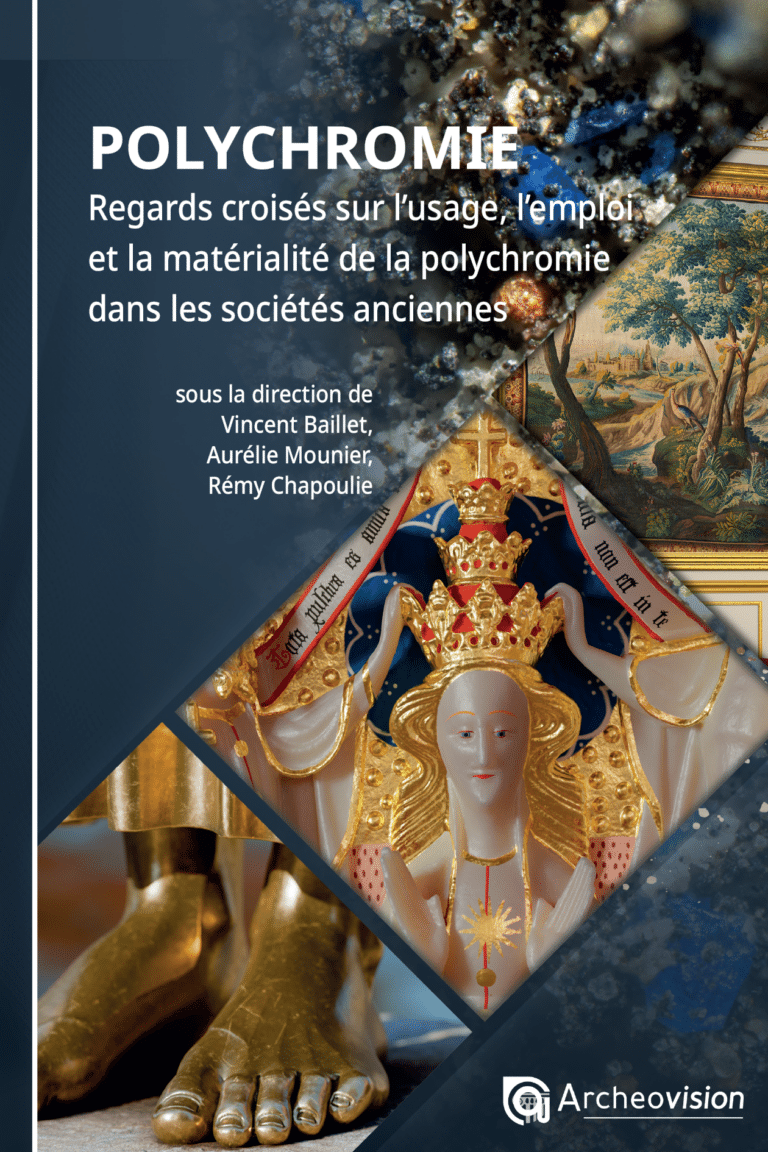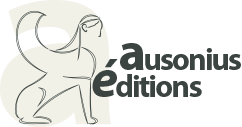Les scènes égyptiennes sont identifiables par leur style figuratif si particulier ainsi que par la qualité de leur polychromie. Les décors des temples et des tombes sont principalement gravés dans des parois en pierre. Le protocole de réalisation de ces œuvres est simple. Après avoir ravalé et enduit les parois, les contours et détails des scènes sont dessinés à la peinture noire ou rouge, puis elles sont gravées avant d’être et peintes.
La mise en relief
Après la pose du dessin préparatoire, ce sont les graveurs qui interviennent pour la mise en relief. Deux techniques1 étaient utilisées en Égypte ancienne (fig. 1) : la gravure en “bas-relief” ou la gravure en “relief dans le creux”.

Fig. 1. Relief dans le creux et relief en saillie (©O. Erhard).
Le bas-relief, ou relief en saillie.
À l’aide de ciseaux et de burins, la paroi est abaissée à l’extérieur tout autour du dessin préparatoire (fig. 1). Les zones vides sont reculées par rapport à la paroi initiale (fig. 2a). Les motifs apparaissent en relief comme posés sur un “fond” (fig. 2b). Leurs détails internes sont ensuite gravés en saillie dans l’épaisseur conservée (fig. 2c).

La progression du travail est clairement perceptible dans la figure 2 : à droite (a), les zones vides ont été dégagées en champlevé, laissant les hiéroglyphes et les motifs en saillie (b) ; à gauche (c), des graveurs modeleurs sont intervenus pour finaliser les détails internes des motifs (fig. 3).
Le relief dans le creux.
La technique consiste à graver les différents motifs directement dans l’épaisseur de la paroi2 (fig. 4). Les dessins préparatoires indiquaient à la fois la limite extérieure des motifs et les détails internes (fig. 5). Les graveurs s’appuyaient sur ces tracés, réalisés à la peinture sur la surface préalablement aplanie et blanchie, pour sculpter les contours et les éléments internes. Le trait de bord extérieur du dessin servait de guide aux artisans pour creuser un premier sillon en retrait et à l’intérieur des motifs. Un talus se formait ainsi entre le bord extérieur et ce sillon, que nous appellerons “sillon intérieur”. À l’intérieur de la zone ainsi définie, les détails internes du motif étaient ensuite modelés en relief (ici, visage du roi). Les formes apparaissaient alors comme “enfoncées” dans la paroi Cette approche est à l’origine de l’expression “gravure en relief dans le creux”.

La gravure intérieure du motif, en fonction de ses profondeurs et de ses superpositions, génère des lignes dont l’interprétation peut parfois s’avérer complexe en l’absence de polychromie (fig. 9). Toutefois, leur présence contribue à une meilleure perception des volumes figurés (fig. 10 et 11).
La polychromie au secours de la lisibilité des motifs
Les gravures exécutées dans les parois de grès, au début du règne d’Akhénaton à Karnak, n’atteignent pas la finesse de ceux de la fin du règne, réalisées dans des calcaires fins. Néanmoins, malgré une exécution encore rudimentaire, ces gravures répondent à un protocole rigoureux. Les contours extérieurs des figurations sont systématiquement doublés par un sillon intérieur (fig. 4). Un léger talus en pente vers l’intérieur les sépare. Dans le document présenté figure 6, la teinte ocre de la chaire du roi englobe le sillon intérieur pour venir, en intégrant le talus, jusqu’au contour extérieur. Les talus sont systématiquement peints, ce qui confirme définitivement que le dessin préparatoire à prendre en compte est bien le tracé extérieur et non pas le sillon intérieur.

Les techniques de gravure des scènes en relief dans le creux ont évolué au cours du règne d’Akhénaton (fig. 7). La principale avancée concerne le bord extérieur désormais étroitement lié au sillon intérieur. Il épouse de près le contour extérieur, sans toutefois se confondre avec lui. Les sculpteurs amarniens vont progressivement diminuer l’écart entre les deux et réduire la dimension du talus.

Dans l’exemple suivant (fig. 8), la polychromie conservée aide à la compréhension de l’utilisation des sillons intérieurs. Intéressons-nous au bras droit de la reine (fig. 8, coupe A-B). Le sculpteur doit descendre dans la paroi pour modeler en volume la rondeur du bras. La taille incisive permet d’effectuer le modelé, mais sur une largeur du bras réduite. Pour remédier à cette diminution, la peinture du bras s’étend d’un bord extérieur à l’autre. Elle recouvre le modelé interne du bras et les deux talus. La présence de la couleur sur les talus oblige là aussi à prendre en compte le bord extérieur comme limite du dessin du bras et non pas les sillons intérieurs.

Fig. 8. a et b. La peinture recouvre le modelé du bras d’un bord extérieur à l’autre. Elle recouvre les deux talus, franchit les sillons intérieurs et couvre le modelé interne du bras. La reine Néfertiti effectue une offrande sous les rayons d’Aton
On peut également observer l’extrémité de la manche de la tunique de la reine, nettement visible ici sur le talus. Chaque fois que la polychromie a été préservée, les talus situés entre les contours extérieurs et les sillons intérieurs sont systématiquement peints.
En l’absence de couleur, il pourrait être tentant de croire que le dessin préparatoire coïncidait avec le sillon intérieur. Une telle hypothèse constituerait toutefois une erreur d’interprétation. Les premières études consacrées à l’art amarnien se fondaient principalement sur des documents en noir et blanc. L’aspect maniériste fréquemment attribué aux représentations de cette période pourrait dès lors résulter d’une confusion entre le sillon intérieur et le véritable bord extérieur de la figure. Cette méprise aurait conduit à une perception exagérément amincie des profils corporels.
Il convient, par conséquent, d’aborder avec prudence les analyses stylistiques de la période amarnienne fondées sur ce type de relevé graphique (voir fig. 16).
L’identification du tracé préparatoire
La disparition des couleurs, résultant de mauvaises conditions de conservation, peut ainsi entraîner une identification erronée des contours, augmentant le risque de produire des fac-similés inexacts (fig. 9b).
Dans l’exemple suivant (fig. 9a), le tracé préparatoire, réalisé avant la gravure, comprenait à l’origine le bord extérieur (rouge) ainsi que diverses lignes intérieures (vert). Le dessin de la publication a été réalisé à partir du sillon intérieur et des lignes intérieures (fig. 9b). Or, ce dessin n’a jamais existé dans l’Antiquité en tant que tel ; aucun artiste égyptien n’a pu le réaliser. Le dessin préparatoire, tel qu’il a été exécuté avant la gravure, correspondait au bord extérieur et aux lignes intérieurs (fig. 9c).
Dans un souci de rigueur, les dessinateurs actuels notent parfois dans les relevés le tracé du bord extérieur ainsi que les sillons intérieurs3.
Dans l’exemple de la figure 10, le relief représente un personnage penché en avant, vêtu d’une tunique à manches courtes. Il est précédé d’un autre personnage, également incliné. La technique de gravure fait apparaître ici des “traits” de différentes natures. Dans l’image de gauche, nous avons regroupé les traits de nature comparable sous une même couleur. Les sillons intérieurs sont notés en bleu et délimitent la zone pouvant être modelée. Le bord extérieur est marqué par un trait noir et note la séparation entre les motifs et l’“extérieur”. Les lignes de superposition entre deux plans sont signalées en vert.
On constate que les sillons intérieurs de la tunique blanche le long du dos et de la manche droite ne correspondent pas à la limite du vêtement. La confusion possible sur la limite du vêtement vient du fait de la couleur blanche présente des deux côtés du talus. Un trait de peinture de couleur marron a été ajouté par les peintres antiques pour expliciter le contour physique du vêtement. Ce trait de peinture correspond au trait du bord extérieur.
Les plis dessinés du pagne traversent le sillon intérieur au niveau du bassin du personnage, pour rejoindre le bord extérieur du pagne. Ces traits de peinture confirment que le sillon intérieur n’était pas pris en compte par les artistes en tant que contour (fig. 10).
Vers une typologie des “lignes” gravées.
Quel que soit le degré de complexité du dessin, le bord extérieur le distingue toujours du “vide”. Le contour des motifs affirme leur présence dans la paroi. Le contour constitue le tracé préparatoire, réalisé avant l’intervention des graveurs. Une fois ces lignes définies, elles seront soit gravées, soit peintes, en fonction de leur rôle dans la construction de l’illusion du relief – qu’il s’agisse des limites extérieures, des détails internes ou des jeux de superposition des plans.

Les différentes natures de traits des dessins préparatoires
- Le bord extérieur (fig. 12 – trait noir) Le bord extérieur du dessin affirme la matérialité de l’élément représenté. Il correspond au pourtour du dessin préparatoire et délimite clairement l’espace des motifs à graver. Dans certains cas, quand il peut y avoir confusion, il est souligné par un trait de peinture pour renforcer sa présence.
- Le sillon intérieur (fig. 12 – trait bleu) Le sillon intérieur est une ligne obtenue par la taille du talus, située en retrait du bord extérieur. Le fond du sillon intérieur ne coïncide donc pas avec le bord extérieur. Il est au pied du talus incliné vers l’intérieur. Le talus fait partie du motif, car il est toujours peint de la couleur qu’il borde.
- La ligne de superposition (fig. 12 – trait vert) Une ligne de superposition est le résultat de la hiérarchie des plans lorsque des éléments se chevauchent. En suivant les tracés préparatoires, elle marque distinctement les différentes profondeurs. Cette ligne peut être réalisée par gravure ou peinture. Elle est parfois renforcée par une légère cuvette du côté du plan inférieur.
- Le trait de modelé (fig. 12 – trait gris) Le trait de modelé suit avec précision les tracés préparatoires pour accentuer l’effet de relief, en particulier sur les détails ou les éléments de faible volume. Il peut être appliqué soit par peinture, soit par gravure simple, selon les besoins de la représentation.
- Le tracé fantôme (fig. 12 – trait rouge) Le tracé fantôme désigne un segment du dessin préparatoire qui disparaît lors de la gravure. Il est parfois représenté par un simple trait de peinture (fig. 10 – plissé du pagne en bas à droite). Ce trait doit être restitué lors de la réalisation des fac-similés.
Le suivi des différents traits créés par la gravure en relief aide à interpréter les scènes avec une meilleure compréhension des enchevêtrements de plans (fig. 13 et 14).
Le trait de modelé, cas particulier des tracés trop fins
À petite échelle, les motifs destinés à être gravés en relief dans le creux peuvent être si fins qu’il n’y a pas assez d’espace pour modeler les volumes entre les deux sillons intérieurs. Ce phénomène est particulièrement visible dans la représentation des rayons d’Aton, qui se réduisent alors à de simples traits de modelé (fig. 15A).
Lorsque des rayons solaires passent au premier plan, ils doivent être gravés en superposition, ce qui correspond à un rendu en saillie (fig. 15B, extrémités des rayons). Cependant, à une échelle plus réduite, cette technique devient impossible car les sculpteurs manquent de place pour modeler le rayon entre les deux lignes de superposition. Lorsque ces rayons se trouvent devant les offrandes présentées par le roi, ils gardent l’apparence de simples traits de modelé, accentuant ainsi le détail sans exprimer la profondeur (fig. 15A). L’échelonnement des plans n’est pas traduit dans le relief par les lignes de superposition. Il est à noter que pour les rayons du côté droit dans l’exemple figure 15A, les rayons passent en arrière de l’offrande, ce qui élude ici la difficulté.
La superposition de plans
L’artiste traduit la différence de profondeur des motifs par une superposition de plans. Une talatat, retrouvée à Hermopolis et provenant d’un temple situé à Amarna, témoigne de l’habilité des graveurs à la fin du règne d’Akhénaton (fig. 16). Le sculpteur a fait ressortir six superpositions de plans pour un même personnage. Le dessin préparatoire était suffisamment explicite pour que le graveur traduise dans la pierre les différences de profondeurs.
Sur le fragment de scène, le couple royal se tient devant deux dressoirs surmontés d’un bouquet de fleurs de lotus (1). La trace d’un édifice est visible à droite de la reine (2). Rien n’est présent à l’arrière-plan du couple royal (3).

Le modelage du corps des personnages est exécuté dans une faible profondeur de la pierre. Les mollets du roi (a) sont délimités par un sillon de contour jusqu’à la retombée du pagne (c), qui passe à l’arrière des jambes (b). Le haut des mollets et les genoux sont en léger relief (b) en avant du pagne dont les plis sont évoqués par des traits inclinés du modelé (c). Le vêtement se retourne (d) alors sur la jambe droite et couvre la cuisse droite (e). La cuisse gauche du roi (f), plus proche de l’observateur, est logiquement représentée en avant de la cuisse droite (e). Les plis du tissu tendu sur la cuisse gauche (f) sont suggérés par les traits de modelé. Enfin, un long ruban est noué à la taille du roi et retombe (g, h et i) de chaque côté des jambes. Le ruban situé au premier plan suit la jambe gauche (h) puis passe dans le vide entre le roi et la reine (i). Il est alors bordé par des sillons intérieurs. Il finit sa course devant le bas de la robe de la reine où il est alors de nouveau gravé en relief saillant.
La sculpture fait état d’une succession de plans depuis le “fond” de l’image vers le devant :
1 – le fond de l’image qui correspond à l’arrière-plan de la scène (2) ;
2 – le pagne qui passe à l’arrière de ses jambes du roi (c) ;
3 – les jambes du roi (a et b) ;
4 – le pagne qui recouvre les cuisses (e et f) ;
5 – le ruban noué à la ceinture (h)
L’avantage des premiers plans et le relief en saillie.

Lorsqu’un visage est placé devant un objet, il est représenté en saillie, offrant alors plus de liberté au graveur. Une pierre montre une nourrice placée à l’arrière de la reine et tournée vers la princesse dont elle a la charge (fig. 17). Le visage de la nourrice, au nom de Tya, est figuré au premier plan devant un grand récipient. En étant ainsi positionné, le profil de son visage échappe à la contrainte du sillon intérieur. Le portraitiste, peut alors exprimer pleinement son art, car il n’a pas à gérer le “double trait” imposé4.
Le roi étant rarement représenté devant des objets, les artistes utilisaient parfois la technique du chevauchement, plaçant ainsi son profil au premier plan, devant celui de la reine5. Ce procédé permettait de mettre en valeur le profil royal, mais reléguait celui de la reine au second plan, tant visuel que symbolique.
Les Égyptiens étaient conscients que le double trait nuisait à la lisibilité des visages. Plusieurs études des profils royaux (fig. 18) suggèrent que les iconographes du règne poursuivaient des recherches pour remédier à ce problème. Pour pallier l’absence de chevauchement améliorant le travail du portraitiste, les artistes eurent l’idée d’abaisser légèrement la surface autour du profil, créant ainsi une subtile cuvette. Le visage du roi semblait être placé au premier plan, sans véritable arrière-plan. Dans certaines de ces études, la cuvette aménagée autour du profil montre une volonté de raccorder la gravure au reste du relief. Claude Vandersleyen avait déjà souligné que la période amarnienne était la seule sur les trois mille ans de la civilisation égyptienne à avoir su et pu mêler, dans une même paroi, la technique du relief dans le creux et celle du bas-relief, en saillie.

Plusieurs fragments de murs témoignent en effet que les artisans ont commencé à appliquer concrètement ce mélange de technique sur les parois6. Un motif de grappe de raisin a ainsi été sculpté selon ce procédé, avec la surface environnante légèrement abaissée en cuvette, ce qui fait disparaître le sillon intérieur (fig. 19). La limite sculptée de la grappe correspond alors exactement au contour du dessin préparatoire.

Ce procédé consiste à utiliser ponctuellement la technique du relief saillant dans une paroi gravée en relief dans le creux, tout en économisant de champlevé la surface de fond de la scène. Les derniers essais suggèrent que cette exploration graphique prenait des proportions qui les conduisaient sur la voie du haut-relief, une technique que les Grecs ne découvriront qu’un millénaire plus tard7. Plusieurs vestiges semblent être les témoins de telles expérimentations. Une tête de cheval et des pieds chaussés du roi, par exemple, suggèrent un traitement dans l’esprit du haut-relief, et non plus du simple relief dans le creux (fig. 20).
Bibliographie
Chappaz, J.-L. et Schweizer, F. (1994) : “L’énigme d’un sphinx”, in : Schweizer, F. et Rinuy, A. : L’œuvre sous le regard des sciences, Genève, 11-23.
Davis, N. de G. (1905) : The rock tombs of El Amarna, Part II.– The tombs of Panehesy and Meryra II., Londres.
Goyon, J.-C., Golvin, J.-C., Simon-Boidot, C. et Martinet, G. (2004) : La construction pharaonique : du Moyen Empire à l’époque gréco-romaine : contexte et principes technologiques, Paris.
Laboury, D. (2023) : “On the Alleged Involvement of the Deir el-Medina Crew in the Making of Elite Tombs in the Theban Necropolis during the Eighteenth Dynasty: A Reassessment” , in : Bryan, B. et Dorman, P. : Mural Decoration in the Theban Necropolis, Chicago, 115-138.
Lauffray, J., Daniel, L., Traunecker, C. et Marle, P. (1980) : “Les ‘talatat’ du IXe pylône et le Teny-Menou (assemblage et première reconstruction d’une paroi du temple d’Aton dans le musée de Louqsor”, Cahiers de Karnak 6, 67-89.
Le Fur, D. (1994) : La conservation des peintures murales des temples de Karnak, Paris.
Mulliez, M. (2019) : Restituer les couleurs : le rôle de la restitution dans les recherches sur la polychromie en sculpture, architecture et peinture murale, Actes du colloque du 29-30 novembre et 1er décembre 2017, Pessac.
Redford, D.B. (1988) : The Akhenaten Temple Project. Vol. 2, Rwd-Mnw, foreigners and inscriptions, Toronto.
Vandersleyen, C. (1979) : “De l’usage du relief dans le creux à l’époque ramesside”, Bulletin de la Société Française d’Égyptologie, 86, 16-38.
Vandersleyen, C. (1995) : L’Égypte et la vallée du Nil, tome 2 : De la fin de l’Ancien Empire à la fin du Nouvel Empire, Paris.
Vanderselyen, C. (2012) : Écrits sur l’art égyption : Textes choisis (1973-2011), Bruxelles.
Vergnieux, R. (1999) : Recherches sur les monuments Thébains d’Amenhotep IV à l’aide d’outils informatiques : méthodes et résultats, Genève.
Vergnieux, R. (2025) : Amarna, La cité solaire d’Akhénaton et Néfertiti, Paris.
Notes
- Goyon et al. 2004, 362-363 ; Vandersleyen 1979 ; sur les scènes de la fin de la XVIIIe dynastie : voir Vandersleyen 1995, 386-388, voir Laboury 2023.
- Voir Vandersleyen 1979.
- Voir par exemple, les relevés des reliefs du mur du musée de Louqsor par Christian Second, dans Lauffray et al. 1980, 85, fig. 14.
- Vergnieux 2025, 283-285.
- Voir par exemple Davis 1905, pl. XXXVIII, ou Vergnieux 2025, 148, fig. 152.
- Vandersleyen avait repéré l’apparition de “cuvettes” entourant parfois les motifs pour mélanger relief en saillie et relief en creux Vandersleyen 1979, 25.
- Le haut-relief consiste à presque détacher le volume les motifs qui apparaissent en rond de bosse sur l’avant de la paroi.