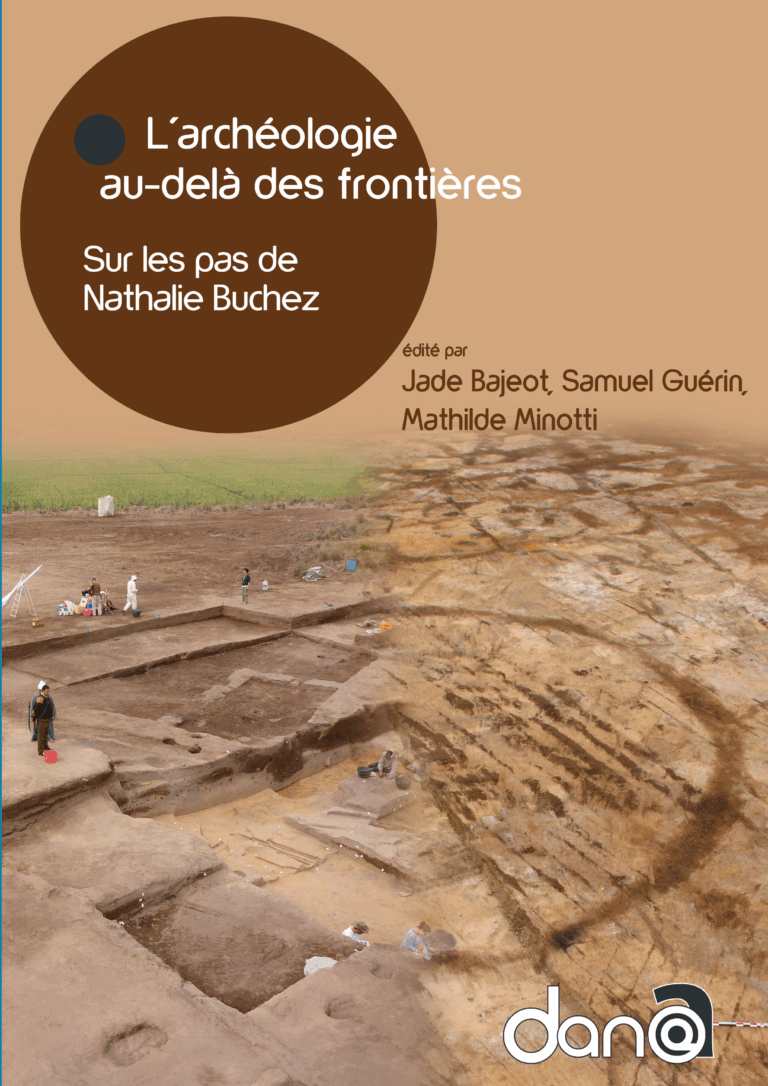J’ai de la chance.
Je ne sais plus si l’on était à la fin de l’hiver ou déjà au début du printemps, mais je me souviens de quelques timides rayons de soleil venant chatouiller les murs gris de pluie de la cour du 11 Place Marcelin Berthelot quand on m’avertit qu’une jeune femme demandait à me voir. Nathalie Buchez, qu’on appellera désormais “Bubu”, m’attendait, élégante silhouette brune au sourire discret.
Nous nous étions déjà croisées, en 1985, lors d’un congrès d’égyptologie à Munich. Je savais donc qu’elle fouillait à cette époque avec l’équipe allemande de Dietrich Wildung à Minshat Abou Omar, dans le Delta oriental, ainsi qu’avec celle de Lech Krzyzaniak, au Soudan. Une archéologue donc qui avait très tôt orienté son cursus égyptologique vers la voie sans issue de l’Égypte prédynastique et avait compris qu’aucune étude sérieuse en ce domaine, comme en tout autre en archéologie, ne s’opérerait hors du terrain.
Le terrain, je venais d’en obtenir un auprès de la directrice d’alors de l’IFAO, Madame Paule Posener-Krieger. Adaïma. Huit kilomètres au sud d’Esna.
“J’ai su que vous allez [premier et dernier vouvoiement] ouvrir une fouille prédynastique, me dit-elle, j’aimerais faire partie de l’équipe. La céramique, dis-je, ça vous va ? Banco”.
Elle fut la première recrue de la fouille d’Adaïma avec la charge colossale de traiter la céramique tant de la nécropole que nous allions découvrir l’année suivante que de l’habitat sur lequel nous faisions nos premières armes.
Dès novembre 1989, alors que les yeux de tous étaient fixés sur l’écroulement d’un monde et du mur de Berlin, nous attaquions – petite équipe isolée – un ramassage raisonné de surface dirigé par un chef d’orchestre exceptionnel, Albert Hesse. S’ensuivirent les premiers sondages dans le sable, les premiers paniers de tessons et de silex déversés sur les tables. C’est alors que Nathalie, devenue Bubu, s’appropria son matériel, élaborant un protocole d’analyse qui, d’année en année, alors que la fouille de l’habitat s’étendait sur des surfaces considérables et que près d’un millier de tombes sortaient des mains expertes des anthropologues, la mènerait, début 2008 à soutenir à l’EHESS-Toulouse une thèse remarquable. À travers l’étude des mobiliers céramiques domestiques et funéraires, elle propose une reconstitution de l’évolution structurelle de l’habitat d’Adaïma sur toute la durée d’occupation du site. Un travail de grande qualité qui, bien qu’encore non publié, fait référence, et lui a donné, au sein de notre petite communauté scientifique, la place d’une chercheuse hautement considérée.
Mais plus encore. Elle nous fit bénéficier, sans la moindre condescendance, de son expérience d’archéologue professionnelle et nous a orientés, toujours avec la même discrétion, vers les techniques nouvelles d’une archéologie qu’il n’était d’ailleurs pas toujours aisé de mettre en pratique en Égypte.
Première recrue à Adaïma, elle constitua vite, avec quelques autres, le noyau dur d’une équipe qui, 16 ans durant, ne fit que se souder davantage autour d’un site passionnant. Chacun avait compris qu’Adaïma était capable d’offrir à une équipe jeune – ils n’avaient pas 30 ans – un potentiel archéologique exceptionnel à condition de s’y investir. Chacun y trouva sa place. La sienne, Bubu la trouva à mes côtés, une place d’autant plus importante qu’au gré des années une amitié solide se forgea entre nous. Une amitié vraie, faite de respect, d’estime et de complicité.
Quand vint le temps de quitter la magie des cieux d’Adaïma pour les brumes matinales du Delta, Bubu était bien sûr, à la manœuvre, en co-direction de l’équipage.
Un nouveau challenge s’annonçait. Ce que nous étions venus chercher dans le Delta ? Un ensemble culturel nouveau – au moins pour nous – et qui, par définition, n’était pas représenté à Adaïma, puisqu’il s’agissait de la Culture de Basse-Égypte. Voilà à quoi nous étions venus nous frotter. La démarche correspondait à un questionnement bien précis : pour appréhender les processus qui avaient conduit la vallée du Nil, au milieu du IVe millénaire, à un phénomène longtemps assimilé à une “unification culturelle”, il était nécessaire de débusquer sur ses terres cet ensemble particulier du nord, de démêler ses éléments structurants afin de comprendre de quelle manière ils s’étaient un jour fondus dans les grandes traditions du sud. Nos ambitions visaient les habitats qui, dans l’épaisseur des limons du Delta, nous offraient les stratigraphies absentes de la Haute-Égypte, là où le sable et le vent diluent les vestiges en incessants palimpsestes. Aux cimetières, nous préférions les lieux de vie. Nous avons eu les deux.
Kom el-Khilgan d’abord, avec ses quelque 200 tombes dégagées à partir de grandes tranchées sondages dont la mise en place nous valut bien des aventures et dont le souvenir ne manquera pas de la faire sourire. Kom el-Khilgan où les deux grandes traditions funéraires, celle du nord et celle du sud, se côtoyaient sur le terrain et se succèdent dans l’état de nos connaissances. Si l’expérience des céramiques du sud, acquise à Adaïma, offrait d’incontestables avantages, il fallut adapter les protocoles d’analyse à ces nouveaux ensembles funéraires, au fond modestes et peu bavards, comparés à leurs voisins méridionaux. Il s’ensuivit l’histoire d’une petite bouteille en céramique à fond arrondi, “un pot-citron” qui, dans notre microcosme, fit couler un peu d’encre.
Tell el-Iswid. Un habitat digne de ce nom, enfin ! Quoique…
En octobre 2006, nous procédions, en équipe minimum de cinq personnes, aux premiers carottages sur le tell d’Iswid-sud, un site qu’une équipe hollandaise avait testé à la fin des années 1980, nous assurant ainsi que nous y trouverions stratigraphie et habitat prédynastique.
Les tombes de Kom el-Khilgan, plongées dans le sable de la gezira et surmontées par 1,5 m d’occupations plus tardives, nous avaient déjà confrontés à la fouille des tells du Delta, mais selon une succession qu’il n’était pas trop difficile de suivre. Tell el-Iswid s’avérait plus compliqué avec ses bâtis fugaces de branchages et de boue, surmontés de vestiges plusieurs fois reconfigurés de murs de briques crues, ses espaces abandonnés puis reconquis, ses niveaux imbriqués, écrasés et défoncés par endroits par les énormes “maisons-tours” de la Basse-Époque. C’est là que l’héroïne de ces hommages a pu, à nos yeux, exprimer et développer toutes ses qualités d’archéologue et que sa longue expérience d’une archéologie de sauvetage en France a pu donner sa pleine mesure. Ses dons d’observation, la rigueur de son approche du terrain et sa puissance de travail (Bubu est une bosseuse) ont été une chance pour Tell el-Iswid, pour toute l’équipe, dont certains qu’elle a formés, et pour moi.
En 2016, elle me succédait à la direction de la mission et ce passage de relais était une évidence. Nous avons co-dirigé les publications monographiques des deux premiers volumes de Tell el-Iswid, dévoilant l’épaisse stratigraphie d’une large tranchée et les bâtis de briques des derniers siècles du IVe millénaire. Depuis, elle a plongé avec son équipe dans les profondeurs du tell et de ce millénaire, en quête de cette Culture de Basse-Égypte, qu’elle a su mettre en lumière sur ce site et dont elle assurera, avec ses collègues, une prochaine monographie.
Discrète dans la vie, mal à l’aise à l’oral, Bubu excelle sur un terrain et, au-delà, par ses réelles qualités de chercheuse. Que dire de plus, qui ne serait pas à sa place dans cette préface ? Depuis les premières années d’Adaïma, nous avons l’habitude de clore nos échanges épistolaires par ce sigle : FE pour “For Ever”.
Je terminerai donc par FE pour saluer cette collègue estimée qui m’a fait l’honneur de son amitié.
Béatrix Midant-Reynes,
Toulouse, 21/10/2024