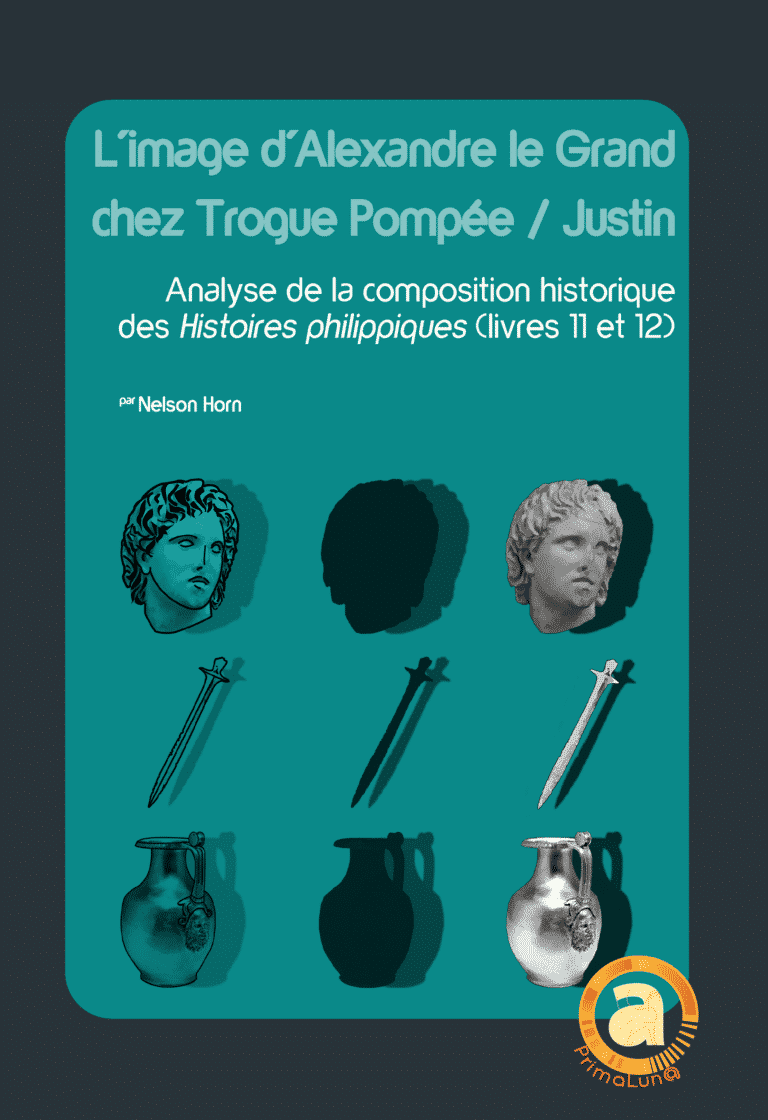Note sur le texte des livres 11 et 12 des Histoires philippiques
La traduction qui suit, ainsi que tous les extraits des livres 11 et 12 des Histoires philippiques qui seront cités dans cet ouvrage, reposent sur le texte que nous avons nous-même établi et traduit dans le cadre de notre thèse soutenue en 20171, dans laquelle le lecteur trouvera un apparat critique. Le présent ouvrage est le fruit d’un remaniement, plus ou moins grand selon les parties, de ce travail de recherche. Il est par conséquent possible que le texte étudié présente ici et là de légères variantes avec ceux établis dans les autres éditions de référence citées dans la bibliographie.
Traduction des livres 11 et 12 des Histoires philippiques
Livre 11
I. De même qu’il y avait dans l’armée de Philippe des nations différentes, de même il y eut après son meurtre des réactions diverses : les uns en effet, écrasés par une injuste sujétion, se redressaient dans l’espoir de recouvrer leur liberté ; d’autres, que rebutait une campagne lointaine, se réjouissaient que l’on renonce à l’expédition ; quelques-uns s’affligeaient qu’on eût placé la torche allumée pour les noces de la fille sous le bûcher du père.
Les Amis aussi, face à un bouleversement si soudain, étaient pris d’une grande crainte : ils songeaient tantôt qu’on avait provoqué l’Asie, tantôt que l’Europe n’avait pas encore été tout à fait réduite, tantôt que les Illyriens, les Thraces et les Dardaniens, ainsi que toutes les autres nations barbares, étaient d’une loyauté incertaine et d’un esprit déloyal, et que si tous ces peuples faisaient défection à la fois, on ne pourrait en aucune façon les arrêter.
À tous ces maux, l’intervention d’Alexandre fut comme une sorte de remède : devant l’assemblée, il réconforta et exhorta si bien toute la foule au vu des circonstances, qu’il ôta la crainte à ceux qui avaient peur et qu’il inspira à tout le monde de l’espoir. Ce jeune homme avait vingt ans ; et à cet âge, il avait fait beaucoup de promesses qui l’engageaient avec tant de mesure qu’il était manifeste qu’il réservait des qualités plus nombreuses pour les épreuves à venir. Il accorda aux Macédoniens une dispense de toutes leurs charges, sauf l’exemption des charges militaires ; et par cette action il se ménagea si bien la sympathie de tous qu’ils disaient que c’était le corps de l’homme, non la valeur du roi, qui avait changé.
II. Son premier soin fut d’organiser les funérailles paternelles lors desquelles, avant toute chose, il ordonna que l’on exécutât les complices du meurtre à côté du tombeau de son père. Il n’épargna qu’Alexandre, frère des Lyncestes, respectant en lui l’auspice de sa propre grandeur : il avait en effet été le premier à le saluer du nom de roi. Son rival pour le trône également, Caranos, son frère né de sa belle-mère, il prit soin qu’on le tuât. Pendant les débuts de son règne, il tint en respect de nombreuses nations qui se soulevaient, éteignit quelques révoltes qui se levaient. Mis en confiance par ces succès, c’est au pas de course qu’il se hâte en Grèce où, après avoir convoqué les cités à Corinthe, à l’exemple de son père, il est nommé chef à sa place. Il entreprend ensuite de poursuivre la guerre contre la Perse commencée par son père.
Alors qu’il était occupé aux préparatifs de cette guerre, on lui annonce que les Athéniens et les Lacédémoniens l’ont abandonné pour passer du côté des Perses, et que le responsable de cette défection fut l’orateur Démosthène, qui s’était laissé corrompre par les Perses pour une grande quantité d’or : il a affirmé que toutes les troupes des Macédoniens, avec leur roi, avaient été détruites par les Triballes, en produisant un garant de la nouvelle devant l’assemblée, qui disait avoir lui aussi été blessé dans ce même combat où le roi était tombé ; que dans cette idée, l’état d’esprit de presque toutes les cités avait été changé ; que les garnisons de Macédoniens étaient assiégées. Pour faire face à ces mouvements, l’armée est mise en ordre de marche et préparée, et Alexandre tomba sur la Grèce avec une telle rapidité que, celui que les Grecs n’avaient pas senti arriver, ils croyaient à peine le voir.
III. Au passage, il avait exhorté les Thessaliens et leur avait rappelé les bienfaits de Philippe, son père, et du côté de sa propre mère, descendante de la famille des Éacides, la parenté qui l’unissait à eux. Les Thessaliens, écoutant ses propos avec passion, l’avaient élu, à l’exemple de son père, chef du peuple tout entier, et lui avaient remis l’ensemble de leurs redevances et leurs propres revenus.
Or les Athéniens, tout comme ils avaient été les premiers à faire défection, furent les premiers à commencer à se repentir, changeant leur mépris de l’ennemi en admiration, et élevant la jeunesse d’Alexandre, auparavant dédaignée, au-dessus de la valeur de leurs anciens chefs. Aussi supplient-ils, par l’envoi d’ambassadeurs, qu’on écarte la guerre ; après les avoir écoutés et leur avoir adressé de sévères reproches, Alexandre renonça à la guerre.
De là, il tourna son armée contre Thèbes, prêt à user de la même indulgence, s’il avait rencontré un semblable repentir. Mais ce fut d’armes, et non de prières et de supplications, que les Thébains usèrent ; aussi une fois vaincus, éprouvèrent-ils toutes les rigueurs les plus pénibles de la plus misérable captivité. Alors que l’on discutait en conseil de la destruction de la ville, les Phocéens, les Platéens, les Thespiens et les Orchoméniens, qui étaient les alliés d’Alexandre et avaient participé à la victoire, rappelaient la destruction de leurs propres villes et la cruauté des Thébains, leur reprochant leur dévouement pour les Perses, contre la liberté de la Grèce, non seulement actuel, mais aussi ancien ; c’est pourquoi ils étaient un objet d’exécration pour tous les peuples, ce que révélait notamment le serment par lequel ils s’étaient tous liés de détruire Thèbes, une fois les Perses vaincus. Ils ajoutent encore les fables de leurs crimes antérieurs dont ils avaient rempli toutes les scènes de théâtre, afin que ce ne soit pas seulement pour leur perfidie actuelle, mais aussi pour leur infamie ancienne qu’ils soient détestés.
IV. Alors Cléadas, l’un des prisonniers, à qui l’on avait accordé le droit de s’exprimer, avança que ce n’était pas au roi, dont ils avaient entendu dire qu’il avait été tué, que les Thébains avaient fait défection, mais aux héritiers du roi ; que tout ce qu’ils avaient fait contre lui était la faute de leur crédulité, non de leur perfidie, et ils l’avaient déjà expiée par de grands supplices, puisque leur jeunesse avait été détruite ; qu’il ne restait à présent qu’une foule de vieillards et de femmes, aussi inoffensive qu’innocente, qui avait elle-même été tant accablée de violences et d’outrages qu’ils n’avaient jamais subi sort plus pénible ; et que ce n’était plus pour les citoyens, dont il était resté un si petit nombre, qu’il plaidait, mais pour le sol innocent de sa patrie et pour sa ville, qui avait fait naître non seulement des hommes, mais aussi des dieux. Il va jusqu’à supplier le roi au nom du culte qu’il porte personnellement à Hercule, né chez eux, duquel la famille des Éacides tire son origine, et rappelle l’enfance que son père a passée à Thèbes. Il lui demande d’épargner la ville, qui adore en tant que dieux nés chez elle une partie de ses ancêtres, qui a vu y être élevée une autre partie, des rois de la plus haute majesté.
Mais la colère s’avéra plus puissante que les prières. Aussi la ville est-elle détruite, sa campagne partagée entre les vainqueurs, ses prisonniers vendus à l’encan, dont le prix augmente non pas en fonction de l’avantage qu’en tirent les acheteurs, mais de la haine que leur portent leurs ennemis.
Leur sort fit pitié aux Athéniens ; aussi ouvrirent-ils leurs portes, contre l’interdiction du roi, aux exilés qui avaient pris la fuite. Mais Alexandre prit si mal la chose que, quand une seconde ambassade le supplia pour la seconde fois d’écarter la guerre, il n’y renonça qu’à la seule condition qu’on lui livrât les orateurs et les généraux sur la foi desquels ils se révoltaient si souvent ; et comme les Athéniens étaient prêts, plutôt que d’y être contraints, à subir une guerre, il ramena ses exigences à ce que, tout en gardant leurs orateurs, ils exilent leurs généraux, qui, partis incontinent rejoindre Darios, firent grossir de façon importante les forces des Perses.
V. Partant pour la guerre contre les Perses, il fit tuer tous les parents de sa belle-mère auxquels Philippe, les portant à un niveau plus élevé de dignité, avait confié des commandements militaires. Mais il n’épargna pas non plus ceux des siens qui lui paraissaient aptes à régner, pour qu’il ne restât pas en Macédoine de sujet de sédition tandis qu’il agirait au loin ; et il entraîne avec lui au combat les rois tributaires d’un talent plus notable, laisse les plus apathiques à la garde du royaume. Il rassemble ensuite une armée et l’embarque sur des navires d’où l’on aperçoit l’Asie ; cette vue embrase son esprit d’une ardeur incroyable, et il décide d’élever, comme offrandes pour la réussite de la guerre, douze autels aux dieux.
Tout le bien qu’il possédait en Macédoine et en Europe, il le partage entre ses Amis, après avoir annoncé que l’Asie lui suffisait. Avant qu’aucun navire ne quitte le rivage, il immole des victimes, en demandant la victoire à la guerre pour laquelle il a été choisi comme le vengeur de la Grèce, tant de fois attaquée par les Perses : leur a échu un empire qui a désormais assez duré et mûri, et il est temps que le recueillent à leur place des hommes qui le géreront mieux.
Cependant l’armée ne présumait pas moins de la victoire que le roi ; de fait tous oubliaient leurs femmes, leurs enfants et l’expédition militaire loin de chez eux, et regardaient l’or perse et les ressources de tout l’Orient déjà comme leur propre butin, et ce n’était pas à la guerre et aux dangers, mais aux richesses qu’ils songeaient.
Comme ils avaient été poussés sur le continent, Alexandre le premier lança un javelot, comme sur une terre ennemie, et en armes sauta du navire, pareil à un homme qui danse, et ainsi il immole des victimes, après avoir prié pour que ces contrées éloignées ne l’accueillent pas comme leur roi à contrecœur. À Ilion aussi il fit des sacrifices, près des tombes de ceux qui étaient tombés lors de la guerre de Troie.
VI. De là, se dirigeant vers l’ennemi, il interdit à ses soldats de ravager l’Asie, ayant annoncé qu’ils devaient préserver leurs propres biens et ne pas détruire ce dont ils étaient venus s’emparer. Dans son armée, il y avait trente-deux mille fantassins, quatre mille cinq cents cavaliers, cent quatre-vingt-deux navires. Avec une si petite troupe, le plus admirable est-il qu’il ait vaincu le monde entier ou qu’il ait osé l’attaquer, on ne le sait.
Alors qu’il recrutait son armée pour une guerre si dangereuse, ce ne furent pas de jeunes hommes vigoureux, la première fleur de l’âge, mais des vétérans, dont la plupart avait même fini leur carrière militaire, qui avaient servi sous son père et ses oncles, qu’il recruta, de sorte qu’on pouvait penser que ce n’étaient pas des soldats mais des instructeurs militaires qui avaient été recrutés. Personne non plus ne commanda une division s’il n’était sexagénaire, de sorte que, à regarder l’état-major du camp, on aurait dit que l’on voyait le sénat de quelque antique république. C’est pourquoi au combat, personne ne songea à la fuite, mais à la victoire ; et personne ne plaça son espoir dans ses pieds, mais dans ses bras.
En face le roi des Perses, Darios, par confiance en ses forces, ne fit rien par ruse, affirmant aux siens que des plans cachés revenaient à une victoire volée, et n’écarta pas l’ennemi des frontières du royaume, mais le reçut au cœur du royaume, trouvant qu’il était plus glorieux de repousser la guerre que de ne pas l’accepter.
La première rencontre eut donc lieu dans les plaines d’Adraste. Dans la ligne perse, il y avait six cent mille soldats qui, dominés non moins par l’art d’Alexandre que par la valeur des Macédoniens, s’enfuirent : ainsi ce fut pour les Perses un grand massacre. De l’armée d’Alexandre tombèrent neuf fantassins, cent vingt cavaliers que le roi, pour consoler les autres, fit mettre en terre somptueusement, avec des statues équestres, et aux parents desquels il accorda des exemptions d’impôts.
Après sa victoire, la plus grande partie de l’Asie se rangea derrière lui. Il mena également un assez grand nombre de batailles contre les gouverneurs de Darios que dès lors il vainquit, non pas tant par les armes que par la terreur que son nom inspirait.
VII. Sur ces entrefaites, on lui rapporte pendant ce temps, d’après la révélation d’un prisonnier, qu’un complot est ourdi contre lui par Alexandre des Lyncestes, gendre d’Antipater qui avait été mis à la tête de la Macédoine. Craignant pour cette raison que, s’il le faisait tuer, un soulèvement ne naquît en Macédoine, il le tint dans les fers.
Après quoi il gagne la ville de Gordion qui est située entre la grande et la petite Phrygie ; et ce n’est pas tant à cause du butin que lui prit l’envie de s’emparer de cette ville, mais parce qu’il avait entendu dire que c’était dans cette ville, dans le temple de Jupiter, que le joug de Gordios avait été déposé, et que d’antiques oracles avaient prédit que, si un homme en défaisait le nœud, celui-ci régnerait sur toute l’Asie.
Voici quelle en fut la cause et l’origine. Comme Gordios était en train de labourer en ces contrées avec des bœufs qu’il avait loués, des oiseaux de toute espèce se mirent à voler tout autour de lui. Parti consulter les augures de la ville voisine, il rencontra à la porte une jeune fille d’une beauté remarquable ; il lui demanda quel augure consulter de préférence ; après avoir entendu la raison de la consultation, maîtrisant cet art grâce à l’enseignement de ses parents, elle lui répond que le trône lui est annoncé et lui propose de se lier à lui par le mariage et le partage de son espérance. Un si beau parti semblait le premier bonheur du trône. Après les noces naquit une sédition entre les Phrygiens. À ceux qui les consultaient sur la fin des discordes, les oracles répondirent que, dans les discordes, on avait besoin d’un roi. À ceux qui, une seconde fois, demandaient l’identité du roi, il est ordonné d’honorer comme leur roi le premier homme qu’à leur retour ils auraient trouvé en train de se rendre en chariot au temple de Jupiter. Ils rencontrèrent Gordios, et aussitôt le saluent tous du nom de roi. Ce héros plaça le chariot qui le transportait quand le trône lui avait été confié dans le temple de Jupiter, et le consacre à la majesté royale. Après lui régna son fils Midas qui, initié par Orphée aux cérémonies solennelles des rites, remplit la Phrygie de cultes grâce auxquels il fut plus en sécurité toute sa vie que par les armes.
Donc Alexandre, après la prise de la ville, alors qu’il s’était rendu au temple de Jupiter, réclama le joug du chariot ; on le lui présente et, comme il ne parvenait pas à retrouver les extrémités des courroies cachées à l’intérieur des nœuds, il observe l’oracle de manière passablement violente, tranche de son glaive les courroies, et, une fois les nœuds ainsi défaits, trouve les extrémités dissimulées dans les nœuds.
VIII. Tandis qu’il accomplit ces actions, on lui annonce que Darios approche avec une immense armée. C’est pourquoi, craignant les défilés, il franchit le Taurus en toute hâte, et dans son empressement fit cinquante stades à la course. Comme il était arrivé à Tarse, séduit par le charme du Cydnos qui coule au milieu de la ville, après avoir lancé ses armes, plein de poussière et de sueur, il se lance dans l’onde glacée quand une raideur saisit soudain ses nerfs, si grande que, alors que sa voix était coupée, on ne trouvait non seulement pas d’espoir de remède, mais pas non plus de moyen de retarder le danger. Parmi ses médecins il n’y en avait qu’un, du nom de Philippe, qui seul proposât un remède ; mais lui aussi, une lettre de Parménion envoyée la veille de Cappadoce le rendait suspect : celui-ci, qui n’était pas au courant de la maladie d’Alexandre, lui avait écrit de se défier de son médecin Philippe car il avait été corrompu par Darios contre une grosse somme d’argent. Alexandre estima cependant plus sûr de se fier à la loyauté douteuse de son médecin que de périr d’une maladie qui ne laissait pas de doutes. Il accepta donc la coupe et remit la lettre au médecin et ainsi, tout en buvant, dirigea ses regards sur le visage de ce dernier, pendant qu’il lisait. Comme il le vit calme, il se réjouit, et recouvra la santé le quatrième jour.
IX. Cependant Darios, avec quatre cent mille soldats fantassins et cent mille cavaliers, s’avance pour la bataille. Cette foule d’ennemis, au regard de la faiblesse de ses propres forces, ébranlait Alexandre, mais il songeait entre temps aux exploits qu’il avait accomplis avec ces faibles forces, et aux grands peuples qu’il avait renversés. Aussi, comme l’espoir vainquait la crainte, ayant pensé qu’il était plus dangereux de différer la guerre de peur que l’abattement ne grandît chez les siens, il fait un à un le tour des peuples de son armée et leur adresse des harangues différentes. Les Illyriens et les Thraces, c’était par l’étalage des ressources et des richesses qu’il les enflammait ; les Grecs, par le souvenir des anciennes guerres et de leur haine mortelle à l’égard des Perses ; quant aux Macédoniens, il leur rappelle tantôt l’Europe vaincue, tantôt l’Asie convoitée, et il se vante de n’avoir pas trouvé d’hommes qui leur fussent égaux sur toute la terre ; du reste ce serait là aussi la fin de leurs fatigues et le comble de leur gloire. Et, pendant ces discours, il ordonne que sans cesse l’armée s’arrête en position, pour que les soldats s’habituent par ce retardement à soutenir la vue de la masse de leurs ennemis.
Et le soin de Darios à mettre son armée en ordre de bataille ne manqua pas d’énergie ; de fait, sans se reposer sur les devoirs de ses chefs, il fit lui-même le tour de tout, exhorta les soldats un à un, leur rappela la gloire ancienne des Perses et la possession éternelle de l’empire que les dieux immortels leur avaient accordée.
Après quoi le combat est engagé de très grand cœur. Lors de celui-ci, l’un et l’autre roi sont blessés. La lutte fut longtemps incertaine, jusqu’à ce que Darios s’enfuit. Il s’ensuivit le massacre des Perses. Furent tués soixante-et-un mille fantassins, dix mille cavaliers ; furent capturés quarante mille hommes ; chez les Macédoniens tombèrent cent trente soldats à pied, cent cinquante cavaliers. Dans le camp des Perses, on trouva beaucoup d’or et toutes les autres sortes de richesses. Parmi les prisonniers faits dans le camp, il y eut la mère de Darios, sa femme qui était aussi sa sœur, et ses deux filles. Alors qu’Alexandre était venu les voir et les encourager, à la vue des hommes en armes, elles s’embrassèrent mutuellement, comme si elles devaient mourir sur le champ, et poussèrent ensemble des lamentations. Puis, s’étant jetées aux genoux d’Alexandre, elles le supplient par leurs prières non pas de leur épargner la mort, mais de différer leur mort, le temps qu’elles ensevelissent le corps de Darios. Touché par la piété si grande de ces femmes, Alexandre leur dit que Darios était en vie, ôta la peur de la mort à celles qui la craignaient, et prescrivit qu’on les considérât et saluât comme des reines ; les filles aussi, il les engagea à espérer un mariage qui ne fût pas plus méprisable que ce que leur valait la dignité de leur père.
X. Après quoi, ayant contemplé les trésors de Darios et le faste de ses richesses, il est pris d’admiration pour de telles merveilles. C’est alors qu’il se mit, pour la première fois, à fréquenter les copieux banquets et la splendeur des festins, alors aussi qu’il se mit à aimer, à cause de la beauté de ses formes, une prisonnière, Barsine, dont il eut plus tard un enfant qu’il appela Hercule.
Pourtant, se rappelant que Darios était encore en vie, il envoya Parménion se rendre maître de la flotte perse, et d’autres Amis prendre possession des cités d’Asie qui, le bruit de la victoire aussitôt entendu, alors que les gouverneurs de Darios se livraient eux-mêmes avec une grande quantité d’or, se soumirent au pouvoir des vainqueurs.
Alors il part pour la Syrie, où vinrent à sa rencontre de nombreux rois d’Orient, avec leurs ornements sacrés. Parmi eux, en fonction des mérites de chacun, il reçut les uns dans son alliance, priva les autres de leur trône en nommant de nouveaux rois à leur place. Plus remarquable que les autres fut Abdalonymos, roi établi à Sidon par Alexandre : alors qu’il avait l’habitude de louer son travail pour tirer de l’eau au puits et arroser les jardins, Alexandre avait fait roi cet homme qui se maintenait en vie misérablement au mépris des nobles, pour éviter qu’ils pensent que ce bienfait venait de leur naissance, non de son donateur.
Comme la cité des Tyriens avait envoyé à Alexandre, par l’intermédiaire d’ambassadeurs, une couronne d’or de grand poids à titre de félicitations, une fois le présent reçu avec plaisir, il dit qu’il voulait aller à Tyr pour s’acquitter de vœux faits à Hercule. Comme les ambassadeurs, qui cherchaient à empêcher son entrée dans leur ville, lui disaient qu’il serait mieux qu’il le fît dans la vieille Tyr et dans un temple plus ancien, il s’échauffa au point de menacer la ville de destruction et, son armée aussitôt dirigée contre l’île, les Tyriens, sans être moins courageux, comptant sur les Carthaginois, c’est par une guerre qu’il est accueilli. En effet, l’exemple de Didon qui avait cherché, par la fondation de Carthage, à conquérir la troisième partie du monde, augmentait le courage des Tyriens, qui jugeaient qu’il serait honteux que leurs femmes aient fait preuve de plus de courage dans la conquête d’un empire qu’eux-mêmes dans la défense de leur liberté. Ils éloignent donc ceux qui n’étaient pas en âge de combattre, font bientôt venir des secours de Carthage, et sont pris peu de temps après par trahison.
XI. À partir de là, Alexandre prit possession, sans combat, de Rhodes, de l’Égypte et de la Cilicie. Il se rend ensuite directement au temple de Jupiter Ammon, pour le consulter tant sur ce qu’allait donner l’avenir que sur sa propre origine. Sa mère Olympias avait en effet avoué à son mari, Philippe, que ce n’était point avec lui mais avec un serpent d’une taille immense qu’elle avait conçu Alexandre. Enfin Philippe, presque au dernier moment de sa vie, avait publiquement déclaré qu’il n’était pas son fils. Et c’était pour cette raison qu’il avait renvoyé et répudié Olympias, comme convaincue d’adultère.
Alexandre donc, désirant s’attribuer en surcroît une origine divine et en même temps délivrer sa mère de l’infamie, suborne les prêtres par l’intermédiaire d’émissaires et leur fait savoir la réponse qu’il désire recevoir. Aussitôt qu’il entre dans le temple, les prêtres le saluent comme le fils d’Ammon. Lui, joyeux d’être adopté par le dieu, ordonne d’être considéré comme descendant de ce père. Il demande ensuite s’il s’est vengé de tous les assassins de son père. On lui répond que son père ne peut ni être tué, ni mourir ; que pour le roi Philippe, la vengeance a été menée à son dernier terme. Comme il pose une troisième question, on lui répond que la victoire à toutes les guerres et la possession du monde lui sont données. À ses Compagnons aussi cette réponse : qu’ils honorent Alexandre comme un dieu, non comme un roi. Son arrogance en fut accrue et un orgueil extraordinaire grandit dans son âme, tandis qu’était supprimée l’affabilité qu’il avait apprise des lettres grecques et des institutions macédoniennes.
Une fois revenu d’Ammon, il fonda Alexandrie, et ordonne que la colonie macédonienne soit la capitale de l’Égypte.
XII. Darios, alors qu’il s’était réfugié à Babylone, prie par lettres Alexandre de lui accorder la possibilité de racheter ses prisonnières, et il lui promet pour cela une grande somme d’argent. Mais Alexandre, pour prix des prisonnières, demande tout le royaume, non de l’argent. Quelque temps après, une autre lettre de Darios est apportée à Alexandre, par laquelle un mariage avec sa fille et une part du royaume lui sont offerts. Mais Alexandre écrivit en retour qu’on lui donnait ce qui était à lui, et il lui ordonna de venir en suppliant, et de laisser au vainqueur les décisions à prendre pour le royaume. Alors, comme tout espoir de paix était perdu, Darios prépare de nouveau la guerre, et c’est avec quatre cent mille soldats, cent mille cavaliers, qu’il marche contre Alexandre.
En chemin on lui annonce que sa femme est morte du contre coup d’une fausse-couche, qu’Alexandre a pleuré sa mort, qu’il a suivi avec bonté le convoi funèbre, et qu’il l’a fait non par amour, mais par humanité : Alexandre ne l’avait en effet vue qu’une fois seulement, alors qu’il allait souvent réconforter sa mère et ses toutes jeunes filles. Alors Darios pensa qu’il était vraiment vaincu, puisqu’il était encore, après l’avoir été dans les combats, surpassé par son ennemi en bienfaits, et qu’il lui était agréable que, s’il ne pouvait le vaincre, il fût à tout le moins vaincu par un tel homme. Aussi écrit-il encore une troisième lettre et remercie-t-il Alexandre de n’avoir rien fait d’hostile contre les siens. Il lui offre ensuite une plus grande partie du royaume, jusqu’à l’Euphrate, ainsi que son autre fille, trente mille talents pour le reste des prisonnières.
À cela Alexandre répondit que les remerciements sont superflus de la part d’un ennemi ; qu’il n’a rien fait pour flatter son ennemi, rien qui cherchât des moyens pour lui plaire en vue des issues incertaines de la guerre ou des conditions de la paix, mais que c’était grandeur d’âme, par laquelle il avait appris à lutter contre les forces des ennemis, non contre leurs malheurs ; et il promet qu’il garantira cela à Darios s’il accepte d’être tenu pour son second, non pour son égal ; au reste l’univers ne pouvait être dirigé par deux soleils, ni le monde avoir deux autorités suprêmes tout en gardant ses terres bien ancrées ; par conséquent, qu’il prépare ou la capitulation en ce jour, ou son armée pour le lendemain, et qu’il ne se promette pas d’autre victoire que celle dont il a déjà fait l’expérience.
XIII. Le jour suivant, ils font avancer leur armée en ligne, quand soudain, avant le combat, le sommeil s’empare d’Alexandre épuisé par les soucis. Comme seul le roi manquait pour le combat, il fut réveillé à grand-peine par Parménion ; à tout le monde qui lui demande les raisons de son sommeil au cœur des dangers alors même qu’il a toujours été particulièrement économe de son repos, il dit qu’il a été libéré de sa violente agitation, et que son sommeil lui est venu d’une tranquillité soudaine, parce qu’il peut combattre toutes les troupes de Darios ; qu’il craignait un long enlisement de la guerre si les Perses avaient divisé leur armée.
Avant le combat, chacune des armées fut observée par ses ennemis. Les Macédoniens admiraient la multitude des hommes, la taille de leurs corps, la beauté de leurs armes ; les Perses étaient stupéfaits de ce que tant de milliers des leurs aient été vaincus par si peu d’hommes.
Mais les chefs ne cessaient pas non plus de faire le tour de leurs hommes. Darios disait que, si l’on faisait la division, un ennemi à peine rencontrait dix Arméniens ; Alexandre avertissait les Macédoniens de ne pas se laisser impressionner par la multitude des ennemis, ni par la taille de leurs corps ou l’étrangeté de leur couleur ; il leur ordonne de se souvenir seulement que c’est la troisième fois qu’ils combattent contre les mêmes ennemis ; et qu’ils ne pensent pas qu’ils ont été rendus meilleurs par la fuite, alors qu’ils apportent avec eux sur la ligne de front le si sombre souvenir des massacres qu’ils ont subis et de tant de sang versé en deux combats ; et que, de même que Darios avait une plus grande foule d’individus, de même il avait lui une plus grande foule d’hommes. Il exhorte à mépriser cette armée rangée qui brille d’or et d’argent, dans laquelle se trouve plus de butin que de danger, puisque la victoire ne s’acquiert pas à la parure des armures mais à la valeur du fer.
XIV. Après quoi le combat est engagé. Les Macédoniens se précipitaient sur le fer, avec le mépris d’un ennemi qu’ils avaient si souvent vaincu. En face les Perses préféraient mourir qu’être vaincus. Rarement dans aucun combat on versa tant de sang. Darios, comme il voyait les siens être vaincus, voulut mourir aussi lui-même, mais il fut poussé à la fuite par ses proches. Ensuite, à certains qui tentaient de le persuader de couper le pont du Cydnos pour bloquer la marche des ennemis, il dit qu’il ne voulait pas, pour son propre salut, d’un plan tel qu’il exposerait tant de milliers d’alliés à l’ennemi ; que le chemin de la fuite qui aurait été ouvert pour lui devait aussi être ouvert pour les autres.
Alexandre cependant s’attaquait à tout ce qui était le plus dangereux et, où il avait remarqué que les ennemis, en formation très serrée, combattaient avec le plus d’acharnement, c’était là toujours qu’il se plongeait, et il voulait que les dangers soient les siens, non pas réservés aux soldats. Par ce combat, il ravit l’empire de l’Asie, la cinquième année après avoir accédé au trône ; et son bonheur en fut si grand qu’après cela personne n’osa se révolter et que les Perses, après un empire de tant d’années, acceptèrent patiemment le joug de la servitude.
Une fois ses soldats récompensés et comblés, il fit la revue du butin trente-quatre jours. Il trouve ensuite dans la ville de Suse quarante mille talents. Il prend aussi Persépolis, capitale du royaume persique, ville illustre depuis de nombreuses années et remplie des dépouilles du monde entier, qui ne furent visibles pour la première fois qu’à sa destruction. Sur ces entrefaites au moins huit cents Grecs, qui avaient enduré le tourment de la captivité après la mutilation d’une partie de leur corps, se présentent à Alexandre en lui demandant de les venger de la cruauté des ennemis comme il avait vengé la Grèce. Alors que leur fut donnée la possibilité de rentrer, ils préférèrent recevoir des terres, de peur de ne pas ramener à leurs parents tant de joie qu’une horrifiante image d’eux-mêmes.
XV. Pendant ce temps Darios, pour complaire au vainqueur, est chargé d’entraves et de chaînes d’or par ses propres parents, dans le village parthe de Thara, les dieux immortels en décidant ainsi, je crois, pour que ce soit sur la terre de ceux qui allaient succéder à leur empire que le règne des Perses prenne fin. Alexandre arriva lui aussi en toute hâte le lendemain. Là il apprit que Darios avait été emmené pendant la nuit dans une voiture fermée. L’armée ayant reçu l’ordre de le suivre de près, il poursuit le fuyard avec six mille cavaliers. En chemin il livre de nombreux et dangereux combats. Puis, alors qu’il n’avait trouvé, après avoir parcouru plusieurs milliers de pas, aucune trace de Darios, comme on avait donné aux chevaux la possibilité de reprendre haleine, un de ses soldats, pendant qu’il va jusqu’à une source toute proche, trouve dans sa voiture Darios, percé certes de nombreuses blessures, mais respirant encore ; et celui-ci, comme un prisonnier avait été appelé près de lui, tandis qu’il avait reconnu à sa langue un concitoyen, dit qu’il avait au moins cette consolation dans sa situation d’alors qu’il parlerait auprès de quelqu’un qui le comprendrait, et qu’il ne prononcerait pas en vain ses dernières paroles. Il ordonne qu’on rapporte à Alexandre les propos suivants : qu’il meurt, sans lui avoir rendu aucun service, en lui étant redevable des très grands bienfaits qu’il lui a prodigués, parce qu’il a éprouvé à l’égard de sa mère et de ses enfants l’âme royale, et non ennemie d’Alexandre, et qu’il a eu plus de chance dans l’ennemi que dans les parents et les proches qu’il a obtenus de la destinée ; que de fait, pour sa mère et ses enfants, la vie fut accordée par ce même ennemi, alors que pour lui elle lui fut arrachée par des parents auxquels il avait donné leur vie et leurs royaumes ; que pour cette raison, leur récompense sera celle que voudra le vainqueur lui-même ; qu’il témoigne à Alexandre la seule reconnaissance qu’il peut témoigner en mourant : prier les divinités d’en haut et d’en bas, ainsi que les dieux qui veillent sur les rois, qu’il lui soit donné d’avoir, victorieux, l’empire de toutes les terres ; que pour lui-même il implorait de recevoir la grâce d’une sépulture, plus légitime qu’importune ; que pour ce qui concernait la vengeance, ce n’était désormais plus la sienne propre, mais qu’elle tenait de l’exemple et qu’il s’agissait de la cause commune de tous les rois : il était inconvenant et dangereux à Alexandre de la négliger, puisque de fait c’était d’un côté la question de sa justice, de l’autre celle de son intérêt aussi qui se posaient ; qu’à cette fin il donne à Alexandre, comme unique gage de sa royale loyauté, sa dextre à lui apporter. Après quoi, sa main tendue, il expira.
Lorsque l’on eut annoncé cela à Alexandre, après avoir vu le cadavre du défunt, il accompagna de ses larmes une mort si indigne pour un tel rang, et ordonna que le cadavre fût enterré selon la coutume royale et que l’on portât ses restes aux tombeaux de ses ancêtres.
Livre 12
I. Alexandre fit ensevelir les soldats qu’il avait perdus en poursuivant Darios dans des funérailles à grands frais, partagea treize mille talents entre les compagnons de son expédition qui restaient. La plus grande partie des chevaux fut perdue en raison de la chaleur, même ceux qui avaient survécu devinrent inutilisables. Tout l’argent, cent quatre-vingt-dix mille talents, fut amassé à Ectabane, et Parménion fut préposé à sa garde.
Sur ces entrefaites, on lui remet une lettre d’Antipater venant de Macédoine, où l’on traitait de la guerre d’Agis, roi des Spartiates, en Grèce, de la guerre d’Alexandre, roi d’Épire, en Italie, de la guerre de Zopyrion, son gouverneur, en Scythie. Les nouvelles le touchèrent de manière différente ; il ressentit cependant plus de joie à l’annonce de la mort de deux rois rivaux que de douleur à la perte de Zopyrion avec son armée.
Après le départ d’Alexandre en effet, presque toute la Grèce avait couru ensemble aux armes pour saisir l’occasion de reprendre sa liberté, et avait suivi l’exemple des Lacédémoniens qui avaient été les seuls à mépriser la paix de Philippe et d’Alexandre et à rejeter leurs lois ; le chef de cette guerre fut Agis, roi des Lacédémoniens. Mais Antipater, après avoir rassemblé des soldats, étouffa dans l’œuf ce soulèvement. Le massacre pourtant fut grand des deux côtés. Le roi Agis, tandis qu’il voyait les siens qui tournaient les talons, après avoir congédié ses gardes du corps pour qu’il fût manifeste qu’il était inférieur à Alexandre en fortune, non pas en courage, fit un tel carnage chez les ennemis qu’il mit parfois les bataillons en fuite. À la fin, même s’il fut vaincu par le nombre, il les vainquit cependant tous par la gloire.
II. Quant à Alexandre, roi d’Épire, appelé en Italie par les Tarentins qui imploraient son aide contre les Bruttiens, il était parti avec autant d’empressement que si, dans un partage du monde, l’Orient avait été accordé par le sort à Alexandre, le fils de sa propre sœur, et l’Occident à lui-même, qui devait n’avoir pas en Italie, en Afrique et en Sicile matière à conquête plus petite que ce dernier en Asie et chez les Perses. À cela s’ajoutait le fait que, de même que l’oracle de Delphes avait prédit à Alexandre le Grand des embûches en Macédoine, de même la réponse du Jupiter de Dodone lui avait prédit pour embûches la ville de Pandosie et le fleuve Achéron. Et comme l’un et l’autre étaient en Épire, ignorant qu’il y avait les mêmes aussi en Italie, il avait opté pour une campagne à l’étranger avec un empressement particulier, pour éviter les dangers prédits par les oracles.
Alors donc qu’il était arrivé en Italie, il mena sa première guerre contre les Apuliens et, ayant appris le destin de leur ville, il conclut peu de temps après la paix et une alliance avec leur roi. En effet, les Apuliens habitaient à cette époque la ville de Brindes, que les Étoliens avaient fondée après avoir suivi Diomède, chef fort considéré et fort illustre en raison de la renommée de ses exploits accomplis à Troie ; mais, chassés par les Apuliens, ils avaient consulté les oracles et reçu comme réponse que ceux qui auraient réclamé le lieu le posséderaient éternellement. Pour cette raison donc ils avaient demandé, par l’intermédiaire d’ambassadeurs, sous menace de guerre, que la ville leur fût rendue par les Apuliens ; mais lorsque l’oracle vint à la connaissance des Apuliens, ils tuèrent les ambassadeurs et les inhumèrent dans leur ville où ils trouveraient leur éternel séjour. Et ainsi, comme ils avaient accompli l’oracle, ils possédèrent longtemps leur ville. Or comme Alexandre avait appris ce fait, il respecta les oracles du temps passé et se garda d’une guerre contre les Apuliens.
Il fit aussi la guerre contre les Bruttiens et les Lucaniens et prit de nombreuses villes ; avec les Métapontins, les Pédicules et les Romains, il conclut un pacte et une alliance. Mais alors que les Bruttiens et les Lucaniens avaient rassemblé des renforts venus de leurs voisins, ils reprirent la guerre avec plus d’ardeur. C’est là, près de la ville de Pandosie et du fleuve Achéron, que le roi fut tué, sans avoir appris le nom du lieu fatal avant de périr, et en mourant il comprit que ce n’était pas dans sa patrie que l’avait attendu le danger de mort pour lequel il avait fui sa patrie. Les Thuriens ensevelirent son corps qu’ils avaient racheté aux frais de leur cité.
Tandis que ces événements se déroulaient en Italie, Zopyrion également, qu’Alexandre le Grand avait laissé comme gouverneur du Pont, ayant estimé qu’il aurait été oisif s’il n’avait aussi lui-même rien accompli, après avoir rassemblé une armée de trente mille hommes, porta la guerre contre les Scythes et, massacré avec ses troupes, il paya le fait d’avoir sans réfléchir porté la guerre contre un peuple inoffensif.
III. Comme ces nouvelles étaient arrivées à Alexandre en Parthie, celui-ci, feignant une profonde affliction en raison de sa parenté avec Alexandre, imposa à son armée un deuil de trois jours. Puis alors que tous, comme si la guerre avait été menée à son terme, attendaient le retour dans leur patrie et déjà embrassaient en quelque sorte en pensée leurs femmes et leurs enfants, il convoque son armée en assemblée. Là, il dit que rien n’a été accompli par tant de combats remarquables si on laisse intacte la barbarie de l’Orient, qu’il n’a pas recherché le corps mais le royaume de Darios et qu’il faut poursuivre ceux qui ont fait défection au royaume. Comme ce discours avait pour ainsi dire rendu au moral des soldats son premier enthousiasme, il soumit l’Hyrcanie et les Mardes.
Là vint à sa rencontre Thalestris, ou Minythyia, reine des Amazones, avec trois cents femmes, après avoir accompli une route de trente-cinq jours au milieu de nations très peuplées, pour avoir des enfants du roi ; son aspect et son arrivée soulevèrent l’admiration de tous, tant en raison de sa tenue, inusitée chez les femmes, que de son désir de partager la couche d’Alexandre. Aussi treize jours de repos furent-ils accordés par le roi et elle se retira lorsqu’il lui sembla avoir fertilisé son ventre.
Après cela Alexandre fait siens le vêtement des rois perses et leur diadème, inusité auparavant chez les rois macédoniens, comme s’il adoptait les lois de ceux qu’il avait vaincus. Et pour éviter que ces attributs ne soient regardés avec trop de jalousie sur lui seul, il ordonne que ses Amis portent également la longue robe de pourpre et brodée d’or. Pour imiter aussi la débauche des Perses comme leur raffinement, il partagea ses nuits à tour de rôle entre les harems des favorites royales d’une beauté et d’une noblesse remarquables. À cela il ajouta une pompe somptueuse dans les festins, de peur que leur prodigalité ne parût mal pourvue et atténuée, et il rehausse le banquet de jeux répondant à la magnificence royale, oubliant tout à fait qu’on perd d’habitude par de telles mœurs de si grands empires, et qu’on ne les acquiert pas.
IV. Pendant ce temps, tous dans le camp tout entier s’indignaient que ce héros ait dégénéré de son père Philippe au point de renier jusqu’au nom de sa patrie, et d’adopter les mœurs des Perses qu’il avait vaincus à cause de telles mœurs. Mais pour ne pas paraître être le seul à avoir succombé aux vices de ceux qu’il avait soumis par les armes, il permit aussi à ses soldats, s’ils étaient attachés par une liaison à quelque captive, de les épouser, estimant que le désir de retourner dans leur patrie diminuerait chez ceux qui auraient dans le camp une sorte de reproduction de maison et de foyer domestique ; qu’en même temps les fatigues de leur service militaire seraient aussi adoucies par la douceur de leurs épouses ; que pour recruter des soldats, on pourrait aussi moins épuiser la Macédoine si les fils prenaient la relève de leurs pères vétérans comme recrues qui serviraient dans le retranchement où ils seraient nés, et qui seraient plus constants s’ils avaient ancré dans le camp même non seulement leur apprentissage militaire, mais aussi leur jeune enfance. Et cette coutume demeura chez les successeurs d’Alexandre également. On accorda donc aux enfants de la nourriture, on donna aux jeunes hommes leur équipement en armes et en chevaux, et on accorda aux pères des récompenses en fonction du nombre de leurs fils. Si les pères de certains avaient péri, les enfants mineurs n’en touchaient pas moins la solde de leur père, et leur enfance était un service militaire accompli au cours d’expéditions diverses. C’est pourquoi, endurcis dès leur plus jeune âge aux fatigues et aux dangers, ils formèrent une armée invincible et ils ne regardèrent ni leur camp autrement que comme leur patrie, ni jamais une bataille comme autre chose qu’une victoire. Ces enfants eurent pour nom les Épigones.
Ensuite, une fois les Parthes vaincus, on nomme leur gouverneur Andragoras, choisi parmi les nobles perses. C’est de là que les rois Parthes tirèrent par la suite leur origine.
V. Pendant ce temps, Alexandre commença à sévir contre ses proches, non pas avec la haine d’un roi, mais avec celle d’un ennemi. Il s’indignait surtout d’être harcelé par les propos de ses proches affirmant qu’il avait bouleversé les mœurs de son père Philippe et de sa patrie. Et c’est pour ces griefs que le vieillard Parménion aussi, le plus proche du roi en dignité, est exécuté avec son fils Philotas, après qu’on les eut l’un et l’autre soumis à la question.
C’est pourquoi tous se mirent à frémir dans l’ensemble du camp, s’apitoyant sur le sort de ce vieillard innocent et de son fils, disant parfois qu’eux non plus ne devaient pas espérer mieux. Or comme ces nouvelles avaient été annoncées à Alexandre, dans la crainte que ce bruit ne se répande jusqu’en Macédoine et que ne soit salie par une tache de cruauté la gloire de sa victoire, il feint de vouloir envoyer dans la patrie certains de ses Amis comme messagers de la victoire. Il exhorte les soldats à écrire à leurs proches : les occasions seront plus rares à mesure que l’expédition sera plus lointaine. Il ordonne qu’on lui porte en secret les paquets de lettres qu’ils remirent ; il en tire la connaissance de l’opinion de chacun à son sujet et, ceux qui avaient eu un jugement trop sévère à l’égard du roi, il les incorpora dans une même cohorte, avec l’intention ou de les détruire ou de les répartir dans des colonies aux confins de la terre.
À partir de là, il soumit les Drances, les Évergètes, les Parmines, les Parapammènes, les Adaspes et tous les autres peuples qui demeuraient au pied du Caucase.
Pendant ce temps l’un des amis de Darios, Bessos, lui est amené enchaîné, lui qui avait non seulement trahi son roi mais qui l’avait aussi tué. Pour tirer vengeance de sa perfidie, il le livre au frère de Darios afin qu’il le torture, en se disant que Darios n’avait pas tant été son ennemi que l’ami de celui par lequel il avait été tué.
Et afin de laisser un nom à ces terres, il fonda la ville d’Alexandrie sur le fleuve Tanaïs : un rempart de six mille pieds avait été achevé en dix-sept jours, les peuples de trois cités que Cyrus avait fondées y avaient été transférés. Chez les Bactriens également ainsi que chez les Sogdiens, il fonda douze villes où il répartit tous les séditieux qu’il avait dans son armée.
VI. Ces actions ainsi menées, il invite un jour de fête ses amis à un festin où, alors qu’une conversation était née entre les invités pris de vin sur les exploits de Philippe, il se mit lui-même à se placer au-dessus de son père, et à élever jusqu’au ciel la grandeur de ses propres exploits, tandis que la majeure partie des convives l’approuvait. Aussi, comme l’un des vieillards, Clitos, ayant confiance en l’amitié du roi dont il tenait la palme, défendait la mémoire de Philippe et louait ses exploits, il offensa le roi au point que celui-ci arracha un javelot à l’un de ses gardes du corps et le tua en plein festin. Tout excité par ce massacre, il reprocha au mort sa défense de Philippe et son éloge de l’esprit militaire de son père.
Après que son âme, rassasiée par ce massacre, se fut reposée, et que la réflexion eut pris la place de la colère, considérant tantôt la personne du mort, tantôt la raison du meurtre, il commença à regretter son acte ; de fait il s’affligeait d’avoir accueilli les louanges à son père avec une colère qu’il n’aurait pas dû tant éprouver même contre des injures, et de ce qu’un ami, vieillard et innocent, eût été tué de sa main au milieu des mets et des coupes. Se plongeant donc dans le regret avec la même fureur qu’auparavant dans la colère, il voulut mourir. Et Alexandre, s’abandonnant aux pleurs, d’étreindre le mort, de toucher ses blessures, et de lui avouer sa démence comme s’il l’entendait ; il dirigea contre lui le javelot dont il s’était saisi et il serait passé à l’acte si ses amis n’étaient intervenus. Ce désir de mourir demeura aussi les jours suivants. Le souvenir de sa nourrice, sœur de Clitos, était en effet venu s’ajouter à son regret : penser à elle, même absente, lui inspirait une très grande honte : il la payait pour l’avoir nourri d’un salaire si ignominieux que, jeune et victorieux, il renvoyait à la femme dans les bras de laquelle il avait passé son enfance, pour prix de ses bienfaits, un cadavre.
Il songeait ensuite combien il avait créé de fables et d’hostilité dans sa propre armée, chez les nations vaincues, combien de crainte et de haine il avait attiré contre lui chez tous ses autres amis, combien il avait rendu son festin amer et funeste, lui qui ne fut pas plus terrible en armes au combat que dans un festin ! Alors Parménion et Philotas, alors son cousin Amyntas, alors sa belle-mère et ses frères qu’il avait fait tuer, alors Attale, Euryloque, Pausanias et les autres princes de Macédoine qu’il avait fait disparaître se pressèrent dans son esprit. Pour cela, il passa quatre jours à se priver de nourriture jusqu’à être fléchi par les prières de l’ensemble de son armée, qui le priait de ne pas s’affliger de la mort d’un seul au point de perdre l’ensemble de ses hommes qu’il abandonnait, après les avoir menés jusqu’aux confins du monde barbare, au milieu de nations hostiles et irritées par la guerre. Les prières du philosophe Callisthène furent très utiles ; il lui était lié de manière intime pour avoir suivi avec lui les leçons d’Aristote et c’est le roi lui-même qui l’avait alors fait venir pour transmettre ses exploits à la postérité. Il porta donc alors à nouveau son attention aux guerres et reçut la reddition des Chorasmes et des Dahes.
VII. Ensuite, ce qu’il avait différé dans un premier temps d’emprunter à la coutume perse de l’orgueil royal, pour éviter que toutes ses pratiques, adoptées en même temps, fussent trop révoltantes, il ordonne d’être non pas salué, mais adoré. Le plus acharné parmi les opposants fut Callisthène. Cette attitude causa sa perte et celle de nombreux princes macédoniens, puisque tous furent tués sous prétexte de complot. Pourtant leur façon de saluer le roi fut conservée par les Macédoniens, après le mauvais accueil fait à l’adoration.
Après quoi il gagne l’Inde, pour borner son empire à l’Océan et à la limite de l’Orient. Et afin que même les équipements de l’armée s’accordent à cette gloire, il fait recouvrir d’argent les phalères des chevaux ainsi que les armes des soldats, et appela sa propre armée les Argyraspides en raison de ses boucliers d’argent.
Alors qu’il était arrivé près de la ville de Nysa, comme ses citoyens n’opposaient pas de résistance, ayant confiance en le culte qu’ils rendaient à Liber Pater par lequel la ville avait été fondée, il ordonna qu’on les épargnât, heureux d’avoir suivi non seulement l’expédition du dieu, mais aussi ses traces. Il conduisit alors son armée contempler le mont sacré, recouvert d’une nature bienfaitrice, de vigne et de lierre, tout comme si elle avait été parée par la pratique de la culture et l’industrie des cultivateurs. Mais son armée, quand elle s’approcha du mont, excitée par un soudain élan de l’esprit à pousser les hurlements sacrés dus au dieu, courut en tous sens à la stupeur du roi, sans causer de dommage, de sorte qu’il comprit qu’il n’avait pas veillé tant aux intérêts des citoyens en les épargnant, qu’à ceux de sa propre armée.
De là il gagne les monts Dédale et les royaumes de la reine Cléophis. Cette dernière, alors qu’elle s’était rendue à lui, reçut d’Alexandre son royaume racheté par des rapports sexuels : elle obtint par ses appâts ce qu’elle n’aurait pu obtenir par les armes ; et elle appela Alexandre son fils né de lui, qui fut par la suite maître du royaume des Indes. La reine Cléophis, pour avoir prostitué sa pudeur, fut à partir de là surnommée par les Indiens la catin royale.
Après avoir parcouru l’Inde, alors qu’il était arrivé à un rocher d’un escarpement et d’une hauteur prodigieux, sur lequel de très nombreux peuples s’étaient réfugiés, il apprend qu’Hercule fut empêché de prendre d’assaut ce même rocher par un tremblement de terre. Aussi, pris du désir de surpasser les exploits d’Hercule, il se rendit maître du rocher, au prix d’une peine et d’un danger extrêmes, et reçut la reddition de toutes les nations de cette région.
VIII. Parmi les rois des Indiens, il y en avait un, du nom de Poros, également remarquable par ses forces physiques et sa grandeur d’âme, qui, ayant entendu parler depuis quelque temps déjà de la réputation d’Alexandre, préparait la guerre contre son arrivée. C’est pourquoi, une fois le combat engagé, il ordonne que sa propre armée attaque les Macédoniens, réclame de rencontrer leur roi comme un ennemi personnel, et Alexandre ne retarda pas le combat ; mais, son cheval blessé au premier assaut, alors qu’il était tombé la tête la première, il est sauvé par ses gardes du corps qui étaient accourus. Poros, couvert de multiples blessures, est fait prisonnier. Et il fut à ce point affligé d’avoir été vaincu que, bien que son ennemi lui eût fait grâce, il ne voulut pas prendre de nourriture ni ne souffrit que l’on soignât ses blessures, et l’on obtint avec peine qu’il veuille rester en vie. Alors Alexandre, en honneur de son courage, le renvoya sain et sauf dans son royaume. Il y fonda deux villes : il appela l’une Nicée, l’autre Bucéphale du nom de son cheval.
À partir de là, il soumit les Adrestes, les Catènes, les Présides et les Gangarides, après avoir massacré leurs armées. Alors qu’il était arrivé chez les Cufites, où deux cent mille cavaliers ennemis l’attendaient, toute son armée, épuisée non moins par le nombre des victoires que par ses peines, le supplie en larmes de mettre enfin un terme aux guerres, de se souvenir une bonne fois de la patrie et du retour, de considérer les ans de ses soldats pour lesquels le reste de leur vie suffirait à peine au retour. Et l’un de montrer ses cheveux blancs, un autre ses blessures, un autre son corps épuisé par l’âge, un autre le sien accablé de cicatrices : ils étaient les seuls à avoir supporté sans s’arrêter la campagne ininterrompue de deux rois, Philippe et Alexandre. Ils le prient enfin de rendre à tout le moins leurs cendres aux tombeaux de leurs pères, eux dont ce n’est pas tant le zèle que les ans qui leur font défaut, et que, s’il n’épargne pas ses soldats, il épargne du moins sa propre personne de peur de fatiguer sa fortune en lui en demandant trop. Touché par de si légitimes prières, comme pour signifier la fin de la victoire, il ordonna de monter un camp plus imposant que d’habitude, en sorte que l’ennemi fût terrifié par sa construction, et que fût laissé à la postérité un sentiment d’admiration pour sa personne. Les soldats ne firent jamais aucun travail avec plus de joie. Aussi, après avoir massacré les ennemis, rentrèrent-ils dans ce même camp en se félicitant.
IX. À partir de là, Alexandre se dirige vers le fleuve Acésinès. Il descend en bateau sur ce dernier jusqu’à l’Océan. Il reçut là la soumission des Agensones et des Sibes, nations qu’Hercule a fondées.
De là, il navigue vers les Mandres et les Sugambres ; ces peuples le reçoivent avec des hommes armés, quatre-vingts mille fantassins et soixante mille cavaliers. Comme il était vainqueur au combat, il conduit son armée vers leur ville. Et comme il avait remarqué depuis le rempart, qu’il avait gagné le premier, qu’elle avait été abandonnée par ses défenseurs, il sauta à terre dans la place de la ville sans aucun garde. Aussi, alors que ses ennemis s’étaient aperçu qu’il était seul, ils accourent de toutes parts en poussant une clameur, au cas où ils pourraient, avec une seule tête, mettre un terme aux guerres touchant le monde entier et venger tant de peuples ; Alexandre n’en résista pas moins opiniâtrement et il se bat, lui seul contre tant de milliers d’individus. C’est un récit incroyable, que ni le nombre des ennemis, ni la grande puissance des traits, ni la si forte clameur de ses assaillants ne l’effrayèrent, que seul il massacra et mit en fuite tant de milliers d’hommes ! Quand il vit qu’il était, en vérité, débordé par le nombre, il s’adossa à un tronc d’arbre qui se dressait à côté du rempart ; alors qu’il avait, à l’abri derrière la protection que celui-ci lui offrait, longtemps soutenu leur assaut, lorsqu’ils apprirent le danger ses Amis, dont un grand nombre fut tué, le rejoignirent d’un saut à terre, et le combat fut longtemps incertain jusqu’à ce que toute l’armée vînt à leur secours après avoir abattu les remparts.
Traversé par une flèche sous le sein au cours de ce combat, comme il défaillait en raison de la perte de son sang, il posa un genou à terre et combattit longtemps, jusqu’à ce qu’il tuât l’homme par lequel il avait été blessé. Le traitement de sa blessure fut plus pénible que la blessure elle-même.
X. C’est pourquoi, quand il fut enfin rétabli d’un état qui faisait fortement désespérer de son salut, il envoie Polypercon à Babylone avec l’armée ; lui-même, après avoir embarqué sur des navires avec une troupe d’élite, longe les rivages de l’Océan. Comme il était arrivé à la ville du roi Ambiger, les habitants, apprenant que le fer n’a pu le vaincre, empoisonnent leurs flèches et, comme une blessure était ainsi synonyme de mort, en repoussant l’ennemi loin de leurs murs, ils en tuent un très grand nombre. Alors que, parmi de nombreux hommes, Ptolémée aussi avait été blessé et qu’il semblait devoir mourir d’un instant à l’autre, une herbe apparut au roi pendant son sommeil comme un remède au poison ; aussitôt qu’il la prit dans un breuvage, Ptolémée fut délivré du danger et la plus grande partie de l’armée fut sauvée par ce remède. Puis, après avoir soumis la ville et être revenu à son navire, il offrit des libations à l’Océan, en ayant demandé dans ses prières un retour heureux dans sa patrie ; et, comme un char qui a fait le tour de la borne, après avoir fixé les limites de son empire jusqu’où les déserts de la terre lui ont permis d’avancer ou bien jusqu’où la mer fut navigable, il est porté par un flot favorable jusqu’à l’embouchure du fleuve indien. Là il fonda la ville de Barcé pour garder le souvenir des exploits qu’il avait accomplis et éleva des autels, après avoir laissé un de ses amis comme gouverneur des côtes indiennes.
À partir de là, décidé à faire route sur terre, alors qu’on lui annonçait des lieux arides en cours de route, il ordonna que l’on creusât des puits à des endroits appropriés grâce auxquels, comme on trouva une grande quantité d’eau douce, il retourna à Babylone. Là, de nombreux peuples vaincus mirent en cause leurs gouverneurs qu’Alexandre, sans tenir compte de leurs liens d’amitié, fit mettre à mort sous les yeux de leurs ambassadeurs.
Après cela il épousa la fille du roi Darios, Stateira, mais il donna également aux meilleurs des Macédoniens les plus nobles jeunes filles, choisies dans tous les peuples, pour que fût allégée l’accusation portée contre le roi par le partage de sa conduite.
XI. Il convoque alors ses troupes en assemblée, et promet qu’il paiera les dettes de tous à ses frais pour qu’ils rapportent chez eux intacts leur butin et leurs récompenses. Cette générosité fut remarquable non seulement par son montant mais aussi parce qu’elle était présentée comme une récompense, et elle ne fut pas accueillie avec plus de plaisir par les débiteurs que par les créanciers, puisque le recouvrement et le paiement étaient également difficiles, pour les uns comme pour les autres. On dépensa vingt mille talents à ces frais.
Après avoir licencié les vétérans, il complète l’effectif de son armée avec de plus jeunes soldats. Mais ceux qui furent retenus, supportant mal le départ des vétérans, réclamaient eux aussi leur congé et exigeaient que l’on ne comptât pas leur âge mais le temps de service, estimant équitable que, puisqu’ils avaient été recrutés pour l’armée en même temps, ils soient délivrés de leur serment en même temps. Et ils n’employaient déjà plus les prières mais les invectives, exigeant qu’Alexandre entreprenne seul ses guerres avec son père Ammon, puisqu’il méprisait ses soldats. Il répondit à cette situation tantôt en châtiant ses soldats, tantôt en les engageant par de douces paroles à ne pas ternir leur service glorieux par des séditions. À la fin, comme il n’obtenait aucun résultat avec des paroles, il descendit lui-même d’un bond du tribunal au sein de l’assemblée armée, sans armes, pour saisir les auteurs de la sédition et, sans que personne ne l’en empêche, il en saisit treize de sa propre main et les conduisit lui-même au supplice, que ce soit pour eux la peur du roi qui leur inspirât une telle acceptation de la mort, ou pour lui la discipline militaire qui lui inspirât une telle fermeté à exiger le supplice.
XII. Ensuite il s’adresse séparément aux troupes auxiliaires des Perses réunies en assemblée. Il loue leur loyauté ininterrompue, aussi bien envers lui qu’envers leurs rois précédents ; il rappelle les bienfaits qu’il leur a adressés, comment il ne les a jamais traités comme des vaincus mais comme des alliés de la victoire, enfin que c’est lui qui a adopté leur mode de vie et non eux qui ont adopté celui de son peuple, qu’il a mêlé les vaincus aux vainqueurs par les liens des mariages. Il affirme ensuite également que la protection de sa personne ne sera pas confiée qu’aux Macédoniens, mais à eux aussi ; il choisit ainsi parmi eux mille jeunes hommes à compter parmi ses gardes du corps, et il mêle à sa propre armée une partie des troupes auxiliaires formée à la discipline des Macédoniens.
Mais les Macédoniens supportèrent mal cette mesure, arguant que leurs ennemis avaient été mis à leur poste par le roi. Alors tous viennent en larmes trouver le roi ; ils le prient d’étancher sa colère par leurs supplices plutôt qu’en leur faisant outrage. Cette modération leur valut d’obtenir qu’il donnât leur congé à onze mille soldats vétérans ; mais également parmi ses amis, les plus âgés furent licenciés : Polypercon, Clitos, Gorgias, Polydamas, Amadas, Antigénès. Cratère est placé à la tête des soldats licenciés, avec pour ordre de commander aux Macédoniens à la place d’Antipater, et Alexandre appelle auprès de lui Antipater, accompagné d’un renfort de jeunes recrues. On donna leur solde à ceux qui rentraient comme s’ils étaient en service.
Pendant que l’on s’occupait de cela, un de ses Amis, Héphestion, mourut ; en raison de ses qualités – sa beauté et sa jeunesse – d’abord, et de ses complaisances ensuite, il était très cher au roi. Or Alexandre, faisant fi de la bienséance royale, le pleura longtemps, lui fit élever un tombeau coûtant douze mille talents et ordonna qu’il fût après sa mort honoré comme un dieu.
XIII. Alors qu’Alexandre retourne vers Babylone depuis les rivages les plus éloignés de l’Océan, on lui annonce que des légations de Carthaginois et des autres cités d’Afrique, mais aussi des Espagnes, de Sicile, de Gaule, de Sardaigne, ainsi que quelques-unes venues d’Italie, attendent son arrivée à Babylone. La terreur que son nom inspirait avait à ce point envahi le monde entier que, pour ainsi dire, tous les peuples sans exception adulaient le roi qui leur était destiné. C’est donc pour cette raison qu’il accélérait sa marche vers Babylone, comme pour y tenir les assises du monde entier, quand un de ses mages l’avertit de ne pas entrer dans la ville, ayant affirmé que ce lieu lui serait fatal. Après avoir, pour cette raison, laissé Babylone, il se retira à Borsipa, une ville de l’autre côté de l’Euphrate, autrefois abandonnée. Là, il fut pressé par le philosophe Anaxarque de mépriser au contraire les prédictions des mages, en les tenant pour trompeuses, incertaines, inconnues des mortels si elles s’accordaient avec les destins, et immuables si elles étaient le fruit de la nature.
Étant donc retourné à Babylone, après avoir consacré de nombreuses journées au repos, il organisa un banquet selon la coutume autrefois interrompue ; et alors que, s’étant abandonné tout entier à la joie, il avait fait durer jusqu’au jour une nuit de veille, au moment où il quitte le banquet le Thessalien Médios l’invite, lui et ses Compagnons, à une nouvelle orgie. Il prit une coupe et, au milieu du verre, soudain, comme s’il avait été percé d’un trait, poussa un gémissement et, emporté à moitié mort hors du banquet, il fut torturé par une douleur si grande qu’il réclamait une épée pour y remédier et que le contact des hommes le faisait souffrir comme des blessures.
Ses Amis répandirent le bruit qu’une ivresse excessive était cause de sa maladie ; or ce fut en réalité un traquenard, dont le scandale fut étouffé par la puissance de ses successeurs.
XIV. L’instigateur du traquenard fut Antipater, qui voyait que les Amis les plus chers d’Alexandre avaient été tués, qu’Alexandre des Lyncestes, son gendre, avait été exécuté, que lui-même, après avoir mené de grandes actions en Grèce, n’était pas tant objet de bienveillance que de jalousie aux yeux du roi, qu’il avait également été accablé de diverses accusations calomnieuses par sa mère Olympias. S’y ajoutaient les supplices exercés avec cruauté peu de jours avant contre les gouverneurs des nations vaincues. Et cela l’amenait à penser que lui aussi n’avait pas été appelé de Macédoine pour participer à l’expédition, mais pour être châtié.
Pour devancer le roi, il suborne donc son fils Cassandre après lui avoir confié le poison : il avait coutume de servir le roi à table avec ses frères Philippe et Iollas. Or la puissance de ce poison était si grande qu’il ne se conservait ni dans le bronze, ni dans le fer, ni dans l’argile, et qu’on ne put le transporter dans un autre réceptacle qu’un sabot de cheval. Comme son fils avait été averti de n’avoir confiance en personne d’autre que le Thessalien et ses frères, c’est donc pour cette raison qu’on prépara et qu’on reprit le banquet chez le Thessalien. Philippe et Iollas, qui avaient coutume de goûter les premiers et de préparer le vin du roi, versèrent le poison dans l’eau froide qu’ils venaient de goûter.
XV. Le quatrième jour Alexandre, sentant que sa mort ne faisait plus de doute, dit qu’il reconnaissait le destin de la maison de ses ancêtres car la plupart des Éacides étaient morts avant leurs trente ans. Puis, comme ses soldats s’agitaient et soupçonnaient que le roi périssait victime d’un traquenard, il les apaisa lui-même et, alors qu’il s’était fait porter à l’endroit le plus élevé de la ville, il les laissa tous venir le voir et offrit sa main droite à baiser à ces hommes en pleurs. Bien que tous fussent en larmes, lui-même demeura non seulement sans larmes mais sans rien qui indiquât un esprit plus triste, de sorte qu’il en consola certains qui s’affligeaient sans montrer assez de résignation, qu’il confia à d’autres des commissions pour leurs parents : tout comme face à l’ennemi, face à la mort aussi son courage resta invaincu.
Une fois les soldats dispersés, il demande aux Amis qui l’entourent s’ils pensent retrouver un roi qui lui serait semblable. Comme tous se taisaient, lui dit alors que s’il l’ignorait, du moins il savait, il prédisait, il voyait presque de ses yeux combien de sang la Macédoine verserait dans cette rivalité, par quels massacres, quel sang elle l’honorerait quand il serait mort. À la fin il ordonne que son corps soit enseveli dans le temple d’Ammon. Alors que ses Amis le voyaient défaillir, ils demandent qui il fait héritier de l’empire. Il répond : « le plus digne ». Sa grandeur d’âme fut telle que, quand il laissait un fils, Hercule, un frère, Arrhidée, une femme enceinte, Roxane, il oublia les liens de la famille et désigna le plus digne pour son héritier, tout comme s’il était sacrilège qu’à un homme courageux succédât un autre qu’un homme courageux, ou que les ressources d’un si grand royaume soient abandonnées à d’autres qu’à des hommes estimés. Comme si, par cette parole, il avait donné le signal du combat entre ses Amis ou leur avait lancé la pomme de Discorde, tous se dressent pour rivaliser les uns avec les autres et recherchent, en démarchant la foule, la faveur secrète des soldats.
Le sixième jour, alors que sa parole était empêchée, il confia à Perdiccas un anneau retiré de son doigt, geste qui apaisa la division croissante de ses Amis. En effet, même si l’héritier ne fut pas désigné par la parole, il semblait pourtant avoir été choisi par la pensée.
XVI. Alexandre mourut à l’âge de trente-trois ans et un mois ; c’était un homme doté d’une grandeur d’âme qui dépassait les facultés humaines. La nuit où sa mère Olympias l’avait conçu, elle se vit pendant son sommeil enlacée par un serpent immense, et elle ne fut pas trompée par son rêve car elle porta assurément en son sein une œuvre surpassant la condition humaine des mortels. Et cette femme, alors que la famille des Éacides depuis les temps séculaires les plus reculés, ainsi que les règnes de ses père, frère, mari et de tous ses ancêtres à leur tour l’avaient auréolée de lumière, aucun nom ne la rendit cependant plus illustre que celui de son fils.
Un certain nombre de prodiges annonçant la grandeur d’Alexandre apparurent à sa naissance même. Le jour où il naquit en effet, deux aigles restèrent perchés toute la journée sans interruption sur le faîte de la maison de son père, qui portaient le présage de son double empire, de l’Europe et de l’Asie. Le même jour, son père reçut également la nouvelle de deux victoires, l’une concernant la guerre d’Illyrie, l’autre une épreuve olympique dans laquelle il avait envoyé des quadriges, présage qui annonçait au nouveau-né sa victoire sur toutes les terres.
Enfant, il fut formé par des études littéraires très poussées. Une fois passée l’enfance, il se développa en suivant l’enseignement d’Aristote, fameux entre tous les philosophes.
Après avoir par la suite reçu l’empire, il donna ordre d’être appelé roi de toutes les terres et du monde, et il inspira à ses soldats une si grande confiance en lui qu’ils ne craignirent en sa présence les armes d’aucun ennemi, même désarmés. C’est pourquoi il ne marcha contre aucun ennemi qu’il ne vainquît, il n’assiégea aucune ville qu’il ne prît, il n’aborda aucun peuple qu’il ne foulât aux pieds. Il fut vaincu enfin en dernier lieu non par la bravoure d’un ennemi, mais par un traquenard des siens et par la perfidie d’un sujet.