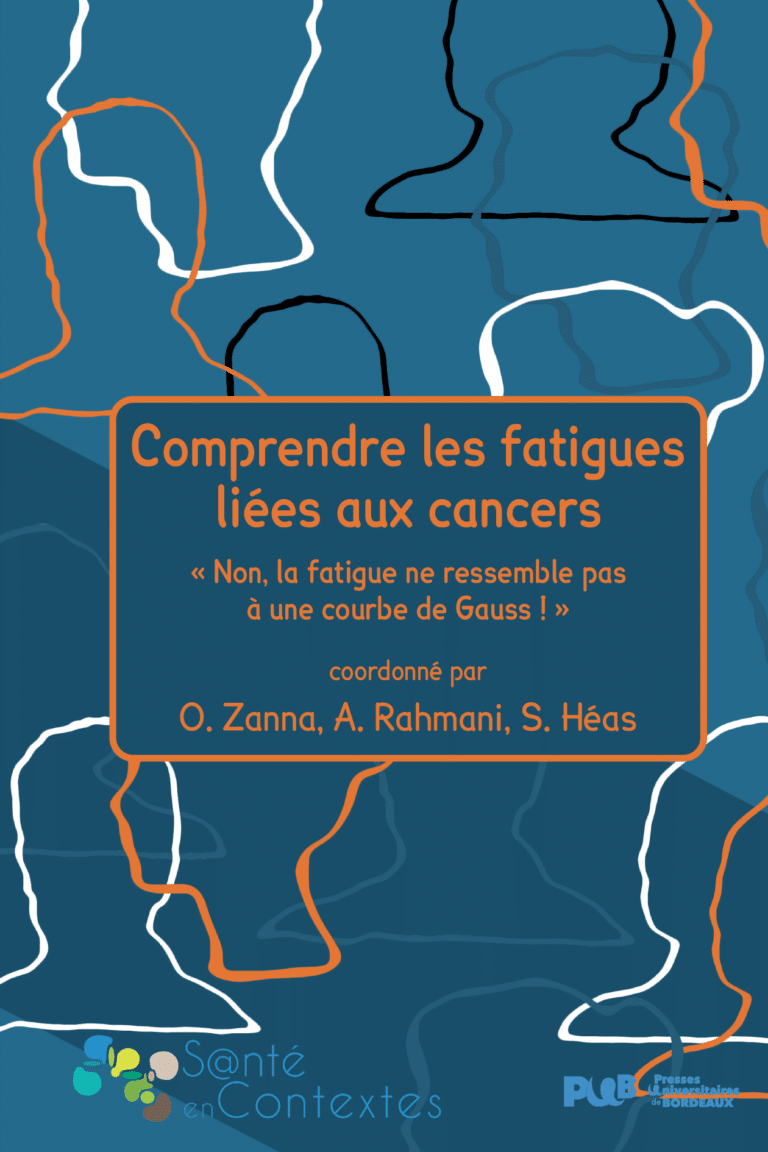Interlude N° 1
Claire, 58 ans, est en rémission complète d’un cancer du sein. Entretien réalisé le 03 mai 2019, à la Maison du Patient.
Elle est omniprésente cette fatigue. En dehors de mon travail à temps plein, de mes trois activités, je ne fais quasiment rien d’autre. Je ne sors pas. Je ne fais rien, rien, rien. Je suis allée mardi soir écouter un concert, ça n’était pas arrivé depuis je ne sais pas combien de temps. Je n’ai plus l’énergie. Quand j’arrive chez moi, c’est comme si on faisait on/off, j’ai fait tout ce que j’avais à faire, mon travail, c’est ma priorité, ensuite mes activités, c’est mon autre priorité, et après… Au point que j’ai une fille qui a deux enfants, alors ce n’est pas que je n’en ai pas envie, c’est que je n’ai plus l’énergie pour faire. Puisque mes petits fils je les adore et réciproquement, quand ma fille me demande de les prendre, il y a d’abord « je suis contente » et puis après… C’est le cas du 8 mai par exemple, je vais les avoir, le mardi soir jusqu’à la fin de l’après-midi, je suis hypercontente mais je vais être dans un état… Ça va être terrible. Ce qui fait qu’une fois qu’ils vont être partis… Moi, je récupère par le sommeil, il n’y a que le sommeil qui peut me sauver. Voilà. Quelques fois j’ai envie… Alors mon autre fille qui travaille sur Paris, quand elle rentre, elle me dit, chaque fois qu’il y a une période de vacances, puisqu’elle est calée sur l’Éducation Nationale, quand elle rentre et qu’elle a sa semaine de vacances elle me dit : « On va dîner à l’extérieur ». Alors on en parle trois semaines avant, oui ça va, j’ai envie, et plus le temps avance, plus ça me soucie, ça me soucie… Alors je prends sur moi. À chaque fois je dépasse cette fatigue et je prends du plaisir, mais voilà… Je me sens obligée de le faire pour ne pas la décevoir.
Introduction
Lorsqu’en 1932, les docteurs Gaston et André Durville déposent le cahier des charges d’Héliopolis (Île du Levant), lotissement appelé à devenir la première commune naturiste de France, l’argument invoqué pour convaincre les pouvoirs publics est de permettre au plus grand nombre de venir « dans le calme d’une nature splendide, se reposer des fatigues de la civilisation artificielle des villes, en passant des vacances simples et saines, avec le seul luxe d’un idéal élevé, et le seul souci d’une santé plus robuste » (Cahiers des charges, 1933). On ne saurait également manquer de remarquer les critiques émises par nombre de leaders naturistes à propos des conditions de travail des ouvriers et de leur exposition aux polluants (Jarrige, Le Roux, 2017), qui constituent autant de sources de maladies et d’épuisement organique. La « fatigue industrielle », ou liée plus généralement aux conditions de travail, est un sujet largement abordé au sein des mouvements naturistes de la fin du XIXe siècle jusqu’aux années 1950. Perte de vitalité, dégénérescence, débilité nerveuse, manque d’énergie, baisse de vigueur, vieillissement prématuré, affaiblissement, épuisement ; les discours naturistes manipulent ainsi un large vocabulaire désignant un état physique affaibli, altéré, un « sentiment de robustesse annulée » (Vigarello, 2020, p. 11), une sensation pénible accompagnant toute activité. De fait, la fatigue tient une place centrale dans la vulgate naturiste qui se déploie alors depuis plus d’un siècle. Sous la plume des théoriciens du naturisme, elle est décrite, en effet, comme le symptôme de la perte de vitalité qui accompagne une existence de plus en plus contre nature. Le constat est unanime : les nouvelles générations sont plus faibles, plus fragiles ; elles sont plus facilement emportées par la maladie, les épidémies. L’abbé Sebastian Kneipp, célèbre promoteur d’une cure naturiste à base d’eau et de plantes, s’interroge en 1892 :
Où allons-nous donc, si, suivant les plaintes de tous les hommes réfléchis, la vigueur et la longévité baissent avec une rapidité effrayante, si la langueur commence déjà là où la force vitale est encore à se développer ? (Kneipp, 1892, p. 12).
Fort de ces remarques, notre propos vise à identifier les différentes conceptions et significations de la fatigue véhiculées dans les discours naturistes de la période considérée. Quelles en sont les caractéristiques, les soubassements théoriques, idéologiques ? Quel contexte préside à leur formalisation ? De façon corollaire, se pose la question des facteurs perçus par les concepteurs1 du naturisme comme étant à l’origine de cette fatigue. Cette généalogie de la fatigue doit nous amener à réfléchir non seulement sur les causes qu’on lui prête, mais aussi sur les moyens préconisés pour y faire face.
À partir de l’analyse d’un large corpus de publications naturistes parues entre le XIXe siècle et la fin des années 19402, nous aurons ainsi l’occasion d’identifier cinq formes de fatigue, témoignages, pour les théoriciens du naturisme, d’une désadaptation de l’individu qui se conjugue au pluriel. Puis, nous verrons que des préoccupations d’ordre identitaire se dissimulent derrière cette obsession de la fatigue. Enfin, nous montrerons que le mythe du retour à la nature, entendu ici comme un récit unificateur, nourrit un processus d’innovation dans le champ de la santé comme dans celui de l’éducation physique et des sports. Confrontés aux différents publics – enfants, malades, blessés de guerre… – qu’ils accueillent dans leurs centres, les chefs de file du naturisme sont amenés à élaborer des activités physiques adaptées à leur état physique. Les pratiques qu’ils promeuvent sont aussi fondées sur l’exposition, parfois éprouvante, du corps aux différents éléments naturels, contribuant, in fine, à développer « le sentiment de soi » (Vigarello, 2014). Elles s’inscrivent également dans une démarche ascétique de transformation corporelle, voire d’excellence corporelle, aux accents souvent eugénistes.
Les fatigues du « civilisé »
La fatigue en tant que « dévitalisation »
Partons d’un premier fait : le naturisme naît vers la fin du XVIIIe siècle comme théorie médicale néohippocratique, c’est-à-dire fondée sur la certitude d’une natura medicatrix, d’une nature interne à l’individu qui soigne, qui trouve par elle-même les moyens de sa guérison. Cette remarque a son importance. De facto, les différentes formes de naturisme qui se succèdent, coexistent parfois au cours du temps, ont toutes une dimension médicale, un soubassement médical (Villaret, 2005). Notons ensuite que c’est au XIXe siècle que le naturisme se structure en tant que projet de réformes des modes de vie et de soins, s’appuyant sur des mouvements, des organisations comme, en Allemagne, l’Union des sociétés allemandes pour une manière de vivre et de se soigner conformément à la nature3, disposant rapidement de structures, de lieux de réalisation. Le point de départ de la réflexion naturiste et des projets réformistes qui en résultent est le constat d’un affaiblissement de la génération actuelle par rapport aux générations passées. Différentes causes et formes de fatigue, les deux se confondant le plus souvent, sont ainsi identifiées, étudiées, formalisées.
Chez les théoriciens du naturisme, la fatigue physique est avant tout perçue comme une perte de vitalité. S’inspirant de la thermodynamique naissante (Vigarello, 1980), l’individu est vu comme une batterie, un accumulateur qui se charge en énergie vitale grâce aux éléments naturels : air, soleil, eau, exercice… La fatigue chronique provient dès lors d’une « coupure », ou plutôt d’une absence de contact suffisant entre l’individu et les flux vitaux contenus dans la nature. Les propos d’Arnold Rikli, l’un des pionniers du naturisme au XIXe siècle, en donnent la parfaite illustration. Celui-ci compare la structure humaine à celle d’un arbre, puisant sa vitalité dans la terre où il s’enracine, mais aussi dans l’atmosphère où il étend ses ramures :
L’homme doit être considéré comme la plante terrestre la plus développée ; c’est pour son plus grand dommage qu’il s’isole de l’atmosphère comme il le fait par son habitation, sa manière de se vêtir, son goût pour l’ombre… et pour les parasols ! (Rikli, 1905, p. 39).
De fait, pour Rikli, le bon fonctionnement du système nerveux est directement dépendant du soleil et, plus largement, de l’atmosphère. Dès lors, « l’homme, privé de lumière, pâlit, se débilite et perd, en dernier lieu, toute son énergie vitale » (p. 42). En conséquence de quoi, Rikli propose, aux « neurasthéniques », ses célèbres « cures atmosphériques » dans le centre qu’il a ouvert à Veldes (Silésie autrichienne). Cette représentation de « l’homme-plante » devient rapidement un pilier de la rhétorique naturiste. Le Dr. Paul Carton, qui est considéré en France entre les deux guerres comme la référence en matière de médecine naturiste, y compris par ses adversaires et ses concurrents, s’en fait l’éminent prolongateur. Il identifie ainsi précisément les sources de la vitalité humaine :
Les différents milieux terrestres et les êtres qui les peuplent sont imprégnés de force vitale. Elle est répandue surtout dans l’air, dont les propriétés vivifiantes ne sont pas un vain mot. Elle est l’essence même des rayons solaires qui apportent la vie à la nature entière. Elle abonde dans les effluves magnétiques du sol. Elle est absorbée par l’eau. Elle est accumulée et hiérarchisée dans les tissus des végétaux et des animaux (Carton, 1922, p. 57).
Sa particularité est d’insister sur l’alimentation qu’il veut impérativement végétarienne. Nulle surprise à ce qu’il s’en prenne ainsi à « la vie claustrée dans l’atmosphère usée des grandes villes », au « séjour prolongé dans des cubes de maçonnerie où la lumière pénètre à peine et où à l’air se renouvelle mal » et au « port incessant de vêtements épais, multiples et sombres ». Nul étonnement à ce qu’il insiste sur « l’insuffisance des soins hydrothérapiques et surtout les habitudes de nourriture cuite, stérilisée et concentrée, c’est-à-dire dévitalisée par l’industrie ». Pour le Dr. Carton, ce sont en effet autant de « causes majeures de déperdition vitales et, par suite, de dégénérescence et d’aptitude morbide ».
La mode vestimentaire est également montrée du doigt (Villaret, 2017). Privant l’individu des échanges vitaux avec les éléments naturels, elle est le vecteur de représentations du corps erronées ainsi qu’une source de limitation des mouvements, voire même de déformation dans le cas du corset. Suivant cette ligne, les naturistes voient dans l’état de fatigue des populations une conséquence d’un mode de vie aberrant mais aussi des différentes pollutions caractéristiques de la société moderne : fumées des usines et des voitures, poussières de routes, contamination des rivières. Ils participent, ce faisant, à l’éveil d’une conscience écologique (Villaret, 2021).
Une cause : le manque d’endurcissement physique
Parmi les autres lignes de force de l’argumentaire naturiste, on discerne l’idée d’une mollesse croissante des individus. Les pionniers du naturisme s’en émeuvent dès le XIXe siècle, y trouvant un argument pour convaincre les autorités publiques de l’intérêt et du bien-fondé de leurs pratiques au moment où s’instaure le monopole de la corporation des médecins. Parmi les premiers à en faire un fonds de commerce, on peut citer l’abbé de Wörishofen, Sebastian Kneipp.
La mollesse de nos contemporains va très loin. La délicatesse, la débilité, le sang appauvri, les nerfs affectés, les maladies de cœur et d’estomac, sont presque la règle, tandis que la vigueur et la santé sont devenues l’exception. On est très sensible à tout changement de temps ; on ne passe pas d’une saison à l’autre sans rhume de cerveau, sans catarrhe ; même le froid de la rue et la chaleur de la chambre ne se succèdent pas impunément, etc… C’était encore toute autre chose il y a cinquante ans ou soixante ans […] (Kneipp, 1892, p. 12).
La fatigue est ainsi entendue comme un manque de rusticité, d’endurcissement, conséquence d’une société du moindre effort et du tout confort. Ce constat nourrit une rhétorique antimoderne, prédisant à la race4 humaine un avenir pour le moins apocalyptique. Les docteurs Georges Rouhet et Paul Carton, connus pour leur verve et l’acidité de leur plume, en sont les porte-paroles en France. Pour le premier, les conditions de vie moderne inventent une nouvelle humanité corporelle, au croisement de la préhistoire et de la science-fiction :
Que penser de cette civilisation qui nous promet, dans un avenir plus ou moins rapproché, une race de nains, avec des muscles mous et sans énergie, des membres grêles, des visages d’anthropoïdes inférieurs et des têtes grosses comme des hydrocéphales, incapables bientôt de se mouvoir par eux-mêmes, ne parcourant la terre que grimpés sur des bicyclettes, blottis dans des automobiles, étendus nonchalamment sur les couchettes des sleeping-cars, ou perchés sur des biplans (Rouhet, 1913, p. 7).
Le second identifie quant à lui un trait psychologique contemporain, « la crainte obsédante de la « ‘faiblesse »‘ » (Carton, 1911, p. 529), à l’origine du refus « de tout exercice musculaire, de peur de [se] fatiguer ». Il en voit la preuve dans l’essor des nouveaux moyens de locomotion : « omnibus, voitures, ascenseurs, etc. ». La conclusion se veut sans appel : « n’ayant plus l’occasion d’accomplir un travail même modéré, nos masses musculaires, notre muscle cardiaque s’atrophient et, au moindre effort, nous laisse anhélant et courbaturés ».
Pour aller plus loin avec Georges Hébert, soutien indéfectible du Dr. P. Carton, la critique porte aussi sur l’excès de propreté, les bains chauds amollissants et les savonnages trop fréquents constituant « des « ‘fuites »‘ de force vitale ou nerveuse à la longue très déprimantes surtout chez les enfants » (Hébert, 1936, p. 298). Cet argumentaire montre bien, par ailleurs, comment fatigue vitale et manque d’endurcissement sont étroitement liés. C’est en toute logique que ce raisonnement se poursuit à travers la mise en accusation d’une médecine de confort, grande pourvoyeuse de dégénérescence.
De la fatigue des « résistances organiques »… à la fatigue de la « race »
Ce manque d’endurcissement trouve en effet une traduction plus complexe au niveau de la physiologie de l’individu, avec ce que les médecins naturistes appellent les « résistances organiques » ou le « terrain ». De fait, pour mieux résister à la fatigue, causée notamment par les maladies, il faut aussi que l’organisme soit habitué, entraîné à lutter contre ces mêmes maladies :
Le remède est là à notre portée. Au lieu de nous préserver des maladies infectieuses, ne songeons plus qu’à reconstituer nos organismes invulnérables par la pratique du végétarisme et de la vie naturelle, et nous n’aurons à redouter ni les maladies aiguës et chroniques ni les démences qui nous déciment (Carton, 1912, p. 43).
Et justement, la médecine moderne, avec ses médicaments, ses vaccins, empêche ce salutaire exercice. Bien au contraire, elle participe directement à l’épuisement du corps. Fait gravissime pour des naturistes, largement influencés par les thèses de Jean-Baptiste de Lamarck et de Charles Darwin, car cette « résistance organique » se transmet selon les lois de l’hérédité. Le Dr. Albert Monteuuis en fait le constat alarmant : « les ancêtres ont semé, la génération actuelle récolte et porte les signes non douteux d’une dégénérescence, d’un affaiblissement de la race » (Monteuuis, 1903, p. 288). La fatigue, ou plutôt l’extrême fatigabilité de l’individu, est finalement le symptôme du cycle infernal de la décadence et de la dégénérescence dans lequel s’enferment les populations au fur et à mesure que la rupture avec la nature est consommée. Les leaders naturistes s’érigent ainsi en spécialistes de la « fatigue de la race », conséquence directe de cette société de la paresse et de la médecine de confort. Le Dr. Jacques Chauveau en fait la démonstration en citant une lettre d’Alexandre Dumas fils à son père :
D’où vient cette dégénérescence de l’homme. Elle vient de ce que, lorsqu’il était enfant, on n’a pas exercé en lui les forces que la nature lui avait départies, si bien qu’à la suite de quelques excès de jeunesse, en passant de l’adolescence à l’âge mur, il s’est déjà trouvé fatigué et s’est laissé envahir par les habitudes casanières, par les charmes de la vie intérieure (Chauveau, 1925, p. 70).
L’eugénisme trouve d’ailleurs dans le naturisme un terrain d’élection. Le Dr. Carton en donne la pleine mesure en 1912, avec des propos aux accents prophétiques :
Actuellement déjà, après avoir affaibli nos organismes par notre alimentation artificielle, nous avons, par nos mesures illogiques de prophylaxie antimicrobienne, faussé ces lois de la sélection, en nous préservant des maladies aiguës et des épidémies qui aurait retranché de la vie tous nos membres débiles. Nous avons réduit la nature à employer le moyen des infections chroniques, tuberculose ou cancer, et des folies, contre lesquelles nous ne pouvons rien, pour achever les individus dégénérés. Mais la sélection ainsi opérée est défectueuse ; elle est insuffisante et surtout elle est trop lente, car elle permet la reproduction de sujets tarés. Aussi, la nécessité se pressent d’un procédé de nettoyage plus radical et plus rapide qui purifiera la race. La nature saura nous sauver en nous envoyant la dose de misère et de famine dont nous avons grand besoin, sous forme de cataclysme obligatoire et imminent : guerre ou révolution.(Carton, 1912, p. 43).
Nulle surprise de constater que nombre de médecins naturistes de premier plan évoluent dans la mouvance de la Société française d’eugénisme fondée en 1912 (Carol, 1995). On ne saurait manquer de remarquer également l’accueil enthousiaste réservé aux écrits d’Alexis Carrel dans les milieux naturistes tout comme le parrainage par le célèbre Pr. Charles Richet, connu pour ses positions radicales en matière d’eugénisme5, de plusieurs organisations naturistes comme la Ligue Vivre (1927). Soulignons enfin que les médecins naturistes sont parmi les premiers à prendre l’initiative de délivrer à leurs patients des certificats prénuptiaux. Les Drs Durville le font dès les années 1920, soit bien avant que le gouvernement de Vichy en fasse une obligation en 1942.
Du surmenage physique…
Parmi les sources majeures d’épuisement de l’organisme identifiées par les naturistes, on trouve en bonne place le surmenage alimentaire. S’il fait partie des fondamentaux du discours naturiste de l’entre-deux-guerres, il est tout particulièrement traité au sein des courants qui font du végétarisme, voire du végétalisme, un des piliers de leur approche du naturisme : la société naturiste française du Dr. Carton, le Trait d’Union de Jacques Demarquette ou le groupe anarchiste des Naturiens6. On oppose aux excès alimentaires les règles de frugalité, de tempérance, et, une fois encore, de rusticité propre à l’alimentation naturelle :
Et comme les individus ne sont pas suffisamment avertis des dangers de l’alimentation excessive ou mal réglée, et comme on ne leur a pas assez crié les méfaits du confortable, de la sédentarité et du luxe alimentaire, on peut affirmer que chaque fois qu’un peu de bien-être s’introduit dans un intérieur familial, la maladie et la mort se glissent avec lui dans le logis. Le tribut du luxe alimentaire, conséquence du bien-être pécuniaire, c’est la dégradation de la santé (Carton, 1911, p. 601).
Les aliments dits « meurtriers » sont mis à l’index. Le Dr. Carton en identifie trois : la viande, le sucre, l’alcool. Il est rejoint en cela par Jacques Demarquette qui voit dans le naturisme « une doctrine de salut public » pour une « race usée par les excès, empoisonnée d’alcool et de viande, et aveuglée par un matérialisme bassement jouisseur » (Demarquette, 1928, p. 46). Mais la critique du surmenage ne s’arrête pas là. Elle englobe également l’exécution des exercices physiques. Celle-ci doit, en effet, se faire dans le strict respect des lois de la nature. Concrètement, il convient de pratiquer en plein air, mieux encore en pleine nature. Cela suppose encore d’exécuter des mouvements « naturels » (Hébert, 1911, p. 13 de l’avant-propos), ceux pour lesquels le corps de l’individu a été conçu, formé au cours de l’évolution. Enfin, l’entrainement doit développer toutes les qualités physiques de l’individu, sans n’en privilégier aucune. Plus encore, celui-ci s’inscrit dans la perspective d’une éducation intégrale, ne négligeant aucune dimension de l’être. Déroger à l’une de ces règles expose dès lors au risque de surmenage. La pratique sportive compétitive se voit tout particulièrement pointée du doigt. La spécialisation qu’elle induit est censée provoquer une fatigue extrême, potentiellement mortelle si elle se répète trop souvent :
Surtout qu’on ne confonde pas l’éducation physique avec le sport. Qui dit sport dit compétition ; or tout concours est néfaste, il crée des spécialistes, des champions capables de belles performances dans un domaine restreint et il engendre un esprit combatif, il exalte la vanité, l’orgueil et le cabotinage. Il est dangereux pour la santé. Peu de champions vivent longtemps… (Vachet, 1928, p. 19).
Les naturistes s’intéressent également aux effets délétères du travail dans les usines. Celui-ci est vu comme une source d’épuisement des corps, voire d’aliénation de l’ouvrier. L’évocation et la critique des conditions de travail des populations ouvrières est tout particulièrement le fait des anarcho-naturistes (Jarrige, 2016), c’est-à-dire de mouvements anarchistes qui associent le retour à la nature à une critique virulente de la société capitaliste et industrielle. Elle est aussi portée haut dans les organisations promouvant un naturisme socialiste, comme dans le cas du Trait d’union de Jacques Demarquette. Selon ce dernier, le naturisme doit ainsi viser à « affranchir l’homme de la machine stérilisante, du travail mécanique qui mécanise l’individu » (Demarquette, 1925, p. 43).
…au surmenage nerveux et intellectuel
On ne saurait être complet sans remarquer la place majeure consacrée au surmenage nerveux. Pour les naturistes, la société moderne complexifie à outrance l’existence par ses conventions alambiquées. Elle bombarde également l’individu de sollicitations, sonores notamment. Reste que cette critique n’est pas spécifique aux naturistes. Elle se déploie avec force dès le XIXe siècle sur fond d’urbaphobie (Baubérot, Bourillon, 2009) et de sentiment de décadence (Winock, 2017). Il suffit pour s’en convaincre de prendre connaissance des propos tenus par le Dr. Philippe Tissié, médecin sportif, dans son ouvrage dédié à la fatigue :
Tous les milieux dans lesquels les organes sensoriels sont excités en totalité ou en partie sont des agents provocateurs de la fatigue. Telles sont les grandes villes avec le bruit de la rue et les mille faits divers, l’alimentation différente de ce qu’elle est à la campagne, les causes d’émotivité plus nombreuses, etc., etc. Cette fatigue est très appréciable pour le rural, et même le citadin, quand celui-ci, ayant abandonné la grande ville pendant quelques mois, y rentre de nouveau (Tissié, 1908, p. 110).
Ces sollicitations, ces excitations, concernent aussi le plan sexuel. Et là se trouve une autre cause de la fatigue nerveuse. Le Dr. Pierre Vachet, chantre de la nudité intégrale, remarque ainsi qu’’« à ce point de vue, les vêtements, les robes des couturiers sont des chefs-d’œuvre de psychologie libertine » (Vachet, 1928, p. 12). Henri Nadel, autre adepte du libre-culturisme, enfonce le clou :
« Toute notre civilisation moderne est obsédée de sexualité. Romans et pièces à succès ne parlent pas d’autre chose, et la mode est là pour attiser le désir. Hommes et femmes sont deux adversaires qui s’épient, toujours prêts à l’attaque ou à la riposte » (Nadel, 1929, 37).
En effet, les défenseurs d’un dénudement total insistent sur la perversion de l’instinct sexuel générée par la morale catholique. En complexifiant cet instinct, l’Église a développé l’obsession sexuelle. De là, une épuisante guerre des sexes ; de là le vice, la surexcitation, la surconsommation sexuelle, l’onanisme, dont on redécouvre les effets « nocifs » à l’aune des écrits de Sigmund Freud (1912), et, en bout de course, une fois de plus, la dégénérescence :
En opposant à l’appétit sexuel des jeunes des barrières multiples et compliquées, l’éducation exalte à l’extrême l’imagination […]. L’instinct primitif se raffine, mais aussi se complique et aboutit aux perversions. On se trouve en présence d’impulsions sexuelles pathologiques qui cherchent à se satisfaire avec une ingéniosité morbide incroyable, un raffinement d’imagination qui confine à la démence.(Vachet, 1928, p. 19).
Une fatigue avant tout identitaire ?
On vient donc d’apprécier les différences facettes de la fatigue telle que les formalisent les naturistes. On aurait tort cependant d’avoir une vision figée et scindée de ces fatigues. Celles-ci se répondent, se combinent, se superposent parfois. Les frontières mises ici en exergue par souci d’identification sont bien plus poreuses qu’il n’y parait. Reste que, avec le temps, les démarches d’investigation de ces fatigues sont toujours plus poussées, précises. Force est donc de constater la place centrale prise par la fatigue au sein des mouvements naturistes au point que leurs leaders s’érigent en spécialistes de la chose. Comment dès lors expliquer ce discours, que d’aucuns pourraient juger hypocondriaque, mêlant réalité, bon sens, vérités scientifiques ; mais aussi fantasmes ?
Plusieurs pistes sont susceptibles d’éclairer ce phénomène. Tout d’abord, le fait que les chefs de file du naturisme sont pour la plupart des entrepreneurs : ils allient engagement et commerce, convictions et préoccupations économiques. Il est vrai que les fonds collectés sont mis au service de leurs actions de propagande en faveur du naturisme. La rhétorique de la fatigue s’inscrit pour partie dans la volonté d’attirer une clientèle aisée, susceptible de constituer à terme la base des adeptes d’un naturisme dépassant le simple traitement médical. La concurrence qu’entretiennent les leaders du naturisme peut aussi expliquer cette surenchère autour de la fatigue et son pendant, le rajeunissement. Le Pr. Al Dini, défenseur d’un « néo-naturisme », consacre au rajeunissement les traitements naturistes proposés au sein de l’Institut intégral de Royan qu’il ouvre en 1924. Il dirige d’ailleurs une revue au titre éloquent : Rajeunir.
Plus largement, cet engouement pour la fatigue est dans l’air du temps. Il témoigne non seulement d’un contexte sanitaire scandé par les catastrophes (guerres, pandémies…) mais aussi d’une étape franchie dans la structuration de la sphère des activités physiques d’entretien, et, au-delà, du marché du bien-être. Que l’on songe, par exemple, aux cliniques et aux instituts médicaux à visée esthétique qui fleurissent alors. Que l’on songe encore au succès que rencontre la xénogreffe, à partir de testicules de singe, que développe le Pr. Serge Voronov (Prédal, 2017).
Pour autant, il nous semble que ces représentations du corps, ce sentiment et ces sensations de fatigue sont porteurs d’autres significations : ils révèlent les angoisses, les peurs, le stress qui accompagnent la modernité et traversent, in fine, la plupart des groupes sociaux tout en s’adaptant à leurs spécificités. Pour aller plus loin, nous pensons que les causes de cette fatigue sont pour, une bonne part, identitaires. Loin de nous l’idée de minimiser l’épuisement produit par les conditions de vie moderne, de travail, par les pollutions (Jarrige, Le Roux, 2017) ainsi que les maladies. Cependant, le public relativement aisé qu’attire le naturisme, un public aux conditions de vie et de travail facilitées, nous amène à envisager sérieusement la piste identitaire. Dès lors, sur fond de peur de déclassement, cette focalisation sur la sensation de perte de vitalité rend compte de la difficulté à s’adapter, et donc à se définir, que rencontrent les individus face aux évolutions toujours plus rapides, voire aux révolutions (politiques, industrielles, scientifiques, artistiques…) qui scandent le XIXe et le XXe siècle et déstabilisent les identités collectives. Le sentiment de fatigue est le révélateur des interrogations existentielles qui caractérisent cette période. Il met en lumière la quête d’un sentiment de soi7 (Vigarello, 2014) plus difficile à construire que par le passé.
Pour aller plus loin, nous soutenons l’idée que cette représentation « naturiste » de la fatigue est aussi le fruit du désenchantement qui accompagne la modernité (Wattier, 2008, p. 15-30). Dans cette quête de sens, on croit, un temps, pouvoir s’en remettre justement au progrès, scientifique en particulier (Jarrige, Fureix, 2015). Que nenni. Nouvelles déceptions avec les errements de la vaccination, avec la mort industrielle qui caractérise le premier conflit mondial, avec la science au service de la destruction de masse et les crises économiques. La nature en ressort confortée. Intemporelle, atemporelle, elle devient, ou redevient, une instance génératrice de sens et de vérité.
Enfin, cette centration sur la fatigue a aussi trait à la montée de l’individu (Kaufmann, 2004). Conséquence des transformations sociales de cette période, le travail identitaire incombe toujours plus à chaque personne, alors qu’il était auparavant pris davantage en charge par la communauté (Le Breton, 2007). L’obsession de la fatigue révèlerait ainsi une étape du détachement de l’individu par rapport à sa communauté à laquelle le naturisme apporte une réponse. Elle va de pair avec l’essor d’un sentiment nostalgique, voire passéiste, l’idée « qu’avant c’était mieux ».
En résumé, la fatigue s’impose face à un monde qu’on ne comprend plus, trop complexe, toujours plus incertain et auquel on doit faire face, toujours plus seul.
Les traitements naturistes de la fatigue
La nature au secours du neurasthénique
Comme on a pu le voir, les chefs de file des mouvements naturistes se positionnent tant par leurs écrits que par leurs réalisations comme spécialistes de la fatigue. De fait, les instituts naturistes ou de médecine naturelle qui fleurissent ainsi au XIXe siècle et entre les deux guerres s’apparentent, à plus d’un titre, à des centres de traitement de la fatigue ou de réadaptation à l’effort s’adressant en priorité aux neurasthéniques. Ces derniers constituent en effet une bonne part du public fréquentant les structures ouvertes outre-Rhin par Prießnitz, Kneipp et Rikli, ainsi que par leurs disciples et prolongateurs. Le Dr. Tissié, dont les positions font autorité en matière d’éducation physique en France, s’en fait l’écho en 1908 :
Le soleil a été mis lui-même à contribution, c’est ainsi que M. Rickli a imaginé une méthode d’endurcissement qu’il pratique dans une station des montagnes de Carniole, près de Trieste, à une altitude de 800 mètres ; il expose ses neurasthéniques nus en plein air et en plein soleil (Tissié, 1908, p. 171).
Cures d’eau, d’air, de soleil, massages, mais aussi cure de mouvement et réforme alimentaire constituent ainsi la base du traitement prescrit aux patients pour en finir avec les formes multifactorielles de fatigue et leurs multiples conséquences. On relève aussi l’importance donnée par certains, dont les Drs Durville, aux cures de repos, de calme et de silence.
Si une part des soins est donnée dans les locaux des instituts ou des centres de soins, il va sans dire que la plupart se font en extérieur, au sein même d’une nature régénératrice. Ces structures disposent, de fait, d’un parc ou d’un solarium. Nombre d’entre elles sont d’ailleurs implantées en zone côtière ou dans la banlieue verte des villes. Si l’établissement installé au cœur même de la ville ne dispose pas d’espaces verts, il n’est pas rare qu’il soit doté d’un terrain à l’extérieur de l’agglomération, annexe jugée indispensable.
C’est le cas, par exemple, de l’Institut naturiste ouvert par les Drs Durville rue Cimarosa, à Paris, et de son prolongement, Physiopolis, aménagé sur l’île de Platais (Villennes-sur-Seine). Les frères Durville affirment ainsi avoir traité avec succès près de 25 000 patients entre 1914 et 1931. Et c’est pour conforter la santé et la vitalité recouvrées de leurs patients qu’ils ont ouvert leur « cité de week-end » (Naturisme, 1933, p. 16), en 1927. Cette obsession de la fatigue se retrouve d’ailleurs dans le règlement même des épreuves sportives qu’ils organisent, comme lors du championnat de course à pied de 1931. Ainsi, le classement des concurrents se base sur « le degré de fatigue apparente » (Naturisme, 1931, p. 5) : « un coureur pourra [ainsi] être déclaré battu par un suivant qui aurait jusqu’à deux tours de piste de retard sur lui, mais qui serait beaucoup plus frais, et dont l’allure serait beaucoup plus belle » (Idem). On pourrait multiplier les exemples à l’envi. De l’institut naturiste d’Alger du Dr. Maurice Didier, à l’institut Intégral d’Al Dini à Royan, en passant par les centres de cure Kneipp ouverts en France à Paris et Lyon dès la fin du XIXe siècle ou le sanatorium la Sylvabelle, lancée en 1905 dans le Var par le Dr. Albert Monteuuis, tous ces établissements font de l’asthénie la cible privilégiée de leurs traitements.
Quoi qu’il en soit, il est fondamental de relever que l’adhésion au mythe du retour à la nature a nourri un processus d’innovation tant dans le champ de la médecine que de l’éducation, et, suivant cette veine, celui de l’éducation physique et des sports. Il facilite l’invention de dispositifs et de pratiques originaux à plus d’un titre. Parmi leurs spécificités, celle de tirer parti de tous les adjuvants de la nature. Celle aussi de s’adresser à l’individu dans son intégralité, en jouant tant sur les plans physique, psychologique, sociologique qu’émotionnel. Celle enfin de développer le sentiment de soi en jouant tout à la fois sur le corps et le mental. Parmi les traitements psychiques proposés en sus des sollicitations physiques, on évoquera, entre autres, la médecine « psycho-naturiste » (Durville, 1920, p. 9) d’Henri Durville, frère des docteurs Gaston et André. Elle est fondée sur la sollicitation de trois facteurs : « le vital », « le mental » et « l’émotion ». Le « vital » correspond aux « radiations humaines », au magnétisme. Le mental relève de la pensée et se travaille grâce à la suggestion raisonnée. Vient enfin l’‘« éducation émotionnelle », moyen jugé des plus efficaces dans le dessein de lutter contre la fatigue, en particulier nerveuse.
Le troisième facteur est l’émotion. La pensée ne se réalise pas toujours. Chez tous, mais surtout chez l’être affaibli et nerveux, elle a besoin d’un élan qui ne vient pas d’elle-même. Il lui vient cet élan de l’émotion. C’est l’émotion qui fait naître les états d’âme. Elle a dans notre organisme des répercussions presque magiques. (…) C’est tout un art de créer des émotions saines qui relèvent les forces sans causer au malade une excessive agitation. (…) Ces trois facteurs ; le magnétisme, la pensée (qu’elle vienne du dehors – hétérosuggestion– ou qu’elle surgisse de l’être même – autosuggestion) et l’émotion, agissent non seulement dans les cas où existe un désarroi moral, un désordre psychique ou mental, mais, grâce au système nerveux grand sympathique, ils font sentir puissamment leur action dans tout trouble fonctionnel, dans toute maladie organique (Durville, 1920, p. 12).
Ancrer corporellement et mentalement l’identité
Pour reprendre le fil des enjeux identitaires, on soutiendra l’idée que le traitement de la fatigue proposé permet principalement de développer le sentiment de soi à travers deux voies. La première, c’est le recours privilégié au corps. Le naturisme s’affirme ainsi comme une stratégie identitaire fondée sur le corps. Pour le dire plus simplement, il s’agit d’ancrer corporellement le sentiment de soi. La seconde fait appel aux ressources cognitives, intellectuelles de l’individu. En effet, la première voie d’enracinement du sentiment de soi mobilisée par les naturistes repose sur la sollicitation du corps. Cette dernière joue sur un large éventail de modalités allant des plus hédonistes aux plus douloureuses. Mais l’effet recherché semble le même : accéder à des sensations corporelles réinscrivant l’individu dans une pleine conscience de soi en lien avec l’environnement physique et humain. En cela, le naturisme relève d’une aventure corporelle dont on ressort profondément transformé. Ses adeptes parlent d’ailleurs de renaissance pour désigner leur état après avoir embrassé le naturisme, en cure ou dans les centres existants.
En suivant les réflexions de Georges Vigarello, les cures naturistes, surtout au XIXe siècle, reposent sur l’« exploration d’états extrêmes » (Vigarello, 2014, p. 132) dont un des principaux mérites est de permettre au patient de « ressentir le corps pour mieux creuser le sentiment de soi ». Par exemple, Prießnitz s’efforce de susciter chez le patient une perturbation importante, nommée « crise dépurative », censée favoriser l’élimination des éléments morbides de l’organisme. Il arrive à ce résultat en provoquant des chocs thermiques dont l’importance est vue comme un gage d’efficacité. L’inventeur de la cure d’eau (wasserkur) n’hésite pas ainsi à échauffer ses malades au moyen d’enveloppements chauds et de frictions avant de les soumettre à de l’eau froide, voire glacée. Un des patients de la cure d’eau inventée par Prießnitz, le Dr. J. Bigel, révèle ainsi qu’« on ne peut éviter, dans le cours de la cure, un malaise général, un sommeil inquiet, un accroissement d’irritabilité, des mouvements fébriles, enfin des éruptions, des abcès, la diarrhée, et quelquefois le vomissement » (Bigel, 1840, p. 86).
La mise à l’épreuve du corps, grace notamment aux températures froides, est une permanence dans les propositions et les réalisations naturistes. Georges Hébert en est le médiatique représentant avec le collège d’athlètes de Reims où ses athlètes s’entrainent vêtus d’un simple maillot sous la neige, tout comme le Dr. Georges Rouhet, adepte des bains dans l’eau glacée en plein hiver devant une foule de curieux. Cette « tradition » éprouvante se perpétue tout au long de l’entre-deux-guerres dans les centres des Drs Durville ou de la Ligue Vivre. Il nous faut apprécier le recours à l’éducation physique et aux sports selon cette même logique identitaire. Être naturiste, c’est se livrer quotidiennement à un entrainement sportif intégral et exigeant, avec comme modèle l’athlète complet formalisé par Hébert et, avant lui, Pierre de Coubertin. Exercer son corps, le soumettre à un entrainement sportif régulier voire intensif est plus qu’un droit dans les structures naturistes. Il s’agit d’un devoir, comme ne manque pas de le rappeler le leader de la Ligue Vivre, Marcel Kienné de Mongeot. On oppose ainsi la fatigue naturelle, saine, qui vitalise et endurcit, à la fatigue artificielle menant à la dégénérescence.
Des pratiques périphériques au XIXe siècle, relevant de la distraction, de l’agrément à l’occasion notamment des bains d’air et de lumière, sport et gymnastique deviennent entre les deux guerres des activités centrales, structurantes. Les installations gymnastiques et sportives sont alors incontournables dans tout centre naturiste qui se respecte. Parmi les impératifs à l’aménagement d’un terrain de réalisation, on relève la construction d’un bassin, d’une piscine. Cette déferlante sportive traverse tous les mouvements naturistes, y compris les plus spiritualistes, mystiques ou à tendances libertaires. Même le Trait d’Union, de Jacques Demarquette, caractérisé par son assise théosophique, libertaire et socialiste, s’ouvre aux sports. Outre le mouvement hébertiste, certaines organisations en font même leur vitrine, la base de leur identité, comme la Société Naturiste du Dr. Durville. Si l’identité se construit dans la douleur, collectivement et individuellement, elle s’inscrit directement sur les corps. Elle s’affiche au travers de la musculature mais aussi de la couleur de peau. Le bronzage devient le signe de reconnaissance des naturistes. La superficie du corps concerné, le teint plus ou moins hâlé témoignent de l’engagement naturiste. Longtemps dévalorisé car associé aux travaux des champs, le bronzage devient un signe de santé, de vitalité et, dans un contexte sanitaire pesant, de beauté (Ory, 2018).
Pour en terminer sur ce point, notons que les chefs de file des mouvements naturistes ont bien compris que la nature se pense autant qu’elle se vit. D’où les revues naturistes qui font office de lieu d’éducation, de transmission d’une culture. D’où, encore, les cycles de conférences organisées dans les centres et les cours du soir organisés à destination des adhérents. D’où enfin les bibliothèques qui se constituent au sein des centres naturistes. Rompre avec la fatigue, c’est trouver du sens, ou plutôt construire du sens autour de son existence, dans son rapport à soi, aux autres à la nature. En plein désarroi suite, notamment, au conflit mondial, de plus en plus d’individus, et les naturistes en premier lieu, trouvent, dans l’idée de retour à la nature, un exutoire. La nature est érigée en guide sûr, source ultime de vérité capable de donner sens et stabilité à l’existence. Mais si elle prend chez le naturiste ce statut si particulier, c’est parce que la vérité qu’elle est censée détenir est expérimentée de façon corporelle.
Enfin, on ne saurait manquer de relever que l’enjeu réformiste poursuivi par tous les chefs de file naturistes donne un « supplément d’âme » à tous les exercices pratiqués et à l’existence de patients devenus adhérents, de malades devenus porte-paroles de la cause. La fatigue cède ainsi sa place à l’engagement au service d’un idéal élevé : refonder la société, sauver l’humanité. L’injonction à se cultiver intégralement, c’est-à-dire tant sur le plan intellectuel, philosophique, artistique, que mental, à partir d’un corpus bien défini, est très présente dans les discours naturistes et fait partie, pleinement, du traitement de la fatigue. Pour certains, comme le Dr. Carton, elle passe aussi par la pratique rigoureuse des rites catholiques.
Conclusion : l’éducation intégrale comme remède à la fatigue
Pour les naturistes, la fatigue est la conséquence physique et psychologique d’une société toujours plus artificielle, coupée de la nature. Elle est, plus encore, le symptôme d’un processus délétère – la dégénérescence/ déchéance – qui en vient à menacer l’humanité tout entière. En effet, dans les réflexions naturistes, on passe du psychologique au social, de l’individu à la « race », de la nation à l’humanité. Pour contrer cette « mécanique » délétère, les naturistes proposent à la population malade, affaiblie, un traitement intégral, jouant sur toutes les facettes de l’individu. De façon préventive, ils organisent également une éducation tout aussi intégrale sous-tendant une réforme radicale des modes de vie.
Comme on a pu le voir, ce sentiment de fatigue s’exprime dans un contexte particulier, marqué par l’avènement de la modernité (Charle, 2011) ; un contexte caractérisé aussi par les révolutions, les guerres, les pandémies, les crises économiques, soit autant de faits qui non seulement fragilisent les corps mais déstabilisent les cadres et repères sociaux. On ne saurait, en effet, s’arrêter à une approche mettant uniquement en avant les données physiques pour comprendre le sentiment de fatigue, tout particulièrement perçu et étudié par les leaders du naturisme. La fatigue se situe ainsi au carrefour de différents facteurs (physiques, psychologiques, sociaux et culturels). Elle est tout autant affaiblissement organique, somatisation des angoisses que quête de sens trouvant un exutoire, dans le cas qui nous intéresse ici, dans le désir de nature, de retour à la nature. Pour aller plus loin, la fatigue semble être le révélateur d’une construction identitaire devenue quête identitaire dans un monde instable, traversé par les crises, un monde perçu comme illisible, incohérent. Pour suivre Vigarello, elle témoigne aussi chez les naturistes d’un « rêve de liberté d’affranchissement rend[ant] toujours plus difficile à vivre tout ce qui peut contraindre et entraver » (Vigarello, 2020, p. 9), un rêve qui se heurte alors aux normes, notamment corporelles, véhiculées par l’Église et les ligues de défense de la moralité. La fatigue s’impose ainsi pour l’historien comme un construit socioculturel, reposant sur une assise physiologique.
Bibliographie
Baubérot, A., Bourillon, F. (2009). Urbaphobie. La détestation de la ville aux XIXe et XXe siècles. Pompignac, Bière.
Bigel, J. (1840). Manuel d’hydrosudopathie, ou Traitement des maladies par l’eau froide, la sueur, l’exercice et le régime, suivant la méthode employée par V. Priessnitz à Graefenberg. Paris, J.-B. Baillière.
Cahiers des charges, (1933). Archives de la commune d’Hyères, série 3 D 20, (7).
Carton, P. (1911). « La tuberculose par arthritisme ». Étude clinique. Traitement rationnel et pratique. Paris, A. Maloine.
Carton, P. (1912). Les trois aliments meurtriers. Paris, A. Maloine.
Carton, P. (1922). Les lois de la vie saine. Paris, A. Maloine.
Carol, A. (1995). Histoire de l’eugénisme en France. Les médecins et la procréation XIXe-XXe siècles. Paris, Le Seuil.
Charle, C. (2011). Discordance des temps. Une brève histoire de la modernité. Paris, Armand-Colin.
Chauveau, J. (1925). « L’éducation naturiste des enfants ». La Revue Naturiste, 4, (70).
Demarquette, J. (1928). Le secret du bonheur, le naturisme intégral, méthode de régénération individuelle et de progrès social. Paris, Trait d’Union.
Demarquette, J. (1925). Libération, essai de naturisme social. Le but de l’émancipation. La quadruple racine de l’exploitation humaine. Les remèdes. Paris, Trait d’Union.
Durville, H. (1920). La médecine psycho-naturiste. Traitement des maladies organiques et psychiques, des troubles mentaux et sentimentaux. 3e ed, Paris, Henri Durville.
Hébert, G. (1911). Le code de la force. Paris, Lucien Laveur.
Hébert, G. (1936). L’éducation physique, virile et morale par la Méthode Naturelle. Tome I. Exposé doctrinal et principes directeurs de travail. Paris, Librairie Vuibert.
Jarrige, F., Fureix, E. (2015). La modernité désenchantée. Relire l’histoire du XIXe siècle français. Paris, La Découverte.
Jarrige, F. (2016). Gravelle, Zisly et les anarchistes naturiens contre la civilisation industrielle. Lorient, Le passager clandestin.
Jarrige, F., Le Roux, T. (2017). La Contamination du monde. Une histoire des pollutions à l’âge industriel. Paris, Le Seuil.
Kaufmann, J.-C. (2004). L’invention de soi. Une théorie de l’identité. Paris, Armand Colin, coll. « Individu et société ».
Kneipp, S. (1892). Ma cure d’eau ou hygiène et médication pour la guérison des maladies et la conservation de la santé. 3e ed, Strasbourg, F.-X. Le Roux.
Le Breton, D. (2007). En souffrance. Adolescence et entrée dans la vie. Paris Métailié.
Dr. Monteuuis, A. (1903). Les abdominales méconnues. Les déséquilibrés du ventre sans ptose. Thérapeutique pathogénique. Paris, Baillière et fils.
Nadel, H. (1929). La nudité à travers les âges. Paris, Vivre intégralement.
Naturisme, (1933). Le grand magazine de culture humaine, 16 novembre 1933, p. 16.
Naturisme, (1931). Le grand magazine de culture humaine, (181), 10 décembre , 5.
Ory, P. (2018). L’invention du bronzage. Paris, Flammarion, coll. « Champs histoire ».
Prédal, R. (2017). L’étrange destin du Dr. Serge Voronoff. Paris, L’Harmattan, coll. « Médecine à travers les siècles ».
Rikli, A. (1905). Médecine naturelle et bains de soleil. Paris, Georges Bridel & Cie.
Rouhet, G. (1913). Revenons à la nature et régénérons-nous. Berger-Levrault.
Freud, S. (1998), « Discussion sur l’onanisme ». Dans Œuvres complètes XI : 1911-1913. Paris, PUF, 157-168.
Tissié, P. (1908). « La fatigue et l’entraînement ». Félix Alcan, Dr. Vachet, P. (1928). La nudité et la physiologie sexuelle. Paris, Éditions de Vivre intégralement, 3e année, 2.
Vachet, P. (1928). La nudité et la physiologie sexuelle. Paris, Vivre intégralement.
Vigarello, G. (1980). « Histoire d’une pédagogie de l’exercice corporel et histoire des sciences ». Travaux et recherches en EPS, 6(53).
Vigarello, G. (2014). Le sentiment de soi. Histoire de la perception du corps XVIe-XXe siècle. Paris, Le Seuil.
Vigarello, G. (2020). Histoire de la fatigue. Du Moyen Âge à nos jours. Paris, Le Seuil, 11.
Villaret, S. (2005). Histoire du naturisme en France depuis le siècle des Lumières. Paris, Librairie Vuibert.
Villaret, S. (2017). Le naturisme et la mode. Du XIXe siècle aux années 1970. Modes pratiques, revue d’histoire du vêtement et de la mode, (2), 202-227.
Villaret, S. (2021). « Naturisme et protection de la nature (XIXe-XXe siècle)». Revue Corps – CNRS Editions, (19), 35-49.
Watier, P. (2008). M. Weber : analyste et critique de la modernité. Sociétés, 100(2), 15-30.
Winock, M. (2017). Décadence, fin de siècle, Paris, Gallimard.
Notes
- On note à ce sujet la large prééminence des hommes. Si les femmes sont loin d’être absentes des mouvements naturistes – on citera Renée Dunan et Christiane Lecoq qui furent des figures marquantes – elles sont sensiblement moins nombreuses à s’y illustrer en tant que théoricienne ou conceptrice de premier plan. Si on ne doit pas sous-estimer le phénomène d’invisibilisation que des recherches ultérieures permettront sûrement d’atténuer, il est possible que la question de la nudité ait constitué un frein à leur engagement tant théorique que pratique.
- Notre corpus repose notamment sur la consultation des ouvrages des théoriciens du naturisme et des principales revues naturistes comme Kneipp-journal. Revue d’hygiène et d’hydrothérapie (1892-1904), Vivre (1926-1962), Naturisme (1930-1939), L’éducation physique (1922-1971), La revue naturiste (1922-1940)…
- Deutschen Bund der Vereine für naturgemäße Lebens-und Heilweise.
- La référence à la race est omniprésente dans les discours de l’époque, rendant compte de la vulgarisation des travaux de l’anthropologie naissante. La race est associée à l’idée d’une dégénérescence, c’est-à-dire à une désadaptation de l’individu causée par les conditions de vie moderne. Elle nourrit, ce faisant, l’essor des préoccupations eugéniques.
- Prix Nobel de médecine en 1913, il prend position en faveur de la stérilisation des individus « tarés » et de l’euthanasie des « anormaux » ou des enfants « chétifs ». Il plaide aussi en faveur de la déportation des criminels et des malades mentaux dangereux dans une « île lointaine ».
- Il s’agit d’un groupe anarchiste fondé en 1895 à l’instigation du peintre Emile Gravelle. Son objectif est de grouper tous les partisans d’un retour à la nature Les Naturiens plaident pour un retour radical à la vie primitive, en prenant pour référence l’homme préhistorique. Profondément antimodernistes, ils adhèrent au mythe d’un âge d’or où l’Homme vivait en harmonie avec une nature satisfaisant tous ses besoins sans qu’il ait d’effort à fournir.
- Suivant cet auteur, le sentiment de soi est entendu ici au sens de sentiment d’existence, de conscience de soi-même, qui se construit au travers de l’exploration des sensations internes.