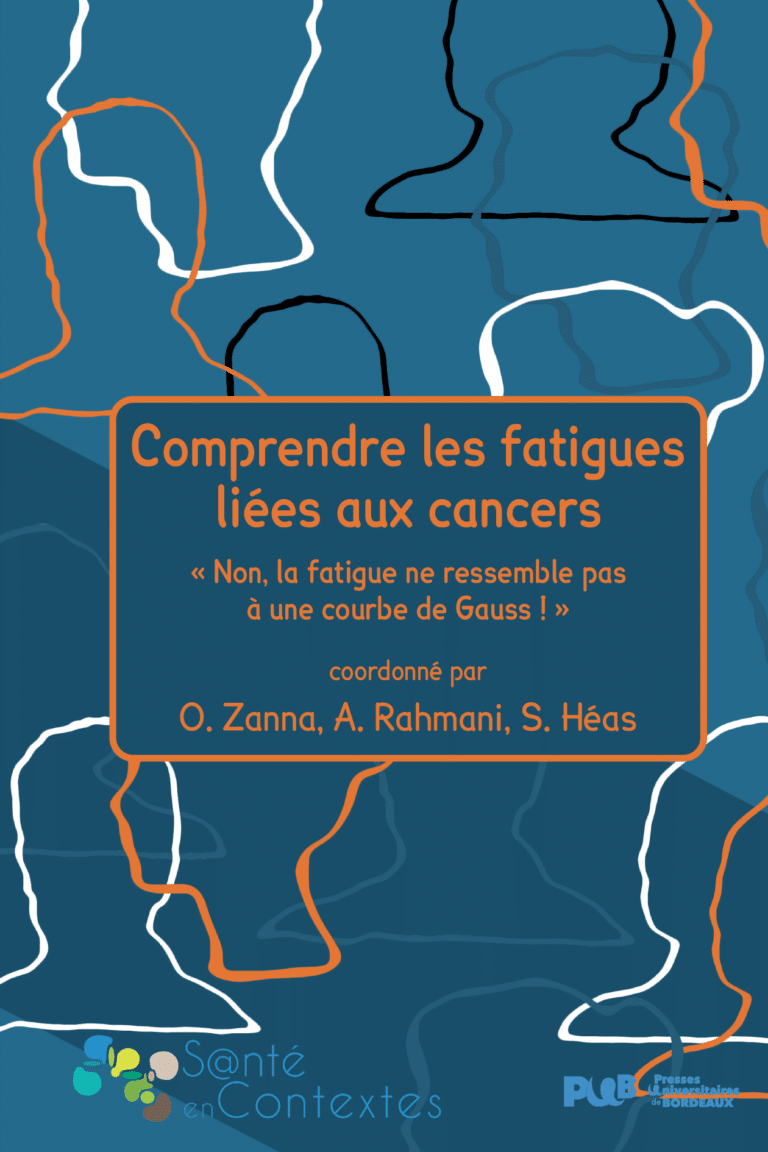Interlude N° 7
Jennifer (43 ans) est suivie pour un cancer du sein depuis cinq mois. Entretien réalisé le 16 mai 2022 lors de sa 7e séance de chimiothérapie.
B : Bah pendant tout le cancer, finalement, moi je suis resté un peu comme ça, à sourire à tout le monde, à dire « ça va », tant que je peux marcher, j’avance, il n’y a pas de souci et puis… Il y avait un truc aussi, c’est qu’extérieurement en fait j’ai gardé à peu près mes cheveux. Alors ça c’est hyper important les cheveux parce que les gens me regardaient et ils me disaient « bah ça va t’es pas très malade en fait, tu as encore tout tes cheveux ». Je me dis « mais ils n’y connaissent rien en fait, ils connaissent rien au cancer », et pendant très très longtemps j’avais des maux invisibles en fait, j’avais des neuropathologies, je n’arrivais pas à ouvrir une bouteille d’eau, c’était tellement dur pour moi de serrer les doigts que je n’arrivais pas à ouvrir une bouteille d’eau, les pots pour bébés, essorer une éponge, n’importe quoi, faire des trucs comme ça j’y arrivais pas. Sauf que, bah ce sont des choses que les gens ne voient pas, donc moi j’étais en pleine forme, et puis dès que je l’ouvrais un peu, que je disais que je n’arrivais pas à faire ça… Oh, c’est bon, t’es jeune… Mais ils ne comprennent pas en fait que ça m’a vraiment, physiquement, entamé. Dès que je montais un escalier, j’étais essoufflée. Et puis je me suis dis « mais je me plains pas assez ». Et les gens qui ne se plaignent pas assez, bah, on les entend pas, enfin, on les voit pas. On ne sait pas qu’ils ont mal et… Je ne voulais pas de toute façon que les gens sachent que j’ai mal et je n’avais pas… Je me disais, tant que c’est supportable, moi je trouvais ça abusé de me plaindre. Surtout que j’étais tellement reconnaissante d’être toujours là, tous les jours, tous les matins, je me réveillais en me disant « C’est génial, je suis là », donc je ne me voyais pas me plaindre. Et puis finalement bah les autres trouvaient tout le temps que j’abusais pour des petites choses. Je me suis dit qu’ils ne me comprenaient pas quoi. À force de ne pas me plaindre, en fait, vous n’avez pas compris que je souffrais physiquement, moralement, que c’était dur. Ce n’est pas parce que j’ai la banane tous les jours que le soir je ne suis pas en train de pleurer toute seule dans mon coin. Et même mon mari, il ne savait pas en fait. Il faisait des trucs, il ne comprenait pas que ça me faisait souffrir mais je disais rien. Maintenant, je me dis, il faut que je fasse un peu comme tout le monde, me plaindre tout le temps.
Introduction
La fatigue liée au cancer (FLC) est une sensation subjective d’épuisement physique, émotionnel ou bien encore cognitif en lien avec la maladie et ses traitements. Elle n’est pas proportionnelle à une activité physique récente, elle perdure malgré le repos et affecte la qualité de vie (Ahlberg et al., 2003). La FLC est disproportionnée au regard de l’activité du patient et n’est pas soulagée par le repos ou le sommeil, bien qu’elle soit décrite par la quasi-totalité des patients (Hoffman et al., 2007). Sa prévalence varie de 70 à 90% et touche les patients aussi bien pendant la prise en charge qu’à distance temporelle des traitements (Reinertsen et al., 2009), ce qui entraine un retentissement majeur sur la vie du patient, puisqu’elle affecte de façon importante les capacités fonctionnelles, les activités de la vie quotidienne ou encore la qualité de vie. La FLC est multifactorielle, et le déconditionnement à l’effort contribue à augmenter cette fatigue (Stedman, 2001). L’objectif de ce travail est de montrer qu’il est essentiel de s’appuyer sur l’activité physique adaptée pour permettre aux patients·es de maintenir, voire d’améliorer leur condition physique malgré la maladie et les traitements, afin de mieux résister à la FLC, ou tout du moins d’apprendre à mieux vivre avec elle. Après avoir défini la condition physique, nous aborderons dans un deuxième temps les conséquences du cancer sur les différents paramètres de l’activité physique (AP), pour démontrer l’intérêt de l’AP. Nous terminerons en évoquant les principes d’entrainement de la condition physique.
La condition physique
Définition
La condition physique correspond à « un ensemble d’attributs, principalement respiratoires et cardiovasculaires, reliés à la capacité de réaliser des tâches qui requièrent une dépense d’énergie » (Stedman, 2001). C’est donc « la capacité à réaliser des activités physiques d’un niveau modéré à intensif sans fatigue indue et la capacité de maintenir de telles aptitudes tout au long de la vie » (ACSM, 1998). La condition physique implique la performance intégrée et efficace des principaux systèmes de l’organisme : le système cardio-pulmonaire, les systèmes musculaires, tendineux, ligamentaires, osseux. Elle est individuelle et déterminée par différents facteurs tels que l’âge, le sexe, l’activité physique et la sédentarité et la maladie (Depiesse et al., 2009). La condition physique peut être considérée comme un facteur essentiel de la qualité de la vie. En effet, la condition physique est « la capacité à effectuer des tâches quotidiennes avec vigueur et vigilance, sans fatigue excessive, et avec une énergie suffisante pour profiter des activités de loisirs et répondre aux situations d’urgence imprévues » (Caspersen et al., 1985). Être en bonne condition physique permet donc de réaliser des activités de la vie quotidienne en toute sécurité et en étant capable de réagir face aux exigences liées à leur réalisation. Les exigences de la vie quotidienne vont d’intensité légère comme marcher, à des activités physiques intenses comme monter plusieurs étages rapidement. Si une personne ne possède pas un niveau suffisant de ressources physiques pour réaliser ces actions, le surmenage peut survenir.
Le déconditionnement à l’effort
Un déconditionnement physique (Neil et al., 2013) caractérise les patients atteints de cancer. Cela résulte d’une augmentation de la sédentarité dès la prise en charge du cancer. L’alitement et les différents traitements– chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie notamment – participent à une baisse de l’activité physique du patient. De plus, la peur des douleurs ou des blessures que cette activité pourrait entraîner (Davis & Walsh, 2010) incite les patients à diminuer de façon importante leur activité physique (Irwin et al., 2004) pendant les traitements. Ainsi, deux phénomènes s’observent : un déconditionnement à l’effort primaire, directement dû au processus néoplasique et aux traitements, et un déconditionnement physique secondaire lié à une réduction des activités physiques pendant le traitement.
Le déconditionnement à l’effort primaire
Le déconditionnement à l’effort primaire résulte des conséquences des processus néoplasiques avec une atteinte d’un ou plusieurs organes, entrainant une perte de confiance en soi. Le patient se sent affaibli, diminué, ce qui peut entrainer un isolement social (HAS, 2022). En effet, les différents traitements peuvent être à l’origine d’une limitation fonctionnelle à l’exercice, avec pour conséquence des difficultés pour le patient à effectuer des gestes, des mouvements, des activités qu’il pouvait réaliser avant les traitements sans éprouver de difficultés particulières. La chirurgie tumorale, la forme la plus fréquente de traitement contre le cancer, implique, une limitation fonctionnelle liée à l’opération et à la cicatrice (INCa, 2017). Par exemple, une mastectomie induit des difficultés à bouger le membre supérieur du côté affecté à cause de l’opération et de la cicatrice qui « tire » sur les tissus. La peur de bouger le membre supérieur et la douleur conduisent la personne opérée à peu utiliser son membre supérieur. Certaines chirurgies induisent des périodes d’alitement prolongé et d’inactivité. Ces diminutions d’activité ont pour conséquence un déconditionnement à l’effort.
Les traitements peuvent également induire une limitation à la tolérance de l’exercice comme c’est le cas, par exemple, lors d’une radiothérapie au niveau du thorax, qui peut toucher le cœur ou les poumons et entrainer une intolérance à l’exercice (Evans et al., 2006), puisque ces deux organes sont responsables de la distribution de l’oxygène aux muscles.
La chimiothérapie peut également induire, dans certains cas, des complications cardiovasculaires qui limitent l’activité physique. En effet, le transport de l’oxygène dans le sang est affecté par la chimiothérapie : les muscles sont moins oxygénés et donc moins performants (Grotto et al., 2008). Ce traitement peut aussi entrainer une anémie avec un impact direct sur l’oxygénation des différents tissus. De fait, le patient ne peut plus réaliser d’exercice à la même intensité qu’auparavant, ou n’est plus capable de maintenir l’exercice autant qu’avant la maladie.
Enfin, l’hormonothérapie, traitement qui vise à la suppression ou à la diminution de certaines hormones, entraine très fréquemment une ménopause ou une andropause prématurée. Les molécules utilisées pour ces traitements peuvent avoir des effets délétères non négligeables sur la masse osseuse et musculaire et ainsi limiter la distribution de l’oxygène aux tissus (Helzlsouer et al., 2012). L’hormonothérapie entraine également fréquemment des douleurs au niveau des articulations qui peuvent diminuer l’amplitude articulaire et limiter l’activité physique (Drillon et al., 2023).
Le déconditionnement à l’effort secondaire
Le déconditionnement à l’effort secondaire est le résultat de l’adaptation de l’organisme à une activité moins importante et une dépense énergétique plus basse qu’avant la maladie. En raison des effets secondaires des traitements évoqués supra, la personne a tendance à réaliser moins d’activité physique. Assez rapidement, les muscles peuvent s’atrophier et la personne voit sa capacité à réaliser des activités de la vie quotidienne diminuée. Cela peut être une conséquence des symptômes (fatigue, douleur…), en lien avec des facteurs psychologiques (syndrome dépressif, altération de l’estime de soi et de son image corporelle avec une perte de confiance en ses capacités physiques voire une kinésiophobie) ou avec des facteurs sociaux (représentations sociales négatives de la maladie) liés à la maladie cancéreuse (HAS, 2022).
Les conséquences du déconditionnement à l’effort
Le processus de déconditionnement conduit à un état d’intolérance à l’exercice au cours duquel la personne subit un état de fatigue invalidant qui nécessite une réduction ou l’arrêt des activités physiques habituelles : activités domestiques, sociales, professionnelles, ludiques, occupationnelles. Ce phénomène s’explique notamment par l’altération d’une ou plusieurs étapes dans les différents processus permettant de distribuer l’oxygène aux muscles. Progressivement, le patient perd ses capacités à réaliser le moindre effort, chaque activité de la vie quotidienne devenant de plus en plus difficile et fatigante à accomplir. Cela engendre un impact important sur le bien-être physique et psychologique (Ainsworth et al., 1993). Ainsi, plus la personne est déconditionnée, plus son état de santé est à risque et moins elle est susceptible de supporter les traitements (INCa, 2017). L’activité physique, comme approche non médicamenteuse et comme moyen de supporter les traitements permet de sortir de ce cercle vicieux de déconditionnement à l’effort (HAS, 2022).
L’activité physique
L’activité physique (AP) est définie comme tout mouvement corporel effectué par l’action
des muscles squelettiques, se traduisant par une augmentation de la dépense énergétique
(Ainsworth et al., 1993). Elle inclut l’ensemble des activités de la vie quotidienne telles que les
tâches domestiques, l’activité professionnelle, les déplacements et les loisirs (Caspersen
et al., 1985). Elle se distingue donc du sport qui désigne « l’ensemble des pratiques physiques,
codifiées, institutionnalisées, réalisées en vue d’une performance ou d’une compétition
Les conséquences du cancer sur les différents paramètres de l’activité physique et l’intérêt de l’AP
La condition physique comporte plusieurs paramètres : l’endurance cardiorespiratoire, la force musculaire, l’endurance musculaire, la flexibilité, l’équilibre et la composition corporelle. Ces paramètres peuvent évoluer différemment les uns des autres dans le cas d’un déconditionnement physique. Par ailleurs, ils n’ont pas le même impact sur la santé. L’endurance cardiorespiratoire, la force, l’endurance musculaire et la composition corporelle sont particulièrement corrélées à l’état de santé et importantes dans le cas du cancer. Il est ainsi observé des modifications dans la composition corporelle, une diminution de la force et de la masse musculaire des muscles striés squelettiques (Kilgour et al., 2010) et une diminution de l’endurance cardiovasculaire dans le cadre du cancer. Nous parlerons plus particulièrement de ces trois paramètres.
L’endurance cardiorespiratoire et musculaire
L’endurance cardiorespiratoire et l’endurance musculaire sont deux composantes importantes de la condition physique bien qu’elles se concentrent sur des aspects différents de la performance physique.
L’endurance cardiorespiratoire est la capacité du système cardiovasculaire (cœur, sang et vaisseaux sanguins) et du système respiratoire (poumons et voies respiratoires) à acheminer l’oxygène et les autres nutriments vers les muscles en action et à éliminer les déchets. Au cours des traitements du cancer, la capacité cardiorespiratoire maximale correspondant à la consommation maximale d’oxygène (VO2 max) diminue d’environ 30% (Jones et al., 2007). Cette baisse est en grande partie due à une altération du système circulatoire assurant le transport de l’oxygène aux différents organes, notamment aux muscles et au cœur. À l’origine de ce phénomène, on observe une réduction de la densité mitochondriale et une diminution de la taille moyenne des mitochondries, ce qui entraine une altération dans la production de l’ATP et donc une production d’énergie moindre (Toth et al., 2013). Cette atteinte est variable et dépend du type de cancer, de sa gravité et de ses traitements. Elle peut durer plusieurs années après la rémission ou la guérison. Il existe cependant un moyen de lutter contre ce phénomène. Ainsi, l’AP améliore chez les patients la capacité cardio-respiratoire (Mishra et al., 2012) que ce soit au début, à la fin ou à distance des traitements. L’intensité perçue lors de la pratique de l’AP doit être « modérée » à « élevée » et l’AP poursuivie sur le long terme pour percevoir et maintenir les effets des programmes (Markes et al., 2006).
L’endurance musculaire est la capacité d’un muscle, ou d’un groupe musculaire, à subir des contractions répétées ou à appliquer une force continue contre un objet fixe. L’endurance d’une personne est exprimée en fonction du nombre de répétitions exécutées sans arrêt au cours d’une durée déterminée. Les traitements contre le cancer, ou le cancer lui-même en fonction de sa localisation sont responsables d’une diminution importante de l’endurance musculaire (Irwin et al., 2004). Cette diminution se retrouve à la fois pendant les traitements, mais aussi plusieurs semaines voire plusieurs mois après les traitements, surtout si le patient reste sédentaire.
Bien qu’elles soient distinctes, l’endurance cardiorespiratoire et l’endurance musculaire sont interconnectées. Une bonne endurance cardiorespiratoire permettra aux muscles de recevoir plus d’oxygène, ce qui peut améliorer leur performance lors d’activités prolongées. De même, une meilleure endurance musculaire peut contribuer à une utilisation plus efficace de l’oxygène pendant l’exercice. Ces deux types d’endurance se complètent et sont souvent travaillés ensemble dans un programme d’entraînement équilibré.
Les aptitudes musculaires
La force, cette capacité d’un muscle à fournir un effort contre une résistance, peut s’exercer de manière isométrique (la longueur musculaire reste constante), concentrique (le muscle produit une force en se raccourcissant), excentrique (le muscle produit de la force en s’étirant) et pliométrique (association d’une phase excentrique et d’une phase concentrique). La mesure de la force musculaire peut se faire en déterminant la charge maximale qu’une personne peut soulever dans le cadre d’exercices d’haltérophilie par exemple. Cette force peut s’exprimer en valeur absolue (la masse réelle soulevée) ou en valeur relative (la masse soulevée divisée par la masse corporelle de la personne).
Les traitements anti-cancéreux peuvent entrainer une perte de force qui se traduit à la fois par une perte de masse et de force musculaire (Toth et al., 2013). Les origines de la perte de force sont liées à deux phénomènes distincts : la sarcopénie et la cachexie.
La sarcopénie est un syndrome générique qui se caractérise par une perte progressive et généralisée de la masse musculaire et donc de la force. Elle s’observe par un amaigrissement au cours de l’évolution de certains cancers dû à une amyotrophie importante (Fearon et al., 2012). Classiquement, on retrouve une diminution des capacités physiques due à l’âge avec une diminution du nombre et de la taille des fibres musculaires (Aniansson et al., 1992). Dans le cas du cancer, elle est augmentée du fait de la pathologie. Cela impacte de façon importante les capacités des malades à réaliser des tâches motrices de la vie quotidienne. Cette atrophie est responsable de la baisse des performances musculaires et peut engendrer un risque d’effets indésirables comme le handicap physique et la perte d’autonomie.
La sarcopénie est associée à la gravité du pronostic, c’est-à-dire que plus la sarcopénie est importante, moins le pronostic est bon (Shachar et al., 2016). L’atrophie est également corrélée à plus d’effets indésirables de la chimiothérapie (Antoun et al., 2013) et à une moins bonne efficacité des traitements pour certains cancers (Prado et al., 2008). Il est possible de limiter l’atrophie musculaire grâce à la pratique d’activité physique pendant et après le traitement.
Un autre facteur de perte musculaire associée au cancer serait le stress oxydatif (Flavier et al., 2003). Celui-ci correspond à une oxydation des différents constituants de l’organisme par les radicaux libres qui proviennent de l’oxygène contenu dans l’air que nous respirons. Ces radicaux libres dénaturent notamment l’ADN et les cellules qui constituent le corps. Le stress oxydatif agresse les cellules et constitue la cause essentielle du vieillissement. Il pourrait contribuer au déconditionnement et à la perte musculaire associés au cancer. Il apparaît que l’oxydation des protéines musculaires est supérieure chez les patients cancéreux. Le stress oxydatif pourrait ainsi contribuer à augmenter la sarcopénie chez les patients souffrant de cancer.
L’autre phénomène à l’origine du déconditionnement musculaire dans la pathologie cancéreuse est la cachexie. La cachexie cancéreuse est une complication métabolique complexe qui s’explique principalement par une augmentation du catabolisme tissulaire (Argilés et al., 2007). On retrouve ainsi une rupture de l’équilibre entre la synthèse et la dégradation des protéines associée à des altérations du métabolisme des acides aminés. La dégradation des protéines musculaires est activée chez le patient cancéreux, ce qui entraine une perte conséquente de la masse musculaire (Toth et al., 1985). La cachexie a des conséquences majeures sur la qualité de vie des patients. Elle entraine une moins bonne tolérance aux traitements de chimiothérapie, un déconditionnement physique important et une diminution des chances de survie. Ni la taille de la tumeur, ni la présence ou l’étendue de métastases ne permettent de prédire l’apparition ou l’importance de la cachexie. La caractéristique principale de ce phénomène est la perte de poids supérieure à 5% dans les six derniers mois pour le cancer souvent associée à une perte de force musculaire, une fatigue se traduisant par une incapacité à réaliser des exercices accomplis, une anorexie, un indice de masse maigre faible ou une biochimie sanguine anormale reflétant une inflammation (Argilés et al., 2008).
Il est possible de ralentir l’impact de ces phénomènes chez le patient. Ainsi, la pratique d’AP basée sur du renforcement musculaire entraine une amélioration de la qualité musculaire des groupes musculaires travaillés (Pedersen et al., 2012), c’est-à-dire une amélioration de la force que le muscle est capable de développer par kilogramme de muscle. Il ne s’agit pas ici d’une augmentation de la quantité de muscle, ce qui serait difficile avec les effets secondaires des traitements qui provoquent souvent des nausées et des vomissements et qui sont difficilement compatibles avec une prise de masse maigre. L’activité physique semble contribuer également à diminuer le syndrome cachexique, même si les mécanismes à l’origine de ce phénomène ne sont pas encore clairement établis.
La composition corporelle et les intérêts de la pratique physique
La composition corporelle fait référence aux proportions de tissus maigres (muscles, os, tissus vitaux et organes) et de graisses du corps. Une bonne composition corporelle signifie des os solides, des muscles squelettiques de bonne taille, un cœur en santé et une faible quantité de masse graisseuse. Bien que la composition corporelle englobe l’eau, les muscles, les os et la graisse, elle est souvent exprimée uniquement en pourcentage de graisse corporelle. La surcharge pondérale est définie par un IMC (indice de masse grasse) compris entre 25 et 30 kg/m² et l’obésité est définie par un IMC supérieur à 30 kg/m² (OMS, 2024).
La graisse joue un rôle important. En effet, elle a pour fonction de constituer des réserves énergétiques suffisantes en cas de sous-alimentation ou encore de protection contre le froid. Par contre, l’excès de masse grasse – ou surcharge pondérale – a des effets délétères sur la santé. Ainsi, l’obésité est classée comme cancérogène pour les cancers de l’œsophage, du colon, du rectum, du foie, du rein, du pancréas, de la vésicule biliaire, de la prostate, de l’endomètre ou les cancers du sein après la ménopause. De plus, un taux de masse grasse élevé entraine des comorbidités importantes qui peuvent se surajouter au cancer, comme le diabète, les maladies cardiovasculaires, une insuffisance veineuse ou encore de l’arthrose, qui peuvent également fortement diminuer la condition physique (OMS, 2024).
Dans le cas de la pathologie cancéreuse, la composition corporelle est modifiée avec une perte de masse maigre associée à des variations de masse corporelle (perte de masse corporelle, stabilité ou prise de masse corporelle) (Irwin et al., 2004). Une perte de masse musculaire pendant les traitements augmente les effets indésirables de la chimiothérapie et entraine un taux plus faible de réponse au traitement, ainsi qu’une plus grande mortalité pour les cancers avancés (McTiernan et al., 2003).
À l’inverse, une prise de masse corporelle pendant un cancer est essentiellement liée à une augmentation de la masse grasse, ce qui constitue un facteur de risque de morbi-mortalité et de récidive de certains cancers (Strasser et al., 2013). En effet, la graisse possède la particularité de produire certaines hormones, telles que les œstrogènes. Or, ces hormones favorisent la croissance cellulaire, ce qui est évidemment néfaste dans le cas du cancer. De même, la masse grasse produit des protéines qui interviennent dans les processus inflammatoires. Ces derniers produisent à leur tour des facteurs de croissance qui favorisent la prolifération cellulaire et qui peuvent ainsi participer au développement du cancer (Pedersen et al., 2012). Il est donc essentiel de limiter l’excès de masse grasse par une pratique physique régulière.
Pour un patient atteint d’un cancer, pratiquer une activité physique pendant et/ou après les traitements a des effets positifs sur la composition corporelle. L’AP permet un maintien, voire une augmentation de la masse musculaire, notamment dans le cas de programmes mixtes associant à la fois renforcement musculaire et endurance musculaire. Les résultats sont d’autant meilleurs que l’exercice physique est débuté pendant le traitement et poursuivi après la fin des traitements.
Cela entraine également une réduction de la masse grasse, de l’IMC et du périmètre abdominal (Irwin et al. 2004). Enfin, l’AP a un effet sur la densité osseuse avec de meilleurs résultats obtenus pour des programmes mixtes, comparés aux programmes en renforcement musculaire seul (Irwin et al. 2004).
Les principes d’entrainement de la condition physique
Il a été montré l’importance d’avoir la meilleure condition physique possible pour faire face à la fatigue liée au cancer. Il est possible de la travailler, même pendant les traitements, à condition de respecter plusieurs principes d’entrainement.
Tout d’abord, il est nécessaire de prendre des précautions car la réaction d’une personne à l’activité physique dépend de son degré de condition physique. Ainsi, la charge et le type d’exercices doivent être adaptés aux capacités de chaque patient, et individualisés puisque deux personnes d’apparence similaire (même âge, même taille, même masse corporelle) peuvent avoir une réponse physiologique très différente pour une même charge de travail.
Les principes de développement de la condition physique sont au nombre de cinq :
- La spécificité. Le type d’AP dépend de l’élément de la condition physique que l’on souhaite travailler prioritairement (endurance cardio-respiratoire, endurance ou force musculaire, composition corporelle). De même, il est important de cibler les groupes musculaires que l’on souhaite travailler pour obtenir les meilleurs résultats ;
- La surcharge. L’organisme a la capacité de s’adapter face à la demande accrue. Pour pouvoir progresser, il est nécessaire de proposer une dose de travail supérieure à celle que l’organisme est capable de développer. Cependant, dans le cas du cancer, il sera essentiel de respecter les différentes phases du traitement et d’adapter l’entrainement au patient pour ne pas le sur-solliciter, notamment pendant les séances de chimiothérapie ;
- La réversibilité. Lorsque le patient arrête de pratiquer de l’AP, les gains acquis sur le plan de la condition physique diminuent. Il est indispensable d’avoir la meilleure observance possible ;
- La progression. Pour pouvoir avoir des progrès, il est nécessaire de proposer une augmentation graduelle de la quantité de travail fourni. Il est possible de jouer sur une combinaison des différents paramètres : fréquence, intensité ou encore durée de l’AP ;
- La personnalisation. Les facteurs qui vont influencer la pertinence d’un programme d’AP sont nombreux. Il s’agit de la condition actuelle du pratiquant, de son sexe, de son âge, de son hérédité, de sa vulnérabilité aux blessures, de ses besoins en matière de repos, de récupération, de son alimentation et de sa réponse face aux traitements.
Conclusion
Les traitements liés au cancer et le cancer lui-même ont des répercussions sur les capacités fonctionnelles des patients et sur leur aptitude à réaliser des actes de la vie quotidienne. En effet, les conséquences d’un point de vue physiologique du cancer et de ses traitements sont importantes sur la condition physique des patients. À cela se surajoutent des conséquences psychiques avec la peur de bouger, de se blesser et de fatiguer encore plus. De ce fait, les patients sont de plus en plus sédentaires, de plus en plus inactifs et entrent progressivement dans une spirale négative de déconditionnement à l’effort qui va être d’autant plus importante que la personne bouge peu. Tous les paramètres de la condition physique sont touchés et en particulier l’endurance aérobie, la force et l’endurance musculaire ainsi que la composition corporelle sont particulièrement atteints. Or, ces trois paramètres interviennent de façon importante dans la lutte contre le cancer et il est indispensable de maintenir une condition physique la plus grande possible pour pouvoir notamment supporter les traitements et mieux lutter contre la maladie.
Comme cela a été montré, l’AP permet en effet de maintenir ou de ralentir la diminution de la condition physique pendant les traitements. Pour cela, elle doit être pratiquée avec régularité en ayant la meilleure observance possible. Les programmes mixtes combinant à la fois des exercices de type aérobie et des exercices de renforcement musculaire donnent les meilleurs résultats. L’intensité doit être modérée à soutenue. L’AP peut être pratiquée à tout moment, que ce soit pendant le traitement, ou à distance. Les meilleurs résultats sont obtenus lorsque la pratique a lieu pendant et après le traitement (AFSOS, 2020) mais il est possible d’obtenir des résultats bénéfiques sur la condition physique à n’importe quel moment de la prise en charge.
L’AP est aujourd’hui le seul traitement validé de la fatigue en oncologie. Elle permet d’améliorer la fatigue quel que soit le moment de prise en charge.
Alexandra Landry
Bibliographie
American College of Sports Medicine Position Stand (1998) The recommended quantity and quality of exercise for developing and maintaining cardiorespiratory and muscular fitness, and flexibility in healthy adults. Med Sci Sports Exerc., 30(6) : 975-91.
Ainsworth, B. E., Haskell, W. L., Léon, A. S., Jacobs, Jr D. R, Montoye, H. J., Salis, F. J., Paffenbarger Jr RS. (1993). Compendium of physical activities : classification of energy costs of human physical activities. Med Sci Sports Exerc., 25(1) : 71-80.
AFSOS. Fatigue et cancer. (2020) Référentiel en soins oncologiques de support. [en ligne] https://www.afsos.org/fiche-referentiel/cancer-et-fatigue/.
Ahlberg, K,. Ekman, T., Gaston-Johansson, F., Mock, V. (2003). Assessment and management of cancer-related fatigue in adults. Lancet, 362 : 640–650.
Aniansson, A., Grimby, G., Hedberg, M. (1992). Compensatory muscle fiber hypertrophy in elderly men. J Appl. Physiol., 73(3) : 812-6.
Antoun, S., Lanoy, E., Iacovelli, R., Albiges-Sauvin, L., Loriot, Y., Merad-Taoufik, M., Fizazi, K., Di Palma, M., Barakos, V. E., Escudier, B. (2013). Skeletal muscle density predicts prognosis in patients with metastatic renal cell carcinoma treated with targeted therapies. Cancer, 15;119(18) : 3377-84.
Argilés, J., Bales, C., Baracos, V., Guttridge, D., Jatoi, A., Kalantar-Zahed, K., Lochs, H., Mantovani, G., Marks, D., Mitch, W. E., Muscaritoli, M., Najand, A., Ponikowski, P., Fanelli, F. R., Schambelan, M., Schols, A., Schuster, M., Thomas, D., Anker, S. D. (2008). Cachexia : a new definition. Clinical nutrition, 7(6), 793-799.
Argilés, J. M., Lopez-Soriano, F., Busquets, S. (2007). Mechanisms to explain wasting of muscle and fat in cancer cachexia, Curr Opin Support Palliat Care, 1, 293–298.
Bortz, W. M. (1984). Le syndrome de désuétude. Journal occidental de médecine, 141, 691-694.
Caspersen, C. J., Powell, K. E., Christenson, G. M. (1985). Physical activity, exercise, and physical fitness : definitions and distinctions for health-related research. Public Health Rep., 100(2) : 126-31.
Davis, M., Walsh, D. (2010). Mechanisms of fatigue. J support Oncol, 8 : 164-74.
Depiesse, F., Grillon, J-L., Coste, O. (2009). Prescription des activités physiques : en prévention et en thérapeutique. Elsevier Masson, 408.
Drillon, A., Desvergée, M., Prevost, V., Blaizot, X. (2023). Impact of adapted physical activity on joint pain induced under adjuvant hormone therapy for breast cancer : A review of the literature P. Annales Pharmaceutiques Françaises, Volume 81, Issue 1, pages 1-12.
Eley, H. L., Skipworth, R. J., Deans, D. A., Fearon, K. C., Tisdale, M. J. (2008). Increased expression of phosphorylated forms of RNA dependent protein kinase and eukaryotic initiation factor 2alpha may signal skeletal muscle atrophy in weight-losing cancer patients. Br J Cancer., 29;98(2) : 443-9.
Evans, E. S., Prosnitz, R. G., Yu, X., Zhou, S. M. , Hollis, D. R., Wong, T. Z., Light, K. L., Hardenbergh, P. H., Blazing, M. A., Marks, L. B. (2006). Impact of patient-specific factors, irradiated left ventricular volume, and treatment set-up errors on the development of myocardial perfusion defects after radiation therapy for left-sided breast cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys., 15;66(4) : 1125-34.
Fearon, K. C., Glass, D. J., Guttridge, D. C. (2012). Cancer cachexia : mediators, signaling, and metabolic pathways. Cell Metab., 8;16(2) : 153-66.
Flavier, A. (2003). Le stress oxydant. Intérêt conceptuel et expérimental dans la compréhension des mécanismes des maladies et potentiel thérapeutique. L’actualité chimique, 270, 108-115.
Grotto, H. Z. (2008). Anaemia of cancer : an overview of mechanisms involved in its pathogenesis. Medical oncology, 25(1) : 12-21.
Helzlsouer, K. J., Gallicchio, L., MacDonald, R., Wood, B., Rushovich, E. (2012). A prospective study of aromatase inhibitor therapy, vitamin D, C-reactive protein and musculoskeletal symptoms. Breast Cancer Res Treat., 131(1) : 277-85.
Hoffman, M., Ryan, J. L., Figueroa-Moseley, CD, Jean-Pierre, P, Morrow, GR, (2007). Cancer-related fatigue : the scale of the problem. Oncologist, 12 (Suppl. 1) : 4-10.
HAS (2019). Prescription d’activité physique et sportive Cancers : sein, colorectal, prostate. [en ligne] https://www.hassante.fr/upload/docs/application/pdf/201907/app_247_ref_aps_cancers_cd_vf.pdf
INCa. (2017). Bénéfices de l’activité physique pendant et après cancer – Des connaissances aux repères pratiques. Synthèses. Collection Etat des lieux des connaissances. [en ligne] https://ressources-aura.fr/wpcontent/uploads/2019/09/Benefices_de_l_activite_physique_pendant_et_apres_cancer_synthese_mel_20170315.pdf
Irwin, M. L., McTiernan, A., Bernstein, L., Gilliland, D., Baumgartner, R., Baumgartner, K., Ballard-Barbash, R. (2004). Physical activity levels among breast cancer survivors. Med Sci Sports Exer., 36 : 1484-91.
Jones, L. W., Guill, B., Keir, S. T., Carter, K., Friedman, H. S., Bigner, D. D., Reardo, D. A. (2007). Using the theory of planned behavior to understand the determinants of exercise intention in patients diagnosed with primary brain cancer. Psychooncology., 16(3) : 232-40.
Khan, K. M., Thompson, A. M., Blair, S. N., Sallis, J. F., Powell, K. E., Bull, F. C., Bauman, A. E. (2012). Sport and exercise as contributors to the health of nations. Lancet, 380 : 59-6.
Kilgour, R. D., Vigano, A., Trutshnigg, B., Hornby, L., Lucar, E., Bacon, S. L., Morais, J. A. (2010). Cancer-related fatigue : the impact of skeletal muscle mass and strength in patients with advancer cancer. J Cachexia Sarcopenia Muscle, 1 : 177-85.
Markes, M., Brockow, T., Resch, K. L. (2006). Exercise for women receiving adjuvant therapy for breast cancer. Cochrane Database Syst Rev., (4) : CD005001.
McTiernan, A., Rajan, K. B., Tworoger, S. S., Irwin, M., Bernstein, L., Baumgartner, R., Gilliland, F., Stanczyk, F. Z., Yasui Y., Ballard-Barbash R. (2003). Adiposity and sex hormones in postmenopausal breast cancer survivors. J Clin Oncol., 15;21(10) : 1961-6.
Mishra, S. I., Scherer, R. W., Snyder, C., Geigle, P. M., Berlanstein, D. R., Topaloglu, O. (2012). Exercise interventions on healthrelated quality of life for people with cancer during active treatment. Cochrane Database Syst Rev., 8.
Neil, S. E., Klika, R. J., Garland, S. J., McKenzie, D. C., Campbell, K. L. (2013). Cardiorespiratory and neuromuscular deconditioning in fatigued and non-fatigued breast cancer survivors. Support Care Cancer, 21(3) : 873-81.
Pedersen, B. K., Febbraio, M. A. (2012). Muscles, exercise and obesity : skeletal muscle as a secretory organ. Nat Rev Endocrinol., 8(8) : 457-65.
Prado, C. M., Lieffers, J. R., McCargar, L. J., Reiman, T., Sawyer, M. B., Martin, L., Baracos, V. E. (2008). Prevalence and clinical implications of sarcopenic obesity in patients with solid tumours of the respiratory and gastrointestinal tracts : a population based study. Lancet Oncol., 9(7) : 629-35.
Reinertsen, K. V., Cvancarova, M., Loge, J. H., Edvarsen, H., Wist, E., Fossa, S. D. (2009). Predictors and course of chronic fatigue in long terme breast cancer survivors. Curr Sports Med Rep., 8 : 325-30.
Stedman, T. L. (2001). Stedman’s Concise Medical Dictionary for the Health Professions. Lippincott Williams & Wilkins.
Strasser, B., Steindorf, K., Wiskemann, J., Ulrich, C. M. (2013). Impact of resistance training in cancer survivors : a metaanalysis. Med Sci Sports Exerc., 45(11) : 2080-90.
Terret, T. (2023). Histoire du Sport. Que sais-je ? PUF.
Toth, M. J., Miller, M. S., Callahan, D. M., Sweeny, A. P., Nunez, I., Grunberg, S. M., Der-Torossian, H., Couch, M. E., Dittus, K. (2013). Molecular mechanisms underlying skeletal muscle weakness in human cancer : reduced myosin-actin cross-bridge formation and kinetics. J Appl Physiol., 114(7) : 858-68.