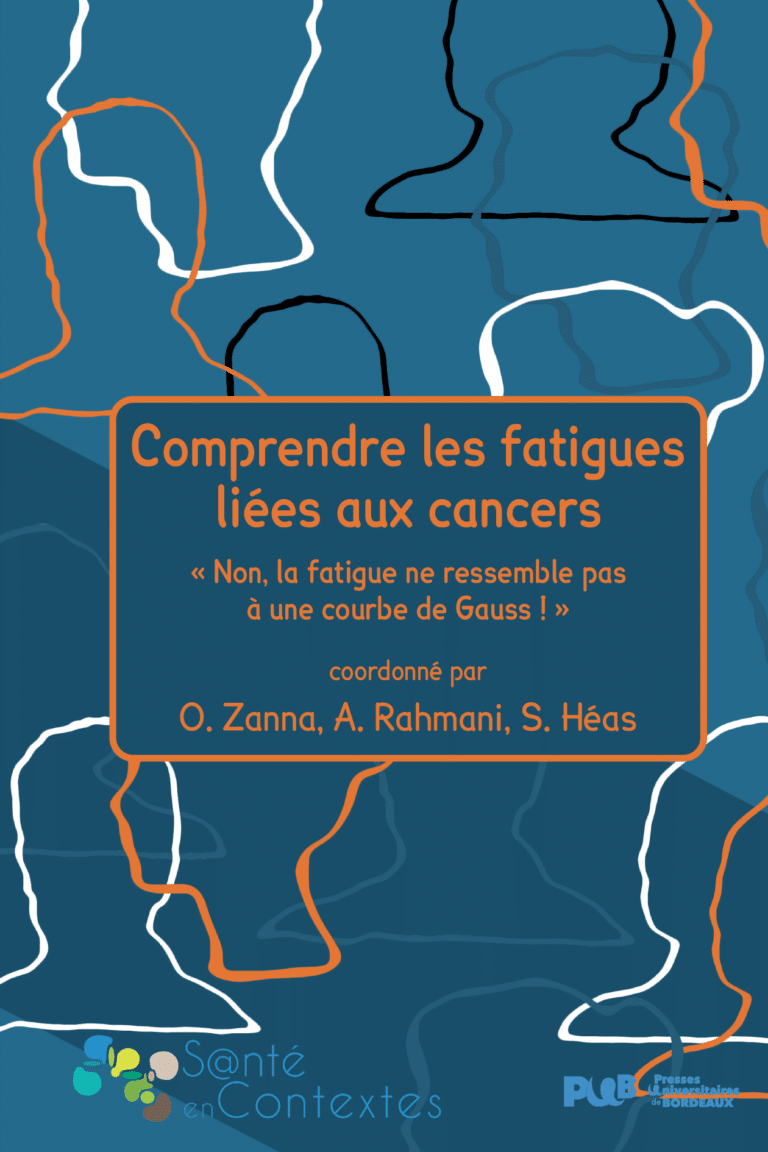Un article sur cette double expérience traumatique est en cours de publication (2026) à l’occasion du numéro anniversaire des 20 ans de Corps. Revue interdisciplinaire.
Interlude N° 11
Maxime, 38 ans, suivi pour un cancer du côlon. Entretien réalisé le 28 janvier 2020, à l’hôpital de jour, suite à sa séance de chimiothérapie, en présence de Cécile, sa conjointe.
M : Mais le fait que voilà, je ne sois pas en super condition physique, même si j’ai le moral, même si je sais que je suis plus maigre, que je suis moins… Que je tiens moins en soirée, c’est évident. Je suis beaucoup plus fatigué donc je n’ai pas envie de montrer ce côté-là aux gens. Ce n’est pas agréable, ni pour eux, ni pour moi, parce qu’ils vont avoir de la pitié et moi ça ne m’intéresse pas. Ça va me rejeter à la figure ce qu’ils voient… donc ce n’est pas intéressant.
C : En fait, ce qui fait ça aussi c’est que t’es obligé d’en faire plus. Tu ne peux pas rester toi même, le fait que tu sois fatigué, que tu n’aies pas envie de parler, quand tu vois les gens, en fait, tu fais en sorte qu’ils ne voient pas que tu sois malade…
M : Ah oui.
C : Donc ça fatigue encore plus.
M : Du coup je ne peux pas vraiment être… si j’ai un coup de… bah je vais essayer d’aller au-dessus parce que je me dis qu’au moins ils sont là. Ils me disent « oui si tu es fatigué, va te coucher ». Bah non, je ne peux pas. Dans ma tête, ils sont là, donc voilà. Quand j’ai envie, par contre, qu’on aille chez des amis, parce que là je me dis que je me sens bien, on peut y aller, ça va nous faire du bien, ça va nous faire changer d’air aussi. Donc on le fait, mais c’est mieux quand c’est moi qui le décide, et par contre, là, je ne supporte plus quand les gens viennent à l’improviste. Je n’aimais déjà pas trop ça savant, parce que je suis toujours quelqu’un qui est organisé, qui aime bien savoir où je vais et qui vient, tout ça, mais là c’est encore pire parce que je me dis que si j’ai vraiment envie de ne pas être habillé, pas rasé, au calme, pas de gosses, tranquille, être dans le lit… Là, c’est beaucoup la période où on aime bien, de temps en temps, se mettre dans le lit à rien faire parce que… et j’ai pas envie que ça vienne sonner, d’être obligé de se changer, boire un café… voilà, j’ai pas trop envie. Il y a des moments où j’ai vraiment envie d’être peinard, un peu plus qu’avant.
Apprendre à vivre, plus précisément apprendre à continuer de vivre après des accidents vasculaires cérébraux, tel est mon défi désormais. J’ai l’impression, plus encore qu’auparavant, de vivre dans un tourbillon, un véritable maelstrom pour reprendre la parabole utilisée par Norbert Elias1. L’étourdissement est à la fois en lien avec les séquelles (cérébrales, visuelles, motrices), les traitements et la vie active que je poursuis tant bien que mal depuis ces accidents. Les populations victimes d’AVC ont été l’objet d’analyses scientifiques spécifiques depuis un demi-siècle au moins. Michel Dumas en 1961 dans une approche épidémiologique, base de sa thèse de médecine, rappelle le travail pionnier de Charles Foix en neurologie et sa participation à la connaissance plus fine des artères et fonctions cérébrales. Dumas indique aux débuts des années soixante et en Afrique au moins la sous-évaluation des AVC comme causes de mortalité et d’infirmité – pour reprendre le langage de l’époque. Il utilise alors une notion intéressante, évoquant par anticipation une approche sociologique (possible) :
Si bien que la maladie vasculaire, en général, et particulièrement en Afrique, doit être considérée comme une maladie sociale, non seulement par le nombre important de sujets atteints, mais aussi par les conséquences lointaines qu’elle entraîne : infirmités motrices ou psychiques, pour lesquelles aucun centre de rééducation n’existe (1961, 2).
Une des premières communications relevant plus strictement des sciences humaines et sociales date de 19702 par M.D. Hyman. L’accent était mis à la fois sur l’impact négatif dans le processus de récupération d’une mauvaise image de soi et de l’isolement social et/ou conjugal avant et après les AVC, et plus largement dans le cadre des maladies au long cours. Puis, une approche sociologique interactionniste plus récente indique, elle, que les comportements « déviants » observés dans les services de soins étaient l’objet de gestion collective et concertée dans les services pour éviter de stigmatiser les malades concernés (Gold, 1983). Étaient particulièrement soulignées les émotions manifestes et manifestées (être/demeurer triste, pleurer devant les personnels et les autres malades, etc.) et les actions « agressives » (parler fort, tutoyer les personnels et les médecins, voire dénigrer leur travail, se mettre en colère, manquer de réserve et/ou de pudeur, etc.). D’autres réactions pouvaient, sans connaissance fine des séquelles ou sans recul critique, être considérées comme des formes de résistance à la rééducation (porter des lunettes de soleil à l’intérieur3, des bottes de cowboy en séance de kinésithérapie4, etc.). Quarante années plus tard, ces mêmes comportements et d’autres attitudes sont interprétés sociologiquement d’une autre manière (cf. Darmon infra). Je préciserai l’écho de ces analyses avec ma propre expérience de vie post-AVC.
En termes d’incapacités, selon ces premières analyses, la récupération psychocorporelle et la rééducation apparaissaient moins aisées en raison des troubles de la vision notamment (Stern et al., 19715). Le travail de normalisation des comportements (et des pensées ? !) et celui de démédicalisation de l’accompagnement au fil du temps étaient soulignés par ces premières études sociologiques. Le coût élevé et la complexité des programmes de réhabilitation n’apparaissaient pas, à l’époque en tous les cas, plus profitables que des formes classiques de rééducation motrice visant à nouveau à marcher, se lever, s’asseoir, etc. (Stern et al., 1971). L’importance d’inclure davantage les proches, la famille, dans la prise en charge et le suivi de la rééducation était évoquée à la fin de ces enquêtes princeps… sans que cela ne soit perceptible un demi-siècle plus tard au niveau de cette expérience en cours ; mon épouse a regretté depuis tous ces mois ne pas avoir été directement questionnée sur les avancées, difficultés, concrètes au quotidien malgré la visite de contrôle de notre habitation par deux ergothérapeutes avant l’autorisation des « permissions de sortie » délivrées par le centre de rééducation.
À l’époque de ces premières enquêtes, la rééducation était largement fonctionnelle et devait permettre de faciliter la vie quotidienne en termes de toilette ou de déplacement moteur6. Les caractéristiques sociodémographiques, sociales, a fortiori culturelles, restaient peu investiguées dans le détail pour expliquer les variations de comportement des personnes concernées par des AVC dans le(ur) processus de récupération.
En France, les recherches sociologiques semblent plus récentes encore. Muriel Darmon analyse et démontre dans une approche empruntant au sillage de Pierre Bourdieu pour les personnes ayant subies un AVC « la dialectique entre ce qui est perdu et ce qui perdure » (2021, 147), les différences de culture (somatique), d’ethos de classe, face à la maladie et la guérison, etc. Elle a, notamment, observé des patients au fil de leurs soins dans des structures hospitalières et de rééducations, se rapprochant ainsi du régime de vie des malades. Elle a suivi parfois pendant plus de six mois une même personne lors de ses séances de soin. En effet, les soins se succèdent, se « cumulent », pour et du côté des patients, et plus largement des malades, au fil d’une journée, d’une semaine, d’un séjour hospitalier, puis ensuite dans le cadre des soins ambulatoires. Les soignants, au contraire, voient les patients toujours par intermittence, parfois brièvement, chaque jour (infirmières, aides-soignantes…), quelques fois chaque semaine (kinésithérapeutes, ergothérapeutes…), voire une fois chaque mois ou même chaque année pour d’autres soignants (cardiologues, neurologues, etc.)… M. Darmon montre, ainsi, comment la classe sociale (plus souvent des classes populaires) et le genre des malades et des soignants (plus souvent des femmes) impactent les objectifs, l’atmosphère de travail et les pratiques même de soins et de rééducation. Les tâches de rééducation ergothérapiques par exemple demandées aux femmes et aux hommes relèvent largement de stéréotypes genrés (aux hommes le bricolage et la conduite automobile, aux femmes la cuisine et les tâches domestiques8), les relations entre soignants et soignés sont empreintes d’une « exigence » de paroles, de la valorisation de la parole sur soi et de ses propres perceptions, voire l’encouragement à « l’expression obligatoire des sentiments9 ».
L’approche ici, en prenant en compte ces connaissances acquises précédemment, est bien différente, loin de cette approche en termes de classes et de cultures socioprofessionnelles10, je présente une réflexion socioanthropologique de type expérience de vie intime11. David Le Breton évoque un processus de « reconquête de soi 12 ». En tous les cas, ma vie est désormais marquée par ces accidents, aux conséquences plus ou moins visibles pour un œil non averti. Soit, une analyse de ma situation personnelle depuis cette inopinée et surprenante13 expérience de vie avec incapacités et handicaps. Non pas une approche extérieure en sciences humaines et sociales où la chercheuse ou le chercheur rencontre pour un temps limité, en présentiel ou non (Héas, Régnier, 2022), des personnes concernées ou leurs proches, voire leurs soignants -, mais une analyse du vécu de l’intérieur même de la situation, ici, accidentelle et traumatique. C’est-à-dire une expérience en première personne. Je (pour)suis, modestement, en cela au moins l’exemple d’un pionnier célèbre en sciences sociales, Robert Murphy (1993) qui a scrupuleusement observé ses paralysies devenir définitives au fil de l’avancée de sa maladie… ce qui n’est pas tout à fait mon cas14.
Parler de soi et écrire sur soi n’est pas dénuée d’écueils (Werner, 1999 ; Ghasarian, 1997). Cette expression et écriture en première personne ne sont pas habituelles en sciences hormis dans certains cadres particuliers (notes de terrain, observations participantes, voire communications orales en colloque…). Cette expérience marquante des AVC participe désormais et se combine à ma professionnelle « attention au monde » (Gomez, 2003, 17), attention particulière et même singulière depuis cette double expérience traumatisante. Le soutien d’expériences personnelles d’autres chercheurs exposés dans des ouvrages, parfois de véritables best-sellers, facilite le travail d’étayage argumentaire, voire de comparaison des situations, si ce n’est des expériences. Citons B. Cyrulnik, P. Levi, E. Louis, etc. Écrire sa vie, histoire de « témoigner et de transmettre » (Gomez, 2003, 18), histoire de partager au moins ; écrire sa vie éventuellement afin de sensibiliser à une cause donnée (comme des violences subies ou observées), voire écrire comme un cri, « crire » (Le Breton, dans Lévy, 2004) histoire de « surmonter un désespoir » pour reprendre G. Bernanos15.
L’axe central de la démonstration s’organise autour de la fatigue, conséquence directe et manifeste des AVC16. Ici, nous mobilisons une conception de la fatigue comme « toujours définie au sein de circonstances précises et selon la part qu’y prend l’individu » (Le Breton, 2014, 114). Cette sensation de fatigue et la fatigue telle qu’elle peut être perçue par les autres, sont considérées, toutes les deux, par les soignants et les soignantes rencontrés et qui m’accompagnent dans cette rééducation, comme normales et durables pour ne pas écrire chroniques étant donné ma situation clinique. Ce thème de la fatigue est appréhendé avec l’aide des concepts de continuité biographique (Darmon, 2021) versus de bifurcation, voire de rupture, biographique (Négroni, 2005 ; Bury, 1982), et celui plus général de rite de passage (Van Gennep, 1981 ; Le Breton, 2005). Je ressens en effet à la fois fortement le « poids » de ces concepts sur ma vie actuelle et comment ils peuvent (m’)aider à mieux la comprendre.
La rupture biographique provient/proviendrait au premier « regard sociologique » (Hughes, 1996) au moins de l’advenue de problèmes de santé, alors qu’auparavant j’étais quasi vierge de tels soucis. Jamais de maladies ou d’accidents graves, aucune fracture. J’étais d’ailleurs plutôt fier de ce « résultat » d’une non-prise de risque (Héas, 1995), d’une tempérance et mesure physiques qui me « conduis(ai)ent » à ne pas aller au-delà de mes capacités de résistance, d’endurance à la douleur, au sommeil17, au froid, etc. Ainsi, je pensais – inconsciemment ? Naïvement ? – garder le contrôle de/sur toutes mes actions, perceptions et sensations et tout ce qui pouvait m’arriver. Une18 ombre majeure à ce tableau sanitaire personnel : une appendicectomie grave au moment de la plus redoutée des épreuves pour moi (l’oral en Allemand) lors du passage du baccalauréat. Cette opération chirurgicale en urgence (résultat du stress intense que je vivais à cette époque des révisions ?) m’a conduit à devoir repasser aux sessions de rattrapage ce fameux sésame pour l’accès à l’enseignement supérieur19. Aucune cause à cette infection n’a été évoquée ni même recherchée d’après mes souvenirs… malgré une situation d’urgence vitale (septicémie).
Dans un premier temps donc, la figure de la rupture biographique20 semble émerger et bouleverser mon quotidien… jusqu’à une intégration progressive de ces accidents – quelque chose comme une « normalisation de l’AVC » (Darmon, 2021, 42), pour les inclure dans une biographie et une vie qui continuent malgré tout. Comme beaucoup d’autres victimes d’AVC, j’observe malgré des contraintes et limitations psychocorporelles la poursuite d’un « flux biographique » (Faircloth et al., 2004). Neuf mois après, je me surprends à récupérer mon niveau d’habileté au tennis de table ou au billard alors même que je me déplace avec difficulté et que mon équilibre est sommaire… Par conséquent, avant ces AVC sans vivre de problèmes sanitaires majeurs, logiquement, j’étais actif dans tous les sens du terme et sans doute hyperactif… je m’en rends compte maintenant que tout m’épuise. Je combinais allègrement une activité professionnelle fortement engagée : d’une part à l’université (soit, toutes les tâches correspondant à ma fiche de poste – en liens avec les enseignements, les recherches – tout en prenant, dès mon entame de carrière, la responsabilité d’un diplôme, puis la création d’un autre, puis la participation active à la création d’un laboratoire de recherche, etc.).D’autre part, en dehors de l’université, au niveau national et international, avec la création d’une association de recherche, de deux revues scientifiques en ligne (la première aux débuts des années 2000, et la dernière en 201721), l’organisation de séminaires bretons sur le genre, puis sur les émotions avec des collègues de Brest, mais aussi du Mans, de Paris, etc. Comme je me suis progressivement spécialisé sur les questions de peau, avec des dermatologues, nous avons créé, en parallèle de toutes ces activités, une société savante en 2006, la Société Française en Sciences Humaines sur la Peau22, qui organise, a minima, une journée d’études par an, et les publications qui s’en suivent (deux ouvrages collectifs et de nombreux articles parus dans les Annales de dermatologie et de vénéréologie, la revue dermatologique française la plus ancienne23).
Les loisirs me prenaient aussi un temps précieux, notamment entre l’âge de 10 ans et 50 ans : sports de loisir et de compétition (courses à pied, tennis de table), bricolage intensif avec la rénovation de quatre maisons depuis 1991. Depuis les AVC de 2021 et 2022, la fatigue (physique, psychique, sociale…) est devenue omniprésente dans ma vie quotidienne. Tout mouvement me demande des efforts incroyables : monter les deux étages pour aller dans la chambre, me retourner dans le lit pour trouver une position plus confortable24, tendre ou allonger le bras ou la jambe gauche, remonter le drap, etc. Cette fatigue plurielle s’invite dès le matin et reste toute la journée au contact des autres (famille, soignants, voisins, etc.), et plus encore après chaque activité d’un niveau d’intensité même faible (s’habiller, se coiffer, se déplacer dans la maison, etc.). Le fait même d’ouvrir les yeux et de répondre aux sollicitations du monde suffit à créer et renforcer ces sensations d’être moins ou pas du tout capable, envahi, dépassé, et incidemment de se sentir débordé de toute part, épuisé par tant de sollicitations. Au point que pendant des mois après l’AVC 2, fermer les yeux et même porter un casque antibruit25 ont limité cette fatigue induite par ce monde humain bruyant et fortement sollicitant. Atténuer dès que possible ces stimulations (tactiles, auditives, visuelles, olfactives, etc.) que je vivais comme autant de mini-agressions a efficacement atténué les sensations et perceptions d’étourdissement, de nausée. Surtout que ces désagréments sont redoublés par les effets secondaires des traitements : somnolence et étourdissements sont explicitement indiqués dans les notices des médicaments qui me sont prescrits depuis la fin de l’été 202226…
La fatigue pour (mieux) disparaître de soi ? !
Ces modalités d’adaptation, si ce n’est ces stratégies, constituent-elles des modalités particulières de « disparaître de soi » (Le Breton, 2015) ? ! Car d’une part, j’oubliais et j’oublie temporairement avec ces parades techniques27 les sensations de vertige, les sensations de raideurs (spasticité et neuropathies) et l’oubli ponctuel des AVC eux-mêmes28. D’autre part et plus globalement, ces « disparitions » transitoires permett(ai)ent d’oublier aussi les responsabilités qui m’incombent en tant que fils, frère, mari, père, parrain, copain, collègue, propriétaire, bailleur, etc. Ce recentrage sur soi, obligatoire, en limitant les stimuli extérieurs et intérieurs, m’a en tous les cas permis de moins mal vivre l’hospitalisation (comme mise à l’écart de la vie sociale et professionnelle habituelle) qui a été somme toute brève (quelques semaines29) et les soins post AVC qui se mesurent, eux, au moins en mois. Il est classique d’entendre les soignants évoquer l’idée que les incapacités pourront être considérées comme quasi-définitives un an après l’AVC. Les séances de rééducation ergothérapique et kinésithérapique m’ont conduit à toujours mieux « discriminer » (c’est le terme technique utilisé par les soignants) entre le foisonnement de stimuli produit par chacun de mes mouvements, chacune de mes actions : marcher, m’asseoir, m’allonger, toucher un objet, puis progressivement au fil de ma progression de le porter, et le reposer, distinguer entre un objet léger et lourd, doux ou rugueux, etc. Plusieurs mois plus tard, et uniquement pour de courtes activités, j’arrive désormais à supporter une petite partie du rythme de vie usuel de tout un chacun. Mais chacune de mes activités est doublée, ensuite, d’une période de repos obligatoire sous peine de ne pouvoir rester éveillé bien longtemps. Sept mois après (M+7), me rendre chez la kinésithérapeute située à cinq minutes à pied, y faire ma séance d’une heure et revenir implique que je m’allonge a minima une demi-heure ensuite, le plus souvent une heure complète (dans le noir), pour pouvoir revenir à une autre activité sans le poids de l’écrasement de fatigue induit par ces déplacements, exercices et mouvements demandés… pour une seule séance. Cet épuisement post-activité rend compréhensible a posteriori que je passais le plus clair de mon temps au centre de rééducation allongé sur le lit à récupérer de chacune de mes séances de soins (au nombre de cinq ou six chaque jour). Accueillir des proches et les rares collègues qui se sont déplacés au centre devenait une épreuve supplémentaire que j’avais bien du mal à « assurer » convenablement, sans irritation manifeste…
L’épreuve du passage par les AVC n’est donc pas limitée à quelques semaines comme dans les rites observés par de nombreux ethnologues, loin de là. Elle n’est pas réservée à un groupe de pairs en termes de sexe ou d’âge non plus30. Elle est par conséquent vécue d’une manière davantage individuelle, même si elle impacte profondément mes proches, au premier chef mon épouse qui participe activement à m’aider au quotidien, à compenser mes pertes et incapacités.
Vivre le risque d’une vie limitée, voire d’une vie minuscule ? Les AVC m’ont ainsi conduit sur les rives d’une « vie minuscule » (Gardou, 2012) avec incapacités majeures… qui s’amenuisent progressivement et lentement. Surtout ces AVC m’obligent à vivre avec maladie alors même que sept mois après le second AVC aucune cause organique ou maladie n’est attestée, ni même confirmée : un foramen cardiaque et une fibrillation atriale ou ventriculaire ont été découverts par différents examens (électrocardiogramme, échographies, puis puce incrustée sous la peau pour mesurer H24 ces mouvements cardiaques erratiques).
Environ six mois après le dernier accident, je me suis surpris à m’envisager progressivement comme un malade cardiaque chronique31. Les spécialistes « à mon chevet32 » temporisent et demandent, aujourd’hui encore, confirmation avec des examens complémentaires pour modifier éventuellement les traitements à l’avenir, et peut-être intervenir par chirurgie. Cette temporalité médicale propre m’a insupporté pendant des semaines. Devenir « patient » était devenu une boutade journalière pour moi puisque je jonglais entre de multiples RDV médicaux et paramédicaux, et la ponctualité des professionnels n’était pas toujours au rendez-vous33. J’ai appris à relativiser les retards des uns et des autres professionnels (le plus souvent en raison d’urgence à gérer : un malaise, un soin qui se déroule moins bien que prévu, etc.). Puis, j’ai lu avec un certain effroi un compte-rendu hospitalier du service de cardiologie où la/ma situation était présentée comme « sans nouvelle thrombose depuis cet été ». Ma vie, consciente et active dans tous les sens du terme, est donc officiellement suspendue à cette non-advenue de nouvelle thrombose… sans savoir précisément comment l’éviter hormis un traitement chimique (Kardégic®) journalier. Quel risque ! Quelle incertitude ! Déjà, l’expérience de subir deux AVC à un an d’intervalle « sans facteurs de risque » avant 60 ans me place dans une anormalité statistique… inquiétante pour le moins.
Si j’ai effectivement mis environ une année à ne plus autant ressentir l’omniprésence de la fatigue suite à mon premier AVC34, cette fatigue me sera présentée d’une manière singulière à la fin de la semaine au CHU en service de soins intensifs à l’été 2022, suite à l’AVC 2. La kinésithérapeute qui, a priori ne me connaissait pas35, utilisa fort à propos une image sportive qui m’a tout de suite interpellée : « vous verrez que prendre une simple douche équivaut à un marathon pour vous ! Vous serez donc obligé de vous reposer souvent (éclats de rire commun) ». Paradoxal, pour quelqu’un comme moi qui ne s’est jamais engagé dans les courses de longue distance – au contraire de mon frère et surtout de ma sœur – car cela me paraissait insurmontable, voire dangereux pour ma santé physique (avec les blessures induites).Or, je me trouve confronté à cet excès de fatigue bien malgré moi… sans même avoir débuté, a fortiori franchi une seule ligne d’arrivée d’un marathon ou d’un trail.
Être fatigué et activé
À M+7, je poursuis des séances de rééducation psychophysique en soins ambulatoires (kinésithérapie et orthophonie). Je vis à nouveau depuis fin janvier 2023 dans mon cadre de vie habituel. Ces séances paramédicales se succèdent à raison de quatre heures par semaine auxquelles il faut ajouter les exercices à réaliser « en autonomie » (équilibre, étirement, assouplissement, automassage), à la maison, chaque jour. La rupture et le changement de vie après AVC sont imposés, ipso facto, par les périodes d’hospitalisation, les traitements à vie, les exercices de rééducation officiels et officieux36. Cette rupture biographique est progressivement intégrée par la personne concernée. En effet, j’ai « profité » des fêtes de fin d’année 2022 pour demander et/ou m’offrir moi-même des outils de rééducation : Bosu®37, ballon de fitness, console Nintendo Wii® avec board pour la proprioception, arc, fléchettes, etc. Après coup, je me rends compte du risque de suractivité y compris au cours de cette période de rééducation et de repos officiel. Mon emploi du temps est fortement allégé par rapport à celui vécu au centre de rééducation (de J+8 à J + 90) où les soins comprenaient entre six et neuf activités-séances différentes d’environ une heure chacune… chaque jour. Un vrai emploi du temps de sportif de haut niveau… je ne m’en suis jamais plaint, bien au contraire, j’ai aimé cette période intense d’activités, même si ce n’était pas une partie de plaisir. Jamais je n’ai considéré ces séances de soins comme de la « torture », au contraire de certains autres malades du centre qui m’en parlaient de cette manière.
Depuis ma sortie de l’hôpital, puis du centre de rééducation, la phase liminaire (de marginalisation donc) tend à se terminer et ma réintégration sociale (Van Gennep, 1981) s’organise au mieux, si ce n’est ma réintégration professionnelle pour l’instant puisque je suis estampillé en arrêt longue maladie depuis M+ 6. Comme nous vivons dans une société d’individus, je n’ai pas été surpris du caractère privé des rites de passage que je vivais, que j’éprouvais à même le corps et dans mes relations sociales (Le Breton, 2005) ; donc peu ou pas surpris par exemple de la faible reconnaissance collective de ma situation que j’espère passagère. Étant donné mon hyperactivité pré-AVC (mes proches pensent d’ailleurs qu’il s’agit de la cause probable de mes accidents), j’ai écouté au mieux les conseils de repos, sans toutefois réussir, par exemple, à ne pas lire et répondre à une partie de mes courriels professionnels38… dès que l’énergie et mes capacités de concentration ne me faisaient pas défaut. Pour autant, par déficit de conscience claire et d’énergie disponible, je suis resté jusqu’à maintenant le plus possible à distance d’une posture professionnelle stricte d’enquêteur ; par exemple, j’ai limité jusqu’à présent au maximum mes contacts avec les associations de malades… qui constituent professionnellement mes interlocuteurs privilégiés depuis plus d’une décennie.
Vignette méthodologiqueÀ l’hôpital où mon état physique et psychique le permettait peu ou pas du tout, et au centre de rééducation, j’ai gardé longtemps une distance « calculée » avec les autres malades. Le traumatisme de ma situation (avec la peur panique de devenir « légume », voire de mourir d’un prochain AVC) et l’atteinte psychologique de ces accidents m’empêchaient d’entrer aisément en contact avec les autres (à raison de ma conscience limitée, de la fatigue et de l’intensité même des soins que l’on me prodiguait alors). Je me découvrais incapable d’écouter même partiellement les histoires de vie et notamment le malheur des autres, tant j’étais absorbé « corps et âme » (Wacquant, 1989) dans mon malheur propre. Impossible pour moi de redevenir l’« écouteur » professionnel que j’étais jusqu’à maintenant (Olivier de Sardan, 1995). Une discrétion était de mise autour de moi et aucun soignant ou personnel n’a jamais évoqué devant moi la situation sanitaire et encore moins personnelle d’un voisin de chambre… ce qui limitait drastiquement la prise d’informations concernant les autres personnes hospitalisées. J’ai continué à mon habitude à saluer, avec le sourire de circonstance, chaque personne que je croisais dans les couloirs, les salles de soins (parfois sans réponse, y compris de la part des soignants ce qui laissait de me surprendre). En outre, avec le port du masque obligatoire partout et tout le temps, y compris en séance de kinésithérapie avec les mesures de distanciation spatiale liée à la pandémie Covid-1939, les moments d’échanges étaient rares, et même au self-service, nous étions isolés seuls à une table dédiée, nettoyée systématiquement après notre passage.
Avant ce texte, je me suis résolu à écrire un premier article dit « immersif » à partir des notes rédigées dans un carnet de terrain dès que j’en ai eu la possibilité physique et psychique, à la fois dans une version papier et dans un bloc-notes sur mon téléphone (écrit et audio). Par contre, écrire me fait aussi revivre en partie les émotions attachées à ces instants, à ces situations, et je me suis vite aperçu que moralement cela ne me réconfortait pas, bien au contraire. C’est pourquoi, j’ai rapidement abandonné à l’hôpital et au centre de rééducation la prise systématique de notes, tout en étant vigilant à noter en catimini le plus souvent mes observations et réflexions. En effet, vivre quelques mois à l’hôpital et en centre de rééducation n’est pas de tout repos et les surveillances et interruptions sont continuelles pour vos propres soins, ou pour ceux des autres, vos voisins de chambre, ce, y compris la nuit… Tout faire pour éviter une fatigue supplémentaire a été l’une de mes obsessions salutaires pendant les premières semaines de mon hospitalisation. D’où un certain « retard à l’allumage » dans cette enquête in vivo in situ…
Cette distance au terrain est confirmée par mes faibles relations, pour l’instant, avec les associations ad hoc. Malgré mes messages cinq mois après l’AVC 2 sur le site internétique de l’association nationale40, je n’ai obtenu de réponses que récemment (M+ 7) de l’antenne locale que j’ai contactée dans un deuxième temps. Quelques jours après avoir adhéré, à distance, à cette association de personnes ayant subi un AVC, je me rends compte du caractère urbanocentré de cette association qui possède des antennes dans les principales villes de la métropole. Sur le site départemental, un RDV mensuel est annoncé pour une rencontre « café pâtisserie » le second jeudi de chaque mois dans une maison des associations (où de mémoire il est difficile de garer sa voiture à proximité). Comment s’y rendre lorsque mon droit de conduire n’est pas… reconduit justement ? Comment devoir encore et toujours dépendre de mon épouse, aidante principale41 depuis mon retour à la maison (M+5) ; elle devrait anticiper sur son emploi du temps professionnel pour prendre une journée de congé pour m’y conduire et éventuellement y assister, elle42 aussi… Je me dis que là encore, la faiblesse des transports en commun en zone rurale où je réside va singulièrement me compliquer la vie. Un trajet d’une petite demi-heure en voiture risque de se transformer en une grosse heure de bus, métro et marche à pied, à l’aller et au retour. Cette perspective seule et la fatigue occasionnée risquent de peser lourd dans la balance le jour « j » et m’inciter à rester chez moi. Mon régime sans gluten semble, en outre, peu compatible avec ce moment de convivialité où il s’agit d’apporter des pâtisseries » maison » ». Quid de mon régime et du risque d’écarts alimentaires, moi, qui ne sait pas trop quel professionnel écouter : les conseils de la diététicienne du CHU m’affirmant qu’aucun aliment n’est proscris, relayé par mon médecin traitant qui a haussé les épaules lorsque je lui ai posé la question, ou bien au contraire ceux des sites d’information sur les AVC qui tous à ma connaissance proposent des prescriptions et proscriptions alimentaires ? Sachant que j’ai allègrement repris les kilos perdus suite à mon hospitalisation et même dépassé depuis quelques jours mon poids maximum jamais atteint (74 kg pour 1m74) dans ma vie, ces rencontres associatives avec force collation sucrée ne me disent rien qui vaillent a priori. Et pourtant, j’aimerais pouvoir parler simplement de choses de mon quotidien avec des personnes concernées par les mêmes ( ?) soucis de santé que moi-même.
La fatigue : l’invisible et omniprésente séquelle pour partenaire… à vie
Les séquelles visibles de mon second AVC ne sont plus aussi manifestes pour un œil non averti… c’est en tous les cas ce qu’on me témoigne au quotidien plus de six mois après. Personnellement, je ressens avec une pointe de désespoir la spasticité importante de mon côté gauche : bras, doigts de main et de pied, tronc et jambe ; ces parties de mon corps toujours aussi « pesantes » (en termes de sensations), même si des progrès notables sont enregistrés chaque semaine ou presque. Alors que j’étais paralysé et alité les heures et jours suivant l’AVC 2, j’ai pu marcher à nouveau moins d’un mois après (sans déambulateur et sans canne). Mes mouvements corporels apparaissent plus déliés, ma démarche orthopédique apparaît quasi normale43 (M+7), mon bras gauche reste pourtant largement tétanisé et raide, sans parler de ma main et de mes doigts gauches… y compris pour taper ce texte ! J’ai perdu une partie de mon champ visuel44, mon équilibre postural est tout relatif et je peux être déstabilisé rapidement par une lumière trop forte, des mouvements effectués rapidement ou bien le froid « me saisissant » et accentuant ma raideur corporelle. Au quotidien, je peux désormais dévisser seul le bouchon45 d’une bouteille d’eau ou de lait sans autant devoir me faire aider ou me concentrer pour le faire, porter un objet sans autant me soucier du risque de le lâcher, etc.
Une fatigue sans lien direct avec les tâches réalisées
Surtout une fatigue qui me « rattrape » dès que je fais quelque chose : me lever, manger… alors même que je ne cuisine rien ou presque et que je me contente de légumes crus46, à peine nettoyés ou râpés ou de plats prêts à consommer. Prendre ma douche journalière conduit à une fatigue rapide47. Brosser et attacher mes cheveux reste une épreuve de tous les jours. Ces activités quotidiennes me fatiguent presque autant qu’il y a un mois (soit six mois après les accidents), je me surprends à devoir m’arrêter quelques minutes seulement après avoir commencé une tâche comme par exemple d’ôter quelques mauvaises herbes de ma petite allée dans mon jardin minuscule. Contracter mes doigts pour arracher puis tenir ces petites herbes « folles », me lever pour les déposer dans un sac, m’accroupir deux ou trois fois suffisent à m’épuiser. Je dois rapidement m’allonger, sous peine d’étourdissements, voire de maux de tête… Les seules pratiques d’endurance auxquelles j’arrive à peu près à m’astreindre chaque semaine sont constituées d’une marche quasi quotidienne d’une petite heure à une vitesse ralentie de 3 ou 4 km/h au mieux48 (avec mes deux petits chiens), et d’un ou deux légers entraînements de tennis de table et encore, j’arrive souvent au beau milieu de la séance et je ne prolonge jamais au-delà de l’heure et demi initialement prévues… ce que je faisais systématiquement avant mes accidents vasculaires.
Syndrome de fatigue chronique en question
Les syndromes se multiplient depuis des années et même des décennies ; au point que cette inflation nosologique interroge la construction des critères et des catégories utilisées. Surtout, ces propositions sont réalisées par qui et pour quels desseins ? La santé et les maladies sont désormais des marchés lucratifs et convoités. Les marges bénéficiaires apparaissent fortes même si les risques d’erreurs, d’accidents voire de scandales médicamenteux et sanitaires ne sont pas négligeables. Le « façonnage des maladies (diseases mongering) » semble bien portant (Formindep, 2017). Que la fatigue entre dans ce processus étonne moins dans une société obnubilée par l’efficacité, la performance et la rentabilité à court terme au moins.
Aujourd’hui, (M+9), ma fatigue ressentie est peu visible à qui me croise quelques minutes dans la rue par exemple ou dans un magasin. Pourtant, cette fatigue est accentuée par l’impression permanente d’un poids anormal sur l’ensemble de mon côté gauche, et ce, dès mon réveil. J’ai l’impression d’avoir un élastique qui enserre et comprime constamment mon épaule, mon bras, ma main, mes côtes et ma cuisse gauche. Cette sensation illusoire de poids, de contrainte invisible, est soi-disant minimisée par un médicament (dont une des modalités de conditionnement est en rupture de stock depuis des mois). Je viens de comprendre que ce médicament est fortement addictif, que le sevrage n’est pas une mince affaire, et qu’il est détourné de son usage thérapeutique par des personnes en mal de drogues. Le regard énigmatique, voire soupçonneux, de différents pharmaciens de ma petite ville lors du retrait de ce médicament m’avait mis sur la voie d’un tel détournement possible…
Logiquement, pour contrer ces neuropathies, les exercices d’ergothérapie et de kinésithérapie sont axés sur la mobilisation musculaire et articulaire de ce côté corporel gauche avec un travail spécifique sur l’équilibre. Je m’en amuse depuis des semaines en répondant à mes kinés « je serai bientôt prêt pour le Cirque du Soleil ! ». Cette affirmation péremptoire relève de la boutade car ma progression en termes de proprioception est d’une lenteur décourageante, et mise en regard avec mes habiletés pré-AVC, je dois me résoudre à des exercices sommaires que j’aurai avant réalisé les yeux fermés sans aucune préparation… Cette frustration a été rapidement prise en compte par les soignants après leur avoir confié que j’étais plutôt sportif, et avec plaisir et fierté quasi ambidextre avant ces accidents vasculaires. Reste la frustration de devoir réapprendre des gestes que je réalisais avec aisance et même dextérité auparavant. Voire, reste à « faire le deuil » de certaines habiletés que je ne retrouverai peut-être jamais plus…
L’immobilité ambivalente
J’ai participé à démontrer il y a des décennies maintenant comment des positions corporelles allongées référaient implicitement à la mort dans le cadre de rituels contemporains (Héas, 1995, 1996). Mais ces postures pouvaient et peuvent être mobilisées dans le cadre de pratiques psychocorporelles en vue d’une régénération par le souffle notamment et la détente physique et musculaire – contrant ainsi concrètement et symboliquement la rigidité cadavérique. J’ai démontré aussi comment ces techniques de relaxation visaient une revitalisation, et plus largement un développement personnel plus harmonieux, avec une lutte contre les iatrogénies et les formes de stress contemporain. Rester immobile allongé sur le dos par exemple n’est pas anodin pour un être humain : la position dite décubitus dorsal en sport ou dans d’autres activités physiques possède des références en lien avec la chute, la défaite, bref, a minima une « petite mort » sportive. La position allongée à même le sol symbolise une dégradation sociale ou sportive (le vaincu est mis KO en boxe ou en Mixed Martial Art (MMA), ou immobilisé sur le dos que ce soit en lutte, au judo), voire il signifie une infériorité sociale et/ou physique (Bourdieu, 1990). Plus fondamentalement, les « visites au mort » dans son lieu de vie ou ailleurs dans le cadre d’un institut médico-légal, d’un funérarium, etc., proposent un corps49 allongé sur le dos, à plat. Se retrouver brutalement dans cette position, immobile et en partie paralysé, sur son lit, puis sur un lit d’hôpital renvoie à ces soubassements symboliques, rituels et pratiques.
Les séquelles des AVC m’ont directement confronté à cette ambivalence humaine posturale. Chaque activité et chaque mouvement me font prendre directement conscience des incapacités « acquises » par ces accidents. J’ai été confronté et je suis toujours confronté à un dilemme. D’une part, rester immobile me permet de ne plus autant être conscient ni ressentir ces séquelles que ce soit les raideurs articulaires et musculaires, et les neuropathies afférentes avec sensations d’engourdissement sans lien direct avec une réalité corporelle objective de pesanteur par exemple. En restant immobile je risque d’apparaître « moins » vivant à mes propres yeux et aux yeux des autres. D’autre part, je suis enjoint à bouger ne serait-ce que pour vivre au quotidien et surtout dans le contexte d’une rééducation au long cours, tout d’abord à l’hôpital, puis en centre de rééducation et désormais en soins ambulatoires et dans le cadre des APA et de la prescription médicale d’APA. Bouger m’active… tout en activant mes sensations-séquelles.
Tout se passe comme si la liminalité, deuxième temps de tout rite de passage, devenait la/ma norme. Être hors circuit de la vie professionnelle et même de la vie sociale est devenu mon quotidien. Après plus de neuf mois, mes sorties à l’extérieur et au-delà de deux ou trois kilomètres de ma résidence se comptent presque sur les doigts d’une main : j’ai assisté à un spectacle vivant d’un jeune humoriste, visité une fois ma fille aînée à Paris et passé deux jours à la mer lors de deux petits week-ends. Chaque fois, c’était des propositions ou des cadeaux de la part de mon épouse ou de mes enfants. Cette attention conjugale et filiale est importante, sans doute que mes proches ont le souci de m’éviter une dépression, même si, mon fils, mes filles et mon épouse connaissent mon goût prononcé pour la réclusion volontaire (chez moi) et la solitude. J’ai en somme une vie de préretraité sédentaire et solitaire. J’ai coutume de dire que ces accidents m’ont fait vieillir physiquement de 20, voire de 30 ans50 en une fraction de seconde. L’ambivalence provient aussi de mon statut récent de personne en situation de longue maladie ; par conséquent d’une personne qui ne doit pas travailler et qui ne cesse d’être sollicitée pour des suivis de mémoire, de thèse, des expertises pour des revues, des instituts de recherche, etc. Ces sollicitations multiples constituaient mon quotidien d’avant AVC et pour lequel je ne ressentais aucunement la contrainte, pour lesquelles je ne percevais le plus souvent pas de rémunération, parce qu’il s’agi(ssai)t d’une partie importante du travail scientifique qui se réalise et se construit de cette manière.
Depuis des mois, je rappelle à qui veut l’entendre (en face à face le plus souvent lorsque je croise une connaissance en me rendant à pied chez « ma » kinésithérapeute ou « mon » orthophoniste ou lorsque quelqu’un m’appelle au téléphone) que je dois m’astreindre à des « repos », des « pauses » ou des « siestes » répétées tout au long d’une journée. Je m’interroge d’ailleurs sur le mot à employer, car tout le monde n’a pas comme moi interrogé la place du repos musculaire, de la détente psychocorporelle dans les sociétés contemporaines (Héas, 1996, 2004). L’éloge de la sieste que j’ai fait mien depuis la fin du siècle dernier n’est pas partagé, loin s’en faut dans ce monde trépidant. Les pauses obligatoires lors des confinements ont peut-être changé quelque peu la donne, et encore, il s’agira de le vérifier dans un avenir proche par des enquêtes spécifiques. Toujours est-il qu’être administrativement je suis en arrêt maladie – une première pour moi depuis mes débuts professionnels à la fin de l’année… 1986 – ce qui conduit à une marginalisation importante surtout pour quelqu’un qui avait un métier public et au contact de publics nombreux (étudiants, collègues lors des cours, séminaires, colloques, personnes malades au sein des associations ad hoc, de la fédération des maladies rares, etc.).
La phase de réintégration post-rituelle est sans doute déjà entamée depuis M+7, mais elle reste inconfortable lorsque le statut administratif n’est pas validé officiellement. Je reste dans une liminalité, un entre-deux social et professionnel (en arrêt maladie et à nouveau un peu actif) où mes actions restent et doivent rester le plus invisible possible. D’où les frustrations cumulées au cours de ces derniers mois… au-delà des limitations de mes capacités psychocorporelles. Les répercussions à moyen et long-termes se laissent progressivement entrevoir comme le rétrécissement de mes relations sociales, amicales, professionnelles. Les impacts sur mon « caractère », voire sur mon identité, apparaissent aussi en filigrane au jour le jour. La fatigue infuse tous ces changements d’une aura lancinante, potentiellement négative. Surtout, la figure de la paresse n’est jamais éloignée du malade chronique, lorsque les/ses handicaps deviennent progressivement moins visibles, voire invisibles, ce risque social demeure en filigrane… et va probablement durer.
Stéphane Héas
Université Rennes 2, Laboratoire, Valeurs, Innovations, Politiques, Socialisations et Sports (VIPS2), UR 4636
Bibliographie
Bourdieu, P. (1990). « La domination masculine ». Actes de la recherche en sciences sociales. 84 (2), 2-31. [en ligne] https : //doi.org/10.3406/arss.1990.2947.
Bury, M. (1982). « Chronic illness as biographical disruption ». Sociology of Health & Illness, 4, 167-182. [en ligne] https : //doi.org/10.1111/1467-9566.ep11339939.
Darmon, M. (2021). Réparer les cerveaux. Sociologie des pertes et des récupérations post-AVC, La Découverte, coll. « Laboratoire des sciences sociales », 326.
Dubuis, A. (2014). L’expérience des grands brûlés de la face : épreuves sociales et travail de reconnaissance, thèse sous la direction d’Olivier Voirol, 348.
Dumas, M. (1961). Accidents Vasculaires Cérébraux chez l’Africain, à propos de 142 observations. Thèse de Santé publique et épidémiologie. Université de Dakar, Faculté Mixte de Médecine et de Pharmacie. Français. tel-02316075.
Faircloth, C.A., Boylstein, C., Rittman, M., Young M. E., Gubrium J. (2004). « Sudden illness and biographical flow in narratives of stroke recovery ». Sociol Health Illn, 26(2), 242-261.[en ligne] 10.1111/j.1467-9566.2004.00388.x.
Formindep (2017). « Le disease mongering à l’heure de la médecine « personnalisée » ». Les Tribunes de la santé, 55, 37-44. [en ligne] https : //doi.org/10.3917/seve.055.0037.
Gardou, Ch., (2012). La société inclusive, parlons-en ! Il n’y a pas de vie minuscule. Erès, 170.
Ghasarian, C. (1997). « Les désarrois de l’ethnographe », L’Homme, 143, 189-198.
Gold, Steven J. (1983). « Getting well : impression management as stroke rehabilitation », Qualitative Sociology 6(3), 238-254.
Gomez, J. F. (2003). Écrire sa vie, VST, 4(80), 17-21.
Héas, S. (1995). « Relaxation : propédeutique d’une pratique à non risque ». Cahiers de Sociologie Économique et Culturelle, 23, 111-122.
Héas, S. (1996). La relaxation comme médecine de ville ?, thèse de sociologie, dir. D. le Breton, université de Strasbourg, 01 octobre.
Héas, S. (2004). Anthropologie des relaxations. Des méthodes modernes de loisirs, de soin et de gestion personnelle ?. Paris, L’Harmattan, 426.
Héas, S., Régnier, P. (2022). « Enquêter à distance : une spécificité, une incongruité… ? ». L. Kimber, M. Bourrier (dir.), « Enquêter à distance : nouvel eldorado ? », Socio-anthropologie, 45.
Hughes, E.C. (1996). Le regard sociologique. Essais choisis. Textes rassemblés et présentés par Jean-Michel Chapoulie, Éditions de l’EHESS, 344.
Le Breton, D. (2005). « Rites personnels de passage. Jeunes générations et sens de la vie ». Hermès, La Revue, 43, 101-108. [en ligne] https : //doi.org/10.4267/2042/23995
Le Breton, D. (2005). Disparaître de soi. Une tentation contemporaine, Métailié, 208.
Le Breton, D. (2016). « Bonne ou mauvaise fatigue ». Dictionnaire de la fatigue dir. Ph. Zawieja. Droz, 114-118.
Lévy Joseph, J. (2004), Déclinaisons du corps, entretiens avec David Le Breton, LIBER, coll. « de vive voix », 187.
Murphy, R. (1993). Vivre à corps perdu. Le témoignage et le combat d’un anthropologue paralysé. Pocket, coll. « Terres humaines », 374.
Negroni, C. (2005). « La reconversion professionnelle volontaire : d’une bifurcation professionnelle à une bifurcation biographique ». Cahiers internationaux de sociologie, 2(119), 311-331.
Olivier de Sardan, J.P. (1995). « La politique du terrain », Enquête, 1. [en ligne] http://journals.openedition.org/enquete/263.
Van Gennep, A. (1981, 1909). Les rites de passage. Éditions A. et J. Picard.
Wacquant, Loïc J.D. (1989). Corps et âme, Actes de la recherche en sciences sociales, 80(2), L’espace des sports, 33-67.
Werner, J.-F. (1999). L’ethnographie mise à nu par l’écriture, L’Homme et la société, 134, Littérature et sciences sociales, 63-80. [en ligne]https://doi.org/10.3406/homso.1999.3226
Notes
- Elias, N. (2007). The Fishermen in the Maelstrom. In : Involvement and Detachment, revised edition, 105-178. Dublin : University College Dublin Press.
- Cité par Stern et al., (1971).
- L’éblouissement n’est pas un épiphénomène des séquelles des AVC (cf. mon expérience personnelle, infra).
- Je me suis « amusé » et aussi par confort personnel à me rendre systématiquement en sandales aux séances de kinésithérapie au centre de rééducation. D’une part je suis habitué à randonner y compris de longues distances et en terrain accidenté en sandales, d’autre part je m’efforçais à réussir en sandales là où des chaussures de sport étaient requises pour tenir en équilibre, sauter, dribbler, se déplacer pour attraper une balle, etc. Surtout, cela me rapprochait des kinésithérapeutes qui portaient toutes et tous des chaussures ouvertes de type claquette en cuir… sauf ma kinésithérapeute référente qui portait des chaussons de danse. À la fin de mon séjour au centre, j’arborais en plateau de kinésithérapie et dans tout le centre une paire de running neuves (Nike®) spécifiant que je commençais à considérer le travail kinésithérapique comme plus proche d’une activité physique et sportive (objet de mes pratiques ante-AVC et de mes enquêtes professionnelles).
- Citant les travaux de Lorenze E.J., Cancro R., (1969). « Dysfunction in visual perception with hemiplegia : Its relation to activities of daily living », Arch Phys Med Rehab, 50 : 514-517, June.
- En France, le dossier de demande de RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé) est largement organisé autour des mêmes thèmes, aujourd’hui encore.
- Dans le format électronique du livre.
- Nous avons pu le constater cet automne 2022 au centre de rééducation pourtant considérée comme « plus dynamique et plus jeune » (dixit les ergothérapeutes) que l’autre centre de cette ville étudiante de province.
- Pour paraphraser un article célèbre : Marcel Mauss, (1921). « L’expression obligatoire des sentiments (rituels oraux funéraires australiens) », Journal de psychologie, 18.
- M. Darmon présente les sociologues « comme les scientifiques spécialistes de la classe sociale », 22.
- D’un sociologue, d’extraction populaire, enseignant-chercheur dans une université de sciences du sport depuis 1996 dans une ville étudiante de province. Mon ancrage familial populaire et rural infuse obligatoirement mes manières de penser, d’agir, de ressentir, de parler, etc. comme je l’indiquerai au fil des développements de mon expérience.
- Dans un échange de courriels à propos de ce texte. L’expression constitue un clin d’œil humoristique au “nouveau” parti politique en France d’extrême droite.
- L’accident vasculaire en ce qui me concerne n’était pas prévisible par des facteurs de risque (cholestérol élevé, hypertension, etc.) et/ou un héritage familial prédisposant à ce type de problèmes sanitaires.
- … pour l’instant et avant une éventuelle récidive toujours possible (au moins théoriquement avant mon opération du foramen ovale poreux en décembre 2023). Selon l’expression médicale je suis en phase de « récupération » de mes sensations et capacités antérieures… sans que personne ne sache trop l’étendue possible de cette récupération. Mon hémiplégie s’est transformée en hémiparésie, de moins en moins sévère.
- Cité par Gomez.
- D’autres séquelles des AVC seront évoquées en filigrane comme un déficit de force (parésie) et la spasticité de mon côté corporel gauche toujours présente plus d’une année désormais après le dernier AVC, m+15 : rigidité-tétanie permanente de mon bras et de mon épaule gauche, engourdissement de mon bras et jambe gauches, sensation d’une gêne sous la voûte plantaire gauche, troubles de la mémoire, de la cognition, notamment les possibilités de se concentrer ou bien de mémoriser des images, des visages, des RDV. Les règles des jeux proposées lors des séances d’ergothérapie ont donné lieu à des échanges parfois truculents (pour moi !) avec les soignantes : je critiquais et modifiais les règles, les complétais, tout en étant incapable de m’astreindre aux consignes a priori simples sur lesquelles j’avais toujours à redire (par leur caractère peu clair, voire ambigüe). Encore aujourd’hui je ne sais pas si réellement les règles étaient ambiguës ou bien si par déni de mes difficultés je complexifiais les règles pour me rassurer sur mes capacités de réflexion et de critique (qui font partie de mes compétences et vigilances professionnelles à propos des questions et réponses possibles dans des grilles d’entretiens ou des questionnaires d’enquête)… Une séquelle est définitive : la perte d’une partie de mon champ visuel gauche… qui participe des déséquilibres et étourdissements vécus et ressentis lors de mouvements brusques notamment. Perte visuelle qui est directement incapacitante comme la contre-indication à la conduite d’un véhicule routier classique.
- En opposition radicale avec les valeurs familiales qui soulignaient l’importance de l’endurance et de la résistance à la douleur, à la fatigue, etc. Mon père, dont une partie de son activité professionnelle consistait à animer des bals populaires ou de mariage, était le premier sur la scène de la fête et systématiquement le dernier debout-éveillé…
- J’ai eu aussi au moins deux fois des phlegmons qui m’ont conduit aux urgences dont une fois à Mamoudzou (Mayotte), un séjour hospitalier mémorable… La solution pratique (une croyance efficace ?) adoptée a été de porter jour et nuit une chèche autour du cou ; depuis, je n’ai plus d’angine donc plus de phlegmon non plus…
- L’anesthésie générale subie-vécue avait considérablement réduit mes capacités de concentration et de mémorisation, sans que personne ne me prévienne de ces possibles effets secondaires. Ce qui m’avait perturbé lors de ces ultimes révisions.
- Ce modèle apparaît comme particulier dans les récits de maladie : le modèle du « coup de tonnerre dans un ciel bleu » touchant une personne active, plutôt jeune, souvent fortement dotée en capital social et/ou culturel (Darmon, 2021 : 44 et s.). Mis en scène dans le film Un homme pressé (2018) avec Fabrice Lucchini.
- La Peaulogie. http://lapeaulogie.fr.
- https://sfshp.wordpress.com.
- Avant même l’invention du mot « sociologie » au milieu du XIXe siècle. J’ai la fierté d’être le premier sociologue à y avoir publié un article scientifique…
- Moins inconfortable puisque mes neuropathies côté gauche sont particulièrement « repérables » lorsque je suis allongé au contact direct d’un drap, sous une couette. Déplacer mon bras ou ma jambe gauche sous le drap multiplie les sensations inconfortables de fourmillement intempestif et « exagéré » à proportion du mouvement esquissé. Les raideurs de ce côté corporel « tranchent » avec la supposée position de détente allongée… ce qui accentue encore le décalage sensible et mon inconfort ressenti.
- Que j’avais réclamé à mon épouse dès les soins intensifs au CHU… soit dans le mois suivant l’AVC 2.
- … lues dans le détail seulement à M+7.
- Casque anti-bruit, bras replié ou chèche devant les yeux pour me protéger de la lumière du jour, sieste dès que le besoin s’en ressent, etc.
- J’ai vécu deux moments de confusion temporaire, un médecin de garde a évoqué à ce propos un « ictus amnésique ». Lors de l’un de ces moments de confusion pendant quelques minutes, j’avais complètement oublié le fait d’avoir même vécu deux AVC… ce qui a induit une angoisse terrible lorsque je me suis souvenu de ce qui m’était arrivé par l’intermédiaire justement de mes paralysies qui étaient plus fortes à l’époque et entravaient tout à fait la moindre de mes actions.
- Notamment au regard d’autres conséquences liées à des accidents routiers ou bien des accidents de la vie quotidienne comme les brûlures graves (Dubuis, 2014). Au centre de rééducation, j’ai croisé des personnes dont la vie est hospitalière depuis de longs mois, et pour certains plusieurs années. Par rapport à elles, je suis passé très rapidement d’une situation dépendante-hétéronomie à une situation assez proche de l’indépendance-autonomie… que certaines n’obtiendront jamais plus.
- Les deux personnes atteintes d’un AVC au centre de rééducation étaient très différentes de moi en termes de position sociale et professionnelle par exemple.
- Après mon AVC 1, j’ai demandé une prescription médicale d’APS (pour participer plus activement encore à l’enquête PRESCAP dirigée par Julie Thomas), et le groupe de marche nordique que j’ai intégré pour quelques mois était justement initié et organisé par une association dédiée aux maladies cardiaques, Atout cœur.
- Je les ai rencontrés quelques minutes chacun en tout et pour tout, même pas deux heures en total cumulé pour chacun des spécialistes (neurologue, radiologue, cardiologue) sur une période de sept mois.
- J’ai un rapport au temps strict pour ne pas écrire psychorigide : être en retard de deux minutes me mettait dans un inconfort et un stress incroyable avant ces accidents.
- Soit jusqu’au second AVC…
- Je travaille dans un département de sciences du sport à l’université depuis 1996 dans une ville moyenne de province.
- Je m’efforce dès le début (déjà dans le camion des pompiers qui m’emmenait aux urgences du CHU) à bouger et à mobiliser mon côté gauche (pied, bras). Même lorsque je fais une de mes nombreuses « pauses » (cf. infra) je bouge mon pied gauche, le touche et le masse avec l’autre pied pour activer les sensations tactiles et proprioceptives. Dans la salle d’attente de la kiné, idem, je « m’échauffe » les articulations. Sans cesse, je me surprends à activer ce corps gauche qui a été paralysé… au risque de paraître subir des TOC, voire de vivre avec une danse de St Guy…
- « BOSU® Pro est un matériel d’entraînement multidimensionnel totalement unique qui permet : la préparation physique pour le sport, le travail de l’équilibre ». https://www.google.com/search?q=bosu&rlz=1C5CHFA_enFR885FR885&oq=bosu&aqs=chrome..69i57j0i512l6j0i10i512j46i512j0i512.1976j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8&sei=BYUsaI35I4qyhbIPhYuB-Ak [Consulté le 30/03/23].
- Soulignant mon propre engagement-« enchaînement » au travail académique et aux notions de rentabilité et d’efficacité.
- Seules les séances de balnéothérapie (une fois par semaine en ce qui me concernait) permettaient de se découvrir le visage et le corps (toutefois le bonnet de bain était obligatoire et les précautions hygiéniques redoublées à l’entrée et à la sortie de l’espace dédié).
- Ma première visite du site m’a plutôt « refroidi » avec les témoignages vidéo disponibles. Voir d’autres personnes post AVC m’a heurté, moi qui en ai peu rencontré y compris au centre de rééducation présenté comme un « centre pour jeunes et pour sportifs ». L’autre centre de rééducation près de chez moi rassemble lui exclusivement des personnes plus âgées. Soit, une population plus classique et conforme à la représentation sociale des victimes d’AVC.
- Nous avons bénéficié pour quelques heures de l’assistance d’une femme de ménage de la part de ma mutuelle de santé.
- L’adhésion pour un « couple » (patient·e + aidant·e) était proposée dès l’entame comme possibilité ; j’ai trouvé cela particulièrement pertinent.
- Seule ma mère m’a indiqué percevoir une différence dans ma façon de marcher (près de 8 mois après l’AVC2)…
- Au CHU j’ai réalisé des tests de champ visuel frontal et latéral, mais sans avoir le détail des résultats à ce jour (M+7), alors même que je constate ce déficit visuel à chaque déplacement effectué. Depuis, une autre phase de tests réalisée à ma demande a confirmé mon incapacité visuelle définitive.
- Les nouveaux bouchons compliquent mon quotidien ; ils sont censés permettre de ne pas les perdre puisqu’ils restent accrochés à la bouteille, mais pour une PSH ce nouveau dispositif est peu adapté. Je me rappelle l’avoir évoqué en centre de rééducation, les personnels confirmaient cette difficulté pour tous, patients comme pour eux-mêmes.
- Je mange des légumes crus depuis des années maintenant, mais je n’arrive pas à savoir si mon envie de « cru » est en lien avec mes difficultés de manipulation des outils de cuisine, du conseil de limiter ma consommation de sel qui est un conseil visible sur tous les sites internétiques des maladies cardio-vasculaires… ou bien d’une flemme.
- Sans que cela ne soit un défi personnel, je n’ai été aidé pour prendre une douche que deux fois à l’hôpital, sinon, je me suis débrouillé seul sans même en parler au personnel du centre de rééducation… souvent avec une forte désapprobation, tant les soignants au chevet tentent de limiter les risques de chutes intra-muros…
- Très souvent ma montre connectée m’interpelle et « me » demande si l’exercice physique (la marche libre le plus souvent) est terminé, alors que j’attends seulement l’un de mes chiens qui renifle ici ou là… un peu plus longuement que d’habitude.
- Ou bien ce qu’il en reste dans le cadre des accidents routiers ou de travail, très mutilants… Un drap dissimule parfois les parties manquantes pour permettre les visites sans trop heurter le regard des proches.
- Je suis à peine plus alerte physiquement à M+9 que ma mère qui a 85 ans…