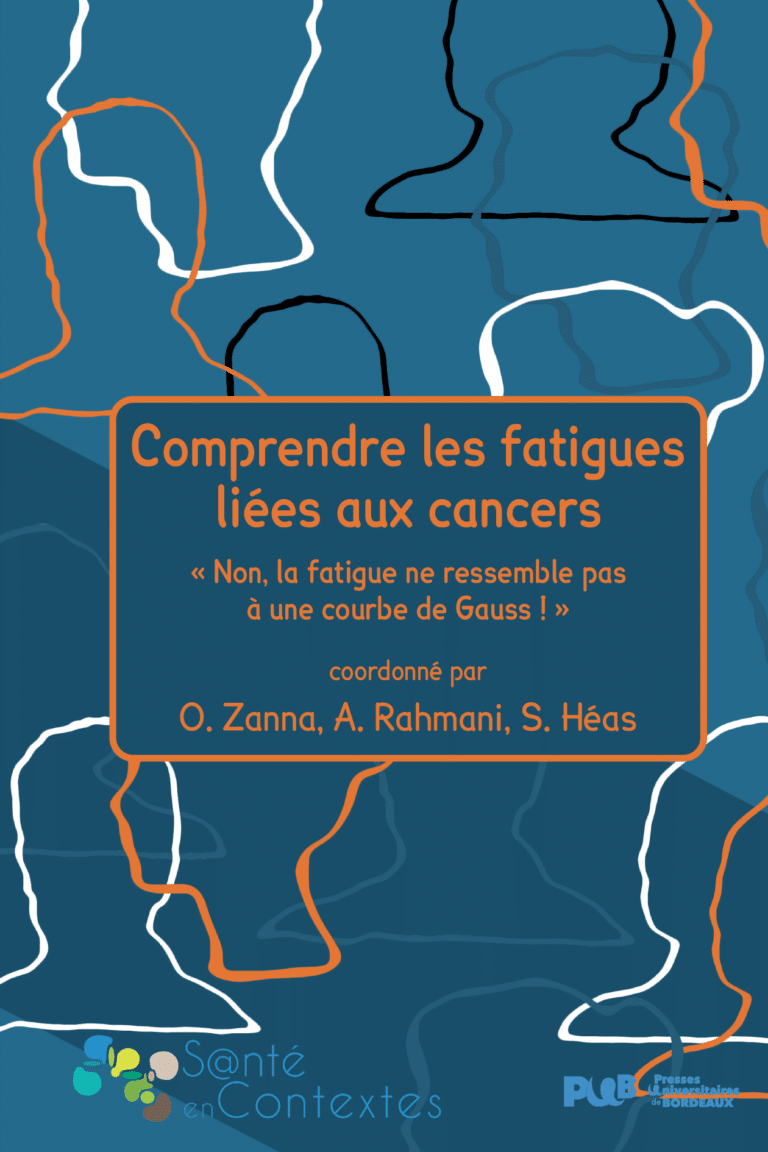Interlude N° 4
Patrice (61 ans) est suivi pour un cancer de la vessie depuis quatre mois. Entretien réalisé le 22 janvier 2020, lors de sa deuxième séance de chimiothérapie.
Oui, on est plus fatigable. Mais le paradoxe, c’est qu’on nous dit « c’est lorsque vous êtes fatigué qu’il faut aller chercher, entre guillemets, à vous faire mal ». Enfin, vous faire mal, aller au-delà. C’est parce que vous êtes fatigué qu’il faut que vous sortiez, qu’il faut que vous marchiez, qu’il faut que vous fassiez cela, parce que c’est ça qui vous permettra de combattre la fatigue, d’éliminer le produit parce que c’est quand même… C’est quand même un poison. Quand je vois les infirmières qui manipulent avec des gants, qu’elles font bien attention à ne pas y toucher, tu te dis… C’est quand même un sacré truc quoi. Donc il faut absolument que… voilà. Donc je vais bien voir la 2e. Je vais bien voir, demain, la semaine prochaine, comment ça se passe. Pour le sport adapté, ça met une obligation aussi. C’est important aussi. Parce que moi, si personne ne me pousse, c’est plus simple de rester dans le canapé quoi, si vous voulez, devant la télé… Et vous n’êtes pas mieux. Au final, vous n’êtes pas mieux. En fait ça n’a rien apporté de concret alors que si vous avez bougé, et que vous êtes fatigué, bah à la limite vous allez dormir. Vous allez dormir parce qu’il y a une fatigue réelle et saine, et puis vous avez pris l’air. Et puis vous avez pensé à autre chose…
Le contexte
Ces dernières années, des études observationnelles ont montré que la pratique d’activité physique avant et après le diagnostic d’un cancer est associée à une diminution du risque de décès (Friedenreich et al., 2019). De nombreux bénéfices de l’exercice physique ont également été rapportés pendant les traitements du cancer, notamment l’amélioration de la qualité de vie, la diminution des effets secondaires des traitements et l’amélioration de la fonction cardiovasculaire (Expertise Inserm, 2019). Outre ces bénéfices, des études préliminaires ont montré que l’exercice physique peut également avoir des effets bénéfiques sur la tumeur et son environnement, en réduisant l’inflammation chronique et en améliorant l’efficacité des traitements anticancéreux. Bien que cette recherche soit encore à ses débuts, elle offre un nouvel éclairage sur l’importance de l’exercice dans la prévention et le traitement du cancer, et ouvre des perspectives passionnantes pour la recherche (Moore et al., 2016). Si les mécanismes restent à préciser, trois principales voies d’action ont été proposées pour expliquer les effets bénéfiques pour les patients atteints de cancer : (I) des effets directs sur la croissance de la tumeur et les métastases, (II) une amélioration des taux de réalisation des traitements, (III) et une amélioration de l’efficacité de certains traitements du cancer (Yang et al., 2021). À ce sujet, des études montrent sur des modèles animaux (souris et rats) que l’exercice physique diminue la croissance (Hojman et al., 2017). Une des clés résiderait dans la façon dont l’exercice modifie l’environnement de la tumeur. Une méta-analyse a en effet rapporté que l’exercice physique inhiberait l’initiation et la prolifération tumorale, participant à une diminution du processus métastatique (Ashcraft et al., 2016). Pour mieux comprendre ces résultats, examiner l’impact de l’exercice physique aux niveaux du microenvironnement et de la tumeur s’impose. La compréhension de ces mécanismes pourrait faire progresser notre compréhension de l’effet de l’exercice sur la biologie du cancer et contribuer au développement de nouvelles approches préventives. Le but de ce chapitre est de proposer un focus sur les effets bénéfiques de l’interaction entre l’exercice, la tumeur et les traitements. Ce chapitre s’appuiera sur la présentation du projet ERICA (Exercise inteRaction Immunotherapy Chemotherapy cAncer), qui illustrera notre propos. Tout au long de cet article, nous utiliserons les termes « activité physique » (AP) et « exercice physique ». Pour clarifier ces concepts, nous adoptons les définitions suivantes : l’AP se réfère à « tout mouvement corporel résultant de la contraction des muscles squelettiques, entraînant une dépense d’énergie » et elle est corrélée positivement à la condition physique. L’exercice, quant à lui, se définit comme un « mouvement corporel planifié, structuré et répétitif, ayant pour but d’améliorer ou de maintenir la condition physique ».
La tumeur et son microenvironnement
Le microenvironnement cellulaire est l’environnement immédiat entourant une cellule, un groupe de cellules, ou un tissu. Il participe à son développement mais aussi à son maintien architectural et fonctionnel. Le microenvironnement tumoral (MET) correspond à l’environnement dans lequel évoluent les cellules cancéreuses. Il est composé de différentes structures comme les vaisseaux sanguins et la matrice extracellulaire, mais également de différents types cellulaires comme les cellules immunitaires, endothéliales ou encore les fibroblastes. Il est dynamique et sa composition évolue au fur et à mesure de la cancérogenèse (développement du cancer). Le MET est un acteur crucial pour les cellules tumorales puisqu’il est capable d’agir à la fois sur leur développement (initiation, survie, croissance), leur progression et leur dissémination (métastases) (Abou-Zeid et al., 2013). Longtemps la plupart des travaux en cancérologie se sont concentrés sur les cellules cancéreuses, mais depuis les années 2000, le nombre d’études sur le MET a augmenté de façon exponentielle.
Au cours de leur développement, les cellules tumorales acquièrent diverses caractéristiques qui les distinguent des cellules normales. Les travaux de Hanahan et Weinberg (en 2001, 2011 et 2022) ont proposé un modèle pour comprendre les caractéristiques tumorales. Selon ce modèle, les tumeurs auraient quatorze caractéristiques fondamentales :
- Capacité de réplication infinie, qui stimule la croissance cellulaire et la multiplication anormale des cellules cancéreuses ;
- L’échappement à la réponse immunitaire, qui permet aux cellules cancéreuses d’éviter d’être détruites par le système immunitaire de l’hôte ;
- L’induction de l’angiogenèse, qui est la formation de nouveaux vaisseaux sanguins pour alimenter la tumeur en nutriments et en oxygène ;
- L’activation de l’invasion et de la formation de métastases, qui sont la capacité des cellules cancéreuses à envahir les tissus environnants et à se propager à d’autres parties du corps ;
- L’inhibition de l’apoptose, qui permet aux cellules cancéreuses de résister à la mort cellulaire programmée ;
- La prolifération cellulaire illimitée, qui est la capacité des cellules cancéreuses à se diviser de manière incontrôlable et à former des tumeurs ;
- L’ignorance des suppresseurs de croissance, qui permet aux cellules cancéreuses d’échapper aux signaux de contrôle de croissance et aux mécanismes de mort cellulaire qui maintiennent normalement la croissance cellulaire sous contrôle ;
- La reprogrammation métabolique, qui permet aux cellules cancéreuses de s’adapter à un environnement métabolique différent de celui des cellules normales et de favoriser leur croissance et leur survie ;
- L’instabilité génomique et la mutation, qui permettent aux cellules cancéreuses d’acquérir des mutations supplémentaires favorisant leur croissance et leur survie ;
- L’inflammation pro-tumorale, qui peut favoriser la croissance et la progression des tumeurs ;
- Capacité à débloquer la plasticité cellulaire (capacité à modifier son phénotype/ses caractéristiques), qui fait référence à la capacité à perturber les mécanismes qui permettent aux cellules tumorales de devenir plastiques, tout en exploitant la plasticité des cellules environnantes pour lutter contre la progression tumorale ;
- Lareprogrammation épigénétique non mutationnelle, processus par lequel les cellules cancéreuses peuvent modifier l’expression de leurs gènes sans changer leur séquence d’ADN leur permettant de s’adapter à différents environnements et de résister à diverses thérapies ;
- Microbiome polymorphe, les tumeurs abritent un écosystème de micro-organismes, notamment des bactéries, des virus et des champignons, qui peuvent affecter la réponse tumorale au traitement ;
- La présence de cellules sénescentes dans les tumeurs, peut induire une réponse immunitaire altérée qui permet aux cellules tumorales de se développer et de se propager.
En conclusion, la recherche en oncologie continue d’évoluer pour mieux comprendre les mécanismes de la progression du cancer. En intégrant de nouvelles caractéristiques dans les modèles existants, il est possible de voir se développer de nouvelles approches thérapeutiques pouvant potentiellement améliorer les résultats cliniques. Cependant, il reste encore beaucoup à apprendre sur ces caractéristiques et leur impact sur la progression du cancer, et de nouvelles recherches seront nécessaires pour approfondir notre compréhension et continuer à faire avancer le traitement du cancer.
Le rôle de l’exercice physique sur le microenvironnement tumoral
Comment l’exercice peut-il diminuer la croissance tumorale ?
La capacité de l’exercice physique à moduler les réseaux de signalisation intra-tumoraux et ainsi enrayer le développement et la croissance des tumeurs suscite de plus en plus d’intérêt (Seet-Lee et al., 2022). Ainsi le remodelage du MET se fait grâce aux adaptations physiologiques induites par l’exercice comprenant à la fois des effets physiques (augmentation du flux sanguin, contrainte de cisaillement sur le lit vasculaire, régulation du pH, production de chaleur et activation sympathique) et des effets endocriniens (hormones de stress, myokines et exosomes circulants), ayant tous deux le potentiel de réguler la progression et la biologie du cancer (Hawley et al., 2014). C’est ce que nous proposons d’aborder dans les lignes qui suivent.
Il est, tout d’abord, important de rappeler que contrairement aux tissus sains, dans lesquels les vaisseaux sanguins sont généralement parallèles, les vaisseaux sanguins situés dans les tumeurs ont une distribution non structurée. En effet, la majorité des tumeurs présentent une vascularisation tortueuse, caractérisée par des « shunts », et une faible densité de micro-vaisseaux. C’est pourquoi, une vascularisation tumorale aberrante entraîne des zones d’hypoxie (zones dépourvues en oxygène), une invasion, des métastases et une diminution de l’infiltration des leucocytes dans les tumeurs. Ces caractéristiques tumorales contribuent à la résistance aux traitements et à la diminution de l’espérance de vie des patients atteints de cancer. Ainsi l’angiogenèse tumorale (formation de nouveaux vaisseaux sanguins) et la normalisation vasculaire pour augmenter l’apport d’oxygène et de médicaments sont des cibles des thérapies antitumorales.
De plus en plus d’études précliniques montrent que l’exercice constitue un modulateur important de la vascularisation tumorale et de l’hypoxie, conduisant à une amélioration de la réponse à différents types de thérapies (Ashcraft et al., 2016). En effet, l’exercice semble entraîner une amélioration de la perfusion tumorale, une normalisation de la structure des vaisseaux sanguins, une diminution de l’hypoxie associée à la résistance thérapeutique et notamment de la chimiothérapie et de la radiothérapie. L’exercice aigu aérobie augmente le débit sanguin total dans les tissus actifs sains (par exemple, les muscles squelettiques en contraction) grâce à la combinaison de l’augmentation du débit cardiaque, de l’augmentation de la pression artérielle et de la vasodilatation des vaisseaux locaux, la vasoconstriction réduisant ou maintenant le débit sanguin dans les tissus inactifs. Ainsi, l’angiogenèse est un processus physiologique normal qui se produit dans des situations telles que la cicatrisation des plaies ou en réponse à un entraînement physique.
L’effet de l’exercice sur le remodelage de la vascularisation intratumorale est un sujet de recherche d’actualité et prometteur. Des études récentes suggèrent que l’exercice induirait une augmentation de la perfusion (apport de sang) de la tumeur par le biais d’une augmentation du débit sanguin total (McCullough et al., 2014). La densité vasculaire, i.e. le nombre de vaisseaux sanguins dans une zone donnée, est un facteur important dans la croissance et la progression tumorale. Les tumeurs ont besoin d’un apport sanguin suffisant pour se développer, et la densité vasculaire élevée est souvent associée à une tumeur plus agressive. Cependant, des études ont montré que l’exercice régulier peut réduire la densité vasculaire à l’intérieur de la tumeur, ce qui peut ralentir la croissance et la progression de la tumeur. Des séances répétées d’exercice aérobie provoquent des adaptations vasculaires dans les tissus sains ainsi que l’association de l’angiogenèse et de la diminution de la résistance permet d’augmenter le flux sanguin vers les tissus sains actifs. Récemment, il a été suggéré que ces effets s’appliquent également au sein des tumeurs, de sorte que l’entraînement aérobie puisse provoquer des adaptations induisant une modulation du flux sanguin tumoral par une augmentation de la densité des vaisseaux sanguins et une amélioration de l’organisation et de la fonction des vaisseaux de la tumeur (Wiggins et al., 2018). Ainsi, l’entraînement aérobie pourrait normaliser le MET et faciliter l’augmentation d’apport de sang et la réduction des zones d’hypoxie, ce qui entraînerait des effets bénéfiques sur la diminution de la progression du cancer et notamment en facilitant l’infiltration des traitements de chimiothérapie ou encore des cellules immunitaires antitumorales. En somme, l’exercice apparaît être un modulateur important de la vascularisation tumorale et de l’hypoxie, conduisant à une réponse potentialisée à différents types de thérapies.
Dans une récente revue narrative, des auteurs allèguent l’usage de l’exercice physique comme une plus-value au traitement par radiothérapie (Schumacher et al., 2020). En témoigne la figure 1 qui montre bien la physiologie potentielle de la tumeur au repos et pendant l’exercice. Ainsi, l’exercice aigu augmente le débit sanguin de la tumeur et la résistance vasculaire de la tumeur est réduite. De plus, l’exercice participe à l’augmentation de la pression de perfusion de la tumeur et résulte de l’augmentation du débit sanguin de la tumeur pouvant conduire à une plus grande distance de diffusion de l’oxygène (O2) et donc réduire les zones tumorales hypoxiques limitées par la diffusion. Enfin, le système vasculaire de la tumeur est dysfonctionnel et structurellement anormal, ce qui entraîne un débit sanguin hétérogène et variable de la tumeur. L‘exercice pourrait augmenter la zone de perfusion de la tumeur ; il réduit donc l‘hypoxie limitée à la perfusion (Fig. 1).

Il est également important de noter que l’exercice peut augmenter le flux sanguin dans les vaisseaux environnants. Cela aide à améliorer l’apport en oxygène et en nutriments à la tumeur. Mieux vascularisée, les traitements sont plus efficients dans la mesure où les médicaments de chimiothérapie, par exemple, atteignent plus facilement toutes les cellules tumorales. En augmentant le flux sanguin, l’exercice aide à réduire cette résistance et rend ainsi la tumeur plus sensible à la thérapie. Il est toutefois important de noter que les effets de l’exercice sur la vascularisation intratumorale dépendent de nombreux facteurs individuels, comme la taille, le type de la tumeur ainsi que du type et de la durée de l’exercice.
Tout compte fait, l’exercice régulier a un effet positif sur le remodelage de la vascularisation intratumorale. Il ralentit la croissance et la progression tumorale et rend la tumeur plus sensible à la thérapie. Cela dit, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour, d’une part, mieux comprendre les mécanismes sous-jacents de ces effets et, d’autre part, afin de déterminer la meilleure façon d’intégrer l’exercice dans la prise en charge des patients atteints de cancer.
Modulation du système immunitaire par l’exercice
Il est désormais acquis que l’exercice physique est un puissant stimulant du système immunitaire (Simpson et al., 2015). Il active en effet divers mécanismes physiologiques conduisant à des modifications du nombre et de la fonction des cellules de l’immunité innée et adaptative. Ces mécanismes comprennent le stress oxydatif, la modification du métabolisme et la libération accrue de catécholamines, de cortisol et de facteur de croissance analogue à l’insuline. Prenons l’exemple des neutrophiles, un type de globule blanc responsable des réactions de défense de l’organisme. Un exercice physique aigu de courte durée produit une augmentation rapide et considérable, mais transitoire, du nombre de neutrophiles dans le sang périphérique immédiatement après l’exercice. Cette première augmentation peut être suivie d’une seconde vague d’augmentation du nombre de neutrophiles après plusieurs heures, eu égard à l’intensité et de la durée de l’exercice (Alack et al., 2019). L’augmentation initiale des neutrophiles est la conséquence de la libération des cellules du pool marginal (cellules collées à la paroi des vaisseaux), tandis que la seconde augmentation est due à l’influence du cortisol libéré à l’exercice sur la moelle osseuse. L’effet transitoire de l’exercice sur la fonction des neutrophiles peut être double : la dégranulation (libération de molécules cytotoxiques), les propriétés phagocytaires (processus de digestion des cellules) et l’activité oxydative sont augmentées dans des conditions spontanées, mais peuvent être diminuées après un exercice aigu. D’autres types cellulaires sont impactés par l’exercice comme les cellules Natural Killer (NK : cellules tueuses naturelles) dont les niveaux circulants augmentent drastiquement (∼10 fois plus) et les cellules T dont le nombre augmente également (∼2,5 fois plus). La mobilisation des cellules B est, quant à elle, plus modérée dans la circulation (Gleeson et al., 2004). Comme le montre le tableau 1, d’autres types de cellules du système immunitaire peuvent également être modulés par l’exercice. Il convient donc de noter que cette mobilisation immunitaire est proportionnelle à l’intensité et à la durée de l’exercice.
| Cellules | Type d’exercice | Nature de l’influence | Références |
| Neutrophiles | Aigu | augmentation biphasique et transitoire dans le sang périphérique. 1ère augmentation du nombre de neutrophiles circulants. 2ème augmentation transitoire des fonctions de dégranulation, les propriétés phagocytaires et l’activité oxydative | Walsh, 2020, Wang, 2020 |
| Neutrophiles | Chronique | Pas d’effet | Wang, 2020 |
| Monocytes | Aigu | augmentation transitoire (~2h) : passage du pool marginal au pool circulant Mobilisation préférentielle des CD14+ / CD16+ par rapport aux monocytes CD14+CD16- En phase de récupération : diminution de la proportion de Walsh,2020 monocytes CD14+ / CD16+ Diminution de l’expression de TLR1, TLR2 et TLR4 | Simpson, 2009 |
| Monocytes | Chronique | Diminution du nombre de monocytes inflammatoires (CD14lowCD16*) | Kurowski, 2022 |
| Macrophages | Chronique | Différenciation en phénotype anti-inflammatoire M2 | |
| Cellules dendritiques | Algu | Augmentation de la production de DC dérivées de monocytes en culture | |
| Cellules NK Aigu | Rapidement mobilisées dans la circulation sanguine périphérique Les cellules NK CD56dmCD16 cytotoxiques préférentiellement mobilisées | Rumpf, 2021, Bigley, 2014 | |
| Cellules NK | Chronique | Augmentation de la mobilisation des cellules NK et une toxicité des cellules NK accrue chez des athlètes par rapport à des sujets sédentaires Pas d’effet de l’entraînement sur la cytotoxicité Résultats hétérogènes | Rumpf, 2021 |
En somme, l’exercice a un effet significatif sur la régulation du système immunitaire. Aigu, il induit une leucocytose dépendante de l’intensité, suivie d’une redistribution des cellules effectrices dans les tissus périphériques. L’exercice aigu de courte durée ou d’intensité modérée, ainsi que l’entraînement régulier, sont principalement « immunorenforçateurs ». À cet égard, l’exercice modifie positivement la composition du compartiment des lymphocytes T et la fonction de diverses sous-populations de leucocytes. Régulier et d’intensité modérée, il exerce également des effets immunorégulateurs. À tout bien considérer, l’exercice s’apparente à un précieux viatique pour les thérapies classiques impliquant le système immunitaire. Il a d’ailleurs été récemment considéré que l’immunomodulation liée à l’exercice constituerait un mécanisme sous-jacent aux effets de l’exercice sur le risque et la progression du cancer (Emery et al., 2022).
La régulation par l’exercice de l’environnement immunitaire de la tumeur
Comme précisé supra, les tumeurs sont capables d’échapper à la surveillance immunitaire grâce à des mécanismes permettant de réduire l’infiltration des cellules immunitaires. Si les mécanismes à l’origine des effets antitumoraux de l’exercice ne sont pas encore clairs, des études in vivo s’intéressent aux liens entre le microenvironnement immunitaire et l’exercice physique (Pedersen et al., 2016 ; Rundqvist et al., 2013 ; Spiliopoulou et al., 2021). Elles montrent, entre autres, que l’infiltration de certaines cellules immunitaires au sein du MET représente une valeur de bon pronostic pour les patients. Cependant, l’infiltration des cellules immunitaires dans le tissu tumoral est affectée par l’hypoxie. Par conséquent, l’augmentation de la perfusion tumorale et la diminution de l’hypoxie induites par l’exercice physique (évoquées plus haut) sont susceptibles d’améliorer l’accessibilité des cellules immunitaires au tissu tumoral (Zhang et al.). Des études précliniques ultérieures ont montré que l’exercice physique ou l’activité physique chez des rongeurs porteurs de tumeurs pouvait augmenter la fréquence et la cytotoxicité des cellules NK systémiques in vitro (Pedersen and Hoffman-Goetz). Plus récemment, il a été démontré que la course volontaire sur roue d’activité ralentissait la croissance tumorale dans divers types de cancer par le biais d’une mobilisation des cellules NK et d’une infiltration intra-tumorale dépendantes de l’épinéphrine et de l’IL-6 (Pedersen et al.). Ces auteurs ont constaté que l’exercice physique augmentait les niveaux de chimiokines attractives pour l’immunité et des ligands du récepteur activant les cellules NK permettant de rediriger les cellules immunitaires cytotoxiques vers la tumeur.
D’autre part, les effets locaux et systémiques de l’exercice contribuent à améliorer l’infiltration des cellules T dans les tumeurs. Les cellules immunitaires mobilisées dans le sang pendant et après l’exercice présentent un grand potentiel cytotoxique. En effet, l’augmentation des cellules effectrices cytotoxiques après un exercice aigu sous-tend une augmentation de la cytotoxicité anticancéreuse in vitro dans des échantillons humains (REF). Dans l’étude récente de Rundqvist et al. (2020), le taux de croissance du mélanome B16 était supprimé chez les souris sédentaires qui avaient reçu des lymphocytes T CD8+ de souris entraînées, par rapport aux souris sédentaires auxquelles on avait greffé des cellules T CD8+ de souris non entraînées. Dans la littérature, d’autres effets de l’exercice sur la régulation de l’environnement de la tumeur ont été cités comme l’effet de l’exercice sur la modification de la présence d’inhibiteurs métaboliques des cellules T dans le microenvironnement tumoral, l’effet de l’exercice sur la modification de la présence d’inhibiteurs inflammatoires des cellules T dans le microenvironnement tumoral, l’effet de l’exercice sur la suppression des lymphocytes T régulateur ayant le potentiel d’induire une immunosuppression.
En somme, l’effet de l’activité physique sur la diminution de la croissance tumorale observée dans des études précliniques semble être médié par l’augmentation de la compétence des lymphocytes T pour promouvoir l’élimination des cellules cancéreuses. Plusieurs pistes confirment l’effet de l’exercice aigu sur l’augmentation de la redistribution et l’infiltration des cellules T CD8+, ainsi que d’autres sous-ensembles de cellules T, vers les sites tissulaires abritant des antigènes (Emery et al.et al., 2022). Par ailleurs, l’exercice régulier peut modifier l’expression des points de contrôle immunitaires, en supprimant de manière préférentielle le développement des cellules T CD4+ TREG dans les sites tissulaires abritant des antigènes tumoraux, en évitant ainsi l’anergie des cellules T et conduisant à des réponses effectrices plus robustes contre les cellules cancéreuses. Il peut également inverser l’épuisement des cellules T CD8+ et modifier la présence de médiateurs inflammatoires dans le microenvironnement tumoral conduisant ainsi à diminuer l’immunosuppression intra-tumorale afin d’améliorer la destruction des cellules cancéreuses par les cellules T. Enfin, l’exercice physique est susceptible de modifier les inhibiteurs métaboliques de l’activité des lymphocytes T dans le microenvironnement tumoral en réduisant l’accumulation de lactate, l’acidose et l’hypoxie qui proviennent des cellules tumorales elles-mêmes. En somme, l’activité physique semble améliorer les réponses immunitaires innées et adaptatives au cancer et cela s’observe systématiquement, mais aussi directement dans le tissu tumoral. Elle ralentit la progression tumorale et améliore la réponse au traitement. Mais d’autres sont nécessaires pour mieux comprendre les mécanismes sous-jacents de cet effet et pour déterminer les modalités d’exercice les plus efficaces pour différents types de cancer.
Implications pour la recherche future
Bien que les recherches actuelles suggèrent que l’exercice physique peut avoir des effets bénéfiques sur le microenvironnement tumoral, il reste encore beaucoup à découvrir sur les mécanismes sous-jacents et les effets à long terme de l’exercice chez les patients atteints de cancer. De nouvelles perspectives de recherche pourraient inclure l’examen de l’impact de différents types d’exercice (par exemple, l’entraînement en résistance versus l’entraînement cardiovasculaire) sur le microenvironnement tumoral, ainsi que l’effet de la durée et de l’intensité de l’exercice sur la santé des patients atteints de cancer. Il pourrait également être intéressant d’explorer les moyens d’encourager les patients atteints de cancer à adopter un mode de vie plus actif, ainsi que les mécanismes qui sous-tendent les changements de comportement. En outre, il est possible que les combinaisons d’exercice et de thérapies conventionnelles, telles que la chimiothérapie et la radiothérapie, puissent être plus efficaces que l’une ou l’autre méthode seule. Ces perspectives de recherche pourraient aider à mieux comprendre comment l’exercice peut être utilisé pour améliorer la santé des patients atteints de cancer et optimiser leur traitement.
L’exemple de l’étude ERICA (Exercise inteReaction Immunotherapy Chemotherapy and cAncer) pour les patients atteints d’un cancer du poumon
Liste des abréviations utilisées dans le projet ERICA :
- AP : Activité Physique
- CTRL : Contrôle
- ERICA : Exercise inteReaction Immunotherapy Chemotherapy and cAncer
- EXE : Exercice
- IL-6 : Interleukine-6
- MET : Microenvironnement tumoral
- NK : Natural Killer
- TRT : Traitement

L’étude ERICA a pour objectif de tester la faisabilité de l’exercice physique juste avant l’administration d’une combinaison de l’immunothérapie et de la chimiothérapie chez des patients atteints de cancer du poumon métastatique (Gouez et al. 2022).
Les patients atteints d’un cancer du poumon métastatique souffrent de nombreux symptômes liés à la maladie et au traitement, qui peuvent encore aggraver l’état global du patient. Comme il a été décrit plus haut, en plus de ses avantages sur la qualité de vie et la fatigue, l’exercice physique peut améliorer la réponse au traitement, notamment en raison de ses effets connus sur le système immunitaire. Seules deux études ont évalué la faisabilité d’exercices physiques de faible intensité réalisés pendant la perfusion de chimiothérapie et ont conclu que l’intervention était sans effets indésirables, sans interférence avec la chimiothérapie ou sans exacerbation des symptômes (Thomas et al., 2020). Récemment, des études précliniques ont suggéré que l’exercice physique pratiqué pendant la perfusion de chimiothérapie pouvait améliorer la perfusion des tumeurs solides, atténuer l’hypoxie tumorale et améliorer l’administration des médicaments au sein de la tumeur (McCullough et al., 2014). Sur la base de ces résultats, l’objectif principal du projet ERICA est d’évaluer la faisabilité d’un exercice physique aigu supervisé réalisé immédiatement avant la perfusion d’immunothérapie et de chimiothérapie dans le traitement de première intention des patients atteints de cancer du poumon métastatique et d’évaluer si cette dose d’exercice planifiée est sûre et tolérable dans cette population cible de patients. Les objectifs secondaires sont d’évaluer les effets de l’exercice aigu supervisé avant l’administration du traitement de première ligne, combiné à un programme de marche à domicile non supervisé, sur (1) la condition physique, (2) le niveau d’activité physique et le mode de vie sédentaire, (3) les facteurs psychosociaux (qualité de vie et fatigue), (4) la qualité du sommeil, (5) la composition corporelle, (6) la sarcopénie, (7) la réponse au traitement, (8) le taux d’achèvement du traitement, (9) les toxicités liées au traitement et (10) la survie sans progression de la maladie. En outre, cette étude de faisabilité fournira des données sur l’effet de cette intervention physique sur les biomarqueurs immunitaires, métaboliques et inflammatoires ainsi que sur le stress oxydatif.
Les patients sont randomisés en deux groupes (ratio 2 :1) : groupe « exercice » et groupe « contrôle » (fig. 3). Pour le groupe « exercice », l’intervention consiste à réaliser un exercice physique aigu pré-administration de l’immunothérapie et de la chimiothérapie sur ergocycle pour chacune des quatre cures prévues par le protocole de soin habituel. L’exercice physique a lieu directement au sein du service d’hospitalisation conventionnel du Centre Leon Bérard de Lyon. L’exercice physique est réalisé juste avant (moins de 30 minutes) l’administration de l’immunothérapie et de la chimiothérapie. L’exercice de type intermittent (alternance de périodes à intensité basse et à intensité moyenne dure 35 minutes. Il est individualisé à partir des résultats obtenus par le patient lors du test d’endurance sur cyclo-ergomètre à l’inclusion. L’intensité de l’exercice est programmée en fonction de la puissance (W) atteinte au Seuil Ventilatoire 1 (SV1) lors du test d’endurance sur ergocycle. Le SV1 correspond à un effort d’intensité modérée (essoufflement modéré). L’exercice est composé de 5 minutes d’échauffement au minimum à 60 % du Seuil Ventilatoire 1 (SV1) suivi de cinq blocs alternant des périodes de 3 minutes à 70 % du SV1 avec 3 minutes à 120 % du SV1. Les patients bénéficient également d’un programme de marche à domicile basé sur une prescription d’un nombre de pas à réaliser. L’objectif du programme de marche à domicile est d’amener le patient à réaliser 6 000 pas par jour et sera mesuré par un bracelet connecté et un carnet de recueil de pas fournis lors des évaluations T0. Le programme de marche a pour but de maintenir voire d’augmenter le niveau d’activité physique afin que les patients puissent réaliser l’intervention aiguë pré-administration de l’immuno-chimiothérapie. Des prélèvements sanguins ont lieu avant et après l’exercice physique lors de la première et la dernière cure de traitement. Les patients du groupe « contrôle » bénéficient de recommandations en activité physique et en nutrition ainsi que des soins habituels de la prise en charge d’un cancer bronchique non à petites cellules (CBNPC) métastatique au Centre Léon Bérard.
Cette étude a été développée au sein du département Prévention cancer environnement du Centre de lutte contre le cancer Léon Bérard à Lyon, en collaboration avec l’équipe Athérosclérose Thrombose et Activité Physique du Laboratoire Interuniversitaire de Biologie de la Motricité (LIBM). Le protocole de l’étude a été approuvé par le Comité de protection des personnes Île de France II (N°ID-RCB 20.09.04.65226, 8 décembre 2020) et l’étude a été déclarée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL ; numéro de référence : 1994192). L’étude est enregistrée sur ClinicalTrials.gov (NCT04676009). Au total, vingt-six patients ont été inclus dans ERICA. L’étude a montré que la réalisation d’un exercice physique avant la perfusion des traitements est faisable chez des patients atteints d’un cancer du poumon métastatique (adhésion de 91 %), sous réserve d’ajustements en termes d’intensité et de durée de l’effort pour certains d’entre eux. Durant les trois mois du programme, les participants du groupe « exercice » ont marché en moyenne 8 550 pas par jour. Bien que cette étude de faisabilité n’ait pas permis d’améliorer significativement les capacités physiques des participants, une tendance à l’amélioration de leur qualité de vie ainsi qu’à une diminution de leur fatigue a été observée. Il s’agit de la première étude à démontrer qu’une séance d’exercice de pédalage dans l’heure précédant l’administration d’une immunochimiothérapie en hôpital de jour est faisable et sans danger pour les patients atteints d’un cancer du poumon métastatique. L’étude ancillaire ERICA-bio évaluera les effets de cet exercice aigu sur la modulation des cellules immunitaires.
Une étude préclinique parallèle à l’étude ERICA
D’autre part, une étude préclinique sur modèle murin de cancer colorectal agressif et traité par anti-PD1 (immunothérapie) et deux agents de chimiothérapie menée par les équipes du Centre Léon Bérard de Lyon et du LIBM (Lyon) a pour objectif d’évaluer l’effet de l’exercice sur tapis de course juste avant l’administration d’un anti-PD1 combiné à de la chimiothérapie sur la croissance de la tumeur, l’infiltration immunitaire et l’hypoxie intratumorale (Gouez et al., 2024).
Brièvement, des cellules MC38 ont été injectées à des souris C57BL6 en sous-cutané au niveau du flanc droit. Le volume de la tumeur a été mesuré tous les deux jours à l’aide d’un pied à coulisse. Les souris ont été randomisées en quatre groupes : groupe contrôle (CTRL, n = 20), traitement par immunochimiothérapie (TRT, n = 20), exercice seul (n = 20) et exercice et traitement combinés (TRT+EXE, n = 20). Au total, 80 souris ont été utilisées dans le cadre de cette étude. Pendant l’intervention, les souris incluses dans les groupes EXE et EXE+TRT ont effectué un exercice de 50 min à intensité modérée sur tapis de course cinq jours/semaine pendant trois semaines juste avant de recevoir un traitement d’immunochimiothérapie, identique au TRT pour le groupe EXE+TRT. L’exercice est réalisé dans l’heure précédant l’injection du traitement, pour le groupe EXE+TRT, ou placebo (NaCl 0,9 %) pour les groupes CTRL et EXE. Le protocole de traitement a été validé pour les souris MC38 (Grasselly et al.et al.) et est composé de capécitabine (250mg/kg, per os) cinq jours/semaine et d’oxaliplatine (5 mg/kg, intrapéritonéal) couplé à un anti-PD1 (12,5 mg/kg, intrapéritonéal) 1 jour/semaine. Deux points d’intérêt ont été définis dans ce projet (fig. 3) : un à J4 (n = 6 souris/groupe) pour étudier le contenu immunitaire intra-tumoral par immunohistochimie et un à J30 (n = 14 souris/groupe) où l’effet de chaque intervention sur la croissance tumorale (volume, vascularisation, contenu immunitaire) a été évalué (Fig. 3).

Les données sont en cours d’analyse mais il semblerait que les résultats aillent en faveur d’une diminution de la croissance tumorale en associant de la course sur tapis aux traitements par immunochimiothérapie (anti-PD1 + sels de platine). Une dernière expérimentation est en cours afin de confirmer ce résultat. Bien que ces résultats ne soient pas transposables à l’étude ERICA, les résultats participent au besoin de compréhension des mécanismes sous-jacents de l’effet de l’exercice sur la tumeur et son microenvironnement tumoral.
Conclusion
L’effet direct de l’exercice physique sur la tumeur est un domaine de recherche émergeant qui suscite de plus en plus d’intérêt de la part des physiologistes et des cliniciens. Les études suggèrent que l’exercice peut réduire la croissance tumorale en affectant directement les cellules cancéreuses, en remodelant le microenvironnement tumoral et en activant le système immunitaire. Cependant, il reste encore beaucoup à apprendre sur les mécanismes exacts de cet effet et sur la manière de l’appliquer de manière optimale dans la pratique clinique. De plus, il est important de souligner que l’exercice ne doit pas être considéré comme un traitement unique pour le cancer, mais plutôt comme une plus-value aux traitements conventionnels tels que la chimiothérapie et la radiothérapie. Les recherches futures devraient se concentrer sur la compréhension plus approfondie des mécanismes de l’effet direct de l’exercice sur la tumeur, ainsi que sur la mise en œuvre d’études cliniques rigoureuses pour déterminer les meilleures pratiques en termes de dose et de durée d’exercice pour les patients en traitement pour leur cancer. En fin de compte, l’exercice physique peut être un outil puissant dans la lutte contre le cancer et améliorer la qualité de vie liée à la santé des patients, mais des recherches supplémentaires sont nécessaires pour en tirer pleinement parti.
Bibliographie
Abou-Zeid, N., David-Basei, C., Bourougaa, K., Atger, V., Calvo, F. (2013). Rôle du microenvironnement dans la tumorigenèse et la progression tumorale. p. 96.
Alack, K, Pilat, C., Krüger, K., (2019) « Current Knowledge and New Challenges in Exercise Immunology ». Deutsche Zeitschrift Für Sportmedizin, 70(10), 250-260. [En ligne :]DOI.org (Crossref). https://doi.org/10.5960/dzsm.2019.391.
Ashcraft, K. A., Peace, R., Betof, A., Dewhirst, MW., Jones, L. (2016). « Efficacy and Mechanisms of Aerobic Exercise on Cancer Initiation, Progression, and Metastasis: A Critical Systematic Review of Preclinical Data ». Cancer Research, 76(14), 4032-4050. DOI.org (Crossref). [en ligne] https://doi.org/10.1158/0008-5472.CAN-16-0887.
Emery, A., Moore, S., Turner, J. E., Campbell, J. P. (2022). « Reframing How Physical Activity Reduces The Incidence of Clinically-Diagnosed Cancers: Appraising Exercise-Induced Immuno-Modulation As An Integral Mechanism ». Frontiers in Oncology, 12, 1-30. PubMed. [en ligne] https://doi.org/10.3389/fonc.2022.788113.
Friedenreich, C. M., Stone C. R, Cheung W. Y., Hayes S. C. (2019). « Physical Activity and Mortality in Cancer Survivors: A Systematic Review and Meta-Analysis ». JNCI Cancer Spectrum, 4(1), 4766-4775. PubMed Central. [en ligne] https://doi.org/10.1093/jncics/pkz080.
Gleeson, M. (2004). «Immune Function and Exercise ». European Journal of Sport Science, 4(3), Sept., 52-66. DOI.org (Crossref). [en ligne] https://doi.org/10.1080/17461390400074304.
Gouez, M., Rébillard, A., Thomas, A., Beaumel, S., Matera, E.-L., Gouraud, E., Orfila, L., Martin, B., Pérol, O., Chaveroux, C., Chirico, E. N., Dumontet, C., Fervers, B., & Pialoux, V. (2024). « Combined effects of exercise and immuno-chemotherapy treatments on tumor growth in MC38 colorectal cancer-bearing mice ». Frontiers in Immunology, 15, 1368550. [en ligne] https://doi.org/10.3389/fimmu.2024.1368550.
Grasselly, C., Denis, M., Bourguignon, A., Talhi, N., Mathe, D., Tourette, A., Serre, L., Jordheim, L.P., Matera, E.L., Dumontet, C. (2018). « The Antitumor Activity of Combinations of Cytotoxic Chemotherapy and Immune Checkpoint Inhibitors Is Model-Dependent ». Frontiers in Immunology, (9), 2100. DOI.org (Crossref). [en ligne] https://doi.org/10.3389/fimmu.2018.02100.
Hanahan, D. (2022). « Hallmarks of Cancer : New Dimensions ». Cancer Discovery, 12(1), 31-46. cancerdiscovery.aacrjournals.org, https://doi.org/10.1158/2159-8290.CD-21-1059.
Hawley, J.A., Hargreaves, M., Joyner, M.J., Zierath, J.R. (2014). « Integrative Biology of Exercise. Cell, 159(4), 738-349. DOI.org (Crossref). [en ligne] https://doi.org/10.1016/j.cell.2014.10.029.
Hojman, P. (2017). « Exercise protects from cancer through regulation of immune function and inflammation », Biochemical Society Transactions, 45(4), 905-911. [en ligne] https://doi.org/10.1042/BST20160466
Institut national de la santé et de la recherche médicale. Expertise Inserm (2019). Activité Physique : Prévention et Traitement Des Maladies Chroniques. [en ligne] https://www.ipubli.inserm.fr/handle/10608/9689. Accessed 14 Feb. 2022.
Junttila, Melissa R., Frederic J. de Sauvage (2013). « Influence of Tumour Micro-Environment Heterogeneity on Therapeutic Response ». Nature, 501(7467), Sept., 346-354. DOI.org (Crossref). [en ligne] https://doi.org/10.1038/nature12626.
Koelwyn, G. J., Quail, D. F., Zhang, X., White, R. M., Jones, L. W. (2017). « Exercise-Dependent Regulation of the Tumour Microenvironment ». Nature Reviews Cancer, 17(10), 620-632. DOI.org (Crossref). [en ligne] https://doi.org/10.1038/nrc.2017.78.
McCullough, D.J., Stabley, J.N., Siemann, D.W., Behnke B.J. (2014). « Modulation of Blood Flow, Hypoxia, and Vascular Function in Orthotopic Prostate Tumors During Exercise ». JNCI Journal of the National Cancer Institute, 106(4). PubMed Central. [en ligne] https://doi.org/10.1093/jnci/dju036.
Moore, S. C., Lee, I. M., Weiderpass, E., Campbell, P. T., Sampson, J. N., Kitahara, C. M., Patel, A. V. (2016). « Leisure-Time Physical Activity and Risk of 26 Types of Cancer in 1.44 Million Adults ». JAMA Internal Medicine, 176(6), 816-825. PubMed Central. [en ligne] https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2016.1548.
Pedersen, Bente Klarlund, Hoffman-Goetz, L. (2000). « Exercise and the Immune System: Regulation, Integration, and Adaptation ». Physiological Reviews, 80(3), 1055-1081. DOI.org (Crossref). [en ligne] https://doi.org/10.1152/physrev.2000.80.3.1055.
Pedersen, L., Idorn, M., Olofsson, G.H., Lauenborg, B., Nookaew, I., Hansen, R.H., Johannesen, H.H., Becker, J.C., Pedersen, K.S., Dethlefsen, C., Nielsen, J., Gehl, J., Pedersen, B.K., Thor Straten, P., Hojman, P. (2016). « Voluntary Running Suppresses Tumor Growth through Epinephrine- and IL-6-Dependent NK Cell Mobilization and Redistribution ». Cell Metabolism, 23(3), Mar., 554-562. DOI.org (Crossref). [en ligne] https://doi.org/10.1016/j.cmet.2016.01.011.
Rundqvist, H., Augsten, M., Strömberg, A., Rullman, E., Mijwel, S., Kharaziha, P., Panaretakis, T., Gustafsson, T., Östman, A. (2013). « Effect of Acute Exercise on Prostate Cancer Cell Growth ». PLoS ONE, edited by Jean-Marc A. Lobaccaro, 8(7), p. e67579. DOI.org (Crossref). [en ligne] https://doi.org/10.1371/journal.pone.0067579.
Schumacher, O., Galvão, D.A., Taaffe, D.R., Chee, R., Spry, N., Newton, R.U. (2020). « Exercise Modulation of Tumour Perfusion and Hypoxia to Improve Radiotherapy Response in Prostate Cancer ». Prostate Cancer and Prostatic Diseases, 24(1), Mar., 1-14. PubMed. [en ligne] https://doi.org/10.1038/s41391-020-0245-z.
Seet-Lee, C. (2022). « The effect of aerobic exercise on tumour blood delivery : A systematic review and meta-analysis ». Supportive Care in Cancer, 17, 30(11), 8637-8653.
Simpson, R. J., Kunz, H., Agha, N., & Graff, R. (2015). « Exercise and the Regulation of Immune Functions ». In Progress in Molecular Biology and Translational Science, 135, 355-380. Elsevier. [en ligne] https://doi.org/10.1016/bs.pmbts.2015.08.001.
Spiliopoulou, P., Gavriatopoulou, M., Kastritis, E., Dimopoulos, M.A., Terzis G. (2021). « Exercise-Induced Changes in Tumor Growth via Tumor Immunity ». Sports (Basel, Switzerland), 9(4), PubMe. [en ligne] https://doi.org/10.3390/sports9040046.
Thomas V. J., Seet-Lee C., Marthick M., Cheema B. S., Boyer M., Edwards K. M. (2020) « Aerobic Exercise during Chemotherapy Infusion for Cancer Treatment: A Novel Randomised Crossover Safety and Feasibility Trial ». Supportive Care in Cancer, 28(2), 625-632. DOI.org (Crossref). [en ligne] https://doi.org/10.1007/s00520-019-04871-5.
Wiggins, J. M., Opoku-Acheampong, A. B., Baumfalk, D. R., Siemann, D. W., & Behnke, B. J. (2018). « Exercise and the Tumor Microenvironment : Potential Therapeutic Implications ». Exercise and Sport Sciences Reviews, 46(1), 56-64. DOI.org (Crossref). [en ligne] https://doi.org/10.1249/JES.0000000000000137.
Yang, L., Morielli, A. R., Heer, E., Kirkham, A. A., Cheung, W. Y., Usmani, N., Friedenreich, C. M., & Courneya, K. S. (2021). « Effects of Exercise on Cancer Treatment Efficacy : A Systematic Review of Preclinical and Clinical Studies ». Cancer Research, p. canres.1258.2021. DOI.org (Crossref). [en ligne] https://doi.org/10.1158/0008-5472.CAN-21-1258.
Zhang, X., Ashcraft, K. A., Betof Warner, A., Nair, S. K., & Dewhirst, M. W. (2019). « Can Exercise-Induced Modulation of the Tumor Physiologic Microenvironment Improve Antitumor Immunity ? ». Cancer Research, 79(10), 2447-2456. DOI.org (Crossref). [en ligne] https://doi.org/10.1158/0008-5472.CAN-18-2468.