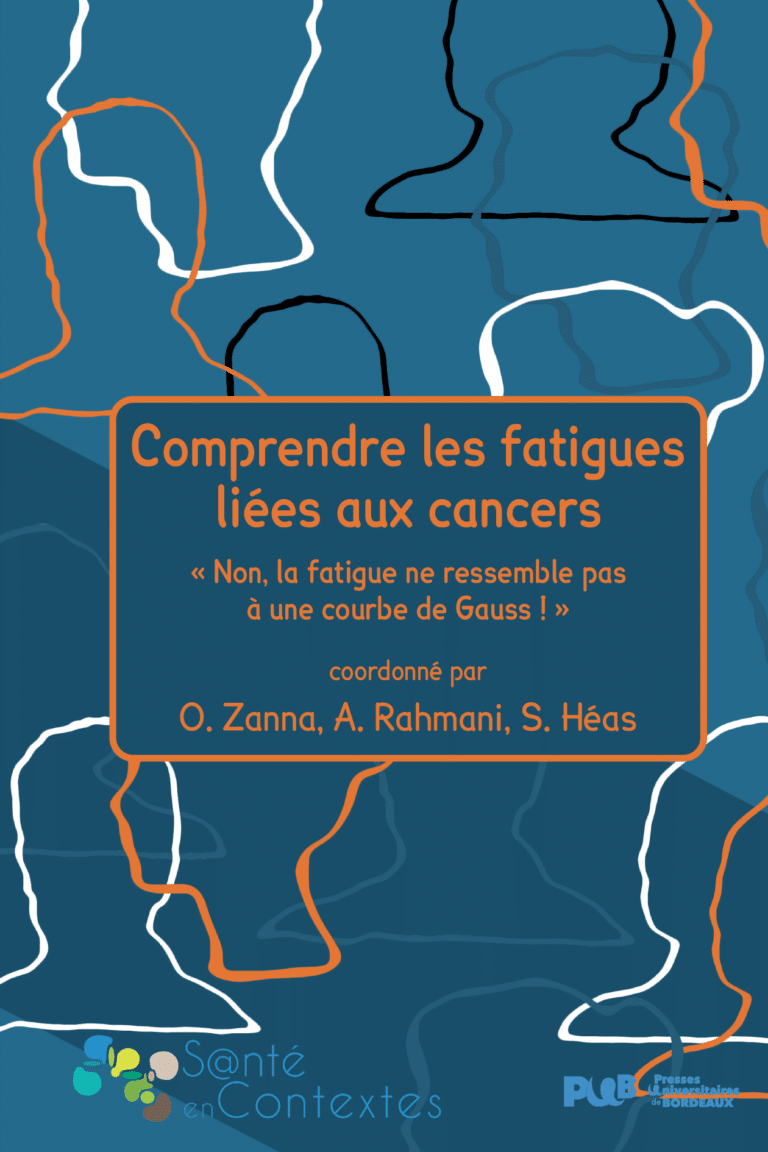Interlude N° 6
Béatrice (43 ans) est en rémission d’un cancer du sein. Entretien réalisé le 12 avril 2022.
Bah pendant tout le cancer, finalement, moi je suis resté un peu comme ça, à sourire à tout le monde, à dire « ça va », tant que je peux marcher, j’avance, il n’y a pas de souci et puis… Il y avait un truc aussi, c’est qu’extérieurement en fait j’ai gardé à peu près mes cheveux. Alors ça c’est hyper important les cheveux parce que les gens me regardaient et ils me disaient « bah ça va t’es pas très malade en fait, tu as encore tout tes cheveux ». Je me dis « mais ils n’y connaissent rien en fait, ils connaissent rien au cancer », et pendant très très longtemps j’avais des maux invisibles en fait, j’avais des neuropathologies, je n’arrivais pas à ouvrir une bouteille d’eau, c’était tellement dur pour moi de serrer les doigts que je n’arrivais pas à ouvrir une bouteille d’eau, les pots pour bébés, essorer une éponge, n’importe quoi, faire des trucs comme ça j’y arrivais pas. Sauf que, bah ce sont des choses que les gens ne voient pas, donc moi j’étais en pleine forme, et puis dès que je l’ouvrais un peu, que je disais que je n’arrivais pas à faire ça… Oh, c’est bon, t’es jeune… Mais ils ne comprennent pas en fait que ça m’a vraiment, physiquement, entamé. Dès que je montais un escalier, j’étais essoufflée. Et puis je me suis dis « mais je me plains pas assez ». Et les gens qui ne se plaignent pas assez, bah, on les entend pas, enfin, on les voit pas. On ne sait pas qu’ils ont mal et… Je ne voulais pas de toute façon que les gens sachent que j’ai mal et je n’avais pas… Je me disais, tant que c’est supportable, moi je trouvais ça abusé de me plaindre. Surtout que j’étais tellement reconnaissante d’être toujours là, tous les jours, tous les matins, je me réveillais en me disant « C’est génial, je suis là », donc je ne me voyais pas me plaindre. Et puis finalement bah les autres trouvaient tout le temps que j’abusais pour des petites choses. Je me suis dit qu’ils ne me comprenaient pas quoi. À force de ne pas me plaindre, en fait, vous n’avez pas compris que je souffrais physiquement, moralement, que c’était dur. Ce n’est pas parce que j’ai la banane tous les jours que le soir je ne suis pas en train de pleurer toute seule dans mon coin. Et même mon mari, il ne savait pas en fait. Il faisait des trucs, il ne comprenait pas que ça me faisait souffrir mais je disais rien. Maintenant, je me dis, il faut que je fasse un peu comme tout le monde, me plaindre tout le temps.
Introduction
La fatigue, comme nous la connaissons tous, est un état physiologique lié à une activité physique prolongée ou une tâche intellectuelle intense induisant des difficultés à poursuivre l’activité. Elle est généralement atténuée grâce à du repos ou une bonne nuit de sommeil simplement. La Fatigue Liée au Cancer (FLC), quant à elle, est nettement plus intense et handicapante. Elle est le principal effet secondaire du cancer ou de ces traitements. En 2018, environ 18 millions de nouveaux cas de cancer ont été enregistrés dans le monde. Ce nombre devrait atteindre, selon la littérature scientifique, plus de 29 millions en 2040 (Defossez, Guyader-Peyrou, & Uhry, 2019). Grâce aux progrès de la médecine, la mortalité par cancer est en constante diminution depuis 60 ans (Cowppli-Bony et al., 2019). De plus en plus de personnes vont donc vivre avec des effets secondaires du cancer et des traitements associés.
La FLC s’installe, bien souvent, dès le début des traitements, voire avant que le diagnostic ne soit posé. Elle peut, dans certains cas, se poursuivre – dans ce que l’on nomme l’« après cancer » – plusieurs années, voire décennies, après la fin des traitements. Cette fatigue singulière peut avoir un impact majeur sur la qualité de vie, englobant notamment les conséquences physiques, émotives et économiques importantes, chez le patient ou ancien patient. En effet, les personnes souffrant de FLC se sentent éprouvées mentalement et physiquement. Cette FLC est généralement décrite par les malades comme un épuisement accablant qui n’est pas soulagé par du repos.
Dans cette partie, après avoir défini la FLC et abordé ces principales dimensions, nous développerons les bénéfices et recommandations en lien avec la pratique d’une activité physique adaptée (APA) en cancérologie. En effet, combinée à une bonne alimentation, un soutien psychologique et une bonne gestion du stress, entre autres, elle va permettre d’aider le patient à ressentir plus d’énergie et à mieux composer avec la FLC qu’il ressent.
La fatigue liée au cancer, un mal fréquent
La FLC se définit comme une « sensation persistante d’épuisement physique, émotionnel et/ou cognitif dû au cancer et à ses traitements, qui n’est pas proportionnelle aux activités récentes et perturbe profondément la qualité de vie » (Berger et al., 2015). La prévalence de la FLC se situe entre 59 à 99 % (Weis, 2011), cela correspond au nombre de cas dans une population donnée, et peut varier en fonction de la localisation du cancer et du type de traitement. La majorité des personnes souffrant d’un cancer va être sujette à cette FLC. Cependant, elle reste peu rapportée spontanément par les patients auprès des professionnels de santé, d’une part, par méconnaissance des prises en charge possibles, mais aussi parfois par peur de se voir proposer des traitements médicamenteux supplémentaires.
A propos de FLC, rappelons qu’elle se distingue de trois manières de la fatigue « classique ». D’abord, elle n’est pas proportionnelle aux activités réalisées. Autrement dit, même si une personne atteinte d’un cancer essaye de limiter ses activités, elle n’est pas pour autant à l’abri de ressentir de la fatigue. Ensuite, à l’inverse de la fatigue classique, le repos ne permet pas de l’atténuer. Enfin, la FLC est une fatigue beaucoup plus intense que les autres. D’ailleurs les patients n’hésitent pas utiliser les termes suivants : « HS », « morts », « vidés », « épuisés », « anéantis », « KO », « crevés », « cassés », etc. La FLC impacte de façon durable le quotidien, en témoignent les propos de Christelle (48 ans) : « même trois ans après je ressens toujours cette fatigue ». Christine en rémission d’un cancer du sein, qui a repris son travail au moment de l’entretien depuis dix mois, confirme la permanence d’une fatigue accablante : « je ne suis plus comme avant » ; « je reste très fatigable au moindre effort » ; « mon compagnon me dit de me reposer, je le fais mais je n’ai pas retrouvé mes capacités d’avant le cancer »
Les différentes dimensions de la Fatigue Liées au Cancer
Tout comme la fatigue classique qui peut être associée à différents mécanismes comme une mauvaise nuit de sommeil, une journée chargée de travail ou une activité physique intense, la FLC peut être liée à différents mécanismes appartenant aux dimensions physique, biologique, émotionnelle, cognitive, sociale et comportementale.
Tout d’abord, la FLC peut se traduire par des perturbations de plusieurs capacités physiques telles que les capacités musculaires, cardiorespiratoires ou encore d’équilibre. L’ensemble de ces aptitudes physiques sont sensibles au déconditionnement, subséquent à toute période d’inactivité ou de comportement sédentaire. Ce manque d’activité est très fréquent chez les personnes atteintes d’un cancer, car elles ont tendance à augmenter les périodes de repos (ou sommeil), comme en témoigne Justin, 57 ans, en cours de chimiothérapie pour un cancer colorectal : « depuis que j’ai commencé la chimio je suis fatigué. Au début je me reposais, je restais un maximum au lit ou sur mon canapé, je me suis dit repose toi et ça va passer. Mais pas du tout c’était de pire en pire ».
Ensuite, la FLC a également une dimension biologique. En effet, il n’est pas rare qu’en cours de traitement, des perturbations biologiques engendrent de la fatigue, des phénomènes inflammatoires ou un affaiblissement du système immunitaire. Pour évaluer cette fatigue il est recommandé de réaliser un bilan biologique comprenant en général une numération formule sanguine (NFS) à la recherche d’une anémie (diminution du taux d’hémoglobine dans le sang), d’une éventuelle infection, une vitesse de sédimentation (VS), ou Protéine C réactive (CRP) pour évaluer la présence d’un état inflammatoire ou infectieux. Il est aussi recommandé de réaliser un dosage de la ferritine afin de rechercher un éventuel manque de fer, un bilan hépatique, une glycémie (taux de sucre dans le sang), le taux de créatinine et/ou clairance de la créatinine permettant de vérifier si votre rein fonctionne correctement ainsi qu’un bilan hormonal notamment thyroïdien par dosage de la TSH.
La troisième dimension de la FLC est émotionnelle et peut être reliée en partie à un « épuisement » émotionnel. La personne atteinte d’un cancer est susceptible de se demander ce qu’elle a fait de mal pour mériter cela. Un sentiment de culpabilité peut alors s’installer suite à l’annonce de la maladie. Vis-à-vis de sa famille et de ses amis, elle pense être devenue un fardeau, inutile, incapable de s’occuper d’une autre personne comme d’un enfant ou d’un parent âgé par exemple. À cela s’ajoute parfois une irritabilité au quotidien et une anhédonie, un manque d’émotions positives, de plaisir, dans des situations auparavant plaisantes. Un manque de motivation à s’engager dans des activités et une tendance à se laisser faire, se laisser porter et ne pas aller de l’avant peut apparaître. Les symptômes d’anxiété et de dépression sont très répandus chez les personnes atteintes d’un cancer et de nombreuses études scientifiques mettent en évidence un lien très fort entre ces derniers et la FLC (Bødtcher et al., 2015 ; Bower et al., 2011). Il semblerait que ces symptômes soient déterminants dans la présence de FLC dès le diagnostic de cancer et dans son maintien au cours des traitements (Bower et al., 2021).
La cognition, quatrième dimension de la FLC, est définie comme l’ensemble des processus mentaux qui se rapportent à la connaissance et au traitement des informations. Parmi eux, la mémoire, le langage, l’attention, les fonctions exécutives permettent de prendre une décision et les fonctions visuo-spatiales permettent de se projeter dans un autre environnement que celui qui nous entoure ou d’imaginer un objet absent. La cognition est impliquée dans la communication, le raisonnement, la perception, le jugement, l’apprentissage, l’organisation et la résolution de problèmes. Or, des troubles cognitifs peuvent entraîner des difficultés dans la vie courante (oublis ou difficultés à trouver ces mots par exemple) et également nuire à la prise de décision et la compréhension des décisions d’autres personnes. Dans certains cas, ils affectent le bien-être émotionnel.
Chez les patients atteints de cancer, et plus particulièrement chez ceux suivant un protocole de chimiothérapie, des perturbations cognitives faibles à modérées ont été observées. Ces perturbations sont visibles à travers différentes fonctions cognitives comme des troubles de la concentration, des difficultés à se rappeler des choses (Curt et al., 2000), ce qui suggère un effet sur la cognition en général et non sur une ou des fonctions en particulier. Plusieurs études ont montré que ces troubles sont parfois déjà présents au moment du diagnostic (environ 30 % des patients), se développent chez la grande majorité des patients au cours de la chimiothérapie (75 % des patients) et demeurent présents plusieurs années après la fin des traitements (chez 35 % des patients) (Janelsins et al., 2014).
La cinquième dimension concerne l’aspect social de la FLC, en partie dépendante de la manière avec laquelle le patient fait face et s’adapte à l’annonce du diagnostic et à la vie avec un cancer. Ces mécanismes d’adaptation psychologique sont appelés stratégies de coping. Chez les patients, on constate deux grandes stratégies opposées : la combativité ou la résiliation, le pessimisme. Dans le cas d’une tendance à la résiliation et au pessimisme, le soutien social des proches aura d’autant plus d’importance qu’un manque de soutien a été associé à des chances de guérison moins élevées et une FLC plus importante (Brownstein et al., 2021 ; Karakoç & Yurtsever, 2010). Le soutien social constitue un appui logistique dans la vie quotidienne (e.g., déplacements aux rendez-vous médicaux, préparation des repas, tâche ménagère, accompagnement des enfants à l’école). Plus le réseau social (sociabilités entretenues par une personne avec sa famille, ses amis ou ses collègues) est développé, plus le soutien pourra être élevé. Il est normal d’observer une diminution ou l’arrêt des activités professionnelles et de loisir après le diagnostic et pendant les traitements. Les relations familiales ou amicales apparaissent donc primordiales pour éviter l’isolement.
Enfin, la dernière dimension de la FLC est la fatigue comportementale. La FLC et les autres effets néfastes de la maladie et des traitements entraînent des modifications du comportement des patients en termes de nutrition, d’activités physiques et de sommeil. En effet, l’arrêt des activités professionnelles lié au cancer modifie la répartition des activités quotidiennes, le temps consacré aux autres activités (loisirs, tâches quotidiennes, repos) devient alors plus important. En parallèle, les patients atteints de cancer vont diminuer l’intensité des activités qu’ils réalisent, les activités physiques modérées à intenses vont être amenées à disparaître et les tâches « exigeantes » de la vie quotidienne (porter les courses, tondre la pelouse) vont être fractionnées si ce n’est évitées (Veni et al., 2019). Les activités de faible intensité et le repos vont donc être privilégiées favorisant l’apparition d’un comportement inactif et sédentaire.
De plus, ces modifications des périodes d’activités vont créer un déséquilibre des cycles veille-sommeil et faciliter l’apparition de troubles du sommeil. Touchant jusqu’à 70 % des personnes atteintes d’un cancer, les troubles du sommeil peuvent apparaître dès le diagnostic et persister plusieurs années après la rémission (Davis & Goforth, 2014). Ils sont associés à la FLC depuis de nombreuses années.
Un autre paramètre comportemental de la FLC peut renforcer certains paramètres physiques telle la diminution de la masse musculaire. Il s’agit de la malnutrition, qui en fonction de la localisation du cancer et du type de traitement reçu, intervient chez 30 et 60 % des patients (Martin et al., 2019). D’après l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la malnutrition se définit par les carences, les excès ou les déséquilibres dans les apports énergétiques et/ou nutritionnels d’une personne. Dans le cadre du cancer, la malnutrition impacte non seulement la qualité de vie, mais peut aussi diminuer le taux de survie en affectant l’efficacité des traitements (modification des doses de traitement en raison de l’état du patient) (Caccialanza et al., 2020).
L’Activité Physique Adaptée (APA) en cancérologie : un viatique pour les patients
C’est aujourd’hui démontré, l’activité physique quand elle est adaptée aux besoins du malade est bénéfique pendant les traitements d’un cancer quel(s) qu’il(s) soi(en)t. Pour que ces bénéfices soient présents, il est nécessaire de réaliser des exercices, environ trois heures par semaine, régulièrement en fonction de l’intensité des séances. Lorsque l’activité physique est dispensée par un professionnel et à destination d’une personne atteinte de maladie chronique ou de handicap, on parle donc d’activité physique adaptée ou APA.
Depuis 2009, l’Institut National du Cancer (INCa) recommande l’activité physique aux personnes touchées par un cancer. Cette institution reconnaît l’APA comme soins oncologiques de support depuis le Plan Cancer 2 (2009-2013) bien avant la loi de prescription de l’APA de 2016. En effet, en France :
La prescription d’activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical dans le cadre du parcours de soins des patients atteints d’une affection longue durée (ALD) est inscrite dans la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016.
Comme nous l’avons évoqué, les patients atteints de cancer voient leurs capacités cardiorespiratoires et musculaires s’altérer. Ce phénomène de déconditionnement physique peut aboutir à un état d’intolérance à l’exercice physique, avec pour conséquences une diminution de l’autonomie générale de la personne, de la qualité de vie, de l’estime de soi, accompagnée d’une augmentation des manifestations physiques et psychologiques de la FLC. De nombreuses études mettent également en avant l’intérêt de l’exercice physique en prévention tertiaire dans l’objectif d’éviter la survenue de complications et de rechutes des cancers. Sur la base du rapport « Bénéfices de l’activité physique pendant et après cancer », publié en 2017, l’INCa préconise l’intégration de la pratique d’APA dans le parcours de soins du patient, appelant à lutter contre la sédentarité dès l’annonce de son diagnostic.
Les recommandations de l’APA pendant les traitements
Pendant les traitements, il est aujourd’hui recommandé d’avoir une dépense énergétique équivalente à 9 MET (signification du sigle ici) par semaine. Cela peut paraître complexe mais en réalité c’est plutôt simple. Les scientifiques ont réussi à coter la dépense énergétique d’une activité physique, en fonction de son intensité et de sa durée, en MET. Quelques exemples sont proposés dans le tableau 1.
| Intensité d’activité | MET | Fréquence Cardiaque Maximale | Caractéristiques physiques | Types d’activités |
| Faible | 1,6 à 3 | 40-50% | Pas d’essoufflement Pas de transpiration | Marche < 5 km/h |
| Modérée | 3 à 6 | 55-70% | Essoufflement modéré Conversation possible Transpiration modérée | Activités de 30 à 60 min Marche de 5 à 6,5 km/h Montée d’escaliers à vitesse lente Sortie à vélo à 15 km/h |
| Élevée | 6 à 9 | 70-90% | Essoufflement important Conversation difficile Transpiration abondante | Activités < 30 min Montée rapide d’escaliers Course de 8 à 9 km/h Sortie à vélo à 20 km/h |
| Très Élevée | > 9 | > 90% | Essoufflement très important Conversation impossible Transpiration très abondante | Activités < 10 min Activités sportives intenses Course entre 9 et 16 km/h Sortie à vélo > 25 km/h |
À titre d’exemple, afin de suivre les recommandations des 9 MET/semaine, il est possible de réaliser soit une fois 3 heures de marche à 6km/h, soit marcher six fois 30 minutes (ou 3 kilomètres en 30 minutes), ou encore réaliser deux sorties de 16 kilomètres en vélo (en une heure environ) dans la semaine.
Les recommandations de l’APA après un cancer
Une fois les traitements terminés, la récupération peut être plus ou moins rapide, il ne faut pas s’attendre à une récupération spontanée et immédiate dès l’arrêt des traitements. L’après cancer est une période difficile, la fatigue et d’autres effets secondaires peuvent durer des semaines, des mois, voire des années. Pour accélérer la récupération, il est recommandé d’avoir une hygiène de vie saine, avec une alimentation équilibrée et une activité physique régulière. Les recommandations changent seulement en termes d’intensité !
En ce qui concerne l’activité physique, il est toujours recommandé, après un cancer, de réaliser un travail cardio-respiratoire (endurance : marche, pédalage en vélo, natation, etc.) et de renforcement musculaire avec un travail d’étirement, d’assouplissement et d’équilibre. La différence avec les recommandations pendant les traitements se situe dans l’intensité demandée. Pendant les traitements, et dans la mesure du possible, il est recommandé d’avoir une dépense de 9 MET par semaine alors que lorsque les traitements sont terminés, les recommandations passent à 15 MET par semaine. Tout comme les recommandations pendant les traitements, ces recommandations sont un objectif vers lequel tendre progressivement dans la mesure du possible et non un impératif à atteindre à tout prix.
| Activité | Programme | Fréquence (nb/ semaine) | MET/h | Dépense énergétique |
| Marche 4 km/h | 4 km en 1h | 5 x 1h | 5 MET/h | 15 MET/h/semaine |
| 2 km en 30 min | 10 x 30 min | |||
| Marche 6 km/h | 6 km en 1h | 3 x 1h | 5 MET/h | 15 MET/h/semaine |
| 3 km en 30 min | 6 x 30 min | |||
| Pédalage 16 km/h | 16 km en 1h | 3 x 1h | 5 MET/h | 15 MET/h/semaine |
| 8 km en 30 min | 6 x 30 min | |||
| Pédalage 20 km/h | 20 km en 1h | 2 x 1h | 8 MET/h | 16 MET/h/semaine |
| 10 km en 30 min | 4 x 30 min |
Quels types d’activités physiques à préconiser
Les activités physiques dites aérobies ou d’endurance
Que ce soit pendant les traitements d’un cancer, ou une fois qu’ils sont terminés, les activités d’endurance sont très importantes. La marche, la marche nordique, le vélo d’appartement ou la course à pied sont les plus fréquemment retrouvées en raison de leur mise en œuvre aisée et peu onéreuse. De plus, elles sont réalisables par l’ensemble des personnes touchées par un cancer (excepté dans de rares cas). Ces activités sont cependant à réaliser avec précautions car elles peuvent parfois augmenter le risque de chute qui associé à la fragilisation osseuse observée pendant les traitements peut augmenter le risque de fracture. D’autres activités dites d’endurance peuvent être réalisée comme la natation, mais sont contre-indiquées aux patients immunodéprimés, en aplasie ou présentant un déficit immunitaires secondaires.
La marche est l’activité physique à conseiller dans tous les cas, à raison de 30 minutes par jour au minimum. En cas de difficulté, il est recommandé de fractionner la durée et par exemple de marcher trois fois 10 minutes par jour. Ceci permettra d’entretenir une bonne condition physique, mais peut aussi, associée à un régime alimentaire adéquat, éviter un gain de masse corporelle, fréquent dans l’après cancer surtout pour les patients et patientes sous hormonothérapie. Marcher est bon pour la santé, même lorsque les articulations sont atteintes par des phénomènes arthrosiques. Bien entendu, lors de crises douloureuses aiguës ou de crise d’arthrose, il est recommandé de mettre les articulations au repos le temps que l’inflammation s’estompe.
Conseils pratiques
Il est recommandé, si possible, de réaliser 10 000 pas par jour ! De nos jours, il est facile de suivre ces activités et si cet objectif est atteint à l’aide de smartphones ou de montres.
De façon approximative, la marche lente représente environ 80 pas/minute, il est donc recommandé de marcher 1h30 à 2h00 par jour. La marche normale représente, elle, environ 100 pas/minute. Dans ce cas, il est donc recommandé de marcher 1h10 à 1h40 par jour. La marche rapide, correspondant à environ 120 pas/minute, il sera donc recommandé de marcher 1h00 à 1h20 par jour. Enfin, la marche très rapide, soit environ 140 pas/minute, induit de marcher 50 minutes à 1h10 par jour.
Il est également possible de marcher avec des bâtons. En effet, la marche nordique est plus dynamique que la marche traditionnelle. Elle a pour principe d’accentuer le mouvement de balancier naturel des membres supérieurs à l’aide des bâtons. La dépense d’énergie est augmentée par rapport à la marche traditionnelle. En marche normale, ce sont les jambes qui propulsent. En marche nordique, c’est la poussée avec les membres supérieurs vers l’arrière avec l’aide des bâtons qui propulse le corps en avant. Pour cela, le pas de marche nordique doit être plus grand que celui de la marche traditionnelle, ce qui permet d’avancer plus vite pour une fréquence d’enjambées équivalente. La marche nordique renforce les fonctions respiratoires et cardiaques, elle soulage les genoux et le dos, elle fait travailler 80 % des muscles du corps et fait dépenser plus de calories que la marche normale.
La course à pied, lorsqu’il est possible pour le patient de la pratiquer, peut être très intéressante pendant ou après un cancer. En plus des bénéfices au niveau cardiovasculaire, les contraintes qu’elle impose au squelette vont permettre d’augmenter la densité osseuse, altérée par certains traitements, des os du bas du corps de 30 à 40 %. Courir va donc renforcer les os du bas du corps. De plus, la pratique modérée de la course à pied à des effets bénéfiques sur le système immunitaire. Il stimule les lymphocytes et les polynucléaires, des cellules qui ont un rôle important dans les défenses immunitaires. La pratique de la course à pied peut également être intéressante dans la régulation du poids. En effet, celle-ci permet de brûler plus de calories par minute que tout autre exercice cardiovasculaire. Associée à un régime alimentaire équilibré, l’endurance aidera le patient à perdre de la masse grasse plus facilement et à stabiliser sa masse corporelle à long terme.
Lorsque la course à pied n’est pas recommandée au patient, il lui est possible d’opter pour des activités où les impacts au sol sont absents comme par exemple des exercices sur vélo d’appartement, rameur ou vélo elliptique. En intérieur, ces activités sont associées à des impacts au sol et un risque de chute nuls, ce qui est préférable les os du patient ont été fragilisé par les traitements. Si cela n’est pas le cas, des balades à vélo en extérieur seront possibles. Des sorties régulières à vélo permettront d’améliorer les fonctions respiratoires et de diminuer l’essoufflement lors de l’effort. Les effets bénéfiques de n’importe quelle activité physique d’endurance sur le cœur contribuent à réduire le risque de maladies cardiovasculaires. Ces activités permettent donc un travail musculaire intéressant au niveau des membres inférieurs tout en diminuant les traumatismes articulaires. Il peut vraiment être très intéressant chez des personnes qui souffrent des chevilles, des genoux ou des hanches. C’est là un des meilleurs avantages quand on veut se remettre en forme sans risquer la moindre blessure.
Les activités physiques de renforcement musculaire, étirements, assouplissement et posturales
Ces types d’exercices sont très importants. La gymnastique d’entretien, que l’on retrouve dans beaucoup d’association sportive, désigne une activité corporelle basée sur des exercices physiques destinés à assouplir et à développer le corps. C’est un mélange de mouvements propres au fitness, au stretching et au yoga. Elle met en jeu l’ensemble de l’appareil locomoteur de la personne et respecte son anatomie fonctionnelle. Le Pilates est une méthode de renforcement des muscles profonds, responsables de la posture. Les muscles profonds sont les muscles qui se situent entre les côtes et le bassin et tout autour de la colonne vertébrale (abdominaux, plancher pelvien et les muscles du dos). Le Pilates est aussi une discipline permettant d’améliorer la conscience de son corps, de sa force et de ses limites pour mieux s’en servir. Le yoga est la pratique d’un ensemble de postures et d’exercices de respiration qui vise à apporter un bien-être physique et mental. Cet ancien art de vivre tel qu’il est expliqué dans les textes se révèle comme un chemin initiatique qui transcende la discipline physique. Bien entendu, il existe d’autres pratiques très intéressantes mais nous ne pouvons pas toutes les aborder ici.
Activité physique adaptée et fatigue liée au cancer
Il a longtemps été recommandé aux patients touchés par la FLC de se reposer mais depuis quelque temps, bien que cela soit plutôt contradictoire à première vue, l’APA fait partie des traitements préconisés contre la FLC. Actuellement, il est d’ailleurs recommandé de pratiquer sous la supervision d’un professionnel en APA, une activité aérobie d’intensité légère à modérée pendant l’équivalent de 150 min/semaine. Cette activité doit être rythmique et/ou continue, impliquer de grandes masses musculaires et adaptée à l’individu que cela soit en termes cliniques ou simplement d’attrait pour l’activité. A celle-ci s’ajoutent des exercices de renforcement musculaires et d’étirements à raison de plusieurs séances par semaine. Ces recommandations basées sur la littérature scientifique constituent un idéal à atteindre avec progressivité (Bower et al., 2014 ; Mustian et al., 2012).
Il existe différents traitements de la FLC, parmi les plus répandus on retrouve notamment des traitements médicamenteux, du soutien psychologique, de l’APA, voire même une combinaison de ces deux derniers éléments. Mais tous ne montrent pas la même efficacité. Une étude scientifique a comparé leur efficacité et il en est ressorti que l’APA est la plus efficace devant le soutien psychologique, la combinaison des deux et loin devant les traitements médicamenteux (Mustian et al., 2017). Cependant, son efficacité est, au mieux, modérée et varie en fonction des modalités de pratique ou des « doses » pratiquées. De manière générale, l’APA a démontré son efficacité que cela soit pendant la période des traitements ou après les traitements. Les exercices de type aérobie semblent les plus efficaces (sans distinction de modalité, que cela soit de la marche, du vélo ou de la natation) contre la FLC surtout lorsqu’ils sont réalisés de manière supervisée par un professionnel en APA. De plus, la fréquence est importante et 20 à 30 minutes par session deux à trois fois par semaine semble être optimal.
Un certain nombre de mécanismes potentiels peuvent expliquer l’effet bénéfique de l’APA sur la FLC. Tout d’abord, une faible masse musculaire a été associée à un niveau élevé de FLC (Neefjes et al., 2017) et l’APA est évidemment le meilleur moyen de préserver ou augmenter la masse musculaire. Ensuite, de manière non-exhaustive, l’APA diminue l’inflammation, les symptômes dépressifs (légers à modérés), les troubles du sommeil, les troubles cognitifs, tous étant des potentiels mécanismes de la FLC, comme nous avons pu le voir (Bower et al., 2014 ; Campbell et al., 2018 ; Legrand & Heuze, 2007 ; Medysky et al., 2017).
Lors d’une de nos récentes études scientifiques, nous avons mis en lumière que les troubles du sommeil, l’anxiété, la dépression et la fatigabilité musculaire étaient les principaux mécanismes de la FLC (Chartogne et al., 2021). Ces paramètres font respectivement partie des dimensions comportementale, émotionnelle et physique de la FLC. Mais plus intéressant encore, la part de ces trois mécanismes dans la FLC ressentie semble être propre à chaque patient. Concrètement, certaines personnes ressentiront de la FLC majoritairement en lien avec leurs troubles du sommeil, alors que pour d’autres, la FLC sera plutôt liée à des symptômes dépressifs et/ou anxieux. Ces résultats sont donc particulièrement intéressants pour les professionnels en soins de support en vue d’individualiser leur accompagnement et de cibler les origines principales de la FLC de leurs patients. Car nous l’avons évoqué, l’APA est le meilleur traitement contre la FLC, mais nous pouvons émettre l’hypothèse que son efficacité pourrait être améliorée en ciblant les mécanismes individuels responsables de la FLC des patients. Les parties suivantes sont des exemples d’accompagnement en APA se focalisant sur les principaux mécanismes de la FLC contre lesquels les professionnels en APA pourraient souhaiter cibler leurs actions.
Activités physiques et dimension physique de la FLC
Nous avons vu précédemment qu’il existait plusieurs paramètres différents dans la dimension physique de la FLC, or il existe des types d’exercices ou d’activités qui pourraient les solliciter spécifiquement. Au niveau musculaire tout d’abord, l’APA pourra inclure un travail spécifique en force de type musculation lorsque la fatigue sera principalement d’origine « centrale » (déficit d’activation ou diminution importante de l’activation volontaire lors d’une tâche fatigante). Concrètement, les exercices comporteront un faible nombre de répétitions avec des charges proches de la charge maximale qu’une personne peut réaliser une fois (la 1-RM). Pendant les traitements, un travail en salle de musculation peut apparaître comme irréalisable, des exercices statiques de type gainage pourront donc être prescrit à la place. À l’opposé, un travail en endurance avec des charges légères et un grand nombre de répétitions, sera pertinent dans le cas de fatigue d’origine « périphérique » (fatigue du muscle en lui-même malgré une activation volontaire élevée). Ces exercices sont très souvent réalisés en combinaison, notamment afin de lutter contre le déclin de masse musculaire lié à une période d’inactivité ou aux complications de la maladie et du vieillissement (sarcopénie, cachexie). La force et l’endurance musculaire vont ainsi être restaurées (voire augmentées), permettant de retarder l’apparition de la fatigue au cours d’un effort donné ou la réalisation d’effort plus intense pour une même fatigue.
Les exercices aérobies impliquant les grands groupes musculaires de manière rythmique et maintenue (par exemple la marche nordique, la marche, le vélo, la natation ou la course à pied) sont les plus sollicitant au niveau cardio-respiratoire lorsqu’ils sont réalisés fréquemment à des intensités modérées. En effet, ces différents exercices permettent l’amélioration de l’absorption, du transport et de l’utilisation de l’oxygène. Ces exercices peuvent aussi être à plus haute intensité sur de courtes périodes mais entrecoupés de périodes de récupération plus longues, comme le jumping jack ou du « fractionné » (15 secondes intenses et 30 secondes de récupération). Cependant, ces exercices sont très éprouvants et il est nécessaire qu’ils soient réalisés sous avis et surveillance d’un professionnel en APA.
Un travail spécifique de l’équilibre est un dernier exemple d’intervention focalisée sur la dimension physique. En sollicitant les différents capteurs sensoriels impliqués dans l’équilibre (la vision, la proprioception, l’oreille interne), il permettra son renforcement. Ce travail peut être effectué dans différentes conditions : pieds joints ou en appui sur un seul pied, les yeux ouverts ou fermés, ou en réalisant une tâche en parallèle (compter à rebours ou de 2 en 2 par exemple). Il est possible de se tenir en équilibre sur un tapis, un bloc de mousse, un plateau ou un coussin d’équilibre afin de créer un léger déséquilibre qu’il faudra contrer pendant un temps donné ou jusqu’à ce qu’il y ait besoin d’effectuer une action pour se rattraper et éviter la chute.
Activités physiques et symptômes émotionnels
Depuis de nombreuses années, l’efficacité de l’APA dans le traitement de la dépression légère à modérée a été démontré. Elle est d’ailleurs comparable à celle des antidépresseurs mais les bénéfices apparaissent de manière moins rapide (Blumenthal et al., 1999). Il semble qu’il n’y ait pas de modalités particulières plus efficaces que d’autres mais que la fréquence de la pratique et l’environnement de groupe soient primordiaux. En effet, le fait de pratiquer une activité physique entre trois et cinq fois par semaine en groupe serait le plus efficace pour réduire les symptômes dépressifs (Legrand & Heuze, 2007). L’effet de groupe est également important pour la dimension sociale de la FLC car il permet de créer de nouvelles sociabilités, sources de soutien et support sociaux. Des activités en groupe comme la marche ou la marche nordique, le yoga, l’aquagym (sauf en cours de traitement, pour limiter le risque infectieux) sont donc particulièrement intéressantes.
Les symptômes anxieux sont également apaisés grâce à l’activité physique, mais là aussi aucun type d’activité n’est, semble-t-il, à privilégier. Seule la dose d’activités réalisées a pour le moment, montré son importance. En effet, plus l’activité est pratiquée fréquemment plus elle est efficace. Cependant, les mécanismes explicatifs restent méconnus, en partie du fait de la diversité des symptômes anxieux (crise de panique, troubles anxieux généralisés, phobies diverses, stress post-traumatique, etc.).
Activités physiques et troubles du sommeil
Principal facteur de la dimension comportementale, le sommeil peut être amélioré par la pratique d’une activité physique. La marche est particulièrement utilisée et efficace mais d’autres modalités d’exercice de type aérobie (exercice d’endurance à des intensités faibles à modérées) sont également bénéfiques, pour améliorer le sommeil, comme la natation. C’est une alternative peu coûteuse, efficace et sans effets secondaires contrairement aux traitements médicamenteux. Par exemple, il est souvent recommandé de réaliser 20 minutes de marche ou marche nordique à intensité modérée à raison de quatre fois par semaine afin d’améliorer le sommeil.
Plusieurs mécanismes physiologiques expliquent les effets bénéfiques de l’activité physique sur le sommeil. Tout d’abord, le rythme circadien, qui est régulé en temps normal grâce à l’exposition à la lumière ambiante, peut être resynchronisé par la pratique d’une activité physique lorsqu’il est déréglé. Le rythme circadien, agissant comme une véritable horloge biologique, va réguler l’ensemble des processus biologiques cycliques comme la sécrétion des hormones, parmi lesquelles on retrouve la mélatonine qui favorise l’endormissement (Shochat, Haimov, & Lavie, 1998). Les troubles du sommeil liés à une latence d’endormissement importante seront donc atténués grâce à l’APA. Le deuxième mécanisme pouvant expliquer l’effet bénéfique de l’APA sur le sommeil est un effet indirect via l’anxiété et la dépression. Ces symptômes émotionnels sont très liés aux troubles du sommeil. Par conséquent en diminuant l’anxiété-dépression, on pourrait améliorer le sommeil par réaction en chaîne. Enfin, Il y a aussi un effet lié à la température corporelle qui, sous l’influence du rythme circadien, diminue de 0,5 à 1°C en fin de journée pour favoriser l’endormissement. Or, chez les personnes sujettes aux troubles du sommeil, cette diminution de température peut ne pas être présente ou ne pas être assez importante pour avoir l’effet escompté. Il est alors intéressant de proposer la pratique d’une activité physique qui permettra à terme d’acquérir une meilleure régulation de la température corporelle, y compris la nuit, améliorant donc le sommeil.
Conclusion
Le cancer et ses traitements entraînent des répercussions importantes sur l’ensemble de l’organisme. Ils engendrent un déconditionnement physique, des douleurs, nausées, vomissements et surtout la fameuse FLC. Cette fatigue est un véritable épuisement mis en avant par la quasi-totalité des malades. De plus, même une fois les traitements terminés, la FLC peut persister durant des années. La plus grande difficulté que l’on observe sur le terrain, n’est pas de savoir comment répondre à cette fatigue mais bien d’identifier l’origine de cette fatigue. En effet, les origines de la FLC sont nombreuses et on observe une très grande variabilité interindividuelle. Dans les diverses origines possibles, apparaissent les origines émotionnelle, cognitive, comportementale ou encore sociale, mais aussi physique, qu’elle soit musculaire, cardiorespiratoire ou encore biologique.
L’organisme est maltraité par les traitements et entraîne une fonte musculaire et une diminution des capacités physiques. L’Activité Physique Adaptée apparaît comme un moyen pour pallier ce déconditionnement et à cette fatigue. Rester actif est une priorité, même si cela semble compliqué et que la FLC est souvent un frein à la pratique d’une activité physique, difficile voire impossible dans certains cas. Même le plus petit effort physique ne peut être que bénéfique. Le plus important est de réaliser une prise en charge adaptée aux besoins de chaque personne, d’où l’intérêt de se tourner vers un professionnel formé en APA afin qu’il puisse évaluer et proposer une prise en charge la plus individualisée possible. Cette prise en charge par un professionnel APA, du moins pendant le parcours de soins, est très importante car les répercussions du cancer et de ses différents traitements nécessitent de connaître les précautions à prendre en fonction de chaque traitement et les recommandations spécifiques à la cancérologie.
Bibliographie
Berger, A. M., Mooney, K., Alvarez-Perez, A., Breitbart, W. S., Carpenter, K. M., Cella, D., … National comprehensive cancer network. (2015). Cancer-Related Fatigue, Version 2.2015. Journal of the National Comprehensive Cancer Network, 13(8), 1012-1039. [en ligne] 10.6004/jnccn.2015.0122.
Blumenthal, J. A., Babyak, M. A., Moore, K. A., Craighead, W. E., Herman, S., Khatri, P., … Krishnan, K. R. (1999). Effects of exercise training on older patients with major depression. Archives of Internal Medicine, 159(19), 2349-2356. [en ligne] 10.1001/archinte.159.19.2349.
Bødtcher, H., Bidstrup, P. E., Andersen, I., Christensen, J., Mertz, B. G., Johansen, C., & Dalton, S. O. (2015). Fatigue trajectories during the first 8 months after breast cancer diagnosis. Quality of Life Research, 24(11), 2671-2679. [en ligne] 10.1007/s11136-015-1000-0.
Bower, J. E., Bak, K., Berger, A., Breitbart, W., Escalante, C. P., Ganz, P. A., … American Society of Clinical Oncology. (2014). Screening, assessment, and management of fatigue in adult survivors of cancer: an American Society of Clinical oncology clinical practice guideline adaptation. Journal of Clinical Oncology, 32(17), 1840-1850. [en ligne] 10.1200/JCO.2013.53.4495.
Bower, J. E., Ganz, P. A., Irwin, M. R., Cole, S. W., Garet, D., Petersen, L., … Crespi, C. M. (2021). Do all patients with cancer experience fatigue? A longitudinal study of fatigue trajectories in women with breast cancer. Cancer. [en ligne] 10.1002/cncr.33327.
Bower, J. E., Ganz, P. A., Irwin, M. R., Kwan, L., Breen, E. C., & Cole, S. W. (2011). Inflammation and behavioral symptoms after breast cancer treatment: do fatigue, depression, and sleep disturbance share a common underlying mechanism? Journal of Clinical Oncology, 29(26), 3517–3522. [en ligne] 10.1200/JCO.2011.36.1154.
Brownstein, C. G., Twomey, R., Temesi, J., Wrightson, J. G., Martin, T., Medysky, M. E., … Millet, G. Y. (2021). Physiological and psychosocial correlates of cancer-related fatigue. Journal of cancer survivorship : research and practice. [en ligne] 10.1007/s11764-021-01115-6.
Caccialanza, R., Goldwasser, F., Marschal, O., Ottery, F., Schiefke, I., Tilleul, P., … Pedrazzoli, P. (2020). Unmet needs in clinical nutrition in oncology: a multinational analysis of real-world evidence. Therapeutic advances in medical oncology, 12, 1758835919899852. [en ligne] 10.1177/1758835919899852.
Campbell, K. L., Kam, J. W. Y., Neil-Sztramko, S. E., Liu Ambrose, T., Handy, T. C., Lim, H. J., … Boyd, L. A. (2018). Effect of aerobic exercise on cancer-associated cognitive impairment: A proof-of-concept RCT. Psycho-Oncology, 27(1), 53-60. [en ligne] 10.1002/pon.4370.
Chartogne, M., Rahmani, A., Landry, S., Bourgeois, H., Peyrot, N., & Morel, B. (2021). Neuromuscular, Psychological, and Sleep Predictors of Cancer-Related Fatigue in Cancer Patients. Clinical Breast Cancer, 21(5), 425-432. [en ligne] 10.1016/j.clbc.2020.12.002.
Cowppli-Bony, A., Colonna, M., Ligier, K., Jooste, V., Defossez, G., Monnereau, A., … Réseau des registres de cancer Francim. (2019). [Descriptive epidemiology of cancer in metropolitan France: Incidence, survival and prevalence]. Bulletin du Cancer, 106(7-8), 617-634. [en ligne] 10.1016/j.bulcan.2018.11.016.
Curt, G. A., Breitbart, W., Cella, D., Groopman, J. E., Horning, S. J., Itri, L. M., … Vogelzang, N. J. (2000). Impact of cancer-related fatigue on the lives of patients: new findings from the Fatigue Coalition. The Oncologist, 5(5), 353-360. [en ligne] 10.1634/theoncologist.5-5-353.
Davis, M. P., & Goforth, H. W. (2014). Long-term and short-term effects of insomnia in cancer and effective interventions. Cancer Journal, 20(5), 330-344. [en ligne] 10.1097/PPO.0000000000000071.
Defossez, G., Guyader-Peyrou, S. L., & Uhry, Z. (2019). Estimations nationales de l’incidence et de la mortalité par cancer en France métropolitaine entre 1990 et 2018.
Registres des cancers. [en ligne] https://www.oncopaca.org/sites/default/files/rapport_vol1_tumeurs_solides_juillet_2019.pdf.
Janelsins, M. C., Kesler, S. R., Ahles, T. A., & Morrow, G. R. (2014). Prevalence, mechanisms, and management of cancer-related cognitive impairment. International Review of Psychiatry, 26(1), 102-113. [en ligne] 10.3109/09540261.2013.864260.
Karakoç, T., & Yurtsever, S. (2010). Relationship between social support and fatigue in geriatric patients receiving outpatient chemotherapy. European journal of oncology nursing : the official journal of European Oncology Nursing Society, 14(1), 61-67. [en ligne] 10.1016/j.ejon.2009.07.001.
Legrand, F., & Heuze, J. P. (2007). Antidepressant effects associated with different exercise conditions in participants with depression: a pilot study. Journal of sport & exercise psychology, 29(3), 348-364. [en ligne] 10.1123/jsep.29.3.348.
Martin, T., Twomey, R., Medysky, M. E., Temesi, J., Culos-Reed, S. N., & Millet, G. Y. (2019). The Relationship between Fatigue and Actigraphy-Derived Sleep and Rest-Activity Patterns in Cancer Survivors. [en ligne] 10.31236/osf.io/yswn8.
Medysky, M. E., Temesi, J., Culos-Reed, S. N., & Millet, G. Y. (2017). Exercise, sleep and cancer-related fatigue: Are they related? Neurophysiologie Clinique = Clinical Neurophysiology, 47(2), 111-122. [en ligne] 10.1016/j.neucli.2017.03.001.
Mustian, K. M., Alfano, C. M., Heckler, C., Kleckner, A. S., Kleckner, I. R., Leach, C. R., … Miller, S. M. (2017). Comparison of Pharmaceutical, Psychological, and Exercise Treatments for Cancer-Related Fatigue: A Meta-analysis. JAMA Oncology, 3(7), 961-968. [en ligne] 10.1001/jamaoncol.2016.6914.
Mustian, K. M., Sprod, L. K., Janelsins, M., Peppone, L. J., & Mohile, S. (2012). Exercise Recommendations for Cancer-Related Fatigue, Cognitive Impairment, Sleep problems, Depression, Pain, Anxiety, and Physical Dysfunction: A Review. Oncology & hematology review, 8(2), 81–88. [en ligne] 10.17925/ohr.2012.08.2.81.
Neefjes, E. C. W., van den Hurk, R. M., Blauwhoff-Buskermolen, S., van der Vorst, M. J. D. L., Becker-Commissaris, A., de van der Schueren, M. A. E., … Verheul, H. M. W. (2017). Muscle mass as a target to reduce fatigue in patients with advanced cancer. Journal of cachexia, sarcopenia and muscle, 8(4), 623-629. [en ligne] 10.1002/jcsm.12199.
Shochat, T., Haimov, I., & Lavie, P. (1998). Melatonin–the key to the gate of sleep. Annals of medicine, 30(1), 109-114. [en ligne] 10.3109/07853899808999392.
Veni, T., Boyas, S., Beaune, B., Bourgeois, H., Rahmani, A., Landry, S., … Morel, B. (2019). Handgrip fatiguing exercise can provide objective assessment of cancer-related fatigue: a pilot study. Supportive Care in Cancer, 27(1), 229-238. [en ligne] 10.1007/s00520-018-4320-0.
Weis, J. (2011). Cancer-related fatigue: prevalence, assessment and treatment strategies. Expert review of pharmacoeconomics & outcomes research, 11(4), 441-446. [en ligne] 10.1586/erp.11.44.