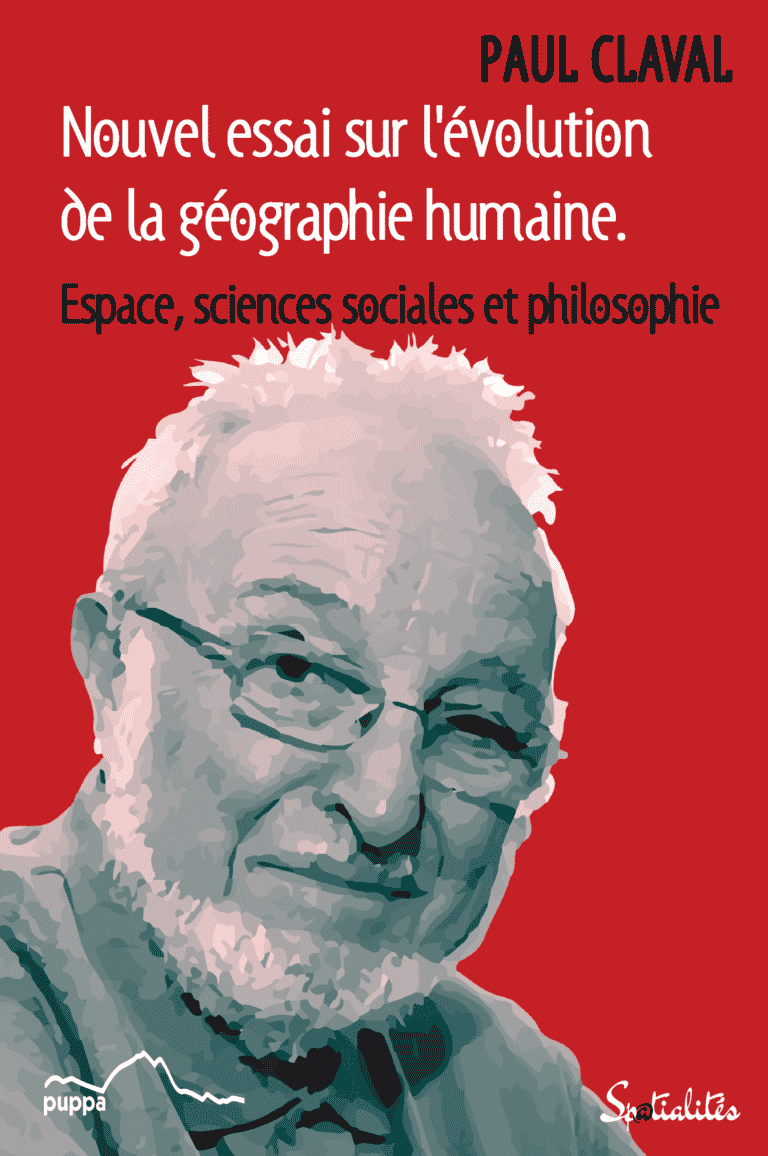Au début des années 1960, je tire de Walter Freeman (1961) la conviction que la géographie humaine a pris naissance sous l’influence de l’évolutionnisme. D’un collègue néerlandais, van Paassen (1957), je retiens que la géographie doit analyser les deux ordres de phénomènes qui modèlent la surface de la terre : (i) ceux qui naissent des rapports des hommes à l’environnement et qui ont une composante verticale dominante ; (ii) ceux qui ont trait aux relations entre les hommes et dont la composante essentielle est horizontale. En partant de là, la géographie classique me semble caractérisée par deux traits : (i) sa préoccupation évolutionniste la structure autour d’une grande question et met l’accent sur l’environnement ; (i) son souci de la circulation lui donne une dimension plus proprement sociale. En pratique, la part faite au milieu l’emporte sur celle accordée aux rapports entre les hommes.
Je nuance par la suite ce tableau en prenant conscience de l’influence de Ritter sur les deux fondateurs de la discipline, Friedrich Ratzel et Paul Vidal de la Blache, et en mesurant le poids de la querelle du déterminisme. La lecture en 1965 d’un article du démographe anglais Edward A. Wrigley (1965) me fait comprendre combien la curiosité de Vidal est plus large que celle de la plupart de ceux qui se réclament de lui.
Le tableau que je dresse de cette phase est donc aujourd’hui plus complexe.
La géographie se réinvente à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe, lorsque le problème de la détermination des longitudes, qui en avait fait une science de cabinet vouée à l’évaluation des distances entre les lieux, est définitivement résolu par l’observation des satellites de Jupiter et par l’invention du chronomètre de marine (Godlewska, 1998). Entre les années 1800 et 1850, Carl Ritter (1779-1859) souligne un des traits essentiels de la démarche géographique : pour comprendre ce qui se passe en un point, il convient de prendre en compte sa position en latitude et longitude, sur un littoral ou à l’intérieur des terres, bien reliée au reste du monde ou isolée ; ce qui le caractérise tient à la fois aux traits spécifiques de l’environnement qu’il offre et aux jeux d’influence qui naissent des flux qui circulent à la surface de la terre, et qui affectent à la fois l’atmosphère, l’hydrosphère et la biosphère. Carl Ritter prend en compte ceux qui sont d’origine naturelle et ceux qui sont liés à la présence humaine à la surface de la terre – migrations de population, diffusion des innovations, échanges commerciaux.
Mais la naissance de la géographie humaine déborde largement du cadre universitaire. Elle est liée à un mouvement de curiosité qui balaie les sociétés occidentales.
Un savoir à la mode
Au moment où se forme la géographie humaine, la discipline est à la mode. L’exploration de l’intérieur de l’Asie et de l’Afrique avance à grands pas. Seules les très hautes latitudes sont encore en partie inconnues, mais leur pénétration avance rapidement. L’immense succès des ouvrages de Jules Verne, Le Tour du Monde en quatre-vingt jours, Vingt mille lieues sous les mers, Cinq semaines en ballon ou Les Enfants du Capitaine Grant en témoigne. Le public est tout autant fasciné par les lieux jusque-là ignorés que par l’exotisme des cultures que l’on vient de découvrir. Les artistes se passionnent pour les estampes japonaises, pour les sculptures de Borobudur ou les temples d’Angkor. Gauguin va peindre à Tahiti et aux Marquises une société qu’il reconstruit à travers ses lectures et dont il impose l’image (Staszak, 2003).
À la curiosité pour des terres, des peuples et des civilisations inconnus ou méconnus s’ajoute la découverte d’espaces à peupler, de cultures à développer, de mines à exploiter : la géographie est populaire parce qu’elle fait naître, chez les hommes d’affaires et chez les politiques, des convoitises, et chez beaucoup, l’espoir de s’enrichir en s’installant dans des mondes neufs ou en exploitant les ressources négligées des pays de vieille civilisation. L’engouement pour la géographie naît de l’impérialisme et l’alimente.
L’Europe et l’Amérique du Nord sont en ébullition : les idées nouvelles font du peuple la source de toute souveraineté, ce qui menace nombre de constructions politiques. La révolution industrielle lie la puissance à l’essor industriel des pays et aux ressources sur lequel repose celui-ci – houille et plus tard pétrole, houille blanche, minerais métalliques. Ceci donne une nouvelle dimension aux nationalismes. À côté de la curiosité pour l’inconnu et la convoitise pour les richesses encore inexploitées des pays nouvellement explorés, c’est des implications spatiales de l’essor des États-nations occidentaux que vient l’intérêt pour la géographie. Pour qu’un pays tire parti de toutes ses possibilités, il est important que toute la population participe à sa mise en valeur, apprenne à le connaître, soutienne ses initiatives extérieures et se prépare à le défendre.
Comme le souligne Vincent Berdoulay, cette triple conjoncture explique la popularité et l’activité bouillonnante des cercles d’affinité qui se battent pour promouvoir la géographie à partir de 1870, lorsque la défaite face à l’Allemagne ébranle la société française, la contraint à repenser les objectifs de son système éducatif, à se doter d’un nouveau potentiel militaire et à chercher outre-mer de nouveaux éléments de puissance. Au terme de son analyse de l’environnement intellectuel dans lequel se forme l’école française de géographie, Vincent Berdoulay conclut :
« Le contexte français qui vient d’être étudié avait de nombreux points de ressemblance avec celui des autres pays occidentaux. […] L’expansion coloniale, mais aussi la diffusion de l’instruction et la question connexe de la montée des nationalismes et des fondements à donner à la morale, étaient des problèmes qui se situaient au cœur de la formation des états-nations modernes et dans lesquels la géographie était souvent impliquée. Le rôle historique du modèle allemand dans l’élaboration d’une pensée géographique de niveau universitaire est une question qui mérite plus d’attention. La grande diversité des courants dans la géographie française au tournant du siècle montre que la pensée géographique allemande n’offrait pas le seul modèle possible pour le développement de la discipline et attire l’attention sur son conditionnement par les différents contextes nationaux » (Berdoulay, 1981, p. 232).
Dans le dernier tiers du XIXe siècle, la géographie humaine naît ainsi de la curiosité générale pour les terres que l’on découvre ; elle s’enthousiasme pour les opportunités de peuplement et d’exploitation qu’elles ouvrent ; elle est partie prenante de l’impérialisme qui s’empare des pays les plus développés et épouse les passions nationales qui favorisent l’étude des réalités territoriales. Outre une connaissance générale de la terre, elle produit des savoirs applicables qui concernent ce que nous qualifions aujourd’hui de géographie économique ou de géographie politique, mais qui manquent encore de cohérence.
Des problèmes épistémologiques posés
par les sciences de la nature
Les chercheurs qui structurent ou redéfinissent les sciences modernes de la nature et de la société au XIXe siècle ne peuvent pas ignorer des débats nés en dehors des champs où ils travaillent, mais qui les affectent. C’est le cas de ceux qui ont trait à la durée de l’histoire de la Terre.
Géomorphologie et longue durée
En s’appuyant sur les données fournies par la Bible, James Ussher, archevêque d’Armagh et primat d’Irlande, avait calculé entre 1650 et 1654 que la création du ciel et de la Terre avait pris place en 4004 av. J.-C. Pour expliquer les formes observables à la surface de la Terre, la pensée religieuse faisait donc intervenir des épisodes de déchaînement des forces naturelles comme le Déluge. Il apparaît très vite aux géologues qu’il est impossible de loger en un temps aussi bref ce que leur apprend l’empilement des couches sédimentaires ou l’histoire des éruptions volcaniques que permettent de reconstituer leurs coulées. James Hutton (1785) s’oppose au catastrophisme en invoquant le principe des causes actuelles : les mêmes forces sont en jeu dans le modelage de notre planète depuis les origines. Peu après sa mort, ses idées sont popularisées par John Playfair (1802). Le débat suscité par les idées de Hutton dure une vingtaine d’années. C’est grâce à lui que la géomorphologie prend son essor – grâce à lui que la géographie apprend à s’inscrire dans des temps très longs.
L’évolutionnisme
La publication de l’Origine des espèces par Charles Darwin (1859) ranime le débat sur l’échelle temporelle des faits naturels et rompt avec le fixisme – la doctrine qui veut que les êtres vivants existent sous la même forme depuis que le Créateur les a tirés du néant. L’hypothèse évolutionniste avait été formulée par certains chercheurs dès le milieu du XVIIIe siècle. Jean-Baptiste de Lamarck (1815) l’avait structurée en France au début du XIXe siècle, mais elle ne déchaîne les passions qu’avec Darwin, car c’est la formulation qu’il en donne qui remet vraiment en cause l’idée d’une humanité créée par Dieu.
Dans la mesure où la sélection naturelle qu’invoque Darwin provient des contraintes du milieu, elle implique la formation d’une discipline nouvelle consacrée à l’influence qu’exerce l’environnement sur les êtres vivants, comme le montre Haeckel dès 1866. La géographie humaine que fonde Friedrich Ratzel naît comme une écologie de l’homme, inspirée de Darwin et plus directement, de Ernst Haeckel ainsi que de Moritz Wagner (1866) – même si elle intègre l’héritage rittérien.
Le grand débat épistémologique qui conduit à la naissance de la géographie humaine comme discipline académique est donc celui de l’évolutionnisme. Il joue un rôle aussi important en France qu’en Allemagne, même s’il est formulé chez nous en termes lamarckiens plutôt que darwiniens (Berdoulay et Soubeyran, 1991).
Qu’elle soit due à des mutations ou à l’héritabilité des caractères acquis, la transformation des espèces est un processus qui s’étale dans le temps. La géographie humaine ne peut donc se contenter d’analyser la distribution actuelle des hommes, de leurs activités et de leurs œuvres à la surface de la terre. Elle doit les appréhender sur de longues périodes. Il lui faut prendre en compte ce que les ethnologues apprennent des sociétés premières et ce que la préhistoire est en train de révéler sur le passé lointain de l’humanité. C’est une discipline au long cours.
À ce qu’apprennent l’observation du monde actuel et le travail de terrain, elle ajoute donc ce qu’enseignent les collections d’artefacts réunies dans les musées ethnographiques ou préhistoriques :
« Dans les principales villes du monde civilisé, il s’est fondé, depuis trente ans, des musées ethnographiques, dont quelques-uns sont remarquablement ordonnés. Rien, en ce cas, n’est plus instructif. Tout est réuni pour nous aider à comprendre à la fois la nature qui a fourni les matériaux, et l’esprit qui a guidé la fabrication » (Vidal de la Blache, 1903, p. 238).
Les géographes apprennent ainsi à raisonner sur les traces laissées par les activités humaines et sur « l’esprit qui [en] a guidé la fabrication ». Sur le long terme, on peut estimer que seul a subsisté ce qui résultait de choix rationnels permettant aux hommes de s’insérer dans le milieu sans le ruiner. La géographie humaine s’enrichit ainsi à se consacrer à l’étude de la longue durée et de l’ensemble des groupes dont elle permet d’appréhender l’action et les caractères.
Au départ, de multiples cercles de pensée s’intéressent alors en France à la géographie et en proposent des versions différentes (Berdoulay, 1981). Les savoirs ainsi élaborés ont souvent des finalités pratiques, à l’exemple de la géographie coloniale que développe Marcel Dubois (1894).
La conception que propose Vidal de la Blache l’emporte dans les années 1890 et s’impose dans l’Université : une trame commune est ainsi largement partagée ; c’est celle de la géographie classique, axée sur l’approche régionale. Elle n’unifie pas totalement les points de vue. Des courants mineurs se forment parallèlement et traitent plus particulièrement de la géographie économique, de la géographie politique et, au sein même de la géographie classique, de sa dimension culturelle.
La géographie classique
Un mode original d’appréhension de l’humanité
dans ses rapports au milieu
Le programme de la géographie classique est double : analyser le rôle de l’environnement dans le destin de l’humanité (la dimension évolutionniste), et prendre en compte la mobilité dans la distribution et dans la vie des groupes humains (l’héritage de la géographie rittérienne).
La dimension évolutionniste est dominante, comme le souligne Vidal de la Blache :
« La géographie humaine mérite ce nom, parce que c’est la physionomie terrestre modifiée par l’homme qu’elle étudie. […] Elle n’envisage les faits humains que dans leur rapport avec la surface terrestre où se déroule le drame multiple de la concurrence des êtres vivants » (Vidal de la Blache, 1903, p. 223-224).
L’évolutionnisme fait comprendre que l’œuvre humaine sur la terre s’inscrit dans la longue durée – une dimension essentielle de la géographie classique, qui, grâce à l’École des Annales et à Fernand Braudel, bouleversera plus tard l’histoire française :
« […] ce qui se dégage nettement des recherches [écologiques], c’est une idée essentiellement géographique : celle d’un milieu composite, doué d’une puissance capable de grouper et de maintenir ensemble des êtres hétérogènes en cohabitation et corrélation réciproque. Cette notion paraît être la loi même qui régit la géographie des êtres vivants. Chaque contrée représente un domaine où se sont artificiellement réunis des êtres disparates qui s’y sont adaptés à une vie commune » (Vidal de la Blache, 1922, p. 7).
La leçon essentielle de ces processus de longue durée, c’est la mise au point par les groupes humains de genres de vie adaptés aux milieux qu’ils permettent de mettre en valeur :
« Ce qui […] prévaut avec les progrès des civilisations, ce qui se développe, ce sont des modes de groupements sociaux originairement sortis de la collaboration de la nature et des hommes, mais de plus en plus émancipés de l’influence directe des milieux. L’homme s’est créé des genres de vie. À l’aide de matériaux et d’éléments pris dans la nature ambiante, il a réussi, non d’un seul coup, mais par une transmission héréditaire de procédés et d’inventions, à constituer quelque chose de méthodique qui assure son existence, et qui lui fait un milieu à son usage. Chasseur, pêcheur, agriculteur, il est cela grâce à une combinaison d’instruments qui sont son œuvre personnelle, sa conquête, et qu’il ajoute de son chef à la création. Même dans les genres de vie qui ne dépassent pas un degré assez humble de civilisation, la part d’invention est assez sensible pour attester la fécondité de cette initiative » (ibid., p. 115-116).
Les genres de vie que révèle aujourd’hui l’observation résultent d’une longue histoire faite d’essais et d’erreurs. Ils ont fait l’objet d’une sélection qui n’a laissé subsister que ceux qui se sont montrés capables de résoudre les problèmes d’adaptation à l’environnement et d’exploitation des milieux. Le géographe n’a pas besoin de questionner les hommes qu’il étudie pour savoir que leur conduite répond à des critères rationnels.
Remonter des lieux à l’ensemble de l’humain
La géographie n’est devenue humaine qu’avec prudence : une phrase célèbre de Vidal de la Blache le rappelle : « la géographie est science des lieux et non des hommes » (Vidal de la Blache, 2013, p. 298).
La formule se prête à de multiples interprétations. Vidal de la Blache est le père de la discipline en France : on ne peut de toute évidence pas lui prêter l’intention d’exclure les hommes de ce domaine. Affirmer que la discipline est science des lieux, c’est indiquer que c’est à travers la présence des hommes en tel ou tel endroit de la surface de la terre, et à travers la manière dont ils la vivent, l’exploitent, la transforment et l’aménagent, que le géographe doit les appréhender. Ce ne sont pas leurs qualités mentales, leur capacité à raisonner ou leur imagination qui l’intéressent au premier chef, mais leur présence physique ici ou là, et tout ce qui concrètement en résulte et en témoigne. Vidal de la Blache se montre par ailleurs très attentif aux multiples preuves d’intelligence que l’on décèle déjà dans les genres de vie et les modes d’habiter des humanités premières et ne cesse de souligner la créativité et l’inventivité des hommes, mais ce n’est pas le point de départ de l’approche qu’il bâtit.
Certains déduisent de sa formule que le géographe ne doit pas se pencher sur l’activité mentale des hommes : c’est ce que fait Pierre Deffontaines lorsqu’il écrit que le spécialiste de géographie religieuse doit « laisser délibérément de côté le domaine majeur de la vie intérieure » (Deffontaines, 1966, p. 1718). Le positivisme qui domine alors la réflexion épistémologique va dans le même sens. La tournure naturaliste de beaucoup de chercheurs qui, en matière de géographie, transposent à la géographie humaine ce qu’ils ont appris en géomorphologie ou en climatologie, renforce cette tendance. Nombreux sont ceux qui considèrent l’homme comme un objet parmi d’autres et ne l’appréhendent qu’à travers sa présence physique, ses activités et ses œuvres.
Collecte des données et typologies
Science d’observation, la géographie classique repose sur la collecte de données relatives à la répartition des hommes, de leurs activités et de leurs œuvres à la surface de la terre : comme le montre Vidal de la Blache (1913) reprenant sur ce point les leçons d’Émile Levasseur (1889), la connaissance des densités humaines est indispensable pour poser clairement le problème environnemental, celui des rapports de l’homme au milieu ; mais les formes d’habitat ou d’outillage sont également à prendre en considération : leur évolution ne montre-t-elle pas comment la capacité inventive des hommes vient à bout de certaines contraintes ? C’est l’essence du possibilisme.
Dans un monde encore largement rural et où la majorité de la population est employée à tirer de la terre ce qui lui est indispensable, il apparaît que ceux qui exploitent un même milieu le font généralement en utilisant les mêmes techniques et les mêmes outillages : ils partagent les mêmes genres de vie. Pas besoin, dans de telles conditions, de reconstituer les budgets espace-temps de tous les individus ; on peut leur substituer le type moyen d’emploi du temps et de labeur qu’ils partagent : leur genre de vie. C’est évidemment pour les sociétés d’agriculteurs et d’éleveurs que cet outil se révèle le plus intéressant. Il est moins pertinent pour les villes – mais les campagnes ne couvrent-elles pas l’immense majorité de l’espace et ne constituent-elles pas une source essentielle de richesses ?
La collecte des données montre que certaines des distributions observées demeurent remarquablement stables au cours des temps, qu’il s’agisse des formations de densité, des établissements humains, des paysages agraires ou des divisions régionales de l’espace. C’est là un résultat important : nombre de chercheurs considèrent que la découverte de ces structures est essentielle : pour eux, la tâche de la discipline est d’établir des typologies qui soulignent l’originalité de ces configurations. Ils s’arrêtent là (Claval, 2001, p. 135-153). Une part importante des conclusions auxquelles aboutit la géographie classique n’a ainsi pas de rapport direct avec les questionnements évolutionnistes qui l’ont fait naître.
Le métier de géographe
Lorsque j’écris l’Essai sur l’évolution de la géographie humaine, au début des années 1960, la réflexion épistémologique ne s’intéresse guère à ce domaine. The Nature of Geography (Hartshorne, 1939) est alors le seul ouvrage qui soit exclusivement consacré aux fondements de notre discipline. Publié à la veille de la guerre, en 1939, il n’en existe, à ma connaissance, qu’un exemplaire en France, à l’Institut de Géographie de Paris. J’en parle un jour avec Max Derruau, qui l’a lu : il l’a trouvé très rébarbatif et n’en fait pas grand cas ! Il me faut plusieurs années pour le consulter moi-même. Comment, dans un tel contexte, expliquer le manque apparent d’intérêt pour les fondements de la discipline ?
L’apprentissage du métier
L’enseignement supérieur est alors fondé sur deux éléments : le cours magistral et l’exercice appliqué. Celui-ci prend plusieurs formes : le commentaire de texte, élément fondamental de l’érudition depuis le Moyen Âge, en constitue l’élément de base pour les humanités. En histoire, à l’exposé structuré se juxtaposent des exercices qui familiarisent avec les documents sur lesquels s’appuie la démarche : paléographie pour la lecture des textes anciens, diplomatique pour comprendre les règles suivies dans l’élaboration de documents officiels, épigraphie pour le déchiffrement des inscriptions gravées… Le cours est ainsi doublé de ce que l’on pourrait qualifier d’ateliers et qui apprennent le métier par des exercices pratiques.
Discipline nouvelle, l’enseignement de la géographie s’accompagne rapidement d’ateliers de ce genre. Elle repose sur la carte : il convient d’apprendre comment on lève les cartes topographiques et comment on figure sur le fond qu’elles offrent des données diverses (cartographie thématique). Discipline de terrain, elle repose sur l’observation, le lever de croquis, l’administration de questionnaires. Pour maîtriser une discipline qui n’était pas encore l’objet d’un véritable enseignement supérieur à l’époque où il était étudiant, Vidal de la Blache passe plusieurs années à s’initier à la cartographie et consacre tous ses étés à parcourir la France et une bonne partie de l’Europe. Emmanuel de Martonne joue un rôle essentiel dans la mise au point de ce que l’on appelle bientôt des travaux dirigés (Martonne et Cholley, 1928). Il crée, à l’Université de Rennes où il enseigne d’abord, un laboratoire de géographie. Il propose des exercices de lecture de cartes. Henri Baulig a fait en 1927 un effort parallèle en ce domaine. De Martonne emmène ses étudiants en excursion, et invente l’excursion interuniversitaire qui assure rapidement la diffusion des savoir-faire en ce domaine.
Walter Freeman, un des pionniers anglais de l’histoire de la géographie, publie en 1967 The Geographer’s Craft, le métier de géographe. Il choisit ce titre en écho à celui de Marc Bloch, Le Métier d’historien (1949). L’un comme l’autre témoignent d’une réalité essentielle : l’histoire, la géographie et les autres sciences sociales qui naissent ou s’institutionnalisent au XIXe siècle ou au début du XXe sont des métiers acquis à travers un apprentissage. C’est lui qui garantit la qualité du travail de recherche. L’accès à la vérité passe par la maîtrise de savoir-faire modestes, mais qui permettent de traiter efficacement les documents qu’exploite la discipline. Celui qui applique les démarches auxquelles il a été formé n’a pas à avoir d’inquiétude méthodologique – sinon celle de perfectionner l’outillage dont il a hérité.
D’un certain point de vue, l’apprentissage du métier de géographe bénéficie de l’intérêt que, depuis Jean-Jacques Rousseau et Pestalozzi (Claval, 1994, p. 24-57), la pédagogie manifeste pour la fréquentation de la nature, l’inventaire botanique et l’observation des œuvres et des savoir-faire humains. Il s’inspire également des pratiques qu’ont mis au point les naturalistes, les géologues, les minéralogistes et les botanistes (Kalahora et Savoye, 1989).
Pour comprendre ce que sont les sciences sociales aux alentours de 1900, il convient donc de se rappeler qu’elles sont enseignées comme des métiers, à partir de la mise en œuvre de méthodes et de démarches qui garantissent les résultats obtenus.
Le parti-pris fonctionnaliste et positiviste de l’explication
Lorsque la géographie classique se montre explicative, la part qu’elle réserve à l’environnement est nettement plus forte que celle qui revient à la circulation. Le point de vue des géographes est alors très proche de celui des naturalistes : ils conçoivent les êtres humains comme des organismes qui doivent maintenir la stabilité de leur milieu interne (ce sont des homéostats) en prélevant dans le monde extérieur l’énergie et les matières dont ils ont besoin, et en y rejetant les gaz qu’ils ont respirés ainsi que des matières liquides et solides. Le parti-pris naturaliste et la dominante positiviste des épistémologies de l’époque empêchent de prendre directement en compte l’activité réflexive des hommes, qu’il s’agisse de leur usage de la raison ou des jeux de leur imagination – ceci étant compensé par la perspective évolutionniste qui conduit à considérer que les genres de vie résultent, sur le long terme, de choix rationnels. Dans le domaine de la circulation, on suppose que les décisions sont bien informées et visent à diminuer les coûts de déplacement et à améliorer l’accessibilité des lieux.
Les explications que l’on propose du réel sont d’un type particulier : elles analysent les groupes humains en supposant qu’ils sont similaires à des organismes vivants ou à des machines : le but est de comprendre leur fonctionnement. On s’attache pour cela aux formes de compétition économique et politique qui caractérisent la vie sociale. C’est le cadre retenu en particulier dans les travaux de géographie économique.
La géographie classique et les sciences
de l’homme et de la société
La géographie humaine tire ainsi une partie de ses atouts des problèmes que lui pose l’évolution et qui l’obligent à traiter de la longue durée. Mais elle s’enrichit tout autant des rapports qu’elle entretient avec d’autres sciences humaines. Vidal de la Blache note ainsi :
« C’est dans cette alliance intime avec la cartographie, la statistique et l’ethnographie, dans cette vue plus compréhensive de l’ensemble des rapports des peuples, dans cette conception plus géographique de l’humanité, que puisent leurs sources les progrès récents de la science qui nous occupe » (Vidal de la Blache, 1903, p. 239).
La géographie est ouverte à d’autres disciplines, mais la gamme de celles que cite Vidal est réduite. Cela tient évidemment à ce que beaucoup d’entre elles sont encore en gestation – les sciences politiques, par exemple, et dans une large mesure, la sociologie. Cela tient aussi à ce que les géographes humains se tournent surtout vers les domaines qui leur fournissent des données (la statistique), aident à mettre en évidence leurs caractéristiques spatiales (la cartographie) ou étendent son champ vers les peuples premiers et la préhistoire (l’ethnographie). L’intérêt pour l’ethnographie que manifeste Friedrich Ratzel est encore plus fort, puisqu’il passe une partie des années 1880 à étudier cette discipline et à mettre en évidence ce qui oppose les peuples de nature et les peuples de culture (Ratzel, 1885-1888) : les premiers subissent très durement les contraintes environnementales ; la culture les affranchit progressivement de cette sujétion…
Vidal de la Blache est historien de formation. La plupart des géographes français sont dans le même cas jusqu’au milieu du XXe siècle et au-delà. Ils n’ont donc pas le sentiment de sortir de leur domaine lorsqu’ils se tournent vers l’histoire. Ils savent que leurs travaux n’auraient pas le même poids s’ils se limitaient au présent. La thèse annexe de Demangeon est ainsi consacrée à ce que l’on peut tirer de l’exploitation des archives (Demangeon, 1905 ; 1907).
Aux alentours de 1900, les géographes se heurtent à l’hostilité des sociologues que domine alors Émile Durkheim. Il y a à cela des questions de circonstance. Vidal de la Blache a quitté l’École Normale Supérieure pour la Sorbonne. Durkheim exerce une influence croissante sur les générations montantes de normaliens, qui prennent sans doute plaisir à critiquer celui qui a encadré durant vingt ans leurs aînés. Mais l’agressivité des sociologues a des causes plus profondes.
La géographie humaine est une science sociale empirique comme le sont l’ethnographie, l’ethnologie, l’histoire en voie de rénovation ou les sciences politiques naissantes. Toutes partagent le même objet : comprendre les phénomènes sociaux. Comme on ne peut observer directement ce qui mène les hommes à leurs choix, elles le font à partir des nombreux types de documents qui témoignent de ceux-ci. L’éclatement des disciplines de la société ne fait que refléter la multiplicité des sources qu’elles mobilisent.
Les géographes sont prêts à s’inspirer de ce qui se fait en sociologie comme ils le font de ce qui paraît en ethnographie. S’il y a hostilité, elle ne vient pas d’eux. Elle vient des sociologues, et plus particulièrement de ceux qui se réclament de Durkheim.
La sociologie durkheimienne se présente en effet comme la seule science apte à traiter les réalités sociales dans leur totalité : alors que les autres disciplines de la société partagent ce champ, la sociologie le représenterait à elle seule. Le conflit éclate à l’occasion de la publication de la Politische Geographie de Friedrich Ratzel en 1897. Il est profond (Berdoulay, 1978 ; Andrews, 1984 ; Rhein, 1982 ; Friedman, 1996). Ce que les sociologues reprochent à Ratzel, c’est de chercher dans l’environnement une explication de faits sociaux, ce qui est contraire à l’une de leurs positions fondamentales, celle selon laquelle le fait social est un fait total, c’est-à-dire échappe à toute détermination qui n’est pas sociale. Un jeune historien, Lucien Febvre, se porte au secours des géographes français. Il reconnaît que Ratzel a parfois été trop loin en adoptant un point de vue déterministe : à travers les processus de sélection qu’elle met en place, la nature s’imposerait aux hommes. Dans un ouvrage dont la publication a été retardée par la guerre, Febvre (1922) soutient que la position de Vidal de la Blache est bien différente : par sa capacité d’invention technique, l’homme a pour lui la possibilité de tourner la nature. Sa position est possibiliste, et pas déterministe.
Un tel point de vue ne peut satisfaire les sociologues. Il ne dédouane pas en effet les géographes du péché capital qu’ils commettent : ce qui est grave, ce n’est pas qu’ils affirment que la nature domine l’homme, c’est le fait qu’ils reconnaissent qu’elle doit être prise en considération dans la mesure où elle capable de les brider : ils n’ont pas compris la nature du fait social.
Le conflit s’éternise donc. Il le fait d’autant plus qu’une partie des historiens est gagnée au point de vue durkheimien. C’est en partie le cas de Marc Bloch, qui a, pour l’histoire, des prétentions hégémoniques similaires à celles qu’affichait Durkheim pour la sociologie. En s’appropriant l’argumentaire développé par Lucien Febvre pour les aider, les géographes classiques acceptent l’idée que leur science est, dans une certaine mesure, une science incomplète ou imparfaite, puisqu’elle est incapable de généralisation – les rapports de l’homme à l’environnement ne sont intelligibles que sous le signe de la contingence.
Géographie économique et géographie politique
De la diversité des cercles d’affinité analysée par Vincent Berdoulay, il subsiste quelque chose dans la géographie humaine de la fin du XIXe siècle et du début du XXe : elle n’est pas monolithique. D’autres formes de la discipline se développent en marge de la géographie classique – mais les frontières ne sont pas étanches.
La géographie économique
La géographie économique a deux antécédents (Claval, 2020a, p 107-117) : (i) la longue tradition des études statistiques (au sens traditionnel du terme : science de la description des États, mais l’on parle aussi d’arithmétique politique en Angleterre et de science caméraliste en Allemagne) et (ii) les recherches de Carl Ritter sur la migration des plantes cultivées et le commerce international de leurs produits. Cette première géographie économique a la particularité de ne pas mettre l’accent sur les activités de production, mais sur l’échange, si bien qu’elle ignore totalement l’autoproduction familiale ou locale et se focalise sur les marchés et les courants commerciaux. Cela explique le succès qu’elle connaît dans les milieux d’affaires et la multiplication des sociétés de géographie commerciale que l’on observe en France dans les dernières décennies du XIXe siècle.
C’est en copiant les manuels allemands (Andrée, 1867-1872 ; Götz, 1882) et surtout anglais (Chisholm, 1889) que la nouvelle discipline est codifiée en France (Dubois et Kergomard, 1897).
Les géographes qui s’intéressent à la géographie économique adoptent généralement une perspective utilitariste : ils réduisent l’homme à ses sensations et à la manière dont il essaie de maximiser les jouissances et de minimiser les désagréments qu’il en tire. Un tel être est rationnel : connaissant ses capacités et les problèmes qu’il a à résoudre, le géographe peut reconstituer ses raisonnements et les décisions qui en découlent sans l’interroger sur ses choix.
Dans ce cadre, les explications que l’on propose du réel sont d’un type particulier : elles analysent les groupes humains en supposant qu’ils sont similaires à des organismes vivants ou à des machines : l’approche est fonctionnaliste. C’est le cadre retenu en particulier dans les travaux de géographie économique.
La géographie politique
L’essor de la géographie politique en France se fait différemment. Il est précoce : Vidal de la Blache s’attache dès le départ aux transformation géopolitiques entraînées par le percement du canal de Suez (Vidal de la Blache, 1873). Les travaux de géographie économique conduisent à souligner le rôle des grandes puissances (Arrault, 2008). Le sujet n’est cependant abordé systématiquement qu’à la suite de la publication de la Politische Geographie de Friedrich Ratzel (1897), et en bonne partie en réaction contre certaines de ses idées : la géographie politique française qui s’élabore pour l’essentiel entre les deux guerres mondiales s’intéresse plus aux équilibres internationaux qu’aux politiques de puissance (Claval, 1994).
Les différents courants de la géographie française doivent au contexte dans lequel ils se développent de partager certains points de vue.
L’essor de la géographie culturelle
et les critiques qu’elle soulève
Au sein même de la géographie classique, une place est faite dès l’origine à la culture : l’opposition des Naturvölker et des Kulturvölker soulignée par Ratzel est largement reprise par les géographes français ; pour Vidal de la Blache, l’homme « a réussi… par une transmission héréditaire de procédés et d’inventions, à constituer quelque chose de méthodique qui assure son existence » : une culture. L’orientation se précise avec Jean Brunhes. L’environnement scientifique dans lequel celui-ci a été formé lui a donné le souci de la rigueur scientifique. Ses curiosités l’ouvrent en même temps à de multiples influences : à la Raubwirtschaft, l’économie destructrice, à la suite des travaux de Karl Friedrich (1904), par exemple ; il fait preuve d’une sensibilité aux problèmes sociaux ou esthétiques qui est proche de celle de John Ruskin.
Pour Brunhes, le géographe doit commencer son enquête en dressant l’inventaire des modes d’utilisation du sol productifs, improductifs ou destructeurs. La collecte de ces données révèle dans le même temps des réalités d’une autre nature :
« En examinant de près les […] faits typiques [d’occupation du sol] aux divers points du globe, on remarque bien vite qu’ils sont par exception réduits à une expression très simple et pour ainsi parler, à une forme nue ; en général, ils sont entourés ou complétés par une autre catégorie de faits, également visibles et tangibles, qui en constituent comme le cortège indispensable, et qui, même dans les manifestations les plus élémentaires, en sont, si l’on peut joindre ces deux mots, les accessoires obligés. »
« La maison ou la caverne habitée ne vont pas sans quelque ameublement et sans quelques ustensiles ; la route comporte des ‘accessoires’, qui sont les moyens de transport, traineau qui glisse ou char qui roule […] » (Brunhes et al., 1947, p. 263-265).
Pour Brunhes comme pour son disciple Pierre Deffontaines et nombre de chercheurs de l’entre-deux-guerres, ces faits mettent en évidence la diversité de l’environnement matériel que se donnent les hommes et qui mérite d’être étudié :
« Tout ce matériel ne laisse pas que de dépendre, dans une certaine mesure, des conditions géographiques, mais avec quelle indépendance croissante ! Il échappe précisément en très grande partie à la tyrannie du cadre géographique immédiat, et partant, l’homme est plus libre d’y manifester ses tendances propres, spontanées ou traditionnelles, impulsives ou ethniques » (ibid., p. 267).
C’est ainsi que les chercheurs deviennent sensibles à la culture, mais d’une manière paradoxale, puisque, si « l’homme est plus libre de manifester ses tendances propres », le géographe, qui est un homme positif, ne peut appréhender celles-ci qu’à travers leurs manifestations matérielles – un champ immense, mais qui laisse de côté les sources mentales de l’activité. Le domaine culturel devient malgré tout un des chapitres les plus passionnants de la géographie classique.
Demangeon est celui des élèves de Vidal de la Blache qui met en œuvre avec le plus de méthode et de brillant le modèle de monographie régionale que préconise ce maître, mais c’est aussi celui que son intérêt pour les économies industrialisées de l’Europe du Nord-Ouest, Belgique, Pays-Bas et Îles Britanniques oriente le plus vers l’analyse des économies : sa démarche est fonctionnaliste. L’attention accordée aux traits culturels lui paraît dangereuse, comme il le précise à propos des recherches sur la maison rurale :
« Toutes ces adaptations, curieuses et pittoresques, de la maison aux conditions du milieu géographique, laissent intacts ses organes essentiels, elles n’intéressent pas, pour ainsi dire, ses fonctions. Elles modifient ses contours, elles lui donnent une originalité superficielle, mais elles ne créent pas sa véritable personnalité » (Demangeon, 1920, p. 356).
Le pittoresque des constructions rurales ne reflète que des modes passagères et laisse passer le plus important :
« La personnalité foncière de l’habitation rurale ne se compose pas de ces éléments qui changent et qui passent ; elle émane surtout de l’ordonnance interne des bâtiments qui est née de besoins agricoles. La maison du paysan donne la solution d’un problème vital qui est de savoir comment s’établiront les rapports réciproques des hommes, des bêtes et des biens » (ibid., p. 356-357).
Ce sont ces rapports qu’il importe de préciser, et pas ce qui fluctue sans cesse et ne joue pas de rôle réel.
D’autres critiques s’élèvent à l’encontre de la géographie culturelle ; pour certains, celle-ci se spécialise dans l’appréhension de ce qui, chez l’homme, n’est pas rationnel. Comme le progrès technique conduit les individus à agir de manière de plus en plus éclairée, le champ de cette discipline est appelé à se rétrécir. La rationalisation que marque la modernité la fera disparaître sous peu.
Le dernier reproche que l’on adresse à la prise en compte de la culture est de même nature, mais plus radical. Comment définir les faits de ce domaine ? Comme des éléments qui, dans les comportements humains, résistent à l’analyse fonctionnelle. Cela ne permet pas de délimiter un champ cohérent, mais conduit à qualifier nos ignorances du nom trompeur d’une discipline qui n’en est pas une !
Un bilan mitigé
La géographie classique avait une double ambition : mesurer le poids de l’environnement dans l’évolution humaine et apprécier le rôle de la mobilité dans la répartition des groupes sociaux. Rares sont les chercheurs qui accordent une attention égale à ces deux composantes. Les initiateurs de la discipline, Friedrich Ratzel en Allemagne et Paul Vidal de la Blache en France font un effort en ce sens, ce dernier en particulier, mais il ne se consacre vraiment au second volet que durant la dernière partie de sa carrière, le tournant se situant vers 1905. Cet aspect de sa réflexion reste longtemps sous-estimé. Au total, la géographie classique éclaire davantage les activités liées à l’environnement – l’agriculture et l’élevage en particulier – que celles tournées vers la transformation des produits ou leur distribution. La discipline présente un cachet ruraliste.
À la question qu’elle considérait comme centrale – celle de l’influence du milieu sur les comportements humains –, elle n’apporte qu’une solution prudente et qui doit être précisée dans chaque cas : le possibilisme ; la nature impose des contraintes, mais l’homme arrive de plus en plus à les contourner grâce à son inventivité. C’est un résultat important, mais qui ne permet pas de construire un vaste ensemble hypothético-déductif d’interprétation.
C’est par ce qu’elle apporte en dehors de son programme initial que la géographie classique compte surtout : par la description nuancée d’une réalité complexe, par la mise en évidence de structures spatiales et par la prise de conscience de la diversité culturelle de la terre – mais une prise de conscience limitée par les partis-pris épistémologiques de l’époque.
La géographie classique analyse l’espace en tant qu’étendue, une étendue différenciée par son relief, sa structure géologique et les roches qui y affleurent, par ses sols, par son climat et par sa couverture végétale comme par ses populations animales. Elle l’est aussi, et de plus en plus, par la présence et l’action humaines. Cette dernière prend en compte l’inégale fécondité des terres. Pour exploiter celles-ci, des droits de propriété et d’usage sont définis au sein des groupements humains : les jeux de pouvoir contribuent de la sorte à prendre économiquement en compte la diversité de la surface terrestre ; la fécondité des sols se traduit par leur valeur foncière. L’espace qu’appréhende la géographie classique est ainsi structuré à la fois par la nature, par les genres de vie imaginés par les hommes pour l’exploiter et par les outils juridiques que les pouvoirs mettent en place et qui traduisent les différences de richesse des terres par des prix. L’empreinte humaine sur notre planète a donc une double dimension, juridico-politique et économique.