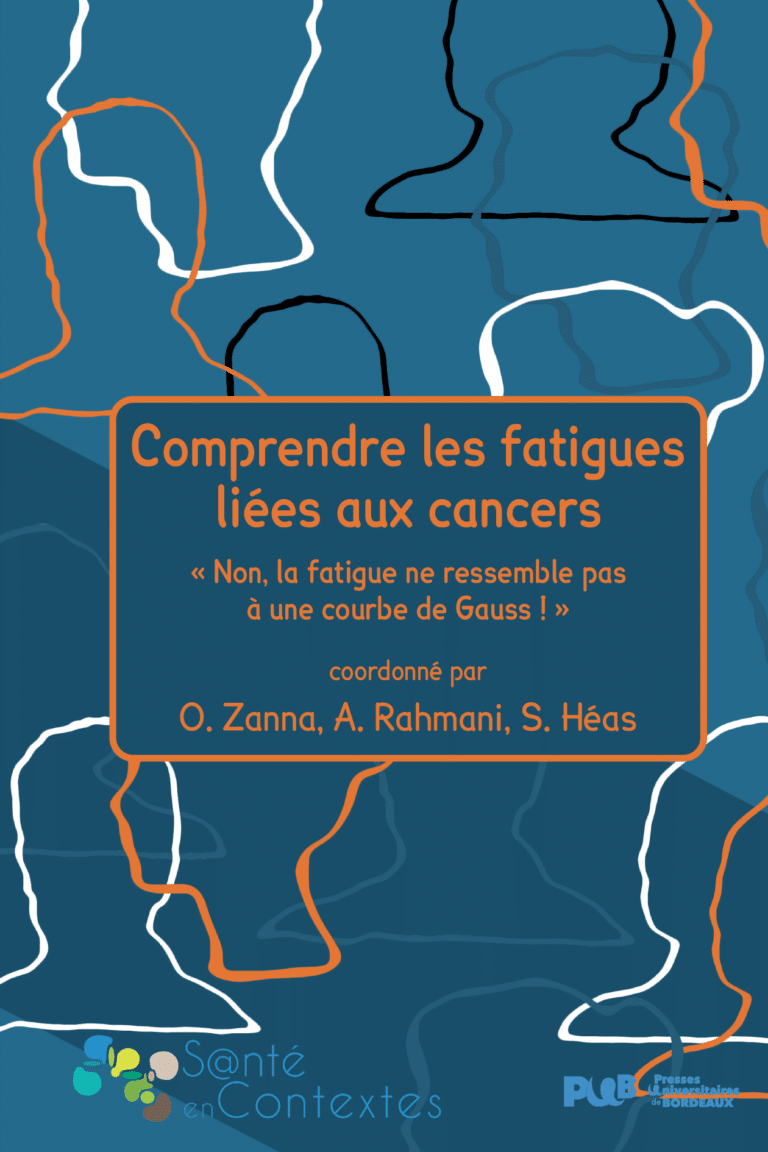Point méthodologique
J’ai entendu pour la première fois le témoignage d’Éna en juin 2021 lors d’une journée d’études sur la fatigue liée au cancer, organisée à l’université du Mans. Sensible à ses propos, je lui ai demandé si elle avait pensé écrire son parcours. À l’époque, Éna a décliné ma proposition, invoquant un manque de temps et d’énergie. Nous sommes néanmoins restés en contact, échangeant par e-mail et parfois par téléphone. En 2024, je suis revenu vers elle pour lui proposer de contribuer au présent ouvrage. Éna a alors accepté. Pour rédiger son parcours, nous nous sommes mis d’accord pour mettre en place des échanges sous forme de questions/réponses par courriel. Fin juin, elle m’a soumis une première version de son témoignage.
Inspiré par la démarche suivie dans l’ouvrage « Un alcoolique anonyme » (Pentecouteau et Zanna, 2013), dans lequel nous avions étudié le cheminement biographique de Camille à partir d’une série d’échanges menés sur deux ans, j’ai demandé à Éna de reprendre son récit, en supprimant mes questions et en élargissant son propos comme bon lui semblait dès lors que celui-ci éclairait, de près ou de loin, la thématique de la Fatigue Liée au Cancer (FLC). Confrontée à une fatigue accrue en juillet 2024 et soucieuse d’honorer son engagement, Éna a bénéficié du soutien de ses amies pour rédiger quelques éléments de sa biopathographie. Le témoignage que vous vous apprêtez à lire est le résultat de ce long processus collaboratif. Son but est de donner au lecteur un aperçu du quotidien d’une femme seule et mère de deux enfants, aux prises avec la fatigue liée au cancer depuis plusieurs années. Afin de rendre la lecture plus fluide, les relances ont été volontairement supprimées.
Éna est le prénom retenu pour préserver l’anonymat de notre interlocutrice. Toujours dans un souci d’anonymat et d’éthique, tous les noms des personnes et des lieux cités dans ce livre ont également été modifiés.
Exigences d’une personne fatiguée
Depuis que je suis petite, je fréquente le milieu médical et celui de l’enseignement de manière particulièrement intense, c’est pourquoi il me semble pertinent de commencer mon témoignage sur la fatigue liée au cancer par une mise en contexte. Très tôt dans mon enfance, j’ai compris qu’il valait mieux paraître bien élevée et en bonne santé pour éviter certains écueils. Pour des raisons de santé, j’ai vécu les six premières années de ma vie chez mon grand-père médecin. Mon oncle, médecin lui aussi, habitait à quelques pâtés de maisons plus loin. Ma tante était infirmière. Ma cousine l’est devenue aussi. Le Vidal était le livre de chevet de ma mère. L’autre partie de ma famille se trouve être dans l’enseignement ; j’ai donc aussi intégré dès mon plus jeune âge l’importance de faire partie des élèves en tête de classe, de paraître sage et obéissante. Autant dire que, lorsque je suis entrée dans la maladie cancéreuse à l’âge de 40 ans, je savais naviguer entre la revendication de mon droit à l’autonomie et celle de mon droit à ne pas me voir imposer de décisions issues d’un certain paternalisme médical. Je dois reconnaître que mon histoire familiale et mon tempérament rendent mon expérience de la maladie assez atypique.
Concernant la fatigue, qu’elle soit liée au cancer ou non, j’ai bien conscience que j’ai des exigences vis-à-vis de moi-même et des autres. Je veux avoir l’air en bonne santé même si je suis malade et fatiguée ; je refuse de me plaindre, mais je souhaite malgré tout que les autres comprennent que je suis épuisée ; j’ai besoin que l’on m’aide, mais je ne l’exprime pas, ça non, surtout pas ! Mon cercle amical proche et ma famille ont toujours eu beaucoup de mal à identifier quand je suis fatiguée. Cela ne date pas du cancer. Je n’ai jamais aimé paraître en situation de fragilité : « Avec Éna, on ne sait jamais si elle est fatiguée ou non », voilà une phrase que j’ai souvent entendue. J’ai tellement intégré les codes familiaux et sociétaux que je ne sais plus faire autrement. Les autres se fient souvent à l’apparence pour savoir si une personne est en forme ou non. Sauf qu’avec moi, cela n’a jamais été possible. Je tiens la dragée haute aussi longtemps que possible et, si je ne suis plus du tout en mesure de faire semblant d’être en forme, je m’éloigne et m’isole.
Devenir une patiente
De mon expérience subjective de la maladie cancéreuse, je dirai que la toute première fatigue qui est entrée dans ma vie est certainement liée au changement de rythme. Une fois que le diagnostic est posé, il y a indiscutablement un avant et un après. L’annonce de la maladie est un choc. J’ai pu constater que je ne gérais plus ma fatigue de la même façon depuis le cancer. Par exemple, si je suis malade, mais que je n’ai pas de symptômes qui me forcent à m’arrêter, cela ne me pose aucun problème de pousser mes limites au-delà du raisonnable. Je le fais en ayant l’espoir qu’à un moment la fatigue se résorbe. Le manque de sommeil et une alimentation déséquilibrée ne me font pas peur, car j’imagine que mes organes pourront récupérer à un moment ou à un autre. J’espère que je vais être en capacité de revenir à un état de fatigue acceptable, même si cela prend du temps. Me sachant malade, je sais que ce mode de fonctionnement ne peut plus convenir. Au fur et à mesure du parcours de soins, l’espoir de pouvoir potentiellement retrouver de l’énergie file et s’éloigne de plus en plus… J’imagine aisément que, tout comme moi, chaque patiente ou patient arrive dans ce parcours de cancer avec son niveau de fatigue et sa propre manière de la gérer. Autour de moi, je connais beaucoup de personnes qui s’arrêtent et se reposent quand elles sont fatiguées, peu importe leurs contraintes et leurs responsabilités. Quelle chance !
Pour ma part, le fait même de me savoir malade a changé mon quotidien à la fois trépidant et éreintant. Auparavant j’avais un rythme de maman solo qui travaillait à temps plein. Mes nuits et mes jours étaient rythmés par la logistique et la charge mentale maternelle. Je ne m’arrêtais pas. Mes pauses ressourssantes ? C’était en étant au travail, assise derrière mon bureau, avec des projets enrichissants. J’aimais beaucoup mon poste et mes collègues, ce qui me permettait de trouver du répit dans mon quotidien de maman. En revanche, dès que le diagnostic de cancer du rectum a été posé, je suis devenue une patiente. Tomber malade ne m’était pas étranger, mais là, c’était autre chose. J’ai vite compris que les délais et les issues étaient bien différentes de ce que j’avais connu jusqu’alors. Il m’a fallu ajuster ma vie pour y inclure la temporalité de la maladie et mes rendez-vous médicaux.
Devenir une grosse masse
La fatigue associée aux traitements ressemble plus ou moins à une sorte de conglomérat qui grossirait de jour en jour. Elle s’est, en outre, ajoutée au niveau de fatigue avec lequel je suis entrée dans la maladie. La première partie de mon protocole de traitements consistait à faire de la radiothérapie associée à de la chimiothérapie tous les jours : chimiothérapie matin et soir, radiothérapie à l’heure du déjeuner. Cela m’imposa un nouveau rythme exténuant. Comme je suis une maman isolée, durant cette période, je n’ai pas pu m’exonérer de mes obligations familiales. En revanche, on m’a donné la possibilité d’arrêter mon activité professionnelle. Comme je l’ai indiqué plus haut, mon travail était pourtant ce qui me permettait d’avoir des moments ressourçants dans mon quotidien. Mes filles sont très actives, pleines de vie et d’une créativité sans limite. J’avais vraiment besoin de travailler pour remonter ma jauge d’énergie vitale, car elle était vite consommée par mon rôle de mère. Avoir le cancer dans ma situation voulait donc dire sacrifier le seul temps que j’avais pour me ressourcer.
Durant les traitements, comme j’ai continué à m’occuper de mes enfants, le programme de mes journées était bien chargé :
- Le matin : préparer les enfants, prendre mon petit-déjeuner édulcoré de chimiothérapie, puis aller-retour en voiture pour emmener les enfants au centre de loisirs (vacances scolaires) ;
- Le midi : trajet aller-retour en VSL1 pour la radiothérapie du déjeuner ;
- Le soir, rebelote : aller-retour au centre de loisirs, cuisiner le repas pour les enfants, prendre mon dîner goût chimio.
C’était bien plus compliqué que le traditionnel circuit « enfant-boulot-dodo » ! J’ai eu énormément d’effets secondaires liés aux traitements : des diarrhées et des vertiges. Rien que le fait de devoir conduire était éprouvant, et je l’avoue ici, je devais être un sacré danger public sur la route ! Heureusement, je n’ai fait que de courts trajets. Les ronds-points me donnaient des vertiges, et devoir tourner la tête à gauche puis à droite m’occasionnait des troubles de la vision. Pour le reste, je remercie les magasins qui ont un drive, l’invention des lingettes, du micro-ondes et des programmes rapides des machines à laver et à sécher le linge. Étant malade et à bout de force, ce mode de vie (qui, j’en conviens, n’est ni écologique ni économique) n’était pas un choix mais l’unique option.
Comme je l’ai dit plus haut, pour inclure la temporalité et la fatigue liées au cancer, j’ai dû arrêter mon travail, mais aucune solution adaptée ne m’a été proposée ni apportée pour soulager mon état de maman lessivée. Au moment du diagnostic, mon aînée avait 10 ans, cette période fleurait la préadolescence tumultueuse, et ma cadette avait 6 ans et demi. Cela signifiait qu’en plus de la maladie et des traitements, j’infligeais à mon corps le rythme terrassant de mes contraintes familiales. Comme ma première fille avait des difficultés scolaires, je refaisais une bonne partie des cours et des exercices avec elle le soir. Il était hors de question que les professeurs puissent stigmatiser ma fille parce que sa maman était célibataire et avec un cancer. J’ai tenu bon, et ses notes sont restées très bonnes. Avec ma cadette, cela a été plus facile, elle faisait déjà partie des têtes de classe et refusait catégoriquement toute aide de ma part. Ouf !
De manière factuelle, la fatigue liée directement aux traitements était très visible. Durant cette première salve de produits, mes yeux étaient gonflés, mes doigts et mes articulations douloureuses. Je devais aller aux toilettes de manière impérieuse et fréquente, de jour comme de nuit. Mon sommeil était de très mauvaise qualité, mes pensées étaient devenues des ruminations incessantes, et je ne récupérais pas du tout des procédures médicales de la veille. Mes jambes ne me portaient plus vraiment. J’avais le sentiment que ma respiration ne m’accordait plus assez d’oxygène, j’étais essoufflée. La gravité m’aimantait au sol sans que je pusse résister. Je me vautrais comme une crêpe, avec la lourdeur d’un menhir et je restais souvent en plein milieu de l’escalier, ou carrément sur le carrelage de l’entrée. Je suis devenue une grosse masse difficilement déplaçable.
One Level Up !
La seconde étape des traitements a été celle de l’hospitalisation et de la chirurgie. C’est un peu comme accéder au niveau supérieur de difficulté et de fatigue, le level juste au-dessus ! À la suite de la chimiothérapie et de la radiothérapie, il a été décidé de m’amputer de mon rectum. J’utilise bien le pronom il plutôt que je, car on ne m’a pas vraiment demandé mon avis. L’unique solution qui m’a été présentée pour accéder au Graal de la rémission, c’était de retirer l’organe atteint par la maladie. Je me demande encore si mon consentement fut bien libre et éclairé, sachant qu’il n’y avait pas d’autres solutions thérapeutiques et que les informations dont je disposais pour consentir étaient bien loin d’être complètes. Les conséquences de cette amputation sont variables d’une personne à l’autre mais le chirurgien, professionnel de santé qui opérait, semblait optimiste. J’ai fini par accepter cette mutilation à contre-cœur, pour mes filles. Mon corps était déjà bien usé et marqué, mais j’étais toujours responsable de mes enfants. Je savais qu’elles avaient besoin que je reste vivante, au moins jusqu’à leur majorité. C’est clairement pour elles que j’ai accepté les conséquences que cette intervention implique.
On ne s’en rend pas compte avant de ne plus en avoir, mais le rectum est un organe socialement vital. C’est lui qui permet le compactage et le stockage des matières issues de la digestion des repas. Sans lui, pas de possibilité de rétention : c’est comme un robinet ouvert en permanence. La seule façon que l’eau ne s’en écoule pas, c’est tout simplement de couper l’arrivée d’eau. Il est donc aisé de comprendre que l’unique solution pour continuer à avoir une vie normale sans posséder de rectum, c’est la privation de nourriture ou bien la mise en place d’un sac pour stomie. Et cela, bien évidemment, je n’en voulais absolument pas. Gérer le quotidien avec une stomie et la poche, hors de question ! Le stress des fuites et des odeurs, les soins pour la cicatrice et les changes plusieurs fois par jour, non !
Une fois que la décision a été prise, tout a été programmé. La mutilation est classiquement effectuée en deux étapes : une première opération avec l’implantation d’une stomie avec une poche provisoire et une seconde intervention, quelques semaines plus tard, pour une remise en continuité. Me concernant, j’ai insisté pour ne pas avoir de poche et que la remise en continuité se fasse lors de la même opération. L’opération a duré de nombreuses heures, je suis entrée au bloc vers 11h30 et je ne me suis réveillée en salle de réanimation vers 20h. S’ensuivirent environ 12 jours en soins intensifs.
La facture de la fatigue hospitalière est vraiment lourde ! Il y a d’abord la fatigue de la chambre d’hôpital, où je n’avais plus d’espace vital. Tout était encombré de machines bruyantes. Je n’avais pas de douche, juste un lavabo et des toilettes. Dans le couloir de la médecine intensive, je n’étais pas chez moi. D’ailleurs, les cloisons sont des vitres et me rappelaient à chaque instant que mon corps était à disposition. Cette dépossession du corps est complètement aliénante ! J’avais l’impression d’être un animal de laboratoire. Non seulement le bruit était usant, mais l’équipe me réveillait toutes les deux heures. J’ai vite compris que le personnel ne disposait pas de temps pour m’expliquer, ce qui m’a ajouté du stress. J’ai bien conscience que les équipes elles-mêmes sont particulièrement sous pression. D’ailleurs, pendant mon séjour, deux erreurs ont été commises par des infirmières, m’obligeant à prolonger de 48 heures mon hospitalisation. Des erreurs de manipulation en outre particulièrement douloureuses.
Avant cette opération, je croyais connaître ce que c’était que de ressentir la douleur. Je pensais déjà avoir expérimenté bon nombre de ses paramètres, et j’avais l’habitude de les taire. Là, j’ai découvert que la quantité d’informations indiquant que j’avais mal pouvait court-circuiter la totalité de mon cerveau. Est-ce ça devenir folle ?
La douleur intense ou chronique est une source importante de fatigue, car il me semble qu’elle entrave tout raisonnement logique. De plus, certains médicaments analgésiques me mettaient dans un état second : j’avais encore mal, mais je n’étais plus capable de l’exprimer. Sans compter les autres drogues avec lesquelles je me suis sentie flotter, mais dont la « descente » est terrible, avec des sueurs froides. Est-ce ce que l’on appelle le « syndrome du sevrage » ? Comment trouver des moments de répit et de repos dans ce tourbillon hospitalier ? On n’en trouve pas. Et c’est logique, car ils n’existent pas.
Rétroplanning
Force est de constater que je suis arrivée à la seconde étape du protocole de soin dans un état d’intense fatigue. En entrant dans cette phase d’hospitalisation, je n’avais absolument pas récupéré des traitements de chimio et de radiothérapie les ayant précédés. Devoir organiser mon absence de la maison pour la résection du rectum m’a conduite à faire un rétroplanning me permettant de ne rien oublier avant la date butoir. Je voulais partir en ayant absolument pensé à tout. Enfin…en ayant pensé à un maximum de choses.
J’ai établi bon nombre de to-do lists à faire avant de passer sur le billard ! Avant l’amputation, il m’a fallu trouver une famille d’accueil pour mes enfants, organiser leurs valises ainsi que leur suivi médical et scolaire. Le système social ne prévoit pas de solutions adaptées pour la garde d’enfant en cas d’hospitalisation complète. Après avoir vraiment beaucoup cherché, vu trois assistantes sociales, appelé ma mutuelle, envoyé un courriel aux parents d’élèves de l’école et à la principale du collège, une famille a fini par proposer son aide. C’était inespéré. C’était une famille dont les enfants fréquentaient la même école que mes filles. On a été invitées à les rencontrer avant mon départ. Les filles et moi étions ravies et rassurées. J’ai rencontré le professeur principal des classes de mes filles, et j’ai établi une fiche des informations indispensables à afficher dans le bureau de l’infirmerie scolaire. Toutes les personnes qui étaient partie prenante dans la prise en charge de mes enfants disposaient des mêmes informations. Même si je ne revenais jamais de l’hôpital, toute l’équipe projet pouvait se débrouiller sans moi ! Les filles ont donc pu continuer à aller en cours la journée avec leurs camarades et retrouver un cocon familial le soir. Pour elles, c’était assez transparent. Cela m’évitait des inquiétudes et, donc, de la fatigue mentale supplémentaire. Je leur avais acheté un tas de vêtements chauds en prévision de l’hiver, car l’opération avait lieu en automne, et je voulais m’assurer qu’elles auraient le nécessaire si je ne devais pas rentrer.
Me concernant, j’ai acheté les vêtements et les accessoires qui rendraient mon séjour hospitalier moins horrible. Des chemises de nuit, des sous-vêtements adaptés, des chaussettes de contention, une petite couette pour mes pieds. J’avais peur, mais j’avais aussi tout organisé pour pallier toutes les problématiques que j’avais recensées. J’ai rédigé mon testament avec une notaire très à l’écoute, et j’ai écrit mes directives anticipées. On ne sait jamais comment une intervention aussi lourde peut tourner, je voulais mettre en ordre ma maison et mes papiers avant un éloignement plus ou moins prolongé. Chaque chose devait aller à une place que je jugeais cohérente pour la retrouver aisément. J’avais aussi réalisé mon dossier MDPH2, car je voulais m’assurer d’avoir ma carte priorité au plus vite, pour m’éviter une fatigue supplémentaire à mon retour chez moi, dans mon rôle de maman isolée. Toute cette partie administrative représente une charge éléphantesque, mais elle est nécessaire quand on n’a pas de soutien. La charge mentale harassante du projet « hospitalisation » en plus de celle accumulée pendant les traitements, a donc aussi largement contribué à l’état de fatigue dans lequel j’étais lorsque je suis entrée à l’hôpital.
La fatigue servie sur un plateau
À mon retour à la maison, j’ai ressenti un véritable soulagement et une vraie libération de la prison médicale. L’espace d’un instant, mon état d’épuisement s’est envolé avec une partie de mes douleurs. J’imagine que c’était lié au sentiment d’euphorie de constater que j’avais survécu. Ce fut évidemment de très courte durée, car j’ai vite ressenti un vide immense en me retrouvant seule à devoir gérer mes cicatrices et ce nouveau corps dont je ne comprenais plus les signaux. Et cela sans compter l’angoisse d’avoir à retourner aux urgences si jamais cela se passait mal, en laissant mes enfants seules. Je m’étais renseignée sur les suites opératoires, mais je ne m’attendais vraiment pas à autant de séquelles douloureusement handicapantes. Le sentiment dominant à ma sortie d’hôpital a donc certes été l’euphorie, mais celle-ci a rapidement cédé sa place à l’inquiétude, à la douleur et à une fatigue encore accrue ! Cette dernière s’était accumulée depuis le début des traitements, et la gestion du handicap « sans rectum » m’a tout d’un coup rendu impossible tout espoir de récupérer l’énergie vitale qui s’était évaporée. Jusque-là, j’avais espéré que la fatigue redescendrait au niveau d’avant l’entrée dans la maladie. Mais c’était illusoire, et je suis restée sur un plateau très élevé de fatigue postopératoire.
Un dispositif innovant libérateur
Après avoir passé un an et quatre mois à essayer de vivre sans rectum et sans stomie, je dispose aujourd’hui d’un dispositif médical innovant. L’acte consiste à vider le gros intestin en introduisant une grande quantité d’eau à 37°C, par le biais d’une sonde gonflable. Ce dispositif nécessite énormément de concentration et une compréhension absolue de sa propre physiologie. C’est un geste très contraignant mais qui me permet de me libérer d’une partie des contraintes liées à l’absence de l’organe et de retrouver une vie sociale, même s’il ne fera pas repousser mon rectum et qu’il n’adoucit pas véritablement mon quotidien.
Ce dispositif, il m’a fallu le quémander, l’implorer ! C’est un appareil habituellement utilisé pour d’autres pathologies (neurologiques). Ce dispositif est tellement peu fréquent qu’une infirmière a dû être formée pour m’enseigner les gestes et le protocole pour l’utilisation de ce dispositif. Je garde en mémoire cette journée d’apprentissage. J’avais demandé à recevoir le dispositif chez moi, en amont, afin de pouvoir l’observer et m’informer sur son fonctionnement. J’avais regardé des tutoriels sur Internet et j’avais déjà pensé à des axes d’amélioration de son utilisation. Je m’étais renseignée sur le péristaltisme, et j’avais investi dans un petit masseur à piles pour mon ventre, afin d’en optimiser l’efficacité. Après quelques heures marquantes de formation à l’hôpital avec l’infirmière, j’ai dû pratiquer le geste seule. Il m’a fallu trois mois pour apprivoiser l’appareil, et j’ai vite compris pourquoi nombre de malades abandonnaient cette solution et se tournaient vers la pose d’une poche de stomie. Il faut ajuster et déterminer l’orientation de l’appareil selon ses propres cicatrices internes, le nombre de pressions permettant d’insérer la sonde gonflable correctement et d’éviter qu’elle n’explose à l’intérieur du colon, la quantité d’eau permettant de vider correctement ses intestins. Une fois cet ajustement réalisé, il peut quand-même changer au gré de la fatigue ou d’un virus attrapé. Se retrouver avec un rhume, une gastro ou le covid est très problématique et je vais vous épargner la complexité de l’utilisation de la sonde dans ces situations.
Je passe plus d’une heure tous les jours à réaliser moi-même un acte infirmier. Ce temps avec cet outil est un temps contraint incompressible. Le geste est loin d’être anodin et peut, si je ne le fais pas correctement, engendrer des hémorragies qui me conduiraient aux urgences pour une autre opération. Il pose également des problèmes d’organisation familiale, car je monopolise longuement l’unique salle de bain de la maison, et ce, tous les jours. Pour m’assurer une autonomie de 24 heures, je dois de plus m’astreindre à un régime alimentaire strict, loin d’assurer l’équilibre des vitamines et minéraux nécessaires d’une alimentation équilibrée.
Ce geste est donc épuisant dans sa nature et dans l’organisation qui va avec. Je l’accepte parce qu’il m’évite de gérer une poche de stomie et tous les désagréments qui l’accompagnent. Je suis encore jeune, je veux m’épargner les odeurs, les fuites et les moqueries ! D’ailleurs, comme vous avez pu le remarquer, j’utilise préférentiellement les mots acte et geste pour ce dispositif au lieu de soin. Un soin, c’est doux et ça soigne, ce qui est à l’opposé de la réalité de l’utilisation de l’appareil. L’absence de rectum constitue un handicap majeur au quotidien. M’inviter à sortir au dernier moment va être un poil compliqué, voire impossible ! En tous cas, toute sortie extérieure exige de l’organisation avec un temps de préparation qui convient.
Une organisation démesurée
Durant tout mon parcours de soins, j’ai attaché une importance particulière à cette sortie au monde. Quand je devais aller voir mon oncologue ou mon chirurgien, il était extrêmement important qu’il me trouve en forme, motivée et battante. Par expérience, je sais que l’on se comporte avec autrui en fonction de la manière dont cette personne prend soin d’elle et pose ses limites. Soigner mon apparence me semblait donc garantir un maximum de chance pour que l’oncologue et le chirurgien n’eussent pas envie d’abîmer mon corps plus qu’il ne l’était déjà. Je savais que l’impression que je renverrais orienterait les traitements. Vous le savez sûrement les ongles d’une personne, sa coiffure, les chaussures et les vêtements repassés donnent une première impression déterminante. Depuis, je porte une attention particulière à mes mains, à mes cheveux et aux vêtements que je porte. J’ai investi dans des crèmes et des shampoings, des masques pour les mains et les pieds. L’objectif n’est pas tant de me faire belle que d’avoir l’air en bonne santé. Merci les cosmétiques !
Je mets également un point d’honneur à ce que le corps médical me voie autrement que sous le prisme de l’organe malade. Je suis une personne capable de comprendre et de prendre des décisions. Je veux être pleinement associée aux choix thérapeutiques, car je sais que ceux-ci peuvent changer radicalement et définitivement mes projets de vie. À cet effet, pour les consultations hebdomadaires avec mon oncologue, je préparais systématiquement un tableau sur une feuille A4 avec la liste des effets secondaires que j’avais ressentis durant la semaine précédente. Ce tableau était accompagné de ma liste de questions et, pour chaque effet secondaire, je faisais figurer une note de 1 à 10, afin de quantifier leur intensité et je mentionnais s’ils avaient augmenté ou régressé. Je réfléchissais aussi au vocabulaire à utiliser. Il me fallait être claire et précise dans ce que je lui exprimais. Je ne voulais pas de stomie, je ne voulais pas de seconde opération pour la remise en continuité. Par ailleurs, dès la deuxième consultation de mon parcours de patiente, j’avais déjà bien compris que je devais rester factuelle dans ce que je disais au médecin. Les douleurs et les ressentis sont subjectifs, et c’est le médecin qui interprète ce que les personnes malades expriment. Il était donc essentiel que l’interprétation faite par le spécialiste fût la plus proche possible de ce que je vivais.
Cette préparation sur le fond et la forme est longue et l’addition de fatigue élevée, mais elle me permettait de garder un peu de contrôle sur ce qui m’arrivait. Cette méthodologie de présentation au monde s’applique encore aujourd’hui pour les consultations médicales, mais aussi pour le peu de sorties entre amis que j’ai conservées. Mes objectifs sont pourtant bien différents. Pour mon cercle amical, le principal est que personne ne se fasse de souci pour moi. Des amis qui se font des soucis, c’est aussi beaucoup de problèmes que je n’aurai jamais eus sinon. Avec le stress de chacun et chacune, cela représente potentiellement des coups de fil chronophages, des inquiétudes inutiles et des propositions d’aide inappropriées. Partant de ce postulat, je mets tout en place pour éviter à tout le monde de la fatigue supplémentaire.
Se sentir chez soi
Je me connais bien et je sais que je me sens vite très redevable si on me rend service et cela me met en grande difficulté. Or, je n’ai plus l’énergie qui me permettrait d’accepter de l’aide pour faire plaisir. J’ai besoin d’une aide adaptée et efficace. Dans notre entourage, il y a toujours au moins une personne pour nous demander. « Mais pourquoi tu ne veux pas que je t’aide ? », et à qui on n’ose pas dire, pour ne pas la vexer : « Simplement parce que tu vas me rajouter de la fatigue ! ». Quant à l’aide proposée par les services sociaux, j’ai aussi rapidement compris que cela avait des répercussions négatives sur mon état de santé physique et mental. Des aides ménagères ont cassé ma poubelle et mon aspirateur… Je ne me sentais plus chez moi. J’ai tout racheté sans me plaindre, car je ne disposais plus de force pour argumenter et prouver que je n’étais pas à l’origine de la casse.
Concernant l’aide qui m’était proposée pour mes enfants, il n’existe aucun dispositif adapté en France pour les parents malades d’un cancer. Dans ma propre maison, j’avais l’impression d’habiter chez les personnes qui étaient censées me donner un coup de main. Mes enfants me sursollicitaient, car elles n’étaient pas en confiance avec les intervenantes à domicile. Cela m’a coûté beaucoup d’énergie physique et mentale de me faire aider, sans compter la douleur déclenchée par le fait de monter et descendre les escaliers pour aller ouvrir et fermer la porte d’entrée. J’ai donc rapidement demandé à arrêter les contrats avec les intervenantes à domicile. Je ne me suis d’ailleurs pas justifiée, j’étais bien trop épuisée pour donner une quelconque explication.
Aujourd’hui, après toutes ces épreuves qui ont généré de la fatigue, visible ou invisible mais surtout pérenne, j’apprivoise mon nouveau corps. J’ai identifié trois incontournables pour passer une journée qui ressemble le plus possible à la normalité que je connaissais avant la maladie :
Le premier, c’est la nécessité d’envisager ma journée. Je me réveille tous les matins en étant déjà épuisée et en sachant que ce ne sera pas mieux demain, ni après-demain, ni jamais. J’ai donc besoin d’analyser mon état pour savoir comment gérer mon énergie en fonction du programme prévu.
Le deuxième besoin est de communiquer sur mon état d’épuisement. Les autres ne sont pas dans mon référentiel « gestion du handicap lié au cancer » et sont loin de comprendre ma situation. Encore hier, ma voisine (jeune retraitée pleine d’énergie) se plaignait des herbes de mon jardin qui dépassaient. Elle m’indiquait qu’il serait grand temps que je passe la tondeuse chez moi. Quand je lui ai dit que j’étais fatiguée à cause d’un cancer, j’ai eu droit à une remarque dénigrante : « Ça se soigne bien les cancers, ma sœur a eu un cancer du sein il y a 10 ans…Ah, cette nouvelle génération de flemmards ! ». Elle est ensuite repartie avec son couteau pour déterrer toutes les mauvaises herbes sur sa place de parking. Je me suis sentie triste et en colère. Communiquer sur mon niveau de fatigue fait partie de la construction de ma relation à l’autre. J’ai donc mis en place plusieurs méthodes, mais celle qui me convient le mieux reste celle de ma montre connectée. Elle a une fonctionnalité body battery qui me permet de voir, comme sur la batterie d’un smartphone, à quel pourcentage d’énergie je me situe. Même s’il ne reflète pas l’exactitude de ce que je ressens, ce chiffre est factuel et communicable aux autres. Il est calculé à partir de la fréquence cardiaque et des efforts que je fournis tout au long de ma journée. Il me permet donc également de décider de m’allonger si la jauge est trop basse.
Le troisième besoin, c’est ma préparation à la fameuse sortie au monde. Depuis l’amputation, je dois y intégrer l’utilisation de mon dispositif libérateur, des soins cosmétiques et une préparation mentale pour les rendez-vous.
Dans ce contexte de maladie cancéreuse, sortir au monde avec mes amis répondait au besoin existentiel de rompre l’isolement dans lequel je me trouvais alors. N’ayant pas de famille proche, je me retrouvais seule, puisque la maladie m’avait exclue du monde du travail, dans lequel j’avais la majeure partie de mes relations sociales. Avant le diagnostic, mes journées étaient rythmées par les heures passées avec mes collègues de bureau et celles consacrées à mes enfants. J’étais très investie dans mon poste et j’avais de très bonnes relations de travail. À l’époque où j’étais salariée, je dressais déjà le constat que j’étais bien isolée et lessivée du fait de mes obligations familiales. Mon travail était indispensable, car il me permettait d’avoir des interactions que je n’avais pas en étant à la maison avec mes filles. Ne plus côtoyer le monde du travail, partager mon temps entre la charge permanente de mes enfants et le parcours de malade a largement accentué mon sentiment d’exclusion de la société. De nouvelles sorties au monde étaient donc indispensables à mon équilibre. Or, pour sortir au monde, il y a deux épreuves qui cohabitent : l’épreuve de la sortie et l’épreuve du monde.
Sortir représente un challenge dans ma situation de personne malade. Cela s’apparente à de la gestion de projet ! La toute première étape consiste à puiser l’énergie nécessaire pour envisager de sortir et de se présenter aux autres. C’est un peu comme si je devais actionner le starter d’une Simca-Talbot Horizon, avant de passer à la seconde étape, qui consiste à se préparer concrètement à la sortie. La seconde étape requiert, elle aussi, beaucoup de force. En effet, elle a pour objectif ultime et, je l’avoue, quasi inatteignable d’avoir l’air en bonne santé. Pour atteindre ce but, il y a bien évidemment des choix à faire. Il est évident que je n’ai pas assez d’énergie pour me préparer aussi facilement qu’une personne en bonne santé, qui sauterait dans la douche et se pomponnerait avec légèreté avant de sortir gaiement. C’est là que les bonnes idées germent : je mets un tabouret en plastique dans la douche pour pouvoir m’y asseoir, j’organise mes affaires de toilette de façon chronologique sur la tablette pour ne pas avoir à les chercher et j’utilise un peignoir facile à enfiler. J’ai donc dû investir dans un nouveau peignoir avec capuche, plus léger que celui que j’avais.
Avant le cancer, en tant que maman solo, j’avais déjà appris à bien optimiser mon temps et mon énergie. Avec la maladie, j’ai assurément peaufiné ma méthodologie du « paraître en forme ». Je prépare mes vêtements en amont sur mon couvre-lit. Je choisis des vêtements qui me donnent l’air en forme. J’opte pour des couleurs gaies qui me donnent bonne mine. Je focalise mon attention sur les parties que les autres sont susceptibles de voir et de remarquer : mes mains, mon visage et ma coiffure. Pour ce qui ne se voit pas, je choisis toujours une solution rapide et confortable, qui me coûte le moins d’énergie possible. Tant pis si c’est très moche, personne ne le saura ! Par ailleurs, il est essentiel de souligner que, lorsque je sors avec mes amis, c’est un véritable choix que je fais. Cela signifie que l’énergie que j’investis dans cette sortie, je ne vais pas pouvoir l’accorder à autre chose.
C’est véritablement renoncer à faire autre chose : renoncer à aller faire les courses, renoncer à faire une sieste, et même renoncer à manger. En effet, ce cancer digestif et ses séquelles imposent un régime alimentaire particulier, et ne pas manger reste quand même la meilleure solution, pour ne pas stimuler la digestion et ne pas me retrouver coincée plusieurs heures d’affilée dans la salle de bain.
Quant à l’épreuve du monde, être avec les autres représente aussi un sacré défi ! Me concernant, les défis se sont révélés être plus difficiles au moment du diagnostic. Car au début, le cercle amical n’est pas encore écrémé et effiloché par la maladie. Voir mes amis, c’était leur montrer que je « gérais » la situation. C’était leur montrer qu’il n’y avait pas de soucis à se faire et qu’il leur était possible de continuer à vaquer à leurs occupations dans le monde des bien portants. C’est moins le cas aujourd’hui, mais je me demande encore souvent quelle image les personnes garderaient de moi si je décédais. Je tiens à ce que l’on se souvienne de moi comme d’une personne pleine de vie et combative. C’est donc aussi avec cette perspective que je me prépare à ces sorties. Mais ce mode de représentation au monde, qui masque la réalité de mon quotidien, est à double tranchant. Comment demander aux autres de comprendre l’état d’épuisement dans lequel je me trouve si je ne laisse rien transparaître ? Cela est d’autant plus vrai si les autres n’ont pas fait l’expérience de la maladie et de ses traitements. En plus, force est de constater qu’il y a autant de cancers que d’individus malades, et j’imagine assez facilement que chaque personne expérimente des subtilités différentes.
Au tout début de mon parcours de soins, je manquais d’expérience en tant que malade du cancer et je ne voulais pas faire de choix dans mes sorties. Pourtant, je me suis vite aperçue du décalage manifeste qui existait entre mes priorités et celles des bien-portants. Cet écart pouvait se révéler éprouvant. Durant ma vie de bien portante, j’avais déjà pris conscience de ce décalage, car mes priorités de maman solo éreintée étaient déjà très éloignées de celles de mon cercle amical. Avec la maladie, j’avais de moins en moins de doutes sur ces différences et sur l’énergie que je dépensais vainement dans certaines relations sociales. Dans mes relations, j’ai souvent tu ce que je pensais pour m’épargner des discussions stériles. Le cancer a définitivement accentué ce trait de caractère. Au fur et à mesure de la maladie, j’ai continué à ne rien dire concernant le décalage que j’observais, mais j’ai fini par répondre de moins en moins aux sollicitations extérieures.
Des sorties qui se transforment en stigmates
Je me souviens d’un déjeuner avec deux connaissances, au tout début de mon parcours de soins. Elles portaient toutes les deux beaucoup d’attention à leur apparence et étaient en pleine forme. Je savais au fond de moi que je n’avais pas forcément d’atomes crochus avec elles, mais j’ai accepté la sortie malgré tout. J’avais besoin d’interactions sociales. C’était une belle journée ensoleillée et j’avais vraiment mis beaucoup de temps à me préparer. Je voulais être à la hauteur ! Au cours du déjeuner, le sujet de la maladie est bien inévitablement arrivé sur la table. Et voici le genre de phrases que j’ai pu entendre, sous couvert d’un certain humour : « Oh, c’est bien, avec la chimio, tu n’as pas besoin de t’épiler ». J’ai donné le change en rigolant avec elles, pour me donner un air assurément détaché et confiant, mais je ne suis jamais ressortie avec elles. Je ne me souviens pas si ce sont elles qui ne sont jamais revenues vers moi ou bien si c’est moi qui ai refusé par la suite, toujours est-il que je ne les ai jamais revues. Quoi qu’il en soit, c’est probablement ce déjeuner qui m’a permis d’intégrer une chose essentielle : alors qu’elles s’apprêtaient pour des questions de mode et d’esthétisme, je préparais ma sortie au monde avec l’objectif de ne pas avoir l’air esquintée.
Une autre sortie m’a profondément marquée. On avait organisé un escape game entre filles, un soir. Je voulais être à la hauteur physiquement et intellectuellement. J’ai mis un temps monstrueux à me préparer. Ce soir-là, je me suis sentie tellement lamentable. Non seulement l’épuisement se lisait sur mon visage, mais je ne pouvais que constater ma lenteur pour la résolution des énigmes. Pour clore cette sortie, nous nous sommes retrouvées sur le trottoir, pour papoter. Certaines ne se gênaient pas pour fumer leur cigarette juste à côté de moi. Je suis non fumeuse, et on connaît aujourd’hui les ravages du tabagisme passif. J’ai été blessée par ce manque d’égard.
La soirée la plus douloureuse demeure celle où une personne s’est tenue à l’écart tout du long. J’ai fini par apprendre que cette personne avait peur d’attraper mon cancer. Quelque chose s’est définitivement brisé à l’intérieur de moi à ce moment. Était-il encore possible à notre époque de ne pas savoir que le cancer n’est pas une maladie contagieuse ?
Avec le temps et pour de multiples raisons, mon cercle amical s’est amoindri. Tout au long de la maladie, la fatigue a grandi, et j’ai refusé de plus en plus les sorties pour lesquelles je n’aurai pas été capable de masquer mon délabrement. Je n’ai conservé que les sorties qui exigeaient le moins de préparation. Les sorties au monde simples et de courte durée étaient acceptables, comme marcher avec une amie dans la nature ou faire un pique-nique dans les champs. Même si ce type de sorties requiert une préparation soignée, dans l’ensemble, aujourd’hui encore, elles me prennent nettement moins d’énergie, parce que je suis moins dans la représentation.
Quelle injustice !
Quand j’évoque les capacités physiques de ma vie d’avant, je parle surtout des libertés et des privilèges dont je bénéficiais lorsque je disposais d’un rectum. Les traitements de mon cancer ayant impliqué sa résection, voici quelques fonctionnalités qui me font désormais défaut :
- Je n’ai plus la possibilité de manger et de boire quand je le souhaite.
- Je ne peux plus manger les aliments et les boissons que j’aime.
- Je ne peux plus ingérer la quantité qui me convient.
- Je n’ai plus la capacité physique de sortir à l’heure et avec qui je veux, sans avoir besoin de préparer mon corps pendant plusieurs jours.
- Je ne suis plus capable d’aller à la patinoire avec mes enfants, de prendre le train ou l’avion et faire des voyages longs sans une organisation sans faille.
Concernant la patinoire, il faut savoir que le patinage artistique est mon sport préféré et que j’en ai fait plusieurs années durant. C’est un sport particulièrement intense, car il faut lutter contre le froid et rester très concentrée pour les figures artistiques. Aujourd’hui, je n’ai plus la capacité physique d’en faire comme avant, car le froid accélère le transit et occasionne des crampes intestinales.
Il n’y a pas seulement les fonctionnalités du rectum dont j’ai dû faire le deuil, mais aussi celles des organes à proximité. Ma qualité de vie en tant que femme a été brûlée avec la radiothérapie et la chirurgie. Je ne suis pas la seule à avoir eu ce type de dommages collatéraux. Je sais d’ailleurs que pour d’autres femmes, c’est bien pire ! Il me semble essentiel de le faire savoir. Quant à mes capacités physiques liées plus directement à la fatigue et moins à la résection, je dirai que j’étais déjà bien épuisée avant le diagnostic du cancer mais que je savais allègrement tirer sur la corde, car j’étais alors convaincue qu’elle ne céderait jamais. C’était une fatigue dont j’étais persuadée qu’elle était résorbable avec un sommeil récupérateur. Je ne faisais plus du tout d’activité sportive, car je courais déjà derrière le temps et derrière mes deux enfants qui avaient alors 7 et 10 ans. De façon très factuelle, il m’arrivait souvent de rester avec mon manteau dans la salle de bain pour donner la douche à mes deux filles, tout en tenant un minuteur permettant de surveiller la cuisson du dîner que j’avais lancé. Courir à toutes les occasions possibles pour ne pas perdre de temps était devenue une seconde nature.
Quand le diagnostic a été posé, et que j’ai dû arrêter mon activité, cela a diminué mon nombre de pas de course quotidienne et les occasions d’en faire, tout en augmentant ma charge mentale. Je me suis alors rendu compte à quel point j’étais devenue dépendante du rythme marathonien effréné que je m’imposais depuis plusieurs années pour éviter de m’écrouler. Il m’a fallu quelques mois pour m’acclimater à ce nouveau rythme profondément injuste. Or, le corps médical ne m’a jamais orienté vers une activité physique adaptée. Je n’ai eu aucune recommandation ni aucun conseil à ce sujet. J’ai donc vraiment fait selon mon intuition et mes ressentis.
Bouger son corps
Comme j’étais en arrêt de travail, je n’ai pas osé m’inscrire à une activité sportive de peur de rencontrer des collègues qui ne comprendraient pas pourquoi j’aurais été en mesure de pratiquer un sport, mais pas d’aller travailler. Je n’ai donc pas fait d’activité physique pendant plusieurs mois. J’ai accepté la sentence de devenir patiente, ce qui s’est principalement traduit par devenir l’esclave de la maisonnée. Je suis rentrée dans mon rôle de mère au foyer en mettant encore plus d’énergie à m’occuper de mes enfants. Je culpabilisais tellement d’être à la maison. Je me suis donc bien empâtée.
Lorsque l’ambulancier qui me conduisait tous les jours aux séances de radiothérapie m’a appris qu’il se préparait pour un trail dans les Pyrénées, je me suis dit qu’il fallait que je bouge mon corps. Pendant cette courte période, je suis sortie marcher de temps en temps. Et il est indéniable qu’il est bien plus bénéfique et agréable de marcher en pleine nature que de piétiner en faisant le ménage et en s’occupant des enfants ! Toutefois le déclic de me remettre au sport s’est produit longtemps après la fin des traitements actifs, puisque les séquelles postopératoires ne me permettaient pas de faire grand-chose. C’est quand j’ai acquis le dispositif que j’ai véritablement recommencé à bouger. Sans lui, il m’arrivait d’être obligée de rester six à huit heures par jour aux toilettes. Mon autonomie était réduite à néant. Je me faisais livrer les courses et je restreignais mes déplacements aux seuls allers-retours nécessaires pour mes enfants.
Une fois que j’eus pris l’habitude d’utiliser le dispositif et que j’ai été mise en invalidité – qu’il était donc officiel que je n’étais plus capable de reprendre mon travail – je me suis sentie plus libre de m’inscrire à une activité sportive. Je me suis inscrite au tennis de table à l’UTL3, car les horaires correspondaient avec l’horaire du dispositif et que j’aimais beaucoup ce sport. De plus, je me suis dit qu’au vu de l’horaire matinal, il me resterait la journée pour récupérer de l’effort réalisé. Malheureusement, je n’ai pas du tout été incluse dans ce groupe de personnes retraitées, en bien meilleure forme que moi. Dans la mesure où mon handicap est invisible et que j’étais bien plus jeune, j’ai rencontré beaucoup d’incompréhension et de questionnements. Comme je n’avais pas du tout envie d’expliquer pourquoi je me retrouvais parmi les retraités, j’ai très vite abandonné.
Je me suis ensuite inscrite à des séances de yoga avec une amie très chère. Même si l’horaire du cours était très proche de celui de mon lavement, je voulais être avec des personnes de mon âge qui ne me poseraient pas de questions. J’ai toutefois dû abandonner très vite pour des raisons d’organisation avec mon handicap. En outre, pendant les séances de yoga, on fait travailler la respiration abdominale. Cela était douloureux à cause des adhérences causées par l’opération. Certaines postures étaient par ailleurs difficiles à tenir, car j’avais terriblement peur d’avoir des gaz intestinaux : je n’avais pas envie de vivre de moment gênant. En parallèle, j’avais commencé le programme Defacto avec la Ligue contre le cancer. Celui-ci consistait en un accompagnement personnalisé d’activité physique adaptée, destiné aux patients ayant terminé les traitements actifs. Cela m’a vraiment aidée à reprendre confiance en moi et en mon corps. Durant tout le programme, j’ai été accompagnée par une ingénieure en activité physique adaptée et j’ai repris plaisir à marcher. J’ai même embarqué deux amies dans ces balades en pleine nature. Grâce à cette activité physique, j’avais de nouveau des relations sociales agréables. Aujourd’hui, après Defacto, je ne peux que constater que les impératifs de la vie ont repris le dessus pour mes amies et moi-même. Je ne prends plus le temps d’avoir une activité sportive. Néanmoins, j’envisage sérieusement de reprendre un sport doux en septembre prochain.
Quelle emmerdeuse !
Depuis les traitements, il faut que je compose avec un système digestif dysfonctionnel. En plus du dispositif, je suis astreinte à un régime sans lactose, sans gluten, sans œufs, et avec un minimum de fibres. C’est en ayant fait des expérimentations alimentaires que je me suis rendue compte qu’avec le dispositif et ce régime draconien, je pouvais avoir une autonomie d’environ 24 heures. Quand je dois sortir manger hors de chez moi, j’évite de dire le mot cancer : je parle de graves allergies alimentaires pour justifier mon régime. Quand je vais chez des amis ou dans ma famille, j’apporte toujours mon panier-repas. Quand je suis au restaurant, je m’arrange pour faire un grand sourire au personnel de service avant d’annoncer qu’il va falloir apporter quelques modifications au plat que je commande. Ça se passe généralement bien.
J’ai cependant le souvenir d’un repas très gênant. C’était une occasion spéciale, et un traiteur avait la charge du repas. Il avait été prévenu de mon régime alimentaire, mais il n’arrivait pas à me mettre dans une case : pas végétarienne, pas végane … très certainement une emmerdeuse ! Pour faciliter sa tâche, je lui avais donné un exemple de repas que je peux manger : viande ou poisson non gras avec des pommes de terre vapeur. Cela a semblé être tellement problématique pour lui que j’ai fini par quitter la table pour m’isoler et manger mes tartines craquantes sans gluten ni lactose. J’avais les yeux rouges de colère, de tristesse et de honte, car j’étais passée pour celle qui exige n’importe quoi, alors que j’avais juste très faim mais qu’il m’est impossible de faire un écart dans mon régime alimentaire, au risque d’en pâtir par la suite.
La gaussienne
Classiquement, quand on est malade (angine, otite, etc.) notre médecin nous donne des médicaments pour guérir. Il y a un temps de traitement, puis un de convalescence et une fois la guérison complète, on retrouve notre vie avec l’énergie d’avant la maladie. Il m’est arrivé d’espérer que la fatigue ressemble à une courbe de Gauss, je veux dire que j’avais imaginé que la fatigue allait augmenter avec les traitements contre le cancer, comme une gaussienne, jusqu’à atteindre un sommet pour ensuite redescendre jusqu’au niveau de fatigue que j’avais au moment du diagnostic. Il m’arrivait même d’espérer que ce niveau final serait moins élevé qu’initialement, puisque j’allais enfin être guérie du cancer. J’idéalisais alors complètement les potentialités de récupération de mon organisme : non, la fatigue ne ressemble pas à une gaussienne.
Dans le cas précis de mon cancer, j’envisageais que les traitements me permettent à plus ou moins long terme de retrouver ma vie d’avant. Et comme je serai guérie, ma qualité de vie ne pourra en être que meilleure. Ce qui s’est réellement passé est tout autre. Comme je l’avais prévu, ma fatigue a effectivement augmenté tout au long des traitements actifs contre le cancer pour atteindre un sommet. J’ai atteint le maximum à la fin des traitements. Ce niveau n’est pas redescendu tout de suite, il a pris tout son temps. Mon chirurgien m’avait dit d’être patiente pour récupérer mes fonctionnalités digestives. Il m’avait dit que cela prendrait une année, voire deux. Il m’avait toutefois informée qu’après ce délai, il n’y avait que très peu d’espoir d’amélioration. J’avais donc en tête de récupérer un transit intestinal et une fatigue acceptable à l’issue de ce délai médical. Au bout de deux ans, je n’ai pu que constater que je n’avais récupéré ni l’un ni l’autre ! Mon transit intestinal était toujours chaotique et le niveau de fatigue auquel je devais faire face était bien plus élevé que celui que j’avais au moment du diagnostic.
Quant à ma qualité de vie, dans la mesure où elle est de fait intimement liée à mon
transit et à la fatigue, elle en a été inexorablement et durablement altérée. J’ai
depuis pris conscience que les traitements que j’ai eus pour lutter contre ce cancer
avaient comme seul et unique but de prolonger ma vie.
Me résigner aux effets secondaires et aux séquelles des traitements est compliqué
dans la mesure où je n’avais pas de symptômes handicapants avant. J’ai le sentiment
que c’est très probablement ici la différence significative entre rémission et guérison.
Est-on fatigué de la même manière si on est guéri d’une maladie ou en rémission d’un
cancer ? Pour ma part, la réponse est clairement non.
Concernant mon niveau de fatigue avant / après, je peux constater que je suis bien plus fatiguée après la maladie, tout en étant pourtant bien plus sédentaire qu’avant. Je suis plus souvent assise, notamment pour faciliter la gestion de mon handicap invisible. Par ailleurs, je suis contrainte à un régime qui me prive de vitamines et de minéraux essentiels. Leurs réserves s’épuisent donc inéluctablement, engendrant aussi de la fatigue.
Aujourd’hui la gestion de mon handicap impose que la plupart de mes activités puissent s’effectuer en visioconférence. La gestion de ce handicap est très exigeante. Pallier l’absence d’un organe socialement vital est éprouvant. Puisque je ne travaille plus, l’énergie que je mettais dans mon emploi est désormais répartie entre le peu de sorties que je fais et l’organisation physique, mentale et familiale liée à l’utilisation du dispositif. Par ailleurs, comme mes enfants sont plus grandes, je n’ai plus à courir derrière, mais gérer l’adolescence de ses enfants demande une autre forme d’énergie.
Voici deux exemples très concrets de ma fatigue avant/après :
- Avant le cancer, je pouvais monter et descendre un nombre incalculable d’étages, même si je me sentais fatiguée. J’aimais beaucoup défier ma fatigue. Aujourd’hui, je suis beaucoup moins dans le challenge et je privilégie l’ascenseur, car je fatigue particulièrement vite. L’ascenseur me permet d’éviter les palpitations cardiaques induites par l’effort de l’ascension, mais surtout, cela m’épargne l’accélération du transit intestinal. Avoir un transit rapide implique que je suis contrainte de réutiliser le dispositif qui m’épuise et m’isole longuement dans la salle de bain.
- Avant, en tant que femme et maman, il m’arrivait tous les jours de lancer plusieurs tâches en même temps et de les gérer de façon parallèle. Aujourd’hui, j’en suis nettement moins capable, et je le fais beaucoup moins fréquemment. Le fait que je ne travaille plus me permet de faire les choses les unes après les autres. D’ailleurs, pourrais-je faire différemment aujourd’hui ? Le retour à ma vie d’avant n’est évidemment pas possible avec ce niveau de fatigue et de handicap. Jour après jour, je m’attelle donc à construire ma seconde vie d’après cancer sur un modèle d’accomplissement bien différent du niveau de performance attendu par la société actuelle.
J’ai une dernière remarque au sujet de la fatigue : de mon expérience subjective de personne malade du cancer, j’ai le sentiment que le mot fatigue est l’un de ceux qui prêtent le plus à interprétation. Il dépend non seulement de la personne qui le prononce, mais aussi de celle qui l’entend. De là, naissent de grandes incompréhensions qui peuvent nuire à sa prise en charge. Si la loi de mars 2004, relative aux droits des malades, stipule que toute personne a le droit de recevoir des soins pour soulager sa douleur, qu’en est-il de celui de bénéficier de soins pour soulager sa fatigue ?
Violences médicales ordinaires
Je viens de vous livrer une partie de ma vie vue sous le prisme de la fatigue liée au cancer. Pour autant, il existe des variations que l’on ne peut nier, qui sont relatives à la vie des personnes malades. J’ai le sentiment que le personnel de santé et la société tout entière sous-estiment à quel point la situation sociale est importante dans le processus de rémission / guérison. Avec mon expérience subjective de la maladie, j’imagine facilement que, dans certains cas, les patients et patientes ne peuvent pas se rendre à certaines consultations, voire refuser catégoriquement ou abandonner les traitements, tellement ceux-ci sont lourds ! C’est pourquoi la fatigue causée par le cancer ne peut être dissociée de celle du parcours de vie de chaque personne.
Je me rends compte à quel point ma situation de femme et de maman isolée a complexifié ma prise en charge. Dans ma vie d’avant, je n’avais vraiment pas le temps de me préoccuper de ma santé. Mes enfants étaient toutes deux grandes prématurées, alors je m’occupais de leur santé, laissant la mienne sur le bas-côté, faute de temps et d’énergie. Cela a contribué à retarder le moment où je me suis dit que les symptômes que j’avais méritaient une investigation plus poussée. Bien évidemment, cela a également eu une incidence sur le diagnostic et le parcours de soins. Quant au moment du diagnostic, je ne me suis pas demandé comment j’allais guérir, mais comment j’allais m’organiser pour que mes enfants aient le moins de modifications et de répercussions dans leur quotidien.
Par ailleurs, la région pelvienne, où se trouve le rectum, est particulière pour les femmes, puisqu’elle est un des lieux de la vie sexuelle et le siège de la gestation. Pourtant, à aucun moment de mon parcours de soins cet aspect de ma vie n’a été abordé par le corps médical. Était-ce parce que j’étais déjà maman ? La sexualité féminine ne serait-elle utile que pour sa fonction reproductrice ?
La première fois que j’ai été contrainte de passer une IRM du rectum, je suis sortie de l’examen en état de choc et je me questionne encore sur la notion de consentement dans ce cas… Cet examen spécifique implique l’injection d’un produit de contraste non seulement dans le bras, mais aussi par voie rectale. Personne ne m’avait prévenue : ni le prescripteur ni le manipulateur avant l’examen. Après m’avoir injecté le liquide dans le bras, ce dernier s’est approché avec le contenant de la solution à mettre dans le rectum. « On ne vous a pas prévenue ? Mais c’est pourtant comme ça que ça doit se passer, madame. » Cette situation m’a plongée dans un état de sidération et j’ai été traumatisée.
La violence de l’IRM n’a malheureusement pas été isolée, puisqu’elle est le reflet d’une faille dans notre système médical et, plus largement, dans notre société. Au tout début de mon parcours, le premier chirurgien que j’ai rencontré me faisait le retour de la réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) : « Madame, vous êtes une femme éduquée, vous pouvez comprendre. » Cela m’a grandement interpellée quant à la façon dont cet homme percevait les femmes et les personnes n’ayant pas fait d’études. Comment se comportait-il avec elles ? Je n’ai évidemment pas voulu que ce soit lui qui m’opère.
Un jour je me suis plainte à un anesthésiste des conséquences des traitements contre le cancer, notamment de mon quotidien sans rectum. À l’époque, je ne bénéficiais pas encore du dispositif infirmier, et je passais entre cinq et huit heures par jour coincée aux toilettes. L’anesthésiste a eu cette phrase que j’ai trouvée scandaleuse : « Mais madame, estimez-vous heureuse d’être en vie pour votre mari et vos enfants ! » De colère, je me suis alors murée dans le silence, d’une certaine manière, ma vie était entre ses mains, puisque c’était lui qui me réanimerait si l’intervention ne se passait pas bien. Je n’ai rien verbalisé, mais je pense que mon regard devait en dire long. Mon projet de vie peut-il se résumer, pour certaines personnes, au seul fait d’être épouse et mère ?
La violence, c’est aussi toutes ces fois où j’ai dit : « J’ai mal, mais tellement mal », et où l’on m’a répondu : « Je ne comprends pas que vous ayez si mal, ce n’est pas possible… ». Pourtant, aujourd’hui, on sait que les femmes perçoivent plus rapidement la douleur et que la tolérance en est plus basse, notamment quand celle-ci est d’origine abdominale. En plus, les cancers digestifs sont ceux que l’on sait être les plus douloureux. Pourquoi nombre de professionnels de santé remettent toujours en question la parole des malades ?
Devant autant d’évènements, je me suis interrogée, notamment sur ma façon de communiquer sur ce que je pouvais ressentir. Mais le problème ne venait-il que de moi ? Tout m’a semblé fluide et simple lorsque j’ai eu une femme oncologue remplaçante. Je me suis enfin sentie comprise dans les douleurs et dans ce que je ressentais concernant les violentes diarrhées et la ménopause brutale. Malheureusement, elle suivait les cancers du sein, je n’ai donc pas pu la revoir.
Au regard de mon expérience subjective de patiente, même si mon histoire remonte déjà à quelques années et que je suis convaincue aujourd’hui que les lignes sont en train de bouger, il me semble qu’il est important de replacer la voix des malades au centre des soins et de ne pas se voiler la face quant aux inégalités de santé basées sur le genre. Il serait aussi nécessaire de réaliser un bilan social systématique. Pourquoi ne pas élaborer un plan d’accompagnement social spécifique à la maladie cancéreuse, qui pourrait être mis à jour durant le parcours ? Il y a bien une consultation d’annonce, pourquoi ne pas prévoir une consultation de bilan social avec le personnel soignant compétent ? La médecine traitante a certainement un rôle central à jouer, néanmoins, aujourd’hui encore, les décisions sont souvent prises sans consulter ces médecins – qui connaissent pourtant leurs patientèle – quand le parcours des traitements actifs débute.
N’allez pas croire, après ce récit, que la vie que j’ai aujourd’hui n’est pas palpitante. C’est même tout l’inverse ! Oui, la vie est dure, mais je ris, j’observe le rythme des saisons, je m’active, je m’engage et je lutte à mon niveau pour des soins plus justes et des valeurs qui m’animent. Aujourd’hui, je suis entourée par des amies précieuses sans lesquelles je n’aurai pas été en capacité d’écrire ce texte. Je leur dédicace ce texte ainsi qu’à toutes les personnes fatiguées par le cancer ou pas et qui doivent tous les jours sortir de leur zone de confort.