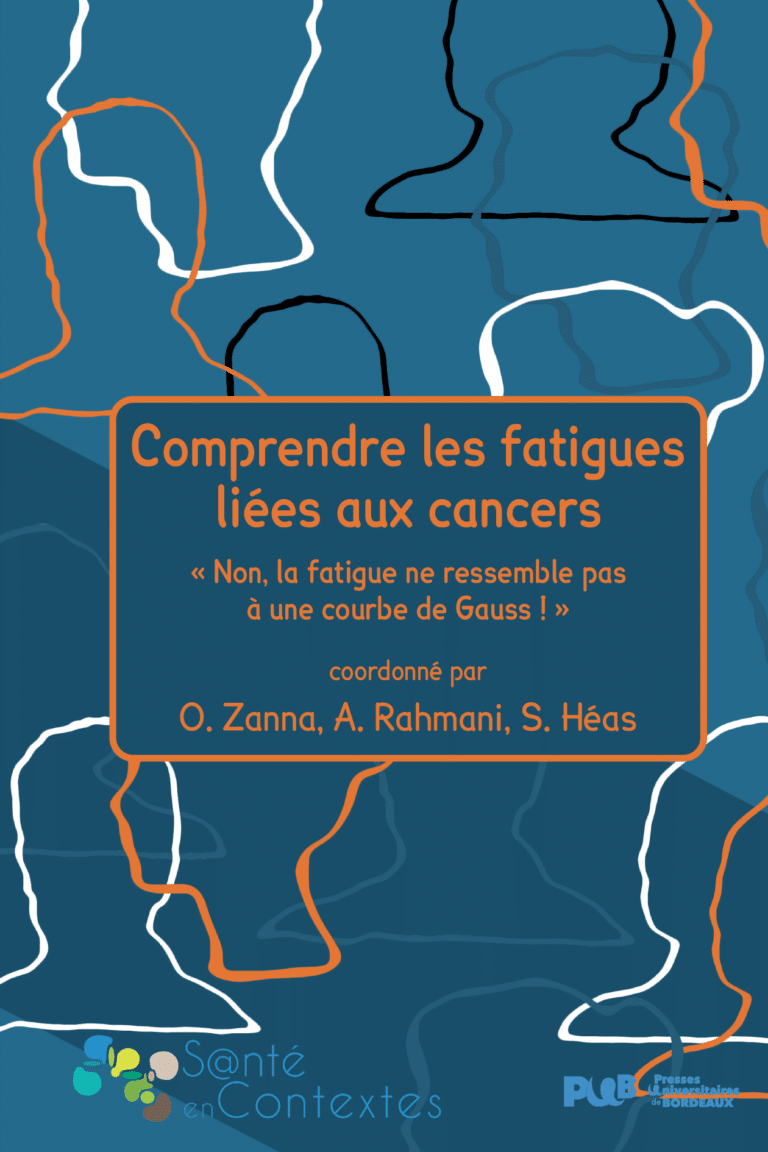Interlude N° 3
Karelle (45 ans) est suivie pour un cancer du sein depuis quatre mois. Entretien réalisé le 14 avril 2022 lors de sa 7e séance dechimiothérapie.
K : (…) Dès qu’on fait quelque chose en fait. La fatigue nous tombe dessus et on ne peut plus… On ne fait plus rien derrière. Et ça ne sert à rien de buter. Donc il faut aller s’allonger, il faut apprendre à se reposer, quoi.
V : Est-ce que vous percevez des différences dans votre sensation de fatigue ? Par rapport à la fatigue que vous connaissiez d’habitude, suite à une journée de travail…
K : Oui. Ah oui. En fait, c’est différent. La journée de travail, on fait la journée de travail ; le soir, quand on rentre, il y a l’activité familiale derrière, donc on est toujours sous tension. Enfin voilà, il faut y aller. Le soir on est posé. Le soir on est posé, on est fatigué par une journée de travail, on est fatigué mais sans être… Comment dirais-je… lourd. Que là avec la chimio, donc moi je travaille plus mais… Passer l’aspirateur, ça me demande un effort mais presque insurmontable. Et du coup notre corps, enfin moi mon corps, je le sens, s’affaiblir, à chaque fois que je fais un geste. Donc en fait, quand je dis « la grosse fatigue qui tombe », c’est vraiment mon corps qui lâche. Enfin, je n’ai plus de jambes, ça commence par les jambes en général, les sueurs, parce que bah voilà, la grosse fatigue… du coup quand on en arrive là, il faut apprendre à éteindre l’aspirateur et aller s’allonger parce que sinon… enfin je peux vite tomber par terre quoi. Donc la différence c’est que tout vient d’un coup. En fait ça tombe… Un petit effort va devenir une énorme fatigue quoi, finalement.
Dans cette étude, moi ce que je me pose comme question… Ma tumeur, on me l’a détectée en septembre. Mais ça fait deux ans que je sens une grosse fatigue. Est-ce que cette tumeur, elle n’a pas mis deux ans à mûrir, et que cette fatigue est déjà liée au cancer ? (…) Mais quand je dis fatiguée, c’est… Il y a des moments, je suis épuisée. Il y a des choses que je pouvais faire avant, que je ne peux plus faire maintenant parce que ça m’use ! (…) Tout me coûte, parce que je suis rincée. Je n’ai rien fait, mais je suis rincée. Si en plus avec la chimio, il y a des effets de fatigue… Je ne sais pas comment on va me retrouver. En carpette, peut-être. (Rachelle, 67 ans. Entretien T0 réalisé le 17 décembre 2021)
C’est dans la chambre 16 du service d’oncologie du centre hospitalier du Mans (72) que nous avons rencontré Rachelle, lors de sa première séance de chimiothérapie. Emmitouflée dans un plaid et somnolant sous son casque réfrigérant1, elle indique se sentir détendue et plutôt confiante quant à la prise en charge de sa maladie. Ce qui n’était pas le cas les semaines précédentes. Veuve d’un mari décédé d’un cancer du poumon il y a quelques années, Rachelle relate une difficulté à prononcer ce mot « cancer » et préférait dire qu’elle avait une « tumeur au sein ». Si aujourd’hui elle parvient à dire ce mot et s’estime « plutôt confiante », c’est notamment parce que « c’est quand même un des cancers qui se soigne le mieux ». Au moment de notre première rencontre, Rachelle est suivie depuis quatorze semaines pour un cancer du sein de stade 2. Après avoir subi une tumorectomie, elle entame un premier protocole de trois séances de chimiothérapie, à vingt et un jours d’intervalles, avant de poursuivre sur un second protocole de douze séances de chimiothérapie pendant douze semaines.
Dès notre premier entretien, Rachelle souligne combien elle se sent déjà extrêmement fatiguée. Très au clair sur les enjeux de l’étude BIOCARE FActory (cf. 39), elle est d’autant plus intéressée par cette recherche qu’elle s’interroge, elle aussi, sur les origines de cette sensation d’épuisement persistante qui entrave son quotidien depuis plusieurs mois : cette fatigue n’était-elle pas la manifestation somatique de son cancer latent ? Surtout, la connaissance et l’anticipation des nombreux effets secondaires induits par les traitements anti-cancéreux lui laissent craindre une période particulièrement éprouvante : cette fatigue inhérente à la chimiothérapie et à la radiothérapie va-t-elle s’ajouter à une fatigue déjà omniprésente et la contraindre à l’alitement ? Six mois plus tard, lors de notre deuxième entretien, voici ce que Rachelle affirmera à propos de la fatigue perçue, en faisant référence à l’un de ses amis ayant récemment eu un cancer :
C’est vrai que notre ami nous disait tout le temps qu’il était fatigué. Même moi, je disais qu’il en rajoutait… On lui fait tout, il ne fait rien de la journée… Et il n’y a pas très longtemps, j’ai discuté avec mes amis en leur disant : « Vous vous rappelez de Georges, quand il disait qu’il était fatigué ? Et bien je crois que tant que l’on n’a pas un cancer, on ne sait pas ce que veut dire le mot fatigué. »
Quelques jours plus tôt, nous rencontrions Molly (58 ans), cette fois-ci à la clinique Victor Hugo, pour sa première séance de chimiothérapie. C’est en salle d’attente, avant d’être installée dans la chambre, que nous avons pu faire connaissance de manière informelle. Récemment à la retraite, Molly est suivie pour un cancer du sein de stade 3 depuis près de dix semaines, et s’est fait retirer la tumeur. Comme Rachelle, elle préfère utiliser un autre mot que celui de « cancer », notamment pour en parler avec ses proches : « Le vrai mot, c’est carcinome » nous dira-t-elle par la suite. Notre conversation porte rapidement sur l’intérêt de pratiquer de l’activité physique, y compris lors de la période des traitements, ce qui l’enchante. Sportive et soucieuse de rester active, elle déplore le peu d’informations transmises à ce sujet par l’oncologue et le fait savoir plus amplement lors de notre entretien :
Il ne sait pas si je fais du sport ou pas. Il ne le sait pas. S’il m’avait posé des questions, j’aurais pu lui dire, mais non, j’étais là en attente… avant d’ajouter : J’avais peur de ne plus pouvoir faire ça aussi. (…) Si on me dit qu’il faut faire de l’activité physique pour aller mieux, c’est que je vais pouvoir bouger, donc sortir de mon lit ? Ça me rassure.
Si ces bribes d’informations transmises sur le rôle de l’activité physique la rassurent autant, c’est parce qu’elle redoute, elle aussi, les effets secondaires des traitements, notamment la fatigue : « J’ai vraiment envie que ça ne m’arrive pas. Tout le monde me dit : « mais c’est pas sûr ». Alors on verra, mais je ne veux pas de fatigue… Je ne veux pas ». Dans son objectif de « toujours pouvoir faire ce que j’ai envie de faire », l’apparition et la gestion de la fatigue cristallisent beaucoup d’appréhensions et se trouvent parfaitement résumées dans cette formule : « c’est l’idée d’être fatiguée qui me fatigue ». Néanmoins, à la différence de Rachelle, Molly semble entretenir un tout autre rapport à la fatigue :
En fait, quand on dit « tu vas être fatiguée », je ne sais pas ce que ça veut dire, être fatiguée. Parce que moi, je n’ai jamais été fatiguée. Est-ce que ça veut dire que je vais être dans mon lit toute la journée, sans pouvoir bouger ? C’est ça qui me fait peur aussi.
Un an plus tard, lors de notre troisième rencontre, Molly en a terminé avec les protocoles de chimiothérapie et de radiothérapie : c’est la rémission. Cela signifie qu’elle n’a plus de traitements, mais reste régulièrement suivie par son oncologue pour prévenir le risque de récidive. Si elle estime avoir « bien supporté » la période des traitements, elle rapporte tout de même une perte de vitalité évidente :
Je fatigue vite, en fait. Hier, je suis allée marcher, et en revenant j’étais… alors je ne suis pas allée loin hein, vraiment, pas du tout… Mais ouais, j’ai mal aux articulations, voilà. Du coup, j’ai plus de difficulté, physiquement, à tenir la cadence.
Molly a continué à pratiquer de l’activité physique tous les jours, tout au long de son parcours. Ceci ne l’empêche pas de se sentir parfois impuissante devant son corps qui lui échappe et n’est plus comme avant : « Comme hier pour la marche, il était temps que j’arrive, j’en avais marre, alors que je n’étais pas loin du tout. » Au moment de décrire ses sensations, elle évoque alors une fatigue « qui tombe », et la « stoppe », pas forcément plus intense, mais « c’est là, c’est comme ça. Ce n’est pas tous les jours, mais c’est régulier ».
Comme la quasi-totalité des malades aux prises avec le cancer, Rachelle et Molly semblent éprouver ce qu’il est désormais commun de qualifier de « Fatiguée Liée au Cancer » (FLC) (Berger et al., 2015 ; Bower, 2014 ; Chartogne & Landry, 2021). Du point de vue de la littérature scientifique, elle se définit comme :
Une sensation subjective pénible et persistante d’épuisement physique, émotionnel et / ou cognitif lié au cancer et / ou à son traitement qui n’est pas proportionnelle aux activités récentes et qui interfère de manière significative avec le fonctionnement quotidien (O’Higgins et al., 2018).
Plus harassante et plus durable, cette sensation est, du point de vue des patients, d’une tout autre nature que l’état de fatigue communément accepté (Holley, 2000 ; Wu & McSweeney, 2007). La FLC peut se révéler dès le début ou au cours de la prise en charge et persister parfois des années après le protocole de soin (Ebede et al., 2017). Parce qu’elle altère considérablement la qualité de vie des malades, la prise en charge de cette FLC est déterminante pour leur garantir un accompagnement de qualité, et ce, tout au long du parcours de soin. À cet égard, les propos de Rachelle et Molly suffisent à donner un aperçu de la nécessité d’envisager sa prise en considération dans l’orientation thérapeutique autant que de la complexité d’étudier ce phénomène de fatigue : que veut dire être fatiguée, aujourd’hui ? En quoi la FLC est-elle si singulière ? Comment évolue-t-elle tout au long du parcours de soins ? Dans une moindre mesure, quel est le rôle de l’activité physique dans cette gestion de la fatigue ? Loin d’être réductibles aux cas de Rachelle et de Molly, ces quelques questions traversent l’ensemble des discours des 26 patientes rencontrées, à plusieurs reprises2, dans le cadre du projet BIOCARE. Elles vont nous servir de point de départ pour cette chronique visant à rendre compte des variations de ces sentiments de fatigue tout au long de leur parcours de soin, non sans avoir, au préalable, présenté le cadre théorique et méthodologique de notre enquête.
Approche sociologique de la fatigue
La FLC représente un objet de recherche largement étudié et laisse supposer des interactions complexes et systémiques entre différentes dimensions telles que les sciences biologiques, psychologiques et sociologiques (Chartogne et al., 2021). Toutefois, la plupart des études menées ces dernières années se concentraient sur une seule dimension de la FLC et n’envisageaient pas d’évaluations répétées à moyen et long terme. C’est pourquoi, dans le cadre du projet BIOCARE FActory, l’option de considérer l’ensemble des dimensions de la fatigue – en interaction – a été retenue, dans une perspective longitudinale. À partir du modèle théorique proposé par McNeely et Courneya (2010) et de l’identification de mécanismes directs (biophysiologiques) et indirects (psychologiques, comportementaux, sociaux), l’étude se propose d’investiguer les différentes dimensions de la FLC en procédant à un suivi de 200 femmes diagnostiquées d’un cancer du sein, pendant dix-huit mois. Suite à l’annonce de leur maladie (T0), puis tous les six mois (T6, T12, T18), ces femmes participent à une session d’évaluation visant à recueillir des données anthropométriques, biologiques, cliniques, psychologiques et sociales. Afin de nourrir le modèle expérimental, chacun des tests vise à mesurer une certaine expression du vivant pour ensuite comparer les résultats, les classifier, et faire émerger des profils de fatigue. À terme, l’objectif est de prédire, tel un algorithme, son apparition, son origine, sa dynamique selon les différents temps de la maladie, sa persistance pour chaque individu et d’être en mesure de proposer les soins de support adaptés pour limiter son effet. C’est dans cette ère de la quantité (Guénon, 1945) que l’approche sociologique entend apporter un éclairage qualitatif avec la réalisation d’entretiens semi-directifs compréhensifs (Kaufmann, 1996) aux différentes étapes du parcours. L’occasion de réactualiser le travail de Marie Ménoret sur les temps du cancer (1999).
Dans son analyse, la sociologue décrivait les séquences successives vécues par les malades, dans une approche interactionniste. Elle appréhende l’expérience de la maladie en resituant la personne malade dans son environnement social et reprend à son compte la notion de trajectoire, telle que définie par Anselm Strauss (1992)3. De l’entrée dans la maladie à la rémission, elle analyse le travail de gestion mis en œuvre par les différents acteurs au fil des séquences. Au-delà de souligner combien le parcours de la maladie s’apparente, pour le malade et son entourage, à un apprentissage, fait d’incertitudes, d’espoirs, et de négociations (Baszanger, 1986), son travail confirme la dimension processuelle de la maladie et nous invite à apprécier l’évolution de ce phénomène de fatigue, tel qu’éprouvé par les malades aux différents temps de la maladie.
En complément des tests cognitifs, des tests de contrôle postural, des tests de fatigabilité neuromusculaire, des tests d’aptitude cardiorespiratoire, de l’analyse de la qualité du sommeil, du niveau d’activité physique des trois derniers jours et des questionnaires, un entretien d’une quarantaine de minutes était réalisé avec la patiente, en présentiel ou par visioconférence, pour recueillir son point de vue. Tandis que l’ensemble des tests vise à mesurer et objectiver un certain état de fatigue, l’approche compréhensive adoptée ici, inscrite dans un prisme phénoménologique, cherche à restituer l’expérience vécue de la fatigue telle qu’elle est perçue et ressentie par les malades. Partant du postulat que la fatigue relève de l’expérience sensible, par définition subjective, son étude empirique ne saurait se réduire aux évaluations numériques et à la conceptualisation rationnelle (au sens étymologique de « calcul »). Lorsque nous invitons une personne à en faire le récit de son expérience, l’enjeu est bien d’explorer son rapport subjectif et incarné à la fatigue, en vue d’en apprécier la qualité et le sens. Les entretiens successifs menés avec les patientes nous ont alors permis d’entreprendre cette chronique non pas de la fatigue, mais des fatigues.
Quelles fatigues ?
Tantôt interprétée comme « bonne », après un effort consenti, comme la pratique d’une activité physique, ou « mauvaise », lorsqu’elle échappe à la volonté du sujet, parfois qualifiée de « psychique », « mentale », ou « psychologique », la fatigue est toujours définie, nous précise David Le Breton (2016), « au sein de circonstances précises et selon la part qu’y prend » ce dernier (114). À ce titre, et bien que l’ensemble des patients s’accorde sur le caractère inhabituel de la fatigue ressentie, celle-ci n’est pas uniforme. Comme l’illustrent les témoignages de Rachelle et Molly, l’expérience de la fatigue se donne à dire, à entendre, et parfois à voir, dans un large spectre, toujours marquée du sceau des contextes sociétal et culturel dans lesquels l’individu est immergé. Un détour par une perspective socio-historique rappelle d’ailleurs que la fatigue, si elle est inhérente à notre condition d’être vivant, n’a plus la même acception et s’est étendue dans toutes les sphères de la vie quotidienne (Vigarello, 2020). Autrefois symptomatique d’un affaiblissement physique, elle renvoie davantage à la surcharge mentale et à la dépression pour bon nombre de contemporains (Huët, 2021). Surtout, la fatigue semble caractériser la manière dont les individus éprouvent le monde, indépendamment de la présence de la maladie et des traitements anti-cancéreux. Elle renvoie à une problématique collective non réductible à un état individuel et peut, à ce titre, être considérée comme un « fait social », voire comme un « fait social total », à savoir « un phénomène qui dépasse le corps individuel et le diagnostic médical et dont les discours à son propos expriment quelque chose de la société et des acteurs qui la composent » (Charmillot, 2016, 75). L’étude de la FLC, aussi spécifique soit-elle, ne peut dès lors faire l’économie d’une prise en compte de l’univers de sens qui cimente les relations sociales des individus et nous invite à interroger le récit qu’ils en font.
L’enquête menée par Sophia Rosman (2004) auprès des patients atteints d’un cancer avait d’ailleurs permis de mettre en évidence trois manières différentes d’interpréter la fatigue. Si ce symptôme était effectivement ressenti par la quasi-totalité des patients rencontrés (33 sur 35), son expérience pouvait tantôt être « positivée », lorsqu’elle était considérée comme un baromètre de l’efficacité des traitements et associée à l’espoir de guérison, ou « normalisée » lorsqu’elle était interprétée comme une conséquence inévitable des traitements, et enfin vécue comme « immersive » lorsque toute la souffrance autour du cancer était exprimée à travers ce symptôme. Au-delà de rappeler combien notre manière de percevoir notre corps, nos sensations et finalement d’éprouver le monde est façonnée par nos environnements social et culturel (Boltanski, 1971), cette enquête souligne également qu’une même émotion, ici la fatigue, n’est pas vécue de la même manière et ne renvoie pas aux mêmes enjeux. Selon la temporalité du parcours du soin et le rapport que la personne entretient avec sa maladie, selon ses ressources (affectives, matérielles, économiques, sociales) à disposition au quotidien pour la gérer, selon son rapport passé à la fatigue, ou encore son investissement dans des séances d’activités physiques, les discours des patients révèlent de multiples tonalités de fatigue dont il convient d’apprécier la signification et les dynamiques sociales associées. Partant de ces considérations, il nous a alors semblé pertinent d’apprécier ce phénomène de fatigue par le prisme des sentiments.
De l’émotion de fatigue… aux sentiments de Fatigue Liée au Cancer
Si les termes d’émotions et de sentiments sont utilisés indifféremment pour parler a priori de la même chose – c’est-à-dire de la vie affective –, un détour par les neurosciences invite au contraire à envisager le phénomène de fatigue en tenant compte de cette distinction. Dans son ouvrage consacré à Spinoza, le neuropsychologue Antonio Damasio (2003) entend démontrer que les émotions et les sentiments, s’ils renvoient tous les deux au même processus homéostatique, s’expriment en revanche sous des modalités différentes : le corps pour les émotions, l’esprit pour les sentiments.
Damasio explique tout d’abord que les émotions se signalent et se donnent à voir par une modification brusque dans le rythme des expressions faciales, vocales, posturales de la personne affectée, et une tendance à l’action. Soulignons à ce titre l’étymologie du mot émotion. Celui-ci tire son origine du latin movere qui signifie « ébranler », et ex-movere que l’on traduit généralement par « mouvement vers l’extérieur ». Toujours visibles, en tant que réactions physiologiques, nos émotions seraient ainsi des expressions spontanées et transitoires du corps visant à rétablir une certaine harmonie au sein de l’organisme et / ou avec son environnement. La fatigue, comme la douleur, en tant qu’émotion, apparaît comme un signal d’alarme et contraint à l’arrêt d’un effort4, voire à l’immobilisme lorsqu’elle devient chronique. Rappelons-nous les propos de Molly quant à sa plus grande fatigabilité à l’effort.
En parallèle de ces émotions, Damasio précise que les sentiments sont toujours cachés, de l’ordre du privé. Ils renvoient à une autre manifestation de l’homéostasie, cette fois-ci dans le domaine de l’esprit : seul celui qui les possède peut les voir. En tant qu’idées du corps, les sentiments seraient ainsi l’ombre de l’émotion. On retrouve ici le postulat ontologique de Spinoza et sa réfutation du dualisme cartésien (1677). Parce qu’il s’oppose à celles et ceux qui regardent les idées comme « quelque chose de muet comme une peinture sur un tableau » (E, 2, XLII, scolie), Spinoza rappelle que l’esprit, en tant qu’idée d’un corps en acte, ne renvoie pas à celle du corps-objet, mais bien au corps vécu, animé par des émotions. C’est ce qui lui permet d’affirmer que l’esprit et le corps ne sont pas en conflit, au sein de l’individu, mais cohabitent, de la même manière que les émotions et les sentiments agissent de concert dans le processus homéostatique.
Or, comme nous l’avons vu précédemment, la fatigue (en tant qu’émotion) peut se traduire, et se donner à dire, à voir et à entendre au travers de multiples tonalités de sentiments. Dans le discours de Rachelle, pourtant extrêmement fatiguée avant le début des traitements, c’est bien le sens attribué à son expérience et la représentation de ce que veut dire « être fatiguée » qui interpellent lors du deuxième entretien. Ces propos réactualisent l’antienne des malades d’un cancer : ce n’est pas une fatigue habituelle. Comme si, finalement, leur émotion de fatigue, en tant que phénomène biophysiologique, ne parvenait pas à se traduire – socialement – en sentiment et s’inscrire dans un univers de sens partagé par le commun des mortels. Cela concourt aux éventuelles dissonances avec l’entourage et à la difficulté de la prendre en charge par le corps médical. C’est tout l’intérêt de notre investigation que de tenter d’éclairer les métamorphoses de ces fatigues, en tant que sentiments, afin d’enrichir la compréhension de ce phénomène et de garantir un accompagnement de qualité aux malades.
Loin d’être une coquetterie sémantique, l’étude de l’objet « fatigue », selon qu’il soit appréhendé en tant qu’émotion ou que sentiment, appelle à des épistémologies différentes que le projet BIOCARE entend interroger par son approche biopsychosociale. Dans cette optique, nous pourrions alors supposer que les tests de fatigabilité neuromusculaire et de contrôle postural réalisés avec les patientes, de même que l’analyse de la qualité du sommeil, visent à rendre compte d’un certain état de la fatigue, une émotion brute rendue visible par la saisie des variations quantitatives. À l’inverse, lorsque nous demandons à une personne comment elle se sent, il s’agit bien d’étudier la perception et l’interprétation de l’émotion de fatigue, comme un sentiment, autrement dit, l’idée qu’elle se fait de cette fatigue.
L’approche sociologique, telle qu’envisagée dans le cadre du projet BIOCARE, souhaite finalement rendre compte des nuances de ce sentiment de fatigue selon l’étape du parcours de soins. Les cas de Rachelle et de Molly sont considérés comme idéaux-types5. Ils feront office de fil rouge pour la narration de cette chronique des fatigues et nous serviront à illustrer les différentes manières d’habiter le monde en situation de maladie. Après avoir montré combien les sentiments de fatigue peuvent être éclairés par la dynamique des relations gravitant autour du malade (Akermann et al., 2018), la grille de lecture goffmanienne des interactions (Goffman, 1973, 1975) nous permettra de reconsidérer la notion de fatigue sociale.
La « saturation » lors de l’entrée dans la maladie
C’est-à-dire qu’il y a eu un moment, ça devenait super confus toutes ces infos que j’avais eues, aussi bien en oncologie qu’en gynécologie… (…) On m’avait dit « si vous avez des questions »… J’en ai de trop. Ça fuse dans tous les sens. Je n’ai pas le temps de les noter, ça s’embrouille. Après ben… c’est le blackout là-haut. (Rachelle, à propos de son entrée dans la maladie)
Si la plupart des cancers du sein sont aujourd’hui diagnostiqués précocement, et font effectivement partie des « cancers qui se soignent le mieux 6», il n’en demeure pas moins que l’urgence règne lors des premiers temps de la maladie. Plus rapidement est identifiée la tumeur, plus grande sera l’efficacité thérapeutique. Tel est le credo des médecins, largement repris par les malades lors de nos entretiens. Comme le révèle leurs discours, cette période de latence est particulièrement intense et génératrice d’une certaine forme de fatigue. Lorsque Rachelle raconte son parcours l’ayant conduit jusqu’à cette première séance de chimiothérapie, et décrit le sentiment qui prédomine, elle a recours au champ lexical de la « saturation ». Ce « blackout » semble effectivement traduire une fatigue largement partagée par les patientes, tantôt qualifiée de « psychologique », de « mentale », de « psychique », ou encore de « nerveuse ». L’une des patientes évoquera même une fatigue « dans le cerveau ». Un sentiment de fatigue dont il est possible d’éclairer les circonstances sociales, propres à cette temporalité.
Comme le rappelle Ménoret (1999), l’entrée dans la maladie, loin de se réduire à l’annonce officielle du cancer par l’oncologue, se déroule en trois temps s’enchevêtrant dans une course contre la montre effrénée. La période pré-diagnostic correspond au temps de latence entre la découverte d’un premier indice suspect, lors d’une mammographie de contrôle ou de manière fortuite, et l’annonce formelle de la pathologie cancéreuse. L’annonce se fait elle aussi de manière fragmentée puisque plusieurs examens se succèdent pour établir avec précision le diagnostic de la maladie : c’est la période de la divulgation du diagnostic. Une divulgation réciproque puisque c’est lors de cette période que les malades entament, à leur tour, la diffusion de l’information au sein de leur entourage. Fortement chargée émotionnellement, cette deuxième annonce est régulièrement considérée comme plus difficile à gérer que celle reçue par le médecin. La période post-diagnostique concerne enfin les semaines qui précèdent l’entrée effective dans les traitements, avec la rencontre des différents médecins en charge du protocole. C’est d’ailleurs en connaissance de cause que nous avons souhaité réaliser le premier entretien lors de la première séance de chimiothérapie, à l’issue de cette intense période.
Lors de l’entrée dans la maladie, le patient doit tout d’abord faire face au « coup de massue » non pas de l’annonce, mais des annonces du cancer, et du protocole à venir. Une fois l’identification de la tumeur et les résultats de la biopsie, d’autres examens s’enchaînent pour déceler de potentielles métastases, et avec eux l’espoir que l’annonce ne soit pas plus lourde. Déjà ébranlé par l’irreprésentabilité de l’annonce de la maladie et la réactualisation de notre condition d’être mortel, le malade est alors soumis à une attention aiguë de la part de l’institution médicale qui lui laisse peu de secondes de répit et d’intimité. La moindre parcelle de l’organisme est scrutée, palpée, examinée, mesurée afin de doser au mieux le protocole, tandis qu’il se trouve démuni dans le flux d’informations conséquent presque quotidien, transmises dans des termes pas toujours accessibles. Assigné à son nouveau statut de patient, ce dernier est entraîné dans une série d’évènements dont il est, pour reprendre l’expression de Philippe Barrier « l’enjeu plus que l’acteur » (2007, 85), et qui ne lui laissent pas vraiment le temps de penser. C’est l’une des raisons pour laquelle Molly se dit fatiguée « nerveusement » :
Moi j’aime être active. J’aime apprendre des choses, prendre des décisions. Là… Je ne fais rien. On me dit « faîtes-ci, faîtes ça ». Ça m’agace. Donc oui, nous sommes au courant de rien, on découvre tout. A la fin, on nous demande si nous avons des questions. Mais en fait, les questions, elles ne viennent pas comme ça, sur le moment. On y pense bien après, la nuit…
Au cours de cette période de chaos existentiel, leur attention tout entière est portée sur la compréhension de ce qui leur arrive et l’anticipation des évènements à venir pour conserver une certaine maîtrise, en vain. Entre les attentes des résultats de la scintigraphie et des prises de sang, la rencontre du chirurgien en prévision de la pose de la chambre implantable, la programmation de nouveaux examens, et l’élaboration du protocole de chimiothérapie et / ou de radiothérapie, le malade est dépossédé de tout pouvoir d’agir, littéralement pris en charge. Plusieurs des patientes indiquaient, à juste titre, « se laisser porter » par les directives médicales, soulignant, par la même occasion, l’impossibilité de s’extraire de ce régime temporel incertain, comme suspendu dans leur existence. Faire machine arrière n’est pas envisageable, mais il n’est pas non plus souhaitable, comme nous le dit Rachelle, de « tirer des plans sur la comète » : il faut avancer « au coup par coup ». Lors de cette période, les malades font l’expérience de l’attente, telle que formulée par Eugène Minkowski (1933) :
On dirait que tout le devenir, concentré en dehors de l’individu, fonce, en une masse puissante et hostile, sur lui en cherchant à l’anéantir ; c’est comme un iceberg surgissant brusquement devant la proue d’un navire qui viendra, dans un instant, se briser fatalement contre lui. L’attente pénètre ainsi l’individu jusqu’aux entrailles, le remplit de terreur devant la masse inconnue et inattendue, allais-je presque dire, qui dans un instant l’engloutira. L’attente primitive est ainsi toujours liée à une angoisse intense ; elle est toujours une attente anxieuse (2013, 80).
Une attente anxieuse, néanmoins mêlée d’impatience, avec la première séance de chimiothérapie en ligne de mire. Rencontrée au lendemain de sa première séance, Marie-France (50 ans, pharmacienne) résume de manière éclairante l’ambivalence de cette attente des dernières semaines lorsque nous lui demandons comment elle se sent :
Alors en fait, j’avais presque hâte que ça commence, puisqu’en fait, entre le moment de l’annonce et le moment où ça commence réellement, c’est long. Enfin moi j’ai trouvé que c’était, enfin, c’est long et court en même temps, mais… c’est long parce qu’en fait on est tout le temps dans l’attente des différents résultats. Donc en fait, à partir du moment où on rentre dans la chimio, bon bah là au moins on rentre dans quelque chose de concret en fait. Et puis bon, quand on rentre, on se dit qu’il y a une fin qui va aboutir entre guillemets quoi, mais j’étais… j’étais stressée, mais j’avais hâte en même temps de commencer cette étape.
Jusqu’à cette première séance de chimiothérapie, le passé et l’avenir se compressent, inéluctablement, dans un présent déjà lourd à assumer. Chaque jour occasionne son lot de découvertes, d’impensées, et avec elles de nouvelles sources d’angoisses : l’efficacité des traitements, la gestion des effets secondaires, en premier lieu la fatigue et les nausées, mais aussi la future perte des cheveux sont autant de questions qui envahissent les pensées des malades. Dépassées devant la démesure d’un tel évènement biographique, les patientes rapportent alors des impressions de « saturation », sous-jacente à la fatigue éprouvée. Cette intensification du rapport au monde peut par ailleurs être observée en dehors de la sphère médicale.
Telle une métastase, l’évènement du cancer se répand au sein des différents réseaux de sociabilité du malade (famille, amis, collègues de travail) et n’est pas sans conséquence sur ce chaos émotionnel et cognitif. Dans un premier temps, le contrôle et la diffusion de la nouvelle auprès des cercles de proches constituent les paramètres sur lesquels les malades peuvent encore éprouver un semblant de maîtrise. L’annonce à l’entourage représente, aux dires des patientes rencontrées, une charge mentale de plus à porter et s’avère parfois difficile à assumer. Dans leur souci de ne pas dramatiser leur situation et / ou de préserver certains proches, celle-ci se réalise de manière graduelle, parfois de manière détournée, comme nous l’indiquaient Molly et Rachelle, et non sans effort. Dans un second temps, de manière quasi-immédiate et surtout unanime, les discours des patientes révèlent un fort soutien de la part de l’entourage, dont certains membres sont plus bouleversés que la malade. Et si ce soutien est, à première vue, bénéfique, plusieurs d’entre elles révèlent qu’il peut donner lieu à des sollicitations parfois excessives qui ne font qu’accentuer ces sensations de « trop plein » :
Ils n’arrêtent pas de m’appeler. Tous. Les copains, les copines, les parents, les frères, les sœurs… Tous. « Comment ça va ? Comment ça va ? »… (Soupir). Ça va bien (rires). C’est un peu lourd. (Molly) Alors mes proches sont trop proches. Mes proches doivent considérer que c’est une… un truc invalidant. Ma plus proche, c’est ma fille qui habite à côté de chez moi. Si je devais l’écouter, je ne ferais rien. Mais rien. (…) Je lui ai demandé d’arrêter de me prendre pour une petite vieille (rires). (Rachelle)
Déjà assaillies par le corps médical et dépossédées de tout pouvoir d’agir, les malades ont parfois la désagréable impression d’être également pris en charge en dehors de l’institution, à la limite de l’étouffement, par leur entourage proche. Certaines, comme Rachelle avec sa fille, rapportent une tendance à la surprotection de la part d’un proche et l’assignation à la condition de « malade ». Cette intensification des relations est d’autant plus intolérable que la personne ne se sent pas, lors de cette période, malade. D’autres, comme Molly, évoquent une tendance à l’interrogatoire tout aussi désagréable et anxiogène, étant donné que les malades n’ont pas toujours les réponses à des questions déjà omniprésentes dans leur esprit. Si l’on poursuit l’analogie homéostatique, on observe une forme de coagulation des relations pour tenter de colmater l’hémorragie émotionnelle provoquée par l’annonce de la maladie et retrouver l’équilibre.
En résumé, les malades font, lors de la période post-diagnostique, l’expérience d’une intensification de leur rapport au monde : vis-à-vis d’eux-mêmes (rappel de leur finitude), du temps (l’attente) et des autres (la coagulation). Il en ressort une sensation de saturation à l’égard de leur condition qui n’est pas sans lien avec la singularité de ce sentiment de fatigue. Toutefois, et c’est important de le souligner dans le cadre de notre investigation, plusieurs patientes rencontrées déclarent ressentir une « fatigue psychologique », relative à une sensation de « trop plein », bien avant l’annonce de la maladie. Le cas de Rachelle, exposé en introduction, est en effet loin d’être une exception, et représente même une généralité pour les femmes actives professionnellement au moment de l’annonce :
J’ai appelé ça une surcharge cognitive, une surcharge mentale. Ça fait… Bah c’est ce que je disais avec mon conjoint, c’est comme ça depuis des années et j’avais toujours réussi à gérer, mais je sentais en fait depuis quelques mois que mon cerveau saturait. Ouais. C’était un burn-out ou… Je ne sais pas, j’en sais rien, mais je le sentais.
Les propos d’Aurélie (40 ans, professeur des écoles) rappellent, tout d’abord, combien l’augmentation des cas de burn-out est symptomatique d’une société fatiguée (Han, 2014). Surtout, ils rendent d’autant plus palpable la consistance sociale de ce phénomène culturellement et historiquement situé qui, dans le cas d’une maladie comme le cancer, semble évoluer selon les phases du parcours de soins. Après la saturation de la période post-diagnostique, une nouvelle temporalité se profile pour les malades, et avec elle, une autre tonalité de fatigue.
La « pesanteur » de la condition de malade
C’est tout d’un coup… Vlan. Un coup de mou, mais… un coup de mou quoi. Physiquement, mais aussi intellectuellement. Pas envie de bouger et pas envie de réfléchir. Voilà, je m’assieds, et là je n’ai plus envie de rien faire. (…) Donc oui, maintenant je sais ce que c’est la fatigue… Pff, ce n’est pas intéressant quoi (rires). Ça empêche. Ça empêche. (Molly, à propos de la fatigue perçue pendant la période des traitements)
À peine l’épreuve du sprint achevée, une épreuve d’endurance se dessine pour les malades. Si nous insistons sur l’aspect processuel de la période de l’annonce, les témoignages révèlent néanmoins que la première séance de chimiothérapie signe le « baptême du feu » de l’entrée dans le monde de la maladie. Elle vient ponctuer ce premier rite de passage7, propulsant le patient bien-portant, soumis à une attention de tous les instants par le corps médical, au statut de patient malade : un cas parmi d’autres souscrivant à la routine du protocole défini, en proie aux effets secondaires. Jusqu’alors dans l’attente, il se rend désormais à l’hôpital une fois par semaine, voire toutes les deux semaines pour recevoir ses traitements en compagnie d’autres malades. C’est un autre rythme de vie, plus lent, plus routinier, mais tout aussi fatiguant par bien d’autres aspects. L’administration successive des traitements anti-cancéreux génère, aux dires des patientes, une fatigue d’une nature jusqu’alors inconnue, difficilement compatible avec un mode de vie actif. Six mois après notre première rencontre, à l’issue de ces seize séances de chimiothérapie, Molly s’est fait une tout autre idée de la fatigue. À l’instar de l’ensemble des patientes rencontrées suite à cette période, elle évoque une fatigue accablante au quotidien, dont l’expérience décrite renvoie au champ lexical de la langueur, de la pesanteur, ou encore de l’apathie.
Après l’intensification de la période de l’annonce, une autre relation se déploie entre le sujet et le monde, davantage caractérisée par une tendance à la mise en retrait, quand ce n’est pas l’immobilisme. Le cas de Rachelle, rencontrée lors de son protocole de radiothérapie, est typique de cette difficulté inhérente des malades à habiter le monde lors de cette temporalité. Extrêmement fatiguée, elle rapporte une intolérance à l’effort quasi-immédiate et, de son point de vue, non proportionnelle à la dépense énergétique fournie :
Cette fatigue m’empêche de faire plein de choses. Elle me limite dans mes activités.
(…) Alors, je peux faire des choses, mais derrière je suis vidée. Il ne faudrait pas
qu’il y ait deux choses importantes à faire à la suite l’une de l’autre, vous voyez.
C’est ce que je vous disais, par exemple, si j’avais dû faire ma jardinière hier matin
et directement aller prendre ma douche, parce que la douche me prend aussi un temps
infini… Pour moi ce n’est pas… Je n’agis pas comme j’agissais avant le cancer. Voilà,
ça ne me laisse pas dans le même état. Ça me laisse sur le carreau parce que l’énergie
physique que je dépense, je ne dois pas en avoir beaucoup, elle est tout de suite
pompée par l’effort et après, derrière, je n’ai plus rien. Donc j’attends.
Évidemment liée à l’accumulation des traitements, dont les propriétés cytotoxiques détériorent inéluctablement l’ensemble de la condition physique, l’évolution de ce sentiment de fatigue décrit par Molly et Rachelle apparaît comme l’incarnation de ce phénomène de FLC, tel que théorisé dans la littérature scientifique. Non spécifique à l’aspect cognitif, musculaire, ou encore émotionnel, cette sensation d’épuisement et de fatigabilité latente englobe la personne dans son expérience au monde la plus primitive et la contraint de se désengager de ses activités. Elle représente à bien des égards ce que la philosophe Claire Marin, elle-même aux prises avec une maladie auto-immune, définit comme une fatigue fondamentale : « Ce n’est pas seulement la fatigue, c’est une fatigue plus essentielle, comme la fatigue d’être, l’incapacité à supporter l’effort d’exister » (2008, 47). Dans un autre registre, et pour illustrer le sentiment partagé par les malades lors de ce calvaire médicamenteux, le journaliste et sportif Vincent Guerrier, en rémission d’un lymphome, proposait une comparaison tout à fait édifiante de la fatigue perçue lors de la période des traitements :
En tant que cycliste, je pourrais la comparer à un violent vent de face. Vous êtes sur une belle ligne droite, il n’y a pas d’arbres, pas de haies, pas de points de repère à l’horizon. Vous ne voyez pas le vent, mais il est là. Vous le sentez sur la peau, dans les jambes. Il vous empêche d’avancer, mais vous ne pouvez rien y faire. Essayez de lui résister et vous le paierez de toutes vos forces. Laissez passer l’orage et vous aurez peut-être la chance, à un moment, de changer de cap pour ne plus lui faire face (2020, 62).
Outre cette description phénoménologique, il convient de souligner que l’expérience de la fatigue perçue par les malades bouleverse les représentations et crée un certain nombre de dissonances, voire d’incompréhensions au quotidien. Celles-ci sont de l’ordre de l’intime, tout d’abord, comme nous l’expliquaient Rachelle et Molly qui ne peuvent faire abstraction de cette perte de vitalité évidente en comparaison avec leurs capacités d’avant, difficilement tolérée. À cet égard, la pratique de l’activité physique au quotidien, si elle est effectivement recommandée pour tenter de réduire cette fatigue, confronte directement la personne malade à ses propres limites et peut s’avérer préjudiciable si elle n’est pas adaptée. Les propos de Rachelle démontrent toute l’ambivalence du discours promouvant l’intérêt de l’activité physique pour lutter contre cette fatigue, alors que le moindre effort occasionne une fatigue extrême et la contraint à se reposer. Malgré son souci « de ne pas restez assise dans son fauteuil » et de préserver son autonomie, elle ne peut que constater cette réalité implacable :
J’ai un grand terrain, j’adore débroussailler, jardiner, bricoler… Et je me dis « Ben je ne vais plus pouvoir faire tout ça ». Plus le temps passe, voilà, des fois ça fait… bah ça me fout un peu le moral en bas parce que je me dis que je n’ai que 68 ans, et je considérais que jusque-là, j’étais suffisamment en forme pour tout ça et là maintenant… Je suis limitée.
Les dissonances relatées par les patientes au sujet de cette fatigue sont d’autant plus prégnantes dès lors que l’on interroge leur expérience à l’aune du sens commun et des relations sociales. Rappelons-nous les propos introductifs de Rachelle au présent texte, insistant sur le caractère insondable de ce sentiment de fatigue, visiblement exclusif à la condition de malade. Lorsque qu’elle évoque ce sentiment avec ses amis, elle n’a de cesse de se justifier d’éprouver cet épuisement irrépressible. La comparaison avec son ami Georges lui a d’abord permis de reconsidérer les propos qu’elle a pu tenir à son égard, et légitime désormais ses dires auprès de ce même groupe d’amis :
Maintenant, ils n’insistent plus à me dire « Allez, mais non, la fatigue c’est rien, au contraire, ça va te faire du bien de sortir »… Et je pense que d’avoir discuté de la fatigue de notre ami et de la mienne, je pense que ça leur a ouvert… enfin, ça leur a montré que ce n’est pas du faux. Quand on dit que l’on est fatigué, ce n’est pas en rajouter.
Au-delà d’illustrer les résonances – émotionnelle et cognitive – entre membres d’une même communauté de destin, le cas de la FLC réactualise la question soulevée par Molly en introduction : « Que veut dire être fatigué ? ». L’étude des récits de patientes interroge non seulement la sémantique employée pour rendre compte de cette expérience hors du commun, mais également l’attitude adoptée à l’égard de cette vulnérabilité extrême. Parce que son étiologie échappe, à l’heure actuelle, à la rationalisation scientifique, la FLC est non seulement sous-estimée par le corps médical, mais s’avère également peu considérée par l’entourage : « Peut-être que les gens, ils ne comprennent pas quand on dit « Je suis fatiguée ». Ben oui, tout le monde est fatigué. Mais je crois qu’ils ont du mal à imaginer le niveau de fatigue ».
Quand bien même les proches feraient preuve de bienveillance et d’empathie, ils ne peuvent tout simplement pas se représenter ce qu’implique ce symptôme de fatigue dans le quotidien, au point de le banaliser. En témoignent les propos des amis de Rachelle, l’invitant à surmonter sa fatigue, de même que ceux de Molly, soucieuse de « se prouver à soi-même qu’on peut aller au-delà de la fatigue, et pousser ses limites », il est communément admis qu’il est possible de lutter contre cette fatigue, de la maîtriser, de lui résister, pour peu que les malades fassent preuve de volonté. Un discours initié par le corps médical et repris unanimement par les patientes stipulant que « c’est aussi dans la tête », « qu’il ne faut pas se laisser abattre », et qu’il est primordial de « toujours positiver ». Sous couvert de résilience, ce refrain reflète une certaine négligence sociale à l’égard de ce sentiment de fatigue évoqué par Claire Marin :
La fatigue, dans la représentation commune, est une forme de paresse, de mauvaise volonté. Elle est impolie, elle agace, un peu comme la dépression : on est tenté d’exiger du malade qu’il se secoue un peu, qu’il fasse un effort (2008, 47).
Lors de cette période, c’est finalement la double peine pour les malades. En plus de la précarité de leur condition, intimement liée à l’omniprésence d’une fatigue accablante, les patientes perçoivent le poids des injonctions – parfois contradictoires – autour de l’attitude à adopter. Avec d’un côté la recommandation de poursuivre et / ou de s’engager dans une activité physique, et de l’autre l’invitation à s’écouter dès que l’on se sent fatigué, le rôle de patient n’est pas sans contraintes. Parce qu’elles sont sous le joug des stigmates8 (Goffman, 1975), ces patientes sont amenées à redoubler d’efforts en présence d’autrui pour donner à voir ce que l’on attend d’elles, en dépit de la fatigue et des effets secondaires.
Comme nous l’indiquait l’une d’entre elles, être patiente, « c’est un boulot presque à temps plein », mais se poursuit-il à l’issue de la période des traitements aigus ?
La fatigue d’être (à nouveau) soi
Il y a un moment où tout le monde est tellement présent, dès qu’on a quoi que ce soit, et puis une fois que c’est fini… C’est l’inverse. Enfin, mon sentiment c’est que c’est l’inverse, on deviendrait presque une gêne. (…) Je suis contente, je suis en rémission, mais voilà, je sens bien que mon cas n’intéresse plus grand monde. C’est vrai qu’on se sent un peu lâchée, abandonnée. (Rachelle, lors de notre troisième entretien)
Le protocole de chimiothérapie et de radiothérapie terminé, une nouvelle temporalité se profile pour les malades : celle de la rémission. En miroir du rite postliminaire de la première séance de chimiothérapie pour conclure l’entrée dans le monde de la maladie, l’annonce de la rémission proclame la fin du statut de patient-malade. Désormais suivie à distance par l’institution hospitalière, parfois sous hormonothérapie pour plusieurs années, la personne est officiellement en mesure de réintégrer le monde des bien-portants, appuyée par l’invitation de « reprendre une vie normale ». Pourtant, les discours mettent en lumière combien cette période de rémission, loin d’être de tout repos, relève d’un autre état de vulnérabilité (Masson, 2013) teinté d’ambivalence et d’incertitude.
Malgré les recommandations de tourner la page, la rémission n’est pas toujours synonyme de retour à la vie dite normale et illustre la difficulté de (re)trouver sa place dans la société (Marin, 2022). Déjà ballottées entre le soulagement de l’annonce et la crainte de la récidive, les personnes se sentent parfois abandonnées par le corps médical, comme lâchées dans la nature alors même qu’elles se sentent encore malades. Cette fatigue latente et persistante des traitements est d’autant plus intolérable qu’elle entrave leur désir de « revenir comme avant » et « de rebondir ». Rappelons-nous les propos de Molly, pourtant très active tout au long de son parcours, ne pouvant que constater sa perte de vitalité au quotidien :
Je fatigue vite, en fait. Hier, je suis allée marcher, et en revenant j’étais… alors je ne suis pas allée loin hein, vraiment, pas du tout… Mais ouais, j’ai mal aux articulations, voilà. Du coup, j’ai plus de difficulté, physiquement, à tenir la cadence.
Bien que la maladie et ses traitements soient perçus et souvent envisagés comme une parenthèse dans l’existence, la période de la rémission rappelle combien cette épreuve laisse des traces et s’inscrit dans la durée. Lors de l’annonce, certes, Rachelle et Molly indiquaient combien il était important pour elles que « l’autre ait le même regard qu’avant », « que la vie continue », « que les gens viennent comme avant, mais pas parce qu’on est malade ». D’autres insistaient sur leur volonté de « tout faire pareil », de « ne pas se laisser aller », qu’elles et leur entourage vivent « comme si… je n’étais pas malade ». Cette injonction de normalité, largement diffusée par les oncologues, s’avère d’autant plus accentuée et légitimée lors de la période de la rémission, mais n’est, cette fois-ci, pas sans soulever d’ambigüités et d’incompréhensions. Le témoignage de Marie-France (50 ans, pharmacienne), rencontrée à l’issue de son protocole de chimiothérapie et de radiothérapie, souligne les dissonances possibles lors de cette transition :
Quand je suis allée récupérer mon ordonnance et que j’ai pris connaissance des rendez-vous médicaux à venir… Oui, le plus gros est passé, mais c’est loin d’être fini complètement quand même. Et certains proches, comme mon mari, j’ai beau leur expliquer que je ne suis pas guérie, ils ne comprennent pas parce qu’ils partent du principe que je n’ai plus le cancer et qu’il faut aller de l’avant.
En résonance avec la gestion de la fatigue évoquée précédemment, la tonalité de ce discours est, nous semble-t-il, révélatrice des nouvelles attentes sociales et normatives associées au rôle de patient (Parsons, 1955). Imprégnées de l’idéologie de la résilience, elles participent à la définition de ce que devrait être un « bon patient » (Sarradon-Eck, 2019), toujours enclin à dépasser de manière active sa condition. Effet direct d’une représentation de la maladie comme un combat et des discours mobilisant l’allégorie militaire et / ou sportive, les patientes sont à l’heure actuelle considérées comme les principales artisanes de leur guérison. Dans cette perspective, les effets secondaires comme la fatigue et les douleurs sont susceptibles d’être combattus, avec comme condition explicite qu’elles mettent en œuvre tous les efforts possibles et adoptent les « bonnes attitudes ». Toujours négociées socialement, l’ensemble de ces représentations façonne l’expérience de la maladie du patient autant que celle de l’entourage. Dans le cas du cancer du sein, elles s’avèrent d’autant plus présentes, y compris lors de la période de la rémission. En effet, ce cancer, bien qu’il soit le plus répandu en France chez les femmes, est aussi celui qui présente, selon les statistiques, l’un des taux de rémission les plus élevés. Si bien que les malades sont étiquetées, sans le vouloir, comme potentielles « survivantes ». Et si, pour certaines personnes, la transition s’effectue sans heurts, pour d’autres en revanche, ce rôle est parfois difficile à assumer. Le témoignage de Natacha (57 ans, formatrice), rencontrée un an après son diagnostic, et de son amie, se passe d’analyse et confirme toute l’ambivalence de la condition sociale des malades lors de cette période :
J’ai eu des moments dans ma vie où j’ai eu des coups de mou, mais là, franchement, je sens bien que je n’arrive pas à remonter, à avoir du punch même si j’ai mis des choses en place à côté… Alors c’est sûr, en plus, il y a toujours cette façade… Les gens me disent « Ah bah oui, tu as l’air d’aller bien » (rires), alors forcément, avec des amis ça a clashé hein. Avec mon fils ça a clashé aussi. Bon, là il revient gentiment, mais c’est vrai que… les gens ne comprennent pas quoi. C’est impressionnant. Ils n’arrivent pas à comprendre tout ce chemin, tout ce parcours, ce qu’on subit en fait. Alors on ne souhaite à personne d’avoir un cancer, bien évidemment, mais il n’y a qu’avec des gens qui sont passés par là que… Moi j’ai des amies qui ont eu des cancers, du sein et d’autres choses, et il n’y a qu’avec elles en fait que j’arrive à échanger, discuter, dialoguer et où vraiment on a une écoute. Et j’ai une amie qui m’a justement dit « tu sais Nat’, maintenant, je dis que je vais bien en fait. Pendant longtemps, je me plaignais un peu, je disais que ça n’allait pas trop, mais les gens ne comprenaient pas quoi. Donc à un moment donné, tu dis que ça va ».
À force d’invisibiliser la vulnérabilité des malades au profit de leur combativité, certaines se voient finalement contraintes de jouer le jeu en répondant aux attentes socialement valorisées par la société. Et parce qu’elles ont la volonté de ne pas rester sous l’emprise des stigmates de la maladie, les anciennes patientes peuvent alors se sentir prises au piège, comme flottant entre deux-mondes9. Ce qui n’est évidemment pas sans susciter un (autre) sentiment de fatigue, teintée d’aliénation chez certaines patientes. C’est à l’aune de ces considérations qu’un détour par la grille de lecture goffmanienne de l’espace social (Goffman, 1973) semble opportun pour éclairer davantage cette nouvelle tonalité de fatigue.
Dans sa métaphore théâtrale, ce sociologue envisage l’ensemble de la vie sociale comme une scène, soit comme un espace où se déroule la représentation, avec ses acteurs, son public, dans laquelle l’ensemble des comportements et des échanges se déroule selon un ordre et des rituels bien définis et connus de tous. Selon lui, l’enjeu de cette représentation est de maintenir une stabilité des interactions et plus généralement de l’ordre social. Pour chaque représentation, les acteurs s’efforcent alors d’« entretenir l’impression selon laquelle ils vivent conformément aux nombreuses normes qui servent à les évaluer, eux-mêmes et leurs produits » (Goffman, 1973, 237). Afin de répondre aux attentes normatives des autres participants, elles-mêmes définies par l’espace social occupé, chaque acteur montre alors à son public l’image qu’il revendique et souhaite qu’on lui renvoie.
La gestion de la fatigue cristallise, en ce sens, les attentes normatives à l’égard du rôle de malade. Dans un contexte où l’initiative et l’autonomie constituent la mesure de la personne, sa valeur sociale (Ehrenberg, 1998), lutter contre la fatigue, et la surmonter, serait l’une des garanties du maintien de l’ordre social tel qu’il se déployait jusqu’alors. Telles des actrices endossant leur rôle avant de monter sur les planches, les patientes jouent avec leurs apparences et leurs expressions pour incarner ce qu’il est attendu d’elles : la figure de la survivante. Mais ce décalage entre leur souci d’y répondre et l’effort que cela implique n’est pas sans générer une certaine fatigue.
La proposition d’une analyse sociologique du sentiment de fatigue des malades à l’aune de l’effort de présentation de soi (1973), aussi audacieuse soit-elle à première vue, nous est néanmoins apparue nécessaire et évidente lors de la journée d’étude BIOCARE de septembre 2022, et notamment avec la rencontre de Nadine et Virginie. Toutes deux atteintes d’un cancer du sein, dont l’une en phase chronique, elles avaient accepté de présenter, en compagnie de deux oncologues, des projets d’activités physiques en faveur du bien-être des patients devant de nombreux étudiants en Master STAPS APAS du Mans et d’Angers. Et bien qu’elles ne participent pas au projet BIOCARE, leur intervention est venue illustrer de manière tout à fait saillante cet effort de mise en scène de la part des malades pour ne pas donner à voir qu’elles le sont.
Alors que les deux oncologues affichaient, une posture pour le moins décontractée sur leur fauteuil, y compris lorsqu’ils étaient en possession du micro, Virginie, munie de son chapeau, et Nadine se sont au contraire tenues à apparaître le plus professionnelle possible. Au-delà de leur discours, il était flagrant d’observer leur volonté de maintenir une posture droite, pour ne pas dire exemplaire, du début jusqu’à la fin de la présentation. Loin d’être anecdotique, l’étude de leur (re)présentation sur scène s’est avérée d’autant plus riche d’enseignement une fois recueilli leur ressenti. C’est pourquoi, si Rachelle et Molly, nous ont servi de fil rouge dans cette chronique, les cas de Nadine et Virginie nous serviront de conclusion.
La fatigue sociale
L’idée c’était aussi de montrer que même si on est encore en traitements, on peut aussi avoir une vie normale (…) C’est d’autant plus difficile de parler de soi, de son parcours, que je renvoie une image de quelqu’un qui n’est pas malade. D’ailleurs, je côtoie tout un paquet de gens qui ne le savent pas forcément donc c’est pas évident de me dévoiler comme ça au grand public. Généralement, quand je rencontre des gens qui ne me connaissent pas, ce n’est pas une caractéristique que je donne. Donc là, je me retrouve devant des gens qui sont tous au courant… Donc ça, c’était particulier, et pas évident (Nadine, rencontrée à la suite de la journée d’étude BIOCARE du 16 septembre 2022).
C’est dans les coulisses de la salle EVE de l’université du Mans que nous avons pris
le temps de discuter avec Virginie et Nadine. Rapidement, Nadine nous fait part de
l’ambiguïté d’être désignée (objectivement) comme malade par le public, alors que
rien ne laisse supposer qu’elle l’est dans son apparence au quotidien. Dans la lignée
de l’analyse de Goffman, ses propos confirment, tout d’abord, qu’un stigmate peut,
selon le contexte de la relation, être rendu visible ou invisible. Dans la première
situation, la personne est discréditée, car sa différence est déjà connue (ce qui
fut le cas de Nadine et Virginie lors de leur intervention) ; dans le second, elle
est discréditable puisque sa différence n’est ni connue, ni directement perceptible
par les personnes présentes.
À la différence des personnes en fauteuil roulant, par exemple, les stigmates de la
maladie cancéreuse (telle que l’alopécie) peuvent faire l’objet d’un travail de dissimulation
et de présentation de soi tout au long de leur parcours pour correspondre aux attentes
du public. La fatigue peut être camouflée, comme l’a fait Virginie, en faisant une
sieste avant de venir. Et pour cause, la revendication lors de cette représentation
est clairement explicitée : montrer que l’expérience de la maladie n’est pas incompatible
avec une vie dite « normale ». Par normale, il est entendu ici une vie de « non-malade »,
voire de « bien-portant » en capacité d’agir par soi-même. Comme si l’expérience de
la maladie, de la vulnérabilité, n’avait finalement pas sa place sur la scène sociale
et devait se cantonner aux coulisses.
Ce désir d’apparaître normal aux yeux des autres, n’est pas réductible à la présentation (officielle) de Nadine dans le cadre de notre journée d’étude, en présence d’inconnus, mais traverse, à bien y regarder, l’ensemble des discours des patientes rencontrées. De l’annonce à la rémission, en passant par la période des traitements, les patientes décrivent une volonté – largement issue du discours médical – de maintenir une certaine continuité avec leur vie d’avant. Cela se traduit, d’une part, par le souhait d’un statu quo des relations : surtout, que rien ne change ! Lors de l’entrée dans la maladie, certaines patientes évoquent dans quelle mesure c’est au travers du regard des autres que la maladie s’impose à elles et rend, de fait, intolérable la modification de leur comportement à leur égard. Elles aspirent, d’autre part, à poursuivre leur rythme de vie, plus ou moins actif, en vue de lutter (symboliquement) contre la maladie et de ne pas la laisser envahir leur quotidien. L’analyse longitudinale des discours donne à voir combien il est difficile pour elles de tenir cet ordre du normal à long terme.
C’est pourquoi, au-delà de rappeler combien nos sentiments sont façonnés par l’environnement social, l’étude de la FLC interroge plus globalement les attentes normatives à l’égard des malades et la considération de leur condition. Dans une société faisant l’apologie de l’effort, incarnée par la promotion de l’activité physique comme remède, la figure du patient contemporain ne serait-elle, en ce sens, qu’une déclinaison du modèle du sujet assigné au culte de la performance (Ehrenberg, 1991) ? Notons qu’en situation de maladie, il convient non seulement de se battre, de lutter contre les effets secondaires, mais également d’y voir la possibilité d’un dépassement de soi. Pour la doxa, il est en effet bienvenu de surmonter activement cette épreuve, s’inscrivant alors dans le célèbre aphorisme nietzschéen : ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Le philosophe Ruwen Ogien (2017), récemment décédé d’un cancer, dénonce d’ailleurs ces slogans incantatoires aux relents doloristes qui placent la résilience comme une vertu et obligent les malades à présenter une certaine image, sous peine de sanctions sociales. De ce point de vue, les transformations de ce sentiment de fatigue peuvent tout autant traduire l’avancée de la maladie et des traitements que l’effort du malade de faire « comme si » il assumait ce rôle. Non réductible aux patients atteints d’un cancer, nous pourrions même conclure en supposant que la métamorphose engagée par les malades pour sortir des coulisses et se mettre en scène en vue de perpétuer le narratif de la maladie est susceptible d’engendrer une fatigue sociale tout aussi contraignante, sinon plus, que celle qu’elle est supposée limiter.
Bibliographie
Akermann, G., Barthe, J.-F., & Defossez, A. (2018). « Dynamique des réseaux personnels à l’épreuve des maladies graves et de longue durée ». Temporalités. Revue de sciences sociales et humaines, 27. [en ligne] https://doi.org/10.4000/temporalites.4016.
Barrier, P. (2007). « Le corps malade, le corps témoin ». Les Cahiers du Centre Georges Canguilhem, 1(1), 79-100. [en ligne] https://doi.org/10.3917/ccgc.001.0079
Baszanger, I. (1986). « Les maladies chroniques et leur ordre négocié ». Revue française de sociologie, 3-27.
Berger, A. M., Mooney, K., Alvarez-Perez, A., Breitbart, W. S., Carpenter, K. M., Cella, D., Cleeland, C., Dotan, E., Eisenberger, M. A., Escalante, C. P., Jacobsen, P. B., Jankowski, C., LeBlanc, T., Ligibel, J. A., Loggers, E. T., Mandrell, B., Murphy, B. A., Palesh, O., Pirl, W. F.,… Smith, C. (2015). « Cancer-Related Fatigue », Version 2. 2015. Journal of the National Comprehensive Cancer Network, 13(8), 1012-1039. [en ligne] https://doi.org/10.6004/jnccn.2015.0122.
Boltanski, L. (1971). « Les usages sociaux du corps ». Annales. Histoire, Sciences Sociales, 26(1), 205-233. [en ligne] https://doi.org/10.3406/ahess.1971.422470.
Bower, J. E. (2014). « Cancer-related fatigue—Mechanisms, risk factors, and treatments ». Nature Reviews Clinical Oncology, 11(10), 597-609. [en ligne] https://doi.org/10.1038/nrclinonc.2014.127.
Charmillot, M. (2016). « Comme avec le vent : Quand la maladie devient source d’apprentissage ». L. Demailly, & N. Garnoussi, Aller mieux : approches sociologiques, 73-82.
Chartogne, M., & Landry, S. (2021). La Fatigue Liée au Cancer. La connaître pour la combattre. IN PRESS.
Chartogne, M., Leclercq, A., Beaune, B., Boyas, S., Forestier, C., Martin, T., Thomas-Ollivier, V., Landry, S., Bourgeois, H., Cojocarasu, O., Pialoux, V., Zanna, O., Messonnier, L. A., Rahmani, A., & Morel, B. (2021). Building a biopsychosocial model of cancer-related fatigue : The BIOCARE FActory cohort study protocol. BMC Cancer, 21(1), 1140. [en ligne] https://doi.org/10.1186/s12885-021-08831-3.
Dall’aglio, L., Guerrier, V. (2020). Malades de sport : Un remède contre le cancer. Éditions du Faubourg.
Damasio, A. R. (2005). Spinoza avait raison : Joie et tristesse, le cerveau des émotions. Odile Jacob.
Ebede, C. C., Jang, Y., & Escalante, C. P. (2017). « Cancer-Related Fatigue in Cancer Survivorship ». Medical Clinics of North America, 101(6), 1085-1097. [en ligne] https://doi.org/10.1016/j.mcna.2017.06.007.
Ehrenberg, A. (1991). Le Culte de la performance. Calmann-Lévy.
Ehrenberg, A. (2008). La fatigue d’être soi : Dépression et société. Odile Jacob.
Gennep, A. V. (2011). Les rites de passage. Éditions Picard.
Goffman, E. (1973). La mise en scène de la vie quotidienne 1 : La présentation de soi. Éditions de Minuit.
Goffman, E. (1975). Stigmate : Les usages sociaux des handicaps. Éditions de minuit.
Guénon, R. (2015). Le règne de la quantité et les signes des temps. Gallimard.
Han, B.C. (2014). La société de la fatigue. Paris, Circé.
Holley, S. (2000). « Cancer‐Related Fatigue : Suffering a Different Fatigue ». Cancer Practice, 8(2), 87-95. [en ligne] https://doi.org/10.1046/j.1523-5394.2000.82007.x.
Huët, R. (2021). De si violentes fatigues : Les devenirs politiques de l’épuisement quotidien. PUF.
Kaufmann, J.-C. (2016). L’entretien compréhensif, Vol. (4e éd.) Armand Colin.
Le Breton, D. (2016). « Bonne ou mauvaise fatigue ». Dictionnaire de la fatigue. Librairie Droz. 114-118. [en ligne] https://doi.org/10.3917/droz.zawie.2016.01.0114.
Marin, C. (2022). Être à sa place. L’Observatoire.
Marin, C., & Sarthou-Lajus, N. (2008). « Violences de la maladie ». Entretien avec Claire Marin. Études, 409(7-8), 41-50. [en ligne] https://doi.org/10.3917/etu.091.0041.
Masson, A. (2013). « Vivre après un cancer : Un autre état de vulnérabilité. Psycho-oncologie, 7(1), 23-29.
McNeely, M. L., & Courneya, K. S. (2010). « Exercise Programs for Cancer-Related Fatigue : Evidence and Clinical Guidelines ». Journal of the National Comprehensive Cancer Network, 8(8), 945-953. [en ligne] https://doi.org/10.6004/jnccn.2010.0069.
Ménoret, M. (1999). Les Temps du Cancer. Éditions du CNRS.
Minkowski, E. (2013). Le temps vécu. Études phénoménologiques et psychopathologiques. PUF.
Ogien, R. (2018). Mes mille et une nuits. Le Livre de Poche.
O’Higgins, C. M., Brady, B., O’Connor, B., Walsh, D., & Reilly, R. B. (2018). « The pathophysiology of cancer-related fatigue : Current controversies ». Supportive Care in Cancer, 26(10), 3353-3364. [en ligne] https://doi.org/10.1007/s00520-018-4318-7.
Parsons, T. (1955). « Structure sociale et processus dynamique : Le cas de la pratique médicale moderne ». Éléments pour une sociologie de l’action, 197-238.
Rosman, S. (2004). « L’expérience de la fatigue chez les malades atteints de cancer ». Santé Publique, 16(3), 509-520. [en ligne] https://doi.org/10.3917/spub.043.0509.
Saillant, F. (1988). Cancer et culture : Produire le sens de la maladie, Éditions Saint-Martin. [en ligne] https://doi.org/10.1522/030165410.
Sarradon-Eck, A. (2019). « Le patient contemporain ». Cancer(s) et psy(s), 4(1), 51-60. [en ligne] https://doi.org/10.3917/crpsy.004.0051.
Spinoza. (2021). Éthique, Paris, Flammarion.
Strauss, A. (1992). « La trame de la négociation ». Sociologie qualitative et interactionnisme, 10(4), 154-157.
Vigarello, G. (2020). Histoire de la fatigue : Du Moyen Âge à nos jours, Paris, Le Seuil.
Weber, M. (1965). Premier essai sur la théorie de la science : L’objectivité de la connaissance dans les sciences et la politique sociales, Paris, Librairie Plon.
Wu, H.-S., & McSweeney, M. (2007). « Cancer-related fatigue : “It’s so much more than just being tired” ». European Journal of Oncology Nursing, 11(2), 117-125. [en ligne] https://doi.org/10.1016/j.ejon.2006.04.037.
Notes
- C’est un bonnet contenant un liquide refroidissant. L’objectif est de limiter localement l’action et la concentration de la chimiothérapie, et potentiellement de réduire la chute des cheveux.
- Pour ce qui nous concerne, 26 entretiens ont été réalisés avec des patientes lors de la période de l’annonce, depuis novembre 2021. À l’heure actuelle, 18 d’entre elles ont été rencontrées une deuxième fois, et 9 d’entre elles une troisième fois.
- Pour Strauss, la trajectoire renvoie « non seulement au développement physiologique de la maladie de tel patient, mais également à toute l’organisation du travail déployée à suivre ce cours, ainsi qu’au retentissement que ce travail et son organisation ne manquent pas d’avoir sur ceux qui y sont impliqués » (144).
- C’est d’ailleurs la définition donnée par le Larousse : « État physiologique consécutif à un effort prolongé, à un travail physique ou intellectuel intense et se traduisant par une difficulté à continuer cet effort ou ce travail ».
- Au cœur de la sociologie compréhensive de Max Weber, un idéaltype n’est pas une description exhaustive de la réalité, mais un tableau de pensée synthétique et homogène d’un phénomène, construit par le chercheur (1904).
- Selon l’expression diffusée par les médias de masse, mais aussi par le corps médical. Exemple : Mino, J. C., & Lefève, C. (2016). Vivre après un cancer. Favoriser le soin de soi. Dunod, 1.
- Pour l’anthropologue Arnold Van Gennep (1909), les rites accompagnent les changements de lieu, d’état, d’occupation ou encore de situation sociale de chaque individu. Ils se déroulent invariablement selon un processus en trois étapes : une phase de séparation de l’individu vis-à-vis de son état initial (rite préliminaire), une phase de mise à la marge (rite liminaire) durant laquelle l’individu se situe dans une sorte d’entre-deux identitaires, une phase d’agrégation (rite post liminaire) dans une nouvelle situation.
- Dans le vocabulaire sociologique d’Erving Goffman, un stigmate est ce qui, lors d’une interaction, affecte l’identité sociale d’un individu, en le discréditant.
- Nous pourrions alors considérer la période de la rémission comme l’avènement d’un état de liminalité prolongée pour les individus (Saillant, 1988).