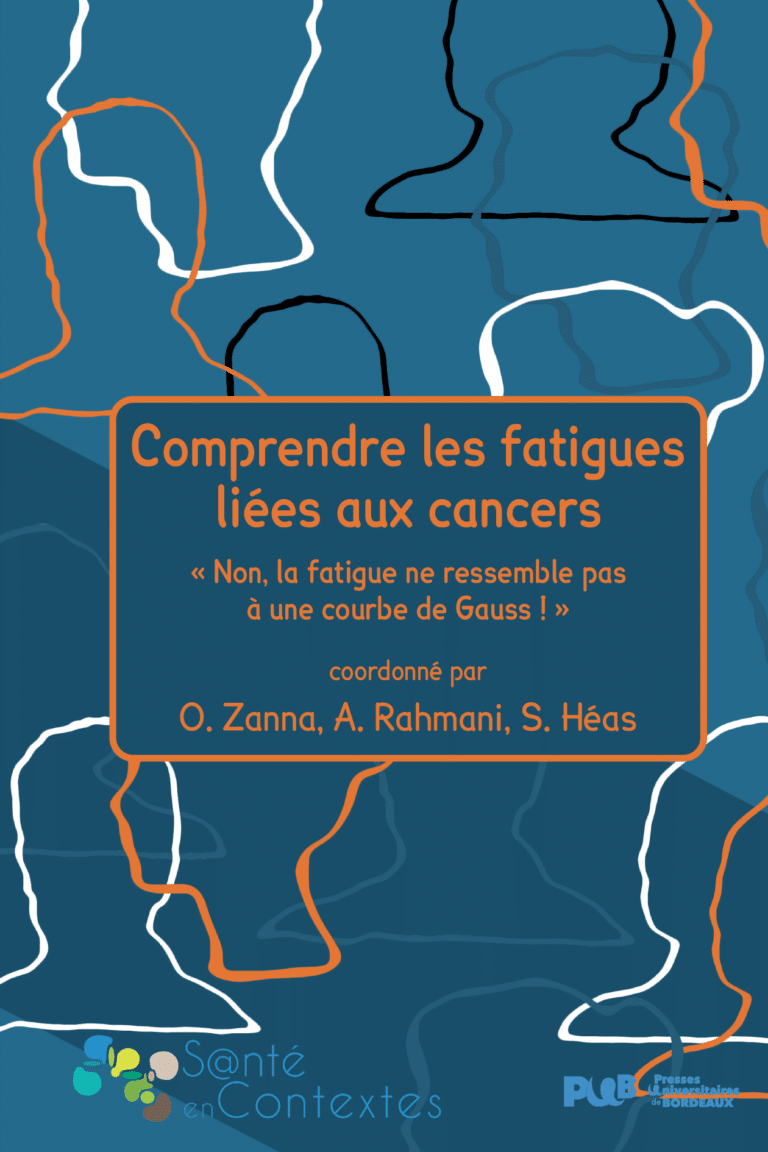Nous remercions l’Association francophone de psychologie de la santé (AFPSA) pour sa contribution à ce chapitre, via la bourse de mobilité accordée à Mme Charlotte Manceau dans le cadre de son stage doctoral auprès de la professeure Sophie Lelorain.
Interlude N° 10
Christelle (42 ans) est suivie pour un cancer du sein depuis dix-sept mois et sous hormonothérapie depuis six mois. Entretien réalisé le 25 avril 2023.
C’est vrai qu’avec le recul je me dis mais… Mais pourquoi j’ai été si forte tout le temps finalement ? Parce que quand on est super fort et qu’on ne veut pas montrer, on veut, on veut… Je n’ai pas envie de dire qu’on va être un superhéro face à la maladie mais on veut toujours montrer le meilleur de nous mais je me dis, mais des fois en fait… Ben ouais, j’aurais mieux fait de dire non sur certaines choses et montrer que ben je n’étais pas si bien que ça et… Pour que les gens comprennent peut-être plus maintenant. Et pas tou- jours être au top du, enfin, essayer d’être au top et pas toujours tout montrer quoi. Mais bon c’est comme ça.
Introduction
Le cancer est un véritable enjeu de santé publique à travers le monde. En effet, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le fardeau associé à la 2e maladie chronique la plus fréquente ne cesse de s’alourdir et de peser sur les personnes malades, les familles et les systèmes de santé. Pour se représenter ce fardeau en quelques chiffres, nous pouvons nous référer aux estimations de l’Observatoire mondial du cancer (Ferlay et al., 2024) et de l’Institut national du cancer (INCa, 2022). Il y est détaillé que près de 20 millions de nouveaux cas de cancers ont été reportés à travers le monde en 2022. En Europe, bien que les taux de mortalité, tous cancers confondus, soient en constante diminution, en 2022, le cancer était encore responsable de 20 millions de décès, demeurant ainsi la première cause de décès chez les hommes et la deuxième chez les femmes. De plus, le cancer impacte la vie de manière durable : cinq ans après le diagnostic, 63,5 % des personnes prises en charge souffrent de séquelles dues au cancer ou aux traitements et pour deux tiers de ces personnes, ces séquelles restent invalidantes (INCa, 2018). L’entourage est également affecté, comme le souligne une récente étude dont la moitié des personnes proches interrogées rapportent des scores de détresse élevés : 33 % d’entre elles dépassent le seuil clinique de dépression et d’anxiété (Teo et al., 2023). Dans cette étude, elles ressentaient même davantage de détresse que leur proche malade (Teo et al., 2023).
Il faut également souligner le coût que représente le cancer. En France, les dépenses hospitalières liées au diagnostic, au traitement ou au suivi de la patientèle représentaient 5,9 milliards d’euros en 2020 (INCa, 2022). Certes, les avancées de la recherche ontpermis de diminuer le délai de dépistage, d’améliorer la qualité et l’efficacité des traitements et des soins en Europe (INCa, 2022), mais les enjeux de la recherche demeurent nombreux, comme le montrent les chiffres que nous venons de présenter. Mieux comprendre les pathologies, trouver de nouvelles pistes thérapeutiques, y compris non-médicamenteuses, aider le corps soignant à mieux prendre en soins et accompagner les personnes malades et leurs proches restent des défis majeurs.
Dans ce cadre, la relation personne soignante / personne soignée est primordiale et se place au cœur des intérêts scientifiques, comme en témoignent les nombreuses recherches publiées ces dernières années à ce sujet. Un aspect de cette relation est de tout intérêt : l’empathie des soignants et soignantes. Les nombreux bénéfices de l’empathie ont été scientifiquement démontrés en oncologie, pour les malades, le corps soignant, et l’ensemble du système de santé (Lelorain et al., 2023 ; Lelorain & Fontesse, 2021). Les corps soignant et soigné s’accordent d’ailleurs à dire que l’empathie est une composante très importante de la prise en soin (Gibson et al., 2021 ; Hall et al., 2021).
En parallèle, de nombreuses études s’intéressent à la vulnérabilité que des membres de l’équipe soignante en oncologie présente face au burnout. Cet intérêt se justifie par les nombreux facteurs de stress identifiés en oncologie (e.g. exposition à la mort, échec des traitements, dégradation des personnes soignées), et par les ressources relationnelles importantes déployées par les soignants et soignantes. L’enjeu est de comprendre si l’empathie de ce groupe pourrait les protéger de l’épuisement professionnel ou, au contraire, les exposer à un plus grand risque d’épuisement.
Ce chapitre a donc pour objectif d’identifier les facteurs explicatifs du burnout pour le personnel en oncologie afin de proposer des pistes de prévention de cet état d’épuisement. Après avoir défini empathie et burnout, nous identifierons les différents facteurs de risque du burnout, tels que les facteurs individuels des soignants et soignantes, dont l’empathie, mais aussi les aspects contextuels inhérents aux conditions dans lesquelles ils et elles exercent. Nous conclurons en proposant des pistes visant à améliorer leur bien-être et à prévenir le burnout.
L’empathie
Les personnes exerçant en oncologie font face à de multiples situations nécessitant de grandes qualités relationnelles et empathiques. L’annonce de mauvaises nouvelles telles que le diagnostic ou la récidive, l’accompagnement de la personne malade et de ses proches, le choix et l’explication des traitements, la prise en compte des besoins des malades sont, entre autres, de grands défis pour ce corps de métier, quotidiennement confronté à la détresse de toutes les personnes confrontées au cancer (malades, proches, collègues). Dans ce contexte, l’empathie joue un rôle majeur. Ces dernières années, la littérature scientifique a démontré les multiples intérêts de l’empathie pour les personnes soignées, mais également pour les personnes soignantes et la relation personne soignante / personne soignée. Avant de détailler ces résultats, il est essentiel de clairement définir l’empathie et ses différentes dimensions. En effet, nous verrons que la réponse à la question « L’empathie mène-t-elle ou protège-t-elle du burnout ? », réside en partie dans la définition même que l’on attribue à l’empathie.
L’empathie est un concept largement utilisé, notamment en psychologie, mais il est difficile d’obtenir une définition consensuelle. En effet, plus de quarante-trois définitions coexisteraient aujourd’hui (Cuff et al., 2016). L’empathie comporte au moins deux dimensions essentielles (Batson, 2009). La dimension affective se définit par la réponse émotionnelle à l’émotion émise par autrui. On peut par exemple, se sentir concerné par la tristesse d’autrui et cette émotion peut plus ou moins résonner en nous. À l’extrême, on peut même être contaminé par l’émotion d’autrui et la ressentir exactement comme l’autre la ressent. La dimension cognitive de l’empathie, quant à elle, fait référence à l’identification et à la compréhension de l’état émotionnel et cognitif d’autrui (prise de perspective). Selon d’autres définitions, l’empathie comporte également une dimension motivationnelle, soit la motivation à se soucier d’autrui et à alléger sa souffrance (Jeffrey, 2016). Par ailleurs, la dimension communicationnelle de l’empathie est fondamentale en médecine. Il s’agit pour le personnel soignant de communiquer à la patientèle ce qu’ils ou elles ont compris de leurs problèmes, de leurs inquiétudes et de leurs besoins, et de vérifier directement auprès des patients si leur compréhension est exacte (Lelorain & Fontesse, 2021).
Définition de l’empathie personnelle ou l’empathie médicale
En s’appuyant sur la définition phare de Mercer & Reynolds (2002) et sur le cadre conceptuel de Beth Lown (2016), l’empathie médicale peut être définie de façon détaillée.Elle regroupe tout d’abord une préoccupation et un intérêt pour les émotions des patients et patientes (i.e., préoccupation empathique), qui s’accompagnent d’un certain ressenti de leurs émotions (i.e., partage émotionnel). Ces deux aspects permettent à la personne soignante de détecter précisément les émotions des patients ainsi que leurs besoins et perspectives (i.e., précision empathique) et de les comprendre plutôt que de les juger (i.e. compréhension empathique). Elle peut alors communiquer cette compréhension avec compassion, tout en vérifiant auprès de sa patientèle son exactitude (i.e. communication empathique). À partir de ce qui a été compris des émotions, besoins et perspectives des malades, le personnel tente ainsi de les aider (i.e. comportements d’aide).
Intérêt de l’empathie en oncologie
Une récente méta-analyse1 a détaillé les bénéfices de l’empathie médicale en oncologie (Lelorain et al., 2023). Tout d’abord, l’empathie du soignant améliore la relation personne soignante / personne soignée. En effet, les malades se sentent écoutés, plus confiants et mieux compris avec du personnel empathique. Cette relation permet aux personnes soignées de dévoiler davantage leurs ressentis, leurs douleurs, de se sentir plus à l’aise pour poser leurs questions ou témoigner de leur incompréhension. En retour, le ou la soignante pourra réajuster les traitements et la prise en soins globale du patient. Les malades perçoivent aussi subjectivement les bénéfices d’une approche empathique. Ils peuvent être plus satisfaits de leurs soins, ressentent moins d’anxiété à l’égard des soins et des traitements, se plaignent moins de douleurs et se sentent plus confiants pour prendre des traitements lourds et contraignants. En bref, la patientèle évalue sa qualité de vie comme étant meilleure lorsque le personnel de santé qui l’accompagne est empathique.
Des indicateurs objectifs témoignent également de l’importance de l’empathie médicale. Par exemple, après une opération pour traiter un cancer œsogastrique, les complications chirurgicales sont plus rares lorsque le chirurgien ou la chirurgienne avait été perçu(e) comme empathique (Gehenne et al., 2021), ou encore, il existe un lien entre l’empathie du médecin et l’adhésion des malades aux traitements proposés (Sikavi, Weseley, 2017). Le pouvoir de l’empathie s’observe également d’un point de vue physiologique. En effet, la sécrétion d’ocytocine associée à l’empathie perçue est connue pour ses effets antidouleurs et anti-stress (Hubble et al., 2017 ; Ma et al., 2019). En diminuant les mécanismes inflammatoires, l’empathie pourrait même diminuer la prolifération de certains cancers. Finalement, la méta-analyse démontre que l’empathie des médecins en oncologie est associée à une meilleure santé physique et psychologique de la patientèle, ainsi qu’à des soins de meilleure qualité (Lelorain et al., 2023).
Les membres de l’équipe soignante elle-même pourrait également bénéficier de son approche empathique. Puisque les soins sont perçus comme plus satisfaisants par les patients et patientes, les personnes exerçant en oncologie reçoivent en retour beaucoup de gratitude de leur part et de leurs proches. Elles sont ainsi plus satisfaites de l’emploi et se sentent plus compétentes (Lamiani et al., 2019 ; Lelorain, Fontesse, 2021). Si tous les bienfaits de l’empathie énoncés auparavant sont clairement en faveur d’une prise en charge humaniste et empathique, il faut souligner que l’effet bénéfique de l’empathie en oncologie varie selon les contextes. Dans les contextes d’annonces de mauvaises nouvelles (diagnostic, échec d’un traitement, récidive, etc.), l’empathie a un effet plus puissant sur les patients, en comparaison à des contextes plus « neutres » émotionnellement, tels que l’explication d’un traitement ou une consultation pré-chimiothérapie sans contre-indication à la poursuite du traitement (Lelorain et al., 2023).
L’empathie présente donc de nombreux bénéfices pour les personnes en oncologie, aussi il serait souhaitable que le personnel soignant soit empathique. Or, de nombreuses données suggèrent une diminution de l’empathie des étudiants et étudiants en médecine et en soins infirmiers au cours de leur cursus d’études (Andersen et al., 2020 ; Howick et al., 2023) et par conséquent parfois un manque d’empathie des soignants et soignantes sur le terrain (Larsen et al., 2022 ; Shen et al., 2019 ; Williamson et al., 2021). Comment expliquer ce niveau non-optimal d’empathie sur le terrain ? L’expression de l’empathie nécessite d’importantes ressources. En premier lieu, elle fait appel à des ressources individuelles pour les médecins et personnels de soin, comme savoir identifier et gérer les émotions des autres. En second lieu, il existe des ressources dites contextuelles, telles que la durée de la consultation ou de l’échange avec la patientèle, l’environnement de travail, le lieu dans lequel la consultation se déroule (dans un bureau convivial ou dans une chambre partagée avec un autre bénéficiaire de soin), etc.
Le manque de ressources permettant l’empathie peut mener à un épuisement émotionnel, fréquent chez le personnel en oncologie (HaGani et al., 2022). Par ailleurs, certains comprennent l’empathie comme le fait de ressentir les émotions de leur patientèle (Gibson et al., 2021). Cet aspect s’éloigne de la définition de l’empathie médicale et se rapproche de la contagion émotionnelle et pourrait mener au burnout. Avant de comprendre les facteurs pouvant mener à cet épuisement et la façon dont les processus empathiques pourraient intervenir, définissons tout de suite l’épuisement professionnel et les concepts associés.
Le burnout
Dans la vie de tous les jours, nous entendons régulièrement parler de burnout, mais ce mot n’est pas toujours bien utilisé. Ce concept, développé par Cristina Maslach dans les années 1980, se définit par un « syndrome associant un état d’épuisement physique et psychique intense ». Il comporte trois sous-dimensions (Maslach, Jackson, 1981). Tout d’abord, on trouve l’épuisement émotionnel, avec le sentiment d’être émotionnellement débordé et épuisé par son travail. Ensuite, il y a la déshumanisation ou dépersonnalisation, le cynisme, qui correspond au fait de considérer les malades comme des « objets ». Enfin, l’effondrement du sentiment d’accomplissement personnel au travail se traduit par le fait de se sentir insatisfait de son accomplissement au travail et moins efficace.
Le burnout se manifeste en particulier dans les situations professionnelles exigeantes en termes d’intensité du travail et d’implications émotionnelles (par exemple, confrontation à la mort et à la souffrance). Il peut également être favorisé par l’insécurité de l’emploi, lorsque la personne ne se sent pas autonome dans ses missions, ne se sent pas soutenue par sa hiérarchie ou ses collègues de travail (e.g., conflits interpersonnels, manque de soutien collectif de travail, management délétère), mais aussi lorsqu’elle ressent un conflit entre ses valeurs personnelles et celles de l’emploi (Maslach, Jackson, 1981).
En oncologie, les chiffres sont édifiants. Selon une récente méta-analyse, 30 % des oncologues et des prestataires de soins éprouveraient de l’épuisement émotionnel, tandis que 20 à 25 % auraient de hauts scores de déshumanisation et un faible accomplissement professionnel (HaGani et al., 2022).
La notion de burnout est également très associée à celle de la fatigue de compassion (fig. 1), concept privilégié pour le personnel soignant, notamment en oncologie ou en soins palliatifs (Zawieja, 2016). La fatigue de compassion regroupe le burnout et l’exposition aux stresseurs traumatiques secondaires (i.e. stress ressenti par le personnel en lien avec les traumatismes des malades). Charles Figley, qui a mis en avant ce concept, postule que le contact prolongé avec la souffrance favoriserait un sentiment d’épuisement émotionnel et physique, dû en partie au fait d’être empathique (Figley, 2002). À l’inverse de la fatigue de compassion, se trouve la satisfaction de compassion, soit le plaisir éprouvé d’avoir aidé autrui. L’échelle de qualité de vie professionnelle (Professional Quality of Life, ProQOL, Stamm, 2009), majoritairement utilisée pour mesurer le bien-être de l’équipe soignante, intègre ces dimensions étroitement liées, comme cela est résumé par la figure 1.
Conséquences du burnout du personnel soignant en oncologie
La vulnérabilité des membres du personnel au burnout et à la fatigue de compassion pose de nombreux enjeux. Tout d’abord, la santé mentale et physique de ces derniers est menacée par les symptômes dépressifs et anxieux, l’irritabilité, les troubles du sommeil, la fatigue, les problèmes cardiaques et digestifs, et l’absentéisme que causent le burnout (Banks et al., 2024 ; Fukumori et al., 2020 ; Hunt et al., 2019). Ces derniers présentant de hauts scores de burnout et de stress traumatiques secondaires tendent également à employer des stratégies inadaptées, comme l’évitement et la suppression émotionnelle, ainsi que l’anesthésie émotionnelle par l’usage de substances et d’alcool (Banks et al., 2024). Ces symptômes ne sont pas sans conséquences et peuvent se cristalliser à long terme. Par exemple, le risque suicidaire est une conséquence non négligeable des troubles dépressifs causés par le burnout, et bien qu’il soit difficile d’obtenir des chiffres précis sur celle-ci, les idéations suicidaires semblent relativement fréquentes chez les internes et les médecins (Menon et al., 2020).
Les membres du corps médical voit également l’intérêt pour leur métier diminuer et ne s’accomplissent plus au travail, bien qu’ils aient certainement choisi cette profession par vocation, par intérêt pour les aspects relationnels et humains, par valeurs, sentiment de compétence, goût pour la médecine, etc. Par exemple, dans l’étude d’Arimon-Pagès et al., (2019), 85 % des infirmiers et infirmières reportaient qu’ils ne choisiraient pas ce cursus à nouveau. Par ailleurs, l’épuisement d’un affecte également la dynamique de son équipe : la cohésion, l’ambiance générale et la motivation en son sein sont bouleversées. De plus, l’absentéisme qui découle du burnout cause des remplacements répétés dans l’équipe, ou une charge plus importante pour l’équipe de soin qui assure une partie du travail de leur collègue absent (Hunt et al., 2019 ; Xie et al., 2021).
L’épuisement de cette équipe impacte aussi la patientèle et la relation personne soignante / personne soignée. En effet, le personnel épuisé est plus à risque de commettre des erreurs médicales, ce qui affectera ensuite la prise en soins de la personne malade et pourrait avoir de lourdes conséquences sur sa santé (Menon et al., 2020). Dans les cas les moins graves, les personnes ayant été victimes d’une erreur médicale réalisent par exemple, des examens inutiles, tandis que dans les cas les plus graves, leur santé est directement menacée, par exemple, par une erreur de dosage de traitement (Doolittle, 2021 ; Xie et al., 2021), ou parce qu’un examen important n’a pas été prescrit. Au-delà de ces conséquences potentiellement catastrophiques, l’épuisement du personnel a aussi des conséquences pour l’institution, notamment financières. Les erreurs médicales se traduisent par des frais de santé supplémentaires. Le fait de devoir remplacer un soignant en arrêt maladie représente également des coûts additionnels pour les institutions (Hall et al., 2016 ; Shanafelt et al., 2017).
En résumé, les conséquences de l’épuisement professionnel du personnel de soin en oncologie concernent l’ensemble des acteurs de santé. Afin de répondre à ces enjeux, la communauté scientifique en psychologie et en sciences médicales a eu l’ambition de mieux comprendre les facteurs de risque du burnout chez le personnel en oncologie.
Facteurs de risque du burnout et rôle de l’empathie
Facteurs sociodémographiques
La littérature scientifique s’est intéressée aux aspects socio-démographiques, tels que l’âge, le statut marital, le niveau d’études, l’ethnie ou encore le genre. Bien qu’aucun consensus ne soit établi pour ces variables, on tend à observer un effet de l’âge sur le burnout. L’expérience professionnelle récente et la moindre confiance en leurs capacités de prise de décision exposeraient en effet les jeunes professionnels de santé au burnout. L’effet de l’âge peut également se comprendre par l’amélioration des capacités de gestion des émotions avec l’avancée en âge (Burr et al., 2021).
Le statut marital a également été largement étudié. Certaines études montrent un effet protecteur du mariage tandis que d’autres montrent l’inverse (Xie et al., 2021). Au-delà du statut conjugal en lui-même, c’est très certainement une relation de qualité avec l’autre moitié qui pourrait être un facteur protecteur contre le burnout (Xie et al., 2021).
Par ailleurs, le genre est un facteur régulièrement exploré. S’il n’y a pas de consensus sur l’effet du genre sur le burnout, de nombreuses études soulignent que les scores d’épuisement émotionnel tendent à être plus importants pour les femmes (HaGani et al., 2022 ; Surchat et al., 2022 ; Xie et al., 2021). Cela peut s’expliquer par une charge émotionnelle plus forte. Les personnes accompagnées dévoileraient davantage leurs ressentis, leurs émotions et leurs traumatismes aux femmes, en comparaison aux soignants hommes. La société attend en effet plus de compassion et d’empathie de la part des femmes et elles le seraient également davantage, ayant été éduquées et socialisées dans ce sens. Les femmes déclarent d’ailleurs plus de préoccupations empathiques que les hommes (Surchat et al., 2022), répondant ainsi à la norme de genre qui oriente les femmes à se montrer plus empathiques que les hommes. À cette charge émotionnelle professionnelle, s’ajoutent les charges mentale et émotionnelle personnelles, que l’on sait plus importantes pour les femmes, dans la mesure où elles sont plus impliquées dans la préservation du bien-être physique et psychologique de leurs proches (HaGani et al., 2022b ; Xie et al., 2021). Par ailleurs, les scores de dépersonnalisation seraient plus élevés chez les hommes (HaGani et al., 2022). Néanmoins, si un effet du genre a pu être observé chez les oncologues, il ne l’était pas toujours pour d’autres professions, comme dans le corps infirmier, ce qui confirme qu’un seul facteur à lui seul ne peut expliquer le burnout.
Le type de profession serait d’ailleurs un autre facteur expliquant les différences d’expérience du burnout. Les professions plus techniques, pour lesquelles l’empathie des médecins tend à être moins importante ou moins démontrée, seraient moins sujettes au burnout, en comparaison aux professions impliquant de hautes qualités relationnelles, mobilisées tout au long de la journée (e.g., être au chevet du patient, annoncer un diagnostic ou l’aggravation de la maladie) (Andersen et al., 2020).
Faire face à la détérioration des personnes malades
Plusieurs spécificités du travail en oncologie ont été identifiées comme étant particulièrement difficiles et épuisantes. Nous les détaillons ici ainsi que leur implication pour l’empathie.
Le fait de travailler avec des personnes diagnostiquées de cancer dont la dégradation physique est très visible est source de détresse pour l’équipe médicale (Fukumori et al., 2020 ; Gibson et al., 2021). C’est le cas, par exemple, pour les cancers du visage et du cou, pour lesquels les besoins sont également très spécifiques et les traitements particulièrement pénibles (Gibson et al., 2021). Ainsi, le personnel peut éprouver une certaine frustration à la suite des efforts déployés pour ajuster les traitements, diminuer la douleur, répondre aux besoins des malades ou améliorer leur qualité de vie. L’exposition à l’irritabilité des patient.e.s et à leurs changements d’humeur est également fréquente (Gibson et al., 2021). Le personnel de soin rapporte ainsi se sentir très empathique envers ces personnes, qui subissent des traitements particulièrement douloureux et dont les transformations physiques sont choquantes. Certains professionnels de santé montrent même leur tristesse, en pleurant avec leurs patients (Gibson et al., 2021).
Travailler avec une patientèle jeune
Le fait de travailler avec de jeunes individus, notamment des enfants, serait une des facettes les plus stressantes du travail en oncologie. Annoncer un diagnostic de cancer à un enfant et à ses parents, ou à une personne jeune, semble plus injuste que d’annoncer une mauvaise nouvelle à une personne plus âgée (Berger et al., 2021 ; Fukumori et al., 2020). Il semble aussi que les soignants soient en difficulté pour se distancier de la maladie ou de la mort d’un enfant, tant cela pourrait faire écho à leur propre expérience (e.g. le fait d’avoir soi-même des enfants).
Faire face aux phases terminales et à la mort
Travailler avec des malades dont les chances de guérison sont très faibles et dont les possibilités de traitements sont très réduites est également particulièrement difficile. Cela se reflète par le nombre important d’études sur le sujet. On pourrait ainsi penser que l’exposition en soi à la mort ou à la douleur physique des personnes souffrantes serait associée au burnout. En fait, le sujet est plus complexe. Ce qui est associé au burnout et à la détresse personnelle de l’équipe médicale, est le sentiment d’échec causé par la mort des personnes en soin ou l’inefficacité des traitements (Laor-Maayany et al., 2020). Le personnel soignant peut se sentir responsable de la souffrance de leur patientèle, voire de leur mort, et se blâmer en conséquence. Or, le blâme envers soi est particulièrement associé au burnout (Doolittle, 2021). Par ailleurs, les soignants exposés à la souffrance et à la mort ont de hauts scores de deuil (i.e. détresse psychologique importante associée à la perte) et de stress traumatiques secondaires (i.e. niveau de stress perçu par le soignant en lien avec les traumatismes des malades) (Laor-Maayany et al., 2020). Une étude centrée sur l’empathie et le sentiment de deuil chez les oncologues lorsque les malades décèdent, est particulièrement éclairante. Elle indique que la détresse personnelle (i.e. le fait d’être personnellement en détresse face à la détresse de l’autre) et la prise de perspective (i.e. essayer de comprendre la perspective de l’autre), soit deux composantes de l’empathie, ont des implications différentes (Hayuni et al., 2019). La détresse personnelle engendre un stress traumatique secondaire qui engendre lui-même un sentiment de deuil important chez le personnel de soin. Au contraire, la prise de perspective atténue le sentiment de deuil de l’équipe soignante. La prise de perspective, composante cognitive de l’empathie, serait donc protectrice. La prise de perspective implique une prise de distance de sa propre perspective et de ses propres émotions pour comprendre les besoins et émotions de la personne malade. Au contraire de cette démarche saine et altruiste, qui reflète une réponse orientée vers autrui en essayant de comprendre la personne, la détresse personnelle reflète une réponse émotionnelle orientée vers soi. Le soignant se sent en détresse face à la détresse de l’autre et reste focalisée sur son propre ressenti (Hayuni et al., 2019 ; Hunt et al., 2019). La distinction entre soi et autrui doit donc être omniprésente pour une empathie « saine ».
Face à la mort, l’attitude et les croyances des membres du personnel de santé jouent aussi un rôle important. Plus le personnel de soin a peur de la mort, plus son score d’épuisement émotionnel et de dépersonnalisation est élevé et moins il a d’accomplissement personnel (Guo, Zheng, 2019). Considérer la mort comme une façon de s’échapper d’une vie faite de souffrances montre les mêmes effets sur les composantes du burnout. Au contraire, considérer la mort comme une phase intégrante de la vie, diminue la dépersonnalisation et favorise l’accomplissement personnel (Guo, Zheng, 2019). Finalement, l’attitude d’évitement ou d’acceptation de la mort de la part des membres du personnel de santé est un élément déterminant du burnout. Il est donc nécessaire d’intégrer les aspects culturels, puisque la perception de la mort diffère selon les sociétés.
Travailler avec les proches des personnes malades
Travailler au contact de la famille de la personne malade est également un facteur d’épuisement (Berger et al., 2021 ; Fukumori et al., 2020). Faire face à la détresse des proches est une difficulté supplémentaire pour le personnel soignant, qui est déjà confronté aux émotions de sa patientèle. Il faut rappeler que les proches paient également un lourd tribut, puisque leur qualité de vie est souvent moindre que celle des personnes en soin. Il est d’autant plus difficile de faire face aux proches lorsque les intentions diffèrent de celles de la personne malade (e.g. l’un souhaite rester à l’hôpital tandis que l’autre souhaite le retour à domicile) ou lorsque les proches n’honorent pas les décisions, souhaits ou besoins de la personne malade. De plus, le manque de communication entre les différents membres de la famille et les malades, le peu de soutien apporté par les proches à la personne suivie sont d’autres éléments qui mettent les membres du personnel de santé en difficulté, surtout lorsque les personnes hospitalisées expriment de la déception et constatent une différence entre leurs attentes et la réalité (Fukumori et al., 2020). À nouveau, on peut imaginer que ces situations, sources d’une grande tristesse pour la personne souffrante, puissent faire écho à la situation personnelle de l’équipe soignante.
Par ailleurs, certains membres du personnel de santé développent un lien fort avec les proches de leur patientèle et prennent pour habitude de les informer de l’évolution de la santé de leur proche malade via les réseaux sociaux (Berger et al., 2021). Cette proximité serait délétère car les conversations peuvent insidieusement s’immiscer dans leurs vies professionnelle et personnelle. Il devient alors difficile de maintenir une relation strictement professionnelle avec les proches.
Aspects contextuels et institutionnels
Bien que l’épuisement professionnel soit par définition étroitement lié au contexte du travail, les aspects contextuels et institutionnels sont souvent peu pris en compte pour expliquer l’épuisement du personnel soignant. Les aspects institutionnels, structurels, d’équipe, de management et d’organisation sont pourtant fondamentaux. Les témoignages de ces soignants et soignantes à propos de leur épuisement révèlent que la qualité de la relation avec les autres membres de l’équipe est un facteur explicatif très important. Les conflits et le turnover au sein de l’équipe, l’impression de ne pas être soutenu par ses collègues et sa hiérarchie, ainsi que les comportements de harcèlement sont des facteurs menant à l’épuisement (Xie et al., 2021). Nous devons en effet souligner la violence générale observée à l’égard de l’équipe de soin, de la part de collègues mais aussi de la part des personnes hospitalisées et des visiteurs (Liu et al., 2019 ; Vargas et al., 2020). Au sein d’une large cohorte de médecins américains, 82,5 % des femmes et 65,1 % des hommes rapportaient avoir vécu au moins un épisode de harcèlement sexuel au sein de l’équipe de travail, durant l’année de l’enquête. De plus, 64,4 % des femmes et 44,1 % des hommes rapportaient du harcèlement de la part des personnes suivies et de leur famille (Vargas et al., 2020). D’autres données montrent que 24,4 % des professionnels interrogés avaient été exposées à la violence physique, tandis que la violence verbale était la plus fréquemment expérimentée, par 57,6 % des membres du personnel de santé (Liu et al., 2019). Ces éléments participent sans aucun doute au sentiment d’épuisement de ces derniers.
Au contraire, le soutien social offert par l’institution, le fait de se sentir valorisé par la hiérarchie protège du burnout, et favorise la satisfaction personnelle et la satisfaction de compassion (Doolittle, 2021). La charge de travail et le nombre d’heures travaillées par jour sont d’autres facteurs de burnout (Hegel et al., 2021). En particulier, le travail de nuit a été identifié comme un élément influençant fortement l’épuisement émotionnel (Berger et al., 2021). En parallèle, l’équipe soignante explique qu’il lui est difficile d’équilibrer la vie personnelle avec la vie professionnelle. Certains agents de santé explicitent le sentiment d’être « tout le temps en service », d’être « un hamster en cage », de ne plus avoir l’énergie d’être disponibles pour leur famille et de ne pas s’autoriser à se distancier de leur travail à la fin de leur service. L’article de Gibson et ses collègues (2021) décrit bien la détresse de l’équipe médicale face aux challenges de sa profession. Si les membres du personnel de santé ont conscience de l’impact négatif du fait de placer leur travail en priorité et s’ils / elles reconnaissent l’importance de préserver leur santé mentale, il leur est difficile d’y parvenir, tant le manque de repos est normalisé au sein du milieu médical. Le personnel interrogé témoigne du sentiment de culpabilité sous-jacent au fait de prendre ses jours de repos et du stigma y étant associé, tel qu’« être paresseux ou paresseuse » ou ne pas « participer au travail d’équipe » (Gibson et al., 2021).
Faute de personnel suffisant dans le service et de ressources institutionnelles, certains membres du personnel de santé réalisent des tâches supplémentaires et expliquent devoir se battre pour trouver des ressources, en plus d’assurer leur travail. Ces derniers travaillent ainsi sans compter les heures, rapportent souvent du travail chez eux et ne parviennent plus à prendre soin d’eux-mêmes ni de leur famille (Gibson et al., 2021). En conséquence, ils se sentent épuisés, ou « robotisés ». On a ainsi du mal à imaginer un soignant, personnellement submergé, être complètement disponible et en capacité d’annoncer une mauvaise nouvelle à une personne hospitalisée et de faire face à ses émotions.
Les aspects financiers sont d’autres éléments influençant le bien-être et la motivation de l’équipe médicale en oncologie. Une méta-analyse a montré que plus le salaire des infirmiers et infirmières était bas, plus leur fatigue de compassion était importante (Xie et al., 2021). Ce lien entre le montant du salaire et la fatigue de compassion peut s’expliquer par l’expérience : un membre de l’équipe infirmière récemment diplômé aurait un salaire inférieur à celui d’un collègue plus expérimenté et se sentirait moins prêt à faire face aux difficultés et à prendre des décisions. Cela favoriserait l’épuisement. Nous pouvons également suggérer qu’un salaire bas peut être lié au sentiment de manque de reconnaissance et de soutien par la hiérarchie et l’institution. Or, comme nous le soulignions plus haut, le soutien perçu de la hiérarchie protège de la fatigue compassion. Les moyens financiers déployés à plus grande échelle jouent également un rôle essentiel pour le bien-être du personnel, qu’ils concernent les locaux, le matériel mis à disposition, ou encore le recrutement et le remplacement du personnel.
Bien que les caractéristiques individuelles des membres du personnel de santé, notamment l’engagement émotionnel et le rapport subjectif à leur métier, jouent un rôle certain dans l’apparition de l’épuisement professionnel, les éléments contextuels que nous venons de détailler doivent impérativement être pris en compte lorsqu’il s’agit de proposer des interventions et des recommandations pour la prévention du burnout chez l’équipe de soin en oncologie. Cela sera développé dans la suite et fin de ce chapitre.
Comment prévenir le burnout ?
Comme nous l’avons vu, le contexte de l’oncologie est propice au burnout et à la fatigue de compassion du corps médical. S’il n’est pas possible de changer leur exposition à la mort, à la souffrance, ou encore aux tâches particulièrement pénibles, il est en revanche possible de modifier la perception reçue. Dans cette dernière partie, nous détaillerons comment prévenir l’épuisement professionnel du personnel soignant en oncologie tout en discutant des limites des approches individuelles proposées.
Mieux comprendre et utiliser l’empathie
L’empathie recouvre différentes facettes, très différentes les unes des autres dans leurs implications psychologiques (Decety, 2020 ; Hall et al., 2021). Reconnaître que le soi est distinct de l’autre et éviter une fusion des expériences est donc essentiel (Delgado et al., 2023). Par conséquent, plutôt que de dire que l’empathie est néfaste ou protectrice du burnout, il est plus pertinent de s’intéresser à ses différentes dimensions. La contagion émotionnelle favoriserait l’émergence de l’épuisement car le fait de se sentir en détresse, face à celle d’autrui, est par définition difficile à vivre émotionnellement. En effet, dans ce cas, la détresse ressentie est envahissante (Decety, 2020). Par ailleurs, si la prise de perspective, qui mobilise la sphère cognitive de l’empathie, est protectrice sur le plan émotionnel, elle peut cependant être coûteuse en termes d’efforts (Cameron et al., 2019). Chercher à comprendre l’autre est parfois difficile, surtout lorsqu’on se sent débordé par le travail. Par exemple, essayer de comprendre la crainte objectivement infondée d’une patiente vis-à-vis d’une chirurgie importante, demande aux médecins de mettre de côté, provisoirement, leur avis médical, de poser des questions à la patiente, d’entrer dans son monde et son histoire, etc.
De plus, nous avons vu que les membres du personnel de santé accordent souvent beaucoup d’importance à la facette émotionnelle de l’empathie, ce qui n’est qu’une partie de ce que recoupe l’empathie médicale. Les malades ont d’ailleurs d’autres attentes et préfèrent que leurs soignants soient davantage centrés sur la relation (i.e. attention pour le bien-être du patient, écoute active, compréhension et considération de la personne à part entière), plutôt que sur les émotions (Hall et al., 2021). Ainsi, le décalage entre les définitions de l’empathie adoptées par l’équipe de soin d’une part et la patientèle d’autre part, montre le besoin d’approfondir la formation du personnel sur le thème de l’empathie, qu’elle soit initiale ou continue. Si les compétences empathiques, relationnelles et communicationnelles sont davantage enseignées ces dernières années, cela doit encore être consolidé.
De plus, donner l’opportunité aux internes de s’entraîner à ces compétences, via des mises en situations pratiques et réalistes, s’avère nécessaire, tant les compétences empathiques semblent diminuer au fil du cursus, notamment chez les internes en médecine (Andersen et al., 2020). D’ailleurs, selon une récente méta-analyse, lorsque l’empathie des internes en médecine est élevée, l’épuisement professionnel tend à être faible, et vice versa. L’empathie des internes est également liée à un accomplissement personnel plus important et à une meilleure compétence clinique, tandis que l’épuisement professionnel est associé à de moins bonnes compétences académiques, à des taux accrus de consommation de substances et à une altération de la santé mentale (Cairns et al., 2024). Il y a donc tout intérêt à créer des environnements d’apprentissage visant à favoriser l’empathie et réduire l’épuisement professionnel.
Par ailleurs, le fait de ressentir de la détresse peut être valorisé par l’équipe médicale. En effet, si la détresse personnelle est associée au burnout, elle peut également être associée à la satisfaction de compassion (Hunt et al., 2019). En d’autres termes, d’un côté, le personnel serait satisfait d’éprouver de la détresse car il penserait alors être un accompagnement de qualité car concerné par sa patientèle et ses émotions, de l’autre, cette détresse personnelle face à la détresse de l’autre peut clairement conduire au burnout. Il serait ainsi judicieux de comprendre la perspective du personnel soignant sur le sujet tout en leur faisant prendre conscience des dangers potentiels de ces ressentis. En effet, le fait de ressentir de la tristesse en réaction à une situation particulièrement douloureuse pour une personne en traitement est une chose, mais se sentir en détresse face à cela en est une autre ; cela signifie précisément que l’impact est trop important.
Finalement, le défi pour les membres du personnel de santé serait surtout d’avoir les ressources nécessaires pour réguler leurs émotions, afin de ne pas être submergés par une accumulation d’émotions négatives trop fréquentes ou intenses.
La régulation émotionnelle : pistes thérapeutiques
Une étude centrée sur les internes en médecine (toutes spécialités confondues) a exploré le lien entre leurs stratégies de régulation des émotions et leur épuisement professionnel (Doolittle, 2021). Les stratégies dites dysfonctionnelles étaient fortement associées au burnout et à l’insatisfaction de la compassion. Concrètement, le fait d’être dans le déni, de se blâmer, de se désengager (e.g., le retrait social, l’évitement des pensées et des émotions concernant le stresseur), était significativement associé au burnout. Au contraire, les stratégies de régulation dites fonctionnelles protégeaient du burnout tout en favorisant la satisfaction de compassion. Ainsi, les internes qui utilisaient des stratégies de planification (i.e., prévoir un plan d’action), un coping actif (i.e., agir concrètement pour améliorer la situation), qui acceptaient la situation, réinterprétaient positivement les choses (i.e., donner un sens positif aux événements) et persévéraient pour atteindre des objectifs à long terme, avaient un score de burnout significativement moins élevé que les membres du personnel de santé utilisant les stratégies dysfonctionnelles. Les stratégies fonctionnelles amenaient également ces derniers à être plus satisfaits de leur compassion, en comparaison aux stratégies dysfonctionnelles (Doolittle, 2021).
Bien que cette étude ne concerne pas spécifiquement l’oncologie, ses résultats soulignent l’influence de la régulation des émotions sur le bien-être des professionnels de santé. Ils confirment d’autres données sur les médecins, qui montrent également qu’une bonne régulation des émotions diminue le burnout (Jackson-Koku & Grime, 2019). Ces recherches font écho aux résultats ultérieurement présentés dans ce chapitre, concernant la mort et le deuil. Ce qui influencerait le plus l’épuisement des soignants et soignantes ne serait pas l’exposition à la mort en soi mais l’interprétation de cet événement menant au blâme de soi et/ou au désengagement, par exemple, « je n’ai pas pu empêcher la mort de cette patiente, je ne suis donc pas apte » versus « la mort est un processus inévitable, j’ai accompagné de mon mieux cette personne avec humanité, je me sens donc satisfait du travail accompli ».
Ainsi, aider le corps médical à réguler ses émotions et à voir les choses sous un meilleur jour serait prometteur pour la prévention du burnout. En pratique, une première solution relativement simple à mettre en place, permettant le décodage et la régulation des émotions, serait la supervision clinique entre collègues (Mahmoud & Rothenberger, 2019). Son importance est souvent soulignée, dès la formation des élèves, notamment en psychologie. En pratique pourtant, ces supervisions cliniques ne sont pas systématiques et souvent reportées, faute de temps et de moyens.
Par ailleurs, de nombreuses recherches ont eu pour objectif de tester l’efficacité d’approches thérapeutiques, telles que la pleine conscience ou l’auto-compassion, pour la réduction du burnout des membres du personnel de santé (Epstein et al., 2022 ; Jarrad, Hammad, 2020 ; Neff et al., 2020), comme le décrivent les paragraphes suivants.
La pleine conscience est une approche thérapeutique dont le processus principal est l’attention non jugeante au moment présent, via notamment la pratique de la méditation (Kabat-Zinn, 2003). Les techniques de pleine conscience ont démontré leur efficacité dans le traitement des symptômes dépressifs et anxieux ainsi que dans la prévention de la rechute dépressive (Ghahari et al., 2020 ; McCartney et al., 2021). Ces bénéfices ont ainsi motivé la création d’interventions de pleine conscience pour le personnel de soin, avec des résultats prometteurs pour leur bien-être, la qualité des soins, ainsi que la satisfaction, l’engagement et le sens trouvé au travail (Epstein et al., 2022 ; Scheepers et al., 2020).
Une autre approche particulièrement pertinente pour prévenir le burnout est l’autocompassion. Nous avons précédemment vu que se blâmer ou blâmer autrui était associé au burnout. Or, il semble que le blâme envers soi soit fréquent chez le corps médical, surtout lorsqu’il est confronté à la mort. La culpabilité ressentie par le personnel soignant en oncologie justifie ainsi l’utilisation de l’autocompassion. Principalement développée par Kristin Neff, l’autocompassion signifie avoir de la compassion pour soi, c’est-à-dire faire preuve, envers soi, d’un soutien et d’une acceptation inconditionnelle de sa personne et de ses émotions et pensées, lorsque l’on se sent en détresse ou en difficulté (Neff, 2003). L’autocompassion repose sur trois principes :
-
La gentillesse envers soi ;
-
L’humanité partagée (i.e. le fait que la souffrance fait partie de l’expérience humaine) ;
-
La pleine conscience (i.e. se centrer sur le moment présent, sans jugement).
Un programme a été conçu sur ces principes pour tous les types de professionnel.le.s de santé et a montré ses bénéfices : en seulement six sessions, le programme améliorait significativement la compassion pour soi et le bien-être, et ces effets se maintenaient trois mois après l’intervention. Les niveaux de burnout et de stress traumatique secondaire diminuaient également (Neff et al., 2020).
En résumé, ces techniques sont efficaces et ont en commun le fait de proposer un recentrage sur soi et sur les aspects identifiés comme prioritaires pour sa vie. Cela fait sens, lorsque l’on sait que de nombreux membres soignants sont insatisfaits du temps consacré à leur famille et aux activités ressourçantes (Jarrad, Hammad, 2020). Les valeurs sont également au cœur de ces approches, ce qui est adapté pour le corps médical qui ne se reconnait plus dans les valeurs prônées par son institution (i.e. conflit de valeurs), ce qui est précisément une composante du burnout. Néanmoins, après avoir détaillé les éléments contextuels participant à l’épuisement du corps médical, nous devons souligner que ces pistes thérapeutiques ne seront pas toujours suffisantes. Nous conclurons sur ce dernier point.
Les limites de la régulation émotionnelle
L’étude de Doolittle (2021), qui relève les bénéfices d’une bonne régulation des émotions, souligne aussi le besoin de considérer davantage les éléments contextuels participant au burnout. Entrainer les soignantes à une meilleure régulation émotionnelle, à mieux comprendre les différentes facettes de l’empathie ou encore les entrainer à l’autocompassion est très utile mais sous-entend que c’est avant tout aux professionnels de santé que revient la responsabilité de leur propre bien-être. Cela peut être lourd et culpabilisant pour les soignants et soignantes dont les missions sont déjà difficiles, et qui devraient en plus, fournir des efforts pour réguler leurs émotions dues à des conditions de travail parfois inacceptables (manque de personnel, de matériel, salaires bas, etc.).
Il faut donc reconnaître que la psychologie ou les approches centrées sur le bien-être n’ont pas le pouvoir de transformer les aspects institutionnels qui pèsent pourtant lourdement sur l’émergence du burnout. La régulation émotionnelle ne pourra pas à elle seule résoudre entièrement les problèmes de burnout. La prévalence de l’épuisement émotionnel chez les infirmiers en oncologie, de 32 % dans une méta-analyse récente, suffit bien à démontrer que le problème ne peut être uniquement psychologique (HaGani et al., 2022). C’est pourquoi, comme d’autres (West et al., 2018), nous prônons, pour lutter contre le burnout et favoriser l’empathie, des interventions visant à améliorer à la fois la régulation émotionnelle des différents corps médicaux mais aussi les conditions et l’environnement de travail. D’ailleurs, il faut souligner que les programmes visant à améliorer le bien-être en milieu médical, doivent être conçus spécifiquement pour un service (par exemple, les urgences) et une profession en particulier (par exemple, les chirurgiens et chirurgiennes). Avant la création et la mise en place de l’intervention, l’organisation du service, les conditions de travail ainsi que les enjeux spécifiques à la profession du service en question doivent être intégrés. Cela est nécessaire pour prendre en compte les difficultés spécifiques à un type de personnel, dans un contexte précis. Ne pas considérer ces spécificités peut alors être délétère, avec pour conséquence potentielle l’augmentation du burnout (Hart et al., 2018).
Pour conclure, soulignons que la prévalence du burnout augmente de façon notable et que l’identification des facteurs menant à cet état d’épuisement est primordiale pour améliorer la qualité de vie du personnel de soin et par conséquent, celle des personnes soignées. Les recherches sont donc nécessaires pour sensibiliser l’ensemble du système médical aux risques du burnout et à ses conséquences directes et indirectes. Valoriser ces résultats et les rendre accessibles au grand public est également un véritable enjeu pour initier une réflexion collective sur l’épuisement émotionnel de nos soignants et sur la stigmatisation associée à cet état (Murali et al., 2018).
Take home messages
Tout au long de ce chapitre, nous avons vu que l’empathie est au cœur de la relation personne soignante / personne soignée et très importante pour la santé des malades. L’empathie est multidimensionnelle, complexe, et parfois mal comprise et de ce fait mal « déployée » par le personnel soignant en oncologie, dont les missions et conditions d’exercice peuvent le rendre vulnérable au burnout. En guise de conclusion, nous souhaitons souligner plusieurs points clés importants à retenir.
-
L’empathie des soignants en oncologie n’est pas le partage émotionnel, et encore moins la détresse émotionnelle face à la détresse d’autrui. L’empathie médicale est multidimensionnelle. Certes, elle comporte une sphère affective, de résonance émotionnelle, mais qui ne doit pas aller jusqu’à la détresse personnelle. Elle comporte aussi une sphère cognitive (identifier les émotions, besoins et perspectives de la patientèle, tenter de la comprendre sans jugement) et comportementale (agir en fonction de cette compréhension, pour aider les malades), qui sont fondamentales;
-
L’absorption des émotions des personnes prises en charge, de manière intense et répétée, peut mener à la détresse et au burnout des professionnels de santé, tout comme le sentiment d’échec ou le blâme envers soi face à la souffrance et à la mort de ces personnes accompagnées;
-
Les personnes en soin attendent une implication plus importante du corps médical sur les aspects relationnels en comparaison aux aspects émotionnels. L’attention pour le bien-être, l’écoute active, la compréhension et la considération de la personne à part entière sont des aspects à prioriser par le corps médical;
-
L’entrainement à la régulation émotionnelle, par exemple, par des programmes favorisant la pleine conscience, l’autocompassion ou encore l’action plutôt que le blâme, est un outil efficace pour prévenir et réduire le burnout. La formation des élèves en études de santé aux différentes facettes de l’empathie médicale est également une piste prometteuse;
-
Enfin, les aspects contextuels participent, par définition, à l’émergence du burnout. Pourtant, les aspects institutionnels, structurels, d’équipe, de management et d’organisation sont souvent sous-estimés. Or, le fait de ne considérer que les facteurs individuels est culpabilisant pour les membres du corps médical. En parallèle d’un travail auprès de ces derniers, l’amélioration des conditions de travail doit être intégrée aux programmes visant à lutter contre le burnout.
Bibliographie
Andersen, F. A., Johansen, A.-S. B., Søndergaard, J., Andersen, C. M., & Assing Hvidt, E. (2020). « Revisiting the trajectory of medical students’ empathy, and impact of gender, specialty preferences and nationality: A systematic review ». BMC Medical Education, 20(1), 52. https://doi.org/10.1186/s12909-020-1964-5.
Banks, J., Lopez, V., Sahay, A., & Cleary, M. (2024). « A Scoping Review of Compassion Fatigue Among Oncology Nurses Caring for Adult Patients ». Cancer Nursing, 47(4), E213. https://doi.org/10.1097/NCC.0000000000001226.
Batson, C. D. (2009). « These things called empathy: Eight related but distinct phenomena ». In The social neuroscience of empathy . Boston Review, 3-15. https://doi.org/10.7551/mitpress/9780262012973.003.0002.
Berger, R. S., Wright, R. J., Faith, M. A., & Stapleton, S. (2021). « Compassion fatigue in pediatric hematology, oncology, and bone marrow transplant healthcare providers: An integrative review ». Palliative & Supportive Care, 1-11. https://doi.org/10.1017/S147895152100184X.
Burr, D. A., Castrellon, J. J., Zald, D. H., & Samanez-Larkin, G. R. (2021). « Emotion dynamics across adulthood in everyday life : Older adults are more emotionally stable and better at regulating desires ». Emotion, 21, 453-464. https://doi.org/10.1037/emo0000734.
Cairns, P., Isham, A. E., & Zachariae, R. (2024). « The association between empathy and burnout in medical students : A systematic review and meta-analysis ». BMC Medical Education, 24, 640. https://doi.org/10.1186/s12909-024-05625-6.
Cameron, C. D., Hutcherson, C. A., Ferguson, A. M., Scheffer, J. A., Hadjiandreou, E., & Inzlicht, M. (2019). « Empathy is hard work: People choose to avoid empathy because of its cognitive costs ». Journal of Experimental Psychology: General, 148(6), 962-976. https://doi.org/10.1037/xge0000595.
Cuff, B. M. P., Brown, S. J., Taylor, L., & Howat, D. J. (2016). « Empathy: A Review of the Concept ». Emotion Review, 8(2), 144-153. https://doi.org/10.1177/1754073914558466.
Decety, J. (2020). « Empathy in Medicine: What It Is, and How Much We Really Need It. The American Journal of Medicine, 133(5), 561-566. https://doi.org/10.1016/j.amjmed.2019.12.012.
Delgado, N., Delgado, J., Betancort, M., Bonache, H., & Harris, L. T. (2023). « What is the Link Between Different Components of Empathy and Burnout in Healthcare Professionals? A Systematic Review and Meta-Analysis ». Psychology Research and Behavior Management, 16, 447‑463. https://doi.org/10.2147/PRBM.S384247.
Doolittle, B. R. (2021). « Association of Burnout with Emotional Coping Strategies, Friendship, and Institutional Support Among Internal Medicine Physicians ». Journal of Clinical Psychology in Medical Settings, 28(2), 361-367. https://doi.org/10.1007/s10880-020-09724-6.
Epstein, R. M., Marshall, F., Sanders, M., & Krasner, M. S. (2022). « Effect of an Intensive Mindful Practice Workshop on Patient-Centered Compassionate Care, Clinician Well-Being, Work Engagement, and Teamwork ». The Journal of Continuing Education in the Health Professions, 42(1), 19-27. https://doi.org/10.1097/CEH.0000000000000379.
Ferlay, J., Ervik, M., Lam, F., Laversanne, M., Colombet, M., Mery, L., Piñeros, M., Znaor, A., Soerjomataram, I., & Bray, F. (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. https://gco.iarc.who.int/today.
Figley, C. R. (2002). « Compassion fatigue: Psychotherapists’ chronic lack of self care. Journal of Clinical Psychology, 58(11), 1433-1441. https://doi.org/10.1002/jclp.10090.
Fukumori, T., Miyazaki, A., Takaba, C., Taniguchi, S., & Asai, M. (2020). « Traumatic Events Among Cancer Patients That Lead to Compassion Fatigue in Nurses: A Qualitative Study ». Journal of Pain and Symptom Management, 59(2), 254-260. https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2019.09.026.
Gehenne, L., Lelorain, S., Eveno, C., Piessen, G., Mariette, C., Glehen, O., D’journo, X., Mathonnet, M., Regenet, N., Meunier, B., Baudry, A.-S., Christophe, V., Adenis, A., Aparicio, T., Assenat, E., Barret, M., Benhaim, L., Benoit, C., Bergeat, D.,… The FREGAT Working Group. (2021). « Associations between the severity of medical and surgical complications and perception of surgeon empathy in esophageal and gastric cancer patients ». Supportive Care in Cancer, 29(12), 7551-7561. https://doi.org/10.1007/s00520-021-06257-y.
Ghahari, S., Mohammadi, Hasel Kourosh, Malakouti, S. K., & Roshanpajouh, M. (2020). « Mindfulness-based cognitive therapy for generalised anxiety disorder: A systematic review and meta-analysis ». East Asian Archives of Psychiatry, 30(2), 52-56. https://doi.org/10.3316/informit.310704814356937.
Gibson, C., O’Connor, M., White, R., Baxi, S., & Halkett, G. (2021). « Burnout or Fade Away ; experiences of health professionals caring for patients with head and neck cancer ». European Journal of Oncology Nursing: The Official Journal of European Oncology Nursing Society, 50, 101881. https://doi.org/10.1016/j.ejon.2020.101881.
Guo, Q., & Zheng, R. (2019). « Assessing oncology nurses’ attitudes towards death and the prevalence of burnout: A cross-sectional study ». European Journal of Oncology Nursing: The Official Journal of European Oncology Nursing Society, 42, 69-75. https://doi.org/10.1016/j.ejon.2019.08.002.
HaGani, N., Yagil, D., & Cohen, M. (2022b). « Burnout among oncologists and oncology nurses: A systematic review and meta-analysis ». Health Psychology: Official Journal of the Division of Health Psychology, American Psychological Association, 41(1), 53-64. https://doi.org/10.1037/hea0001155.
Hall, J. A., Schwartz, R., Duong, F., Niu, Y., Dubey, M., DeSteno, D., & Sanders, J. J. (2021). « What is clinical empathy ? Perspectives of community members, university students, cancer patients, and physicians ». Patient Education and Counseling, 104(5), 1237-1245. https://doi.org/10.1016/j.pec.2020.11.001.
Hall, L. H., Johnson, J., Watt, I., Tsipa, A., & O’Connor, D. B. (2016). « Healthcare Staff Wellbeing, Burnout, and Patient Safety: A Systematic Review ». PLoS ONE, 11(7), 1-12. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0159015.
Hart, D., Paetow, G., & Zarzar, R. (2018). « Does Implementation of a Corporate Wellness Initiative Improve Burnout ? ». Western Journal of Emergency Medicine, 20(1), 138-144. https://doi.org/10.5811/westjem.2018.10.39677.
Hayuni, G., Hasson, Ohayon, I., Goldzweig, G., Bar Sela, G., & Braun, M. (2019). « Between empathy and grief: The mediating effect of compassion fatigue among oncologists ». Psycho-Oncology, 28(12), 2344-2350. APA PsycInfo. https://doi.org/10.1002/pon.5227.
Hegel, J., Halkett, G. K. B., Schofield, P., Rees, C. S., Heritage, B., Suleman, S., Inhestern, L., Butler, T., Fitch, M. I., & Breen, L. J. (2021). « The Relationship Between Present-Centered Awareness and Attention, Burnout, and Compassion Fatigue in Oncology Health Professionals ». Mindfulness, 12(5), 1224-1233. https://doi.org/10.1007/s12671-020-01591-4.
Howick, J., Dudko, M., Feng, S. N., Ahmed, A. A., Alluri, N., Nockels, K., Winter, R., & Holland, R. (2023). « Why might medical student empathy change throughout medical school ? A systematic review and thematic synthesis of qualitative studies ». BMC Medical Education, 23(1), 270. https://doi.org/10.1186/s12909-023-04165-9.
Hubble, K., Daughters, K., Manstead, A. S. R., Rees, A., Thapar, A., & van Goozen, S. H. M. (2017). « Oxytocin increases attention to the eyes and selectively enhances self-reported affective empathy for fear ». Neuropsychologia, 106, 350-357. https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2017.10.019.
Hunt, P., Denieffe, S., & Gooney, M. (2019). « Running on empathy: Relationship of empathy to compassion satisfaction and compassion fatigue in cancer healthcare professionals ». European Journal of Cancer Care, 28(5), e13124. https://doi.org/10.1111/ecc.13124.
INCa. (2018). La vie 5 ans après un diagnostic de cancer ? https://www.e-cancer.fr/Expertises-et-publications/Le-point-sur/La-vie-cinq-ans-apres-un-diagnostic-de-cancer.
INCa. (2022). Panorama des cancers en France. Institut National du Cancer. https://www.e-cancer.fr/Expertises-et-publications/Catalogue-des-publications/Panorama-des-cancers-en-France-Edition-2022.
Jackson-Koku, G., & Grime, P. (2019). « Emotion regulation and burnout in doctors: A systematic review ». Occupational Medicine (Oxford, England), 69(1), 9-21. https://doi.org/10.1093/occmed/kqz004.
Jarrad, R. A., & Hammad, S. (2020). « Oncology nurses’ compassion fatigue, burnout and compassion satisfaction ». Annals of General Psychiatry, 19, 22. https://doi.org/10.1186/s12991-020-00272-9.
Jeffrey, D. (2016). « Empathy, sympathy and compassion in healthcare: Is there a problem ? Is there a difference ? Does it matter ? ». Journal of the Royal Society of Medicine, 109(12), 446-452. https://doi.org/10.1177/0141076816680120.
Kabat-Zinn, J. (2003). « Mindfulness-based interventions in context: Past, present, and future ». Clinical Psychology: Science and Practice, 10, 144-156. https://doi.org/10.1093/clipsy.bpg016.
Lamiani, G., Dordoni, P., Vegni, E., & Barajon, I. (2019). « Caring for Critically Ill Patients: Clinicians’ Empathy Promotes Job Satisfaction and Does Not Predict Moral Distress ». Frontiers in Psychology, 10, 2902. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02902.
Laor-Maayany, R., Goldzweig, G., Hasson-Ohayon, I., Bar-Sela, G., Engler-Gross, A., & Braun, M. (2020). « Compassion fatigue among oncologists: The role of grief, sense of failure, and exposure to suffering and death ». Supportive Care in Cancer: Official Journal of the Multinational Association of Supportive Care in Cancer, 28(4), 2025-2031. https://doi.org/10.1007/s00520-019-05009-3.
Larsen, B. H., Lundeby, T., Gulbrandsen, P., Førde, R., & Gerwing, J. (2022). « Physicians’ responses to advanced cancer patients’ existential concerns: A video-based analysis ». Patient Education and Counseling, 105(10), 3062-3070. https://doi.org/10.1016/j.pec.2022.06.007.
Lelorain, S., & Fontesse, S. (2021). « Empathie et déshumanisation en milieu médical ». In Grynberg & Luminet (Éds), Psychologie des émotions. Concepts fondamentaux et implications cliniques, 2e édition (p. 297-322). De Boeck Supérieur.
Lelorain, S., Gehenne, L., Christophe, V., & Duprez, C. (2023). « The association of physician empathy with cancer patient outcomes: A meta-analysis ». Psycho-Oncology, 32(4), 506-515. https://doi.org/10.1002/pon.6108.
Liu, J., Gan, Y., Jiang, H., Li, L., Dwyer, R., Lu, K., Yan, S., Sampson, O., Xu, H., Wang, C., Zhu, Y., Chang, Y., Yang, Y., Yang, T., Chen, Y., Song, F., & Lu, Z. (2019). « Prevalence of workplace violence against healthcare workers: A systematic review and meta-analysis ». Occupational and Environmental Medicine, 76(12), 927-937. https://doi.org/10.1136/oemed-2019-105849.
Lown, B. A. (2016). « A social neuroscience-informed model for teaching and practising compassion in health care ». Medical Education, 50(3), 332-342. https://doi.org/10.1111/medu.12926.
Ma, M., Li, L., Chen, H., & Feng, Y. (2019). « Oxytocin Inhibition of Metastatic Colorectal Cancer by Suppressing the Expression of Fibroblast Activation Protein-α ». Frontiers in Neuroscience, 13. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnins.2019.01317.
Mahmoud, N. N., & Rothenberger, D. (2019). « From Burnout to Well-Being: A Focus on Resilience ». Clinics in Colon and Rectal Surgery, 32(06), 415-423. https://doi.org/10.1055/s-0039-1692710.
Maslach, C., & Jackson, S. E. (1981). « The measurement of experienced burnout ». Journal of Organizational Behavior, 2(2), 99-113. https://doi.org/10.1002/job.4030020205.
McCartney, M., Nevitt, S., Lloyd, A., Hill, R., White, R., & Duarte, R. (2021). « Mindfulness-based cognitive therapy for prevention and time to depressive relapse: Systematic review and network meta-analysis ». Acta Psychiatrica Scandinavica, 143(1), 6-21. https://doi.org/10.1111/acps.13242.
Menon, N. K., Shanafelt, T. D., Sinsky, C. A., Linzer, M., Carlasare, L., Brady, K. J. S., Stillman, M. J., & Trockel, M. T. (2020). « Association of Physician Burnout With Suicidal Ideation and Medical Errors ». JAMA Network Open, 3(12), e2028780. https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2020.28780.
Mercer, S. W., & Reynolds, W. J. (2002). « Empathy and quality of care ». British Journal of General Practice, 52(Suppl), S9-12.
Murali, K., Makker, V., Lynch, J., & Banerjee, S. (2018). « From Burnout to Resilience: An Update for Oncologists ». American Society of Clinical Oncology Educational Book, 38, 862-872. https://doi.org/10.1200/EDBK_201023.
Neff, K. D. (2003). The development and validation of a scale to measure self-compassion. Self and Identity, 2(3), 223-250. https://doi.org/10.1080/15298860309027.
Neff, K. D., Knox, M. C., Long, P., & Gregory, K. (2020). « Caring for others without losing yourself: An adaptation of the Mindful Self-Compassion Program for Healthcare Communities ». Journal of Clinical Psychology, 76(9), 1543-1562. https://doi.org/10.1002/jclp.23007.
Scheepers, R. A., Emke, H., Epstein, R. M., & Lombarts, K. M. J. M. H. (2020). « The impact of mindfulness-based interventions on doctors’ well-being and performance: A systematic review ». Medical Education, 54(2), 138-149. https://doi.org/10.1111/medu.14020.
Shanafelt, T., Goh, J., & Sinsky, C. (2017). « The Business Case for Investing in Physician Well-being ». JAMA Internal Medicine, 177(12), 1826-1832. https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2017.4340.
Shen, M. J., Ostroff, J. S., Hamann, H. A., Haque, N., Banerjee, S., McFarland, D., Molena, D., & Bylund, C. L. (2019). « Structured Analysis of Empathic Opportunities and Physician Responses During Lung Cancer Patient-Physician Consultations ». Journal of health communication, 24(9), 711-718. https://doi.org/10.1080/10810730.2019.1665757.
Sikavi, D., & Weseley, A. J. (2017). « The relationship between psychosocial factors in the patient–oncologist relationship and quality of care: A study of breast cancer patients ». Journal of Psychosocial Oncology, 35(1), 32-46. https://doi.org/10.1080/07347332.2016.1247406.
Stamm, B. H. (2009). Professional Quality of Life: Compassion Satisfaction and Fatigue Version 5 (ProQOL). http://www.proqol.org.
Surchat, C., Carrard, V., Gaume, J., Berney, A., & Clair, C. (2022). « Impact of physician empathy on patient outcomes: A gender analysis ». British Journal of General Practice, 72(715), e99-e107. https://doi.org/10.3399/BJGP.2021.0193.
Teo, I., Ng, S., Bundoc, F. G., Malhotra, C., Ozdemir, S., Steel, J. L., Finkelstein, E. A., & Group, C. (2023). « A prospective study of psychological distress among patients with advanced cancer and their caregivers ». Cancer Medicine, 12(8), 9956-9965. https://doi.org/10.1002/cam4.5713.
Vargas, E. A., Brassel, S. T., Cortina, L. M., Settles, I. H., Johnson, T. R. B., & Jagsi, R. (2020). #MedToo: « A Large-Scale Examination of the Incidence and Impact of Sexual Harassment of Physicians and Other Faculty at an Academic Medical Center ». Journal of Women’s Health, 29(1), 13-20. https://doi.org/10.1089/jwh.2019.7766.
West, C. P., Dyrbye, L. N., & Shanafelt, T. D. (2018). « Physician burnout: Contributors, consequences and solutions ». Journal of Internal Medicine, 283(6), 516-529. Scopus. https://doi.org/10.1111/joim.12752.
Williamson, T. J., Ostroff, J. S., Martin, C. M., Banerjee, S. C., Bylund, C. L., Hamann, H. A., & Shen, M. J. (2021). « Evaluating relationships between lung cancer stigma, anxiety, and depressive symptoms and the absence of empathic opportunities presented during routine clinical consultations ». Patient Education and Counseling, 104(2), 322-328. https://doi.org/10.1016/j.pec.2020.08.005.
Xie, W., Wang, J., Zhang, Y., Zuo, M., Kang, H., Tang, P., Zeng, L., Jin, M., Ni, W., & Ma, C. (2021). « The levels, prevalence and related factors of compassion fatigue among oncology nurses: A systematic review and meta-analysis ». Journal of Clinical Nursing, 30(5-6), 615-632. https://doi.org/10.1111/jocn.15565.
Zawieja, P. (2016). « Fatigue compassionnelle ». In Dictionnaire de la fatigue (p. 289-292). Librairie Droz. https://doi.org/10.3917/droz.zawie.2016.01.0289.