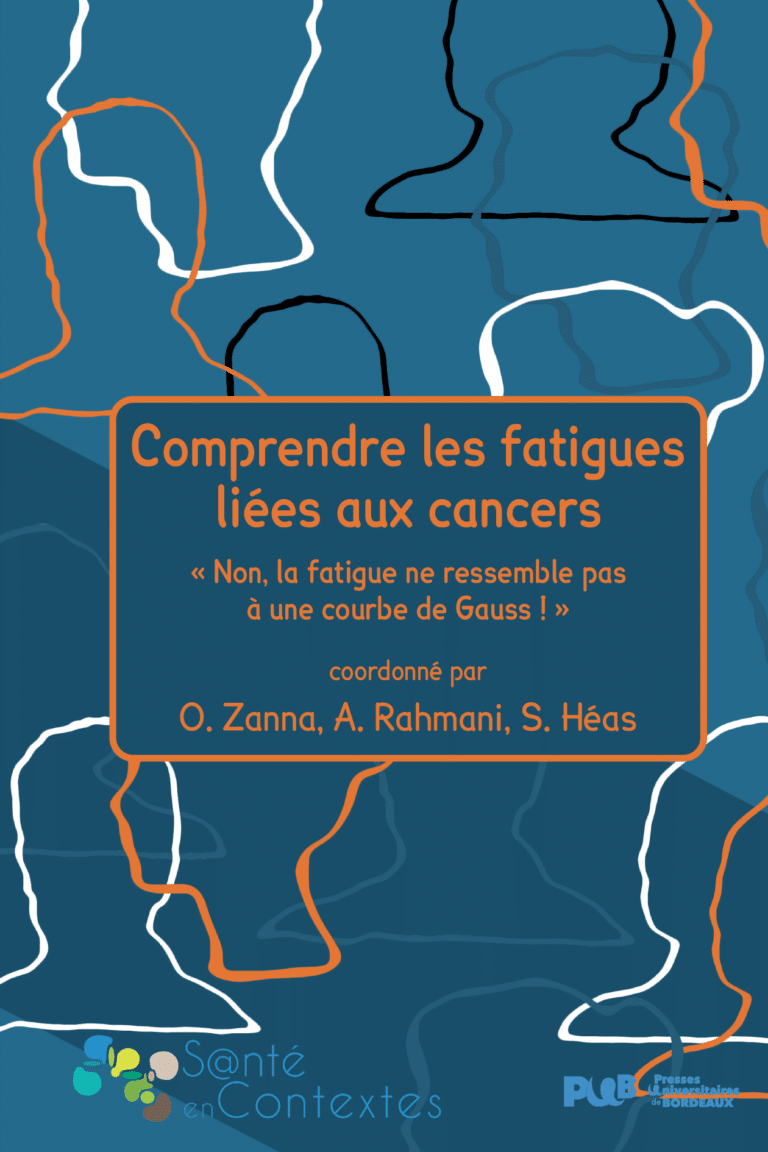Interlude N° 9
Marine (40 ans) est suivie pour un cancer du sein depuis deux mois. Entretien réalisé le 09 juin 2022, la veille de sa première séance de chimiothérapie
Comme un trop, en fait, comme quelque chose de trop, comme si je ne pouvais plus faire plus, il fallait que je stoppe, que j’aille respirer en fait. Comme si, dans les activités quotidiennes que j’avais à faire, je veux dire les activités ordinaires qui ne sont pas forcément intéressantes (rires), il fallait que je stoppe parce que je saturais complètement. Et il fallait que j’aille prendre l’air, faire autre chose, et puis une envie aussi de dormir, en fait. Mais ce qui était plus dur, c’est quand je dormais et que le lendemain matin je me réveillais et que j’étais toujours fatiguée, en fait. Là, ça me le fait un petit peu moins. J’essaie aussi, pour me sentir mieux, de faire des exercices de respiration en fait, même le matin ou le soir avant de m’endormir, et du coup ça me permet de mieux dormir mais, ouais, ça se manifestait par le fait que, comme s’il y avait une saturation, comme s’il y avait tout à coup, ça devenait un peu noir et ça m’agaçait parce que je me sentais fatiguée, je ne voulais plus rien faire.
Introduction
Il n’est pas facile d’évoquer à la fois sa situation personnelle de propre malade et dans le même temps de mettre à distance son cancer en tant qu’ancien enseignant en activité physique adaptée (APA) et management du sport ; adepte des approches d’observations participantes de nature ethnographique, à qui l’université du Mans demande une communication dans le cadre du colloque « Fatigues liées au cancer et activités physiques adaptées ». Les deux conférences de septembre 2023 et la présentation succincte de mon ouvrage intitulé Maladie, Art et Sport ; la reconstruction de soi : oser marcher dans les traces des artistes malades lors de cette manifestation1 doivent être complétées par une mise en perspective plus large. Celle-ci peut s’intégrer à la fois dans les approches d’Erving Goffman pour les rôles sociaux imposés aux malades du cancer, gérant leurs fatigues et les analyses de Michel Crozier pour le jeu des négociations avec les équipes soignantes chargées de trouver une porte de sortie vers la guérison. J’ai évoqué trop rapidement, lors de ces deux conférences, l’influence fondamentale des représentations du cancer (1) et le rôle prioritaire du mental chez le patient dans les différentes étapes des soins thérapeutiques (2) pour lutter contre la fatigue liée au (fait d’être malade du) cancer.
L’influence des représentations sociales du cancer accentuées par les média-cultures à la fin du XXe siècle
Les Cultural Studies anglo-saxonnes avec notamment Stuart Hall (2019) ont montré le rôle des médias modernes dans la diffusion des messages et les processus de leur réception auprès des publics en allant bien au-delà des approches de Pierre Bourdieu (1979) qui postule des clientèles mystifiées. Différents auteurs, notamment Richard Hoggart (1970) ont indiqué les insoupçonnables capacités d’interprétation ou de résistance des publics subalternes à ces messages exportés par les médias-cultures. Jacky Goody a dénoncé cette ambivalence à l’égard des images et leurs rapports complexes avec la religion, la culture et la maladie (2006). Les représentations pessimistes et négatives du cancer ont conduit à des chocs existentiels et même à des conduites pré-funéraires me concernant. Celles-ci sont regroupées en quatre niveaux, chacun renvoyant à un type d’interaction entre le patient et les soignants.
Le premier niveau concerne mon parcours de vie et la réception de l’annonce du cancer avec une phase dépressive, compte tenu du pessimisme affiché par les spécialistes puisque le cancer se généralise. Ici, la fatigue est à la fois psychique et physiologique. Mon alimentation se résume à des boissons vitaminées. Mon cadre familial est lesté du poids des trois décès par cancer dans la fratrie sur une famille de sept enfants, et, logiquement des représentations très négatives du cancer. Par anticipation pré-funéraire je dépose mon testament chez le notaire, je choisis et achète une concession dans un cimetière, souscrit un contrat d’obsèques avec une société funéraire. Paradoxalement, cette sublimation funéraire devient un moyen d’évacuer un problème matériel accessoire pour passer à autre chose…
Le second niveau est mon lien avec l’équipe soignante et mon intégration dans la communauté des malades. Je multiplie les contacts informels et donne dans mon ouvrage des surnoms à ces protagonistes, soit une façon de se rapprocher d’eux : Mme Cuicui, Mme Ongle Rose, Mme Miaou, Mr Bouche-sèche, Christian Dior, Constantin Aminci, Mme Secret bien gardé Mr Malbouche. Mon mental navigue entre repli sur soi et tentative de réinvestissement grâce à la mise en place de divers réseaux de sociabilité : rédactions régulières de sms, création d’un fan club, conversations informelles avec le maximum de personnes malades ou soignantes, notamment avec Magali, une infirmière-chef), ou bien, la tenue d’un journal « sauvage » et ironique envoyé chaque semaine par sms à ce réseau.
Le troisième niveau révèle les stratégies d’acteurs entre moi-même et les équipes soignantes en raison de mon statut d’ex-enseignant APA, porté sur l’observation participante et l’implication dans des activités autant ludiques qu’esthétiques. La fatigue provient aussi de ce travail constant de négociations pour gérer les urgences vitales et la tenue de rôles contradictoires avec loyauté et discipline dramaturgique malgré un « pilotage à vue » de l’équipe soignante : « Votre cas fait beaucoup parler ! » m’a souvent été rapporté.
Enfin, au quatrième niveau, l’opération « commando » au niveau de mon alimentation, de mon implication dans les APA et un travail d’objectivation met à distance la maladie grâce à l’humour, l’ironie et les exercices physiques(natation et randonnées quotidiennes de 5 à 15 kilomètres, variables selon les jours). S’en suit, la surprise de l’équipe soignante devant les résultats progressifs au moment des deux chimiothérapies, puis des séances de radiothérapie. Le rôle joué par les APA devient manifeste puisque la diminution des tumeurs au niveau de l’œsophage et du foie se poursuit bien après l’arrêt des soins, en raison d’une accentuation des marches et des trajets de natations forcées.
Mon positionnement personnel au moment de l’annonce du cancer reste essentiel. La manière de réceptionner les signaux mortifères après une phase normale de sidération devient déterminante pour la suite du parcours de soins. En effet, je pouvais rester bloqué dans une position de dépression /soumission, entraînant progressivement une attitude de démission, ou être incité à se ressaisir et à accepter la dynamique des soins. Dès lors, le mental peut avoir un rôle moteur et actif pour sortir d’un état de fatigue autant physique que mentale, puis, plus tard prévoir une reconstruction de soi dans un long cheminement.
Le rôle du mental dans la « gestion » de son cancer
Il convient de bien distinguer le mental du malade et le mental du champion que certains ont tendance à confondre. Le patient atteint d’un cancer vise sa survie alors que l’athlète aspire à l’excellence et à la victoire sportive. Cette différence de contexte est primordiale. Selon Anne Ancelin Schutzenberger (2004), le mental dépend, en effet, de la psychologie des malades mais aussi de la prise en compte de la fatigue corporelle et psychique. Rappelons que, comme le signale François de Singly (2005), le cancer contribue à une inscription corporelle de la crise identitaire. Le corps du malade ne représente en effet« plus que lui-même. Il symbolise l’ensemble de la personne ». Face à cette rupture biographique provoquée par le cancer, le mental aide à renouer ce fil biographique qui passe par de multiples reconquêtes, notamment celle de l’espace domestique. En effet, le malade hospitalisé perd sa demeure familiale au profit d’un espace médical transformé en une sorte d’espace public et d’une chambre qui s’apparente à bien des égards à un cagibi. Dans cet espace-temps, les enseignants en APA et en Art deviennent de véritables viatiques en ce sens où les premières contribuent à le faire sortir physiquement et le second mentalement de l’espace de réclusion que constitue la chambre d’hôpital.
Pour renforcer son mental, le malade doit tout à la fois éviter de se résigner, de s’isoler et de perdre le sentiment de sa valeur personnelle, ce qui pose la question de la réinvention de soi et de la quête d’une nouvelle identité. Puisque la guérison n’est pas définitive et que le risque de rechute rôde toujours, même après la rémission, le patient doit pouvoir s’orienter vers une nouvelle vision de lui-même. C’est notamment le cas de cette femme de 40 ans, hyper motivée, que j’ai baptisée Forcesuper, rencontrée à plusieurs reprises dans les salles d’attente du centre de radiothérapie, qui rechute plus de quinze ans après sa rémission. Cette épée de Damoclès placée au-dessus de chaque malade nécessite un renforcement du mental impliquant à la fois une résilience psychologique et le développement d’une éthique du care, c’est-à-dire un nouveau sens de l’écoute et de la relation à soi et à autrui.
En participant à restaurer image de soi et à créer de nouvelles sociabilités, voire à appréhender diverses autres altérités comme cela a bien été montré dans les Actes du colloque L’Art-médecine2 à Antibes en 1999, le sport et notamment les APA, ainsi que l’Art au sens très large (peinture, poésie, musique, théâtre, etc.) permettent justement d’y contribuer. Pour ce faire, il convient d’une part de sortir du rôle de victime ou de simple spectateur de son cancer, et, d’autre part, « de puiser de la force dans le traumatisme vécu pour pouvoir le recycler et se réenraciner dans la société » comme me le précisait cette femme rencontrée lors d’une séance de chimiothérapie et que j’ai par la suite appelé « Madame marche forcée ».
La gestion des différentes fatigues du malade
Le cancer et la fatigue, au-delà d’une approche biologique, peuvent s’analyser non seulement en fonction de ses représentations sociales, mais aussi de ses corollaires existentiels (inhibition, anxiété, dépression…) et psycho-sociologiques (rôle de la famille, rôle des encouragements, jeux d’acteurs des équipes soignantes motivantes ou non). Quatre types de fatigue dans ma situation peuvent être identifiées.
La première est la fatigue subie psychique et existentielle. Je peux la définir par des sentiments de ressentiment, d’amertume, de rumination. Elle se rencontre lors de ma confrontation dans les salles d’attente avec des malades en grande souffrance. Ce fut le cas de Nelly, atteinte d’un cancer au cavum, lors d’un contrôle par TEP Scan. Dans ce type de fatigue, le comportement du malade se traduit par une prostration, une démotivation, un sentiment de vide. J’ai pu rencontrer une énorme frustration de ne pouvoir m’alimenter qu’avec des boissons vitaminées. Je me suis retrouvé dans l’impossibilité de résister à la « dévastation » en cours.
La deuxième fatigue subie a pour conséquence l’isolement associé à une désocialisation progressive et par le partage de la famille en deux : les supporters du cancéreux d’un côté et les membres non concernés par ce cancer du frère ainé de l’autre. Le malade quant à lui, abandonne progressivement les « faux amis » qui s’éloignent en raison du cancer et ne donnent plus signe de vie. Il priorise alors certains contacts et en élimine d’autres. La fatigue physiologique et corporelle subie se traduit généralement par une perte de poids
En ce qui me concerne, j’ai perdu plus de dix kilos (passage de 73 Kg à 61 Kg) en très peu de temps. Perte de poids, mais également perte de repères en raison de la multiplication des contrôles : naso-gastroscopie Scanner, TEP SCAN, IREM, échographie… et en raison également des hésitations de l’équipe soignante sur la marche à suivre à partir des données physiologiques réceptionnées dans les machines et de la complexité du cas médical à résoudre.
Enfin, la fatigue volontaire est acceptée lors des séance APA (randonnées, séances de natation…) ou des rencontres amicales, voire esthétiques, à travers la « visite » d’œuvres picturales par exemple. Ces séances en pleine nature ont été vivifiantes. Elles m’ont permis un important travail de restauration identitaire lors des randonnées quotidiennes avec des visites de cimetière, de musées, de sites pittoresques ou des séances de natation. Ces séances d’APA permettent « d’encaisser » les fatigues et les souffrances grâce à un processus de sublimation, de refoulement, d’identification aux artistes malades ou accidentés. Ce faisant, elles permettent l’oubli provisoire des problèmes personnels par l’addition des kilomètres quotidiens au contact de la nature et en recyclant des approches esthétiques, notamment celle de Matisse, atteint d’un cancer à 72 ans (même âge que le patient). Dans la communauté des malades au sein des hôpitaux, j’ai pu constater, lors de mes divers contacts, une sorte de fatigue psychologique. Cette absence de compliance et d’adhésion à leurs traitements les conduisent à une sorte de résignation, exprimée parfois.
Ma fatigue liée au cancer s’est déclinée de plusieurs façons, d’abord au cours d’une première période d’octobre à décembre 2020, constituée par de multiples contrôles médicaux par une difficulté à manger, un amaigrissement de douze kilos, et des difficultés de l’équipe soignante à définir une stratégie de soins précise en présence d’un cas complexe. En conséquence, les interactions sociales entre l’équipe soignante et le patient se sont densifiées à différents moments des parcours de soins.
Pour résumer, à l’analyse des résultats fournis par les machines, j’ai entendu des commentaires conventionnels et accepté les préconisations. J’ai reçu des encouragements appuyés de l’oncologue pour continuer la pratique des APA qui confortent les résultats positifs. Sa volonté d’associer ma compagne à toutes les réunions a été bienvenue. Il a été présent en salle de réveil pour m’annoncer les résultats positifs. Son engagement a été important lorsqu’il s’est opposé à la décision de RCP de refuser le protocole FLOT pour un patient jugé trop âgé et a critiqué les analyses du radiologue concernant les résultats d’un scanner par l’hépatologue (le professeur Grosse Pointure) s’estimant mieux connaître le foie que quiconque.
Lors de la préparation de l’opération du foie pour brûler la tumeur par radiofréquence, la consultation de la RCP jugée inopérante a été abandonnée ainsi que la coopération avec l’hôpital régional de référence qui a refusé la demande d’intégration du patient dans un cycle d’immunothérapie. La stratégie d’opération du foie a été prise en comité informel avec l’oncologue, ma compagne et moi-même, … après accord téléphonique du chirurgien. La mise en œuvre du réseau personnel de l’hépatologue pour trouver un lieu d’opération de la tumeur au foie par radiofréquence est décidée en cinq minutes, hors de la RCP dans le bureau du professeur Grosse pointure, suite à un contact immédiat avec un de ses collègues.
Une IRM du foie effectuée un mois après l’intervention valide la réussite de l’opération par radiofréquence. Elle confirme la disparition du cancer dans les trois zones (œsophage, foie, abdomen). Au-delà de l’effet bénéfique indiscutable des deux chimiothérapies, des vingt-cinq séances de radiothérapies, et de l’opération du foie, l’oncologue admet la présence d’une sorte de « miracle ». Il l’explique par trois causes externes : le mental du malade, l’effet des APA et ma reprise de douze kilos.
La reconstruction de soi tributaire d’interactions entre le patient et les soignants
J’ai entrepris, de ma seule initiative, une sorte d’enquête sauvage. Cette observation participante consistait à parler aux malades de façon spontanée, de façon non directive et sans grille d’entretien, simplement pour tenter de mieux les connaître. En effet, ce regroupement des malades du cancer, dans des salles ou box de chimiothérapies a fait l’objet de très peu d’études académiques. De telles expériences d’altérité ont favorisé mon intégration dans la communauté des malades surtout au moment des séances de chimiothérapie qui durait plus de six heures en salles tous les dix jours, avec en complément, pour ce qui me concerne, deux jours de diffusion jour et nuit d’un produit par une bouteille portative. Au sein de cette population de cancéreux, il m’était facile de m’immerger dans un milieu qui m’était jusque-là totalement étranger. En effet, le malade, en général, dans sa banalité n’a pas de façade personnelle ou d’appareillage symbolique, pas de signe distinctif de sa fonction sauf peut-être pour le cancéreux en chimio avec la perte de cheveux qui « dramatise » son apparence.
Les rôles contradictoires
Très vite j’ai été confronté à l’observation de rôles contradictoires chez certains malades interrogés, selon l’expression d’Erving Goffman (1973) ; à savoir d’une part, une majorité de malades totalement submergés par leur cancer et peu au fait de leur situation médicale du moment, et d’autre part à l’opposé des « clients professionnels » qui se transformaient en « contrôleur » de l’équipe soignante (cas de Mme Balenciaga). Un tel constat s’avère confirmé, mais nuancé lors d’un passage durant vingt-cinq sessions dans les salles d’attente en radiothérapie, avant le contact impressionnant vécu avec des machines et parfois la vision d’une cour des miracles. Sur des marges de la radiothérapie co-existent les interactions complexes vécues aussi avec trois coupeurs de feu, bénévoles (cas d’Arlette Bon Secours) ou mercenaires (cas de Fernande). Ceux-ci intervenaient en parallèle des structures médicales professionnelles, avec parfois des tentatives de collaboration entre scientifiques et chamanes.
Les zones d’incertitude et les rationalités limitées dans le choix des soins
Pour reprendre la terminologie de Michel Crozier, sociologue des organisations, il existe dans certains hôpitaux et cliniques fréquentées des zones d’incertitudes avec des rationalités limitées en raison de jeux de pouvoir entre praticiens, mais aussi en fonction du statut du malade. Ainsi au moment du choix d’un protocole de chimiothérapie, l’oncologue qui jouait cash avec moi, m’a ainsi signalé que la majorité des votants à l’intérieur des RCP s’étaient opposés à l’utilisation du protocole FLOT vu mon âge canonique : 73 ans. Seuls deux praticiens, l’oncologue et le chirurgien qui m’avait installé sous anesthésie la chambre implantable, m’avaient jugé capable de supporter le protocole FLOT. Dès lors, différents partenariats à géométrie variable se sont mis en place lors des consultations.
Conclusion : de la forme biographique aux éléments d’une analyse psycho-sociologique du cancer
Dans les années 1970, l’approche biographique a été réhabilitée avec Roland Barthes (2010) sous la forme d’éléments discrets nommé « biographèmes »et « mythologies personnelles ». Aujourd’hui, dans les situations de précarité, la vie des individus atteints d’un cancer apparait comme un magma d’éléments intéressants, à la fois la médecine et la psychologie sociale. En effet toute approche biographique du cancer induit une généalogie, une hérédité, voire un ensemble de liens transgénérationnels. L’approche biographique peut aller de la psychologie sociale à la généalogie, voire même au geno-sociogramme pour la psychothérapeute-analyste Anne Ancelin Schutzenberger (2004). Ces disciplines permettent de prendre en charge toutes les bifurcations de notre propre identité. Celle-ci peut aller d’une fixation rigide sur l’état-civil du malade arrêté sur son âge, jusqu’à des postures dissociées du malade en danger de mort, et aussi jusqu’à des liens complexes qui se sont tissées sur plusieurs générations avec une famille élargie.
À partir de là, tout être humain cherche des stratégies personnelles, ce qui suppose soit une tentative de reconstruction, soit une acceptation de son destin de cancéreux, comme par exemple Fritz Zorn :elui-ci critique sa famille et son rôle dans la production de son cancer. Et ce malade, dans une comédie dramatique déchirante, évoquée dans son roman (1979) écrit juste avant sa mort à l’âge de trente-deux an,s revient douloureusement sur son parcours biographique.
Bibliographie
Barthes, R. (2010). Mythologies. Seuil.
Bourdieu, P. (1979). La distinction, critique sociale du jugement. Éditions de Minuit.
Chazaud, P. (2013). Itinéraires spirituels, Matisse Leger, Chagall, Le Corbusier, le Sacré. Mandala Toulaud.
Chazaud, P. (2023). Maladie, Art et Sport : La Reconstruction de soi / Oser marcher dans les traces d’artistes malades – H. Matisse, S. Francis, A. Renoir, F. Kahlo, H. Wilke, R. Dufy, P. Klee. Journal d’un cancéreux ironique. Le mental. La douleur. Mandala Toulaud et Aleamte Association.
Goffman, E. (1973). Mise en scène de la vie quotidienne. La présentation de soi. Chapitre 4 « Les rôles contradictoires ». Éditions de Minuit.
Goody, J. (2006). La peur des représentations. Éditions La Découverte.
Hall, S. (2019). Identités et Cultures. Politique des Cultural Studies. Éditions Amsterdam.
Hoggart, R. (1970). La culture du pauvre, Éditions de Minuit.
Mattelart, A., Neveu E. (2003). Introduction aux cultural studies, Éditions de la Découverte.
Narby, J., Huxley, F. (2018). Anthologie du chamanisme. Albin Michel.
de Singly, F. (2005). « Le soi dénudé. Sur l’inscription corporelle de l’identité intime ». Un corps pour soi (dir.), PUF.
Schutzenberger, A. (2004). Vouloir guérir. L’aide au malade atteint d’un cancer. Desclée De Brouwer.
Schutzenberger, A. (2004). Aie, mes aïeux !. Desclée De Brouwer.
Notes
- Pierre Chazaud, Maladie, Art et Sport : La Reconstruction de soi / Oser marcher dans les traces d’artistes malades – H. Matisse, S. Francis, A. Renoir, F. Kahlo, H. Wilke, R. Dufy ; P. Klee. Journal d’un cancéreux ironique, Le mental. La douleur, Éditions Mandala Toulaud et Aleamte Association, Valence, 2023.
- L’Art-médecine, Actes du colloque, Éditions de la Réunion des Musées Nationaux, Paris, 2000.