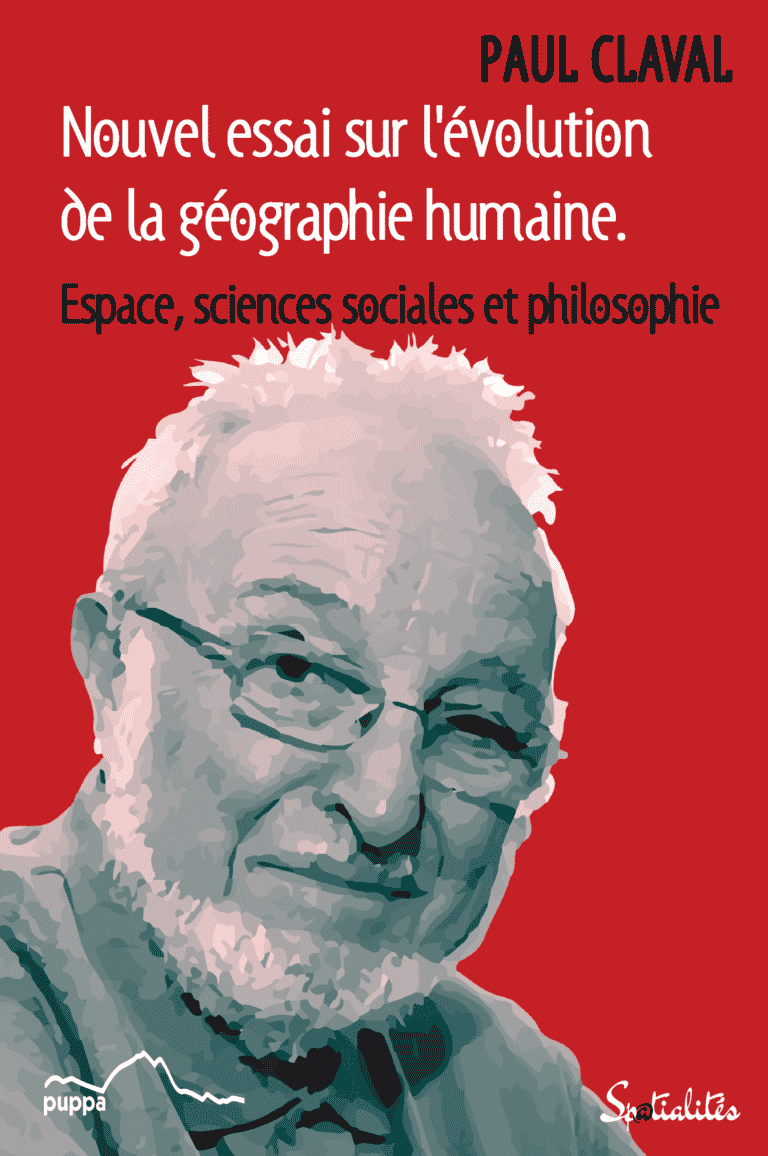Les trois familles de sciences sociales qui se forment au XIXe siècle évoluent. Elles le font en deux actes. Le premier se déroule dans les premières décennies du XXe siècle. Le second, initié dans les années 1950 et qui culmine dans les années 1960 et 1970, remet en cause les fondements de la modernité.
Acte I. Durkheim, Weber
et la systématisation des sciences sociales
Les sciences sociales se structurent au cours du XIXe siècle et prennent aux alentours de 1900 des traits qu’elles conserveront plus d’un demi-siècle, mais elles ne s’unifient pas.
Durkheim et la sociologie d’inspiration philosophique
Le problème de construire de nouveaux savoirs sur l’homme social se pose partout. En Grande-Bretagne l’évolutionnisme inspire largement Herbert Spencer. Francis Galton y intègre la prise en considération de la race. Les réflexions sur ce champ émergent se multiplient en France aux alentours de 1890. L’interprétation se fait souvent en termes psychologiques. Pour Gabriel Tarde, la vie sociale est un jeu de miroirs où chacun se reflète dans les autres mais apparaît aussi, en retour, comme leur reflet : la vie sociale repose sur l’imitation et l’inventivité. L’existence collective est liée à la psychologie de chacun, aux croyances auxquelles il adhère et au désir qui l’anime de s’insérer dans un jeu partagé. C’est également du côté de la psychologie que se tourne Gustave Le Bon pour éclairer la psychologie des foules. René Worms dote la discipline en voie d’élaboration de publications régulières. Mais l’impulsion essentielle vient d’Émile Durkheim (1858-1917).
Né à Épinal d’une famille de rabbins, celui-ci est reçu à l’École Normale Supérieure où il fait des études de philosophie, mais s’oriente vite vers la sociologie, domaine qui présente selon lui des spécificités remarquables :
« Voilà donc un ordre de faits qui présentent des caractères très spéciaux : ils consistent en des manières d’agir, de penser et de sentir, extérieures à l’individu, et qui sont douées d’un pouvoir de coercition en vertu duquel ils s’imposent à lui » (Durkheim, 1895, p. 18).
On ne saurait donc expliquer les faits collectifs à partir de la psychologie de chacun. Ils ne naissent pas de l’individu, même s’ils conditionnent son comportement : l’analyse des choix individuels est incapable d’en rendre compte, puisqu’ils s’imposent à l’homme de l’extérieur. Durkheim conçoit donc la sociologie comme une science des groupes constitués ; elle s’attache plus particulièrement aux freins que les individus doivent respecter ou internaliser pour réguler leurs relations.
Nous sommes là dans le prolongement de la problématique initiée par La Boétie, inversée par les théories du contrat social et passée d’une formulation politique à une formulation sociale à la suite de la Révolution : la vie collective ne peut s’épanouir qu’à travers un certain asservissement ; celui-ci est limité lorsqu’il est négocié et consenti. Pour Auguste Comte, la sociologie a pour tâche de rendre possible le fonctionnement des sociétés modernes en promouvant une nouvelle forme de lien symbolique entre les hommes : cela implique l’institution d’une religion de l’Humanité.
Durkheim s’inscrit dans le sillage de Comte :
« À l’idée du premier que l’ensemble est antérieur au détail, et pour cela même mieux connaissable, correspond la devise du second que le tout est plus que la somme de ses parties, ce qui signifie qu’on ne peut pas partir de ces dernières pour l’expliquer » (Aron, 1928, repris dans Leboyer, 2016, paragraphe. 6).
Pour Durkheim, et même si la sociologie s’appuie sur l’histoire, le droit, la statistique ou l’ethnologie, ce n’est pas une discipline scientifique comme les autres ; c’est un prolongement de la philosophie par d’autres moyens. Elle est seule à offrir une structure adéquate aux savoirs sur l’homme social qui se développent alors : ils n’ont de fondement légitime que s’ils mettent en œuvre les principes qu’elle élabore. Cela crée en France une tension permanente entre les chercheurs qui étudient empiriquement l’homme social selon des perspectives variées et les sociologues qui s’estiment seuls capables d’interpréter le domaine.
Comme toute son époque, Durkheim est sensible au mouvement de l’histoire et à l’évolution. Il tire du séjour qu’il effectue en Allemagne à la fin de ses études l’idée développée par Ferdinand Tönnies selon laquelle la vie collective mute avec la modernité industrielle, lorsque la société extensible du monde de la manufacture se substitue à la communauté limitée du monde traditionnel et que les liens froids d’aujourd’hui remplacent les soutiens proches d’hier. Il découvre chez Wilhelm Wundt une manière originale d’étudier la morale.
Dire que le fait social est contraignant, c’est souligner que la société modèle l’individu : celui-ci est un être de culture ; Durkheim reprend à ce propos une notion qui remonte à Aristote : celle du rôle de l’hexis, par laquelle la société infuse dans l’être ses manières d’être et de penser. Il reprend à Thomas d’Aquin le terme par lequel celui-ci traduisait hexis en latin : habitus. Celui-ci installe chez l’homme des habitudes et des réflexes mentaux qui encadrent ses réactions et orientent son action. Les cadres de la vie des groupes ne naissent pas de l’individu ; ils lui sont imposés par la société, mais sans que celui-ci ait conscience d’être conditionné et sans que cela le prive de créativité.
La sociologie de Durkheim est scientifique au sens du positivisme et fait, par exemple, largement appel aux données statistiques. Elle s’attache en même temps aux idées qui sont au cœur de la culture. La discipline qu’il bâtit se définit comme une étude des institutions, c’est-à-dire de l’ensemble « des croyances et des modes de conduite institués par la collectivité » (Durkheim, 1895). La société est « avant tout un ensemble d’idées, de croyances, de sentiments de toutes sortes, qui se réalisent par les individus » (Durkheim, 1924).
Les études comparatives mettent en évidence des faits communs à tous les groupes humains : la prohibition de l’inceste tout autant que l’existence de conduites qui échappent aux règles instituées, comme le suicide et le crime. Les faits sociaux ne reposent pas sur les consciences individuelles, mais influent sur celles-ci : à travers les croyances qu’ils installent en chacun, ils font naître la conviction que la collectivité constitue une entité supérieure ; ils la sacralisent. Une morale qui guide les comportements de chacun et permet le fonctionnement de la collectivité se met en place. Ainsi sont apparues les religions dont le rôle est essentiel.
Les études comparatives mettent également en évidence la diversité et l’évolution des faits sociaux. Aux petites communautés du monde traditionnel s’opposent les sociétés du monde moderne. À la solidarité mécanique des premières (chacun y conduit les mêmes tâches, ce qui crée une unité fusionnelle de groupes qui restent de taille limitée) se substitue l’unité organique des secondes, où la multiplication des spécialisations professionnelles renforce les complémentarités, mais différencie les conditions, fait perdre le sens des règles communes et suscite des comportements anomiques.
Là où l’on voit que la sociologie de Durkheim n’est pas seulement une science positive, mais qu’elle est aussi une philosophie, c’est dans le rôle qu’il lui assigne dans notre monde : restaurer le lien à caractère religieux (d’autres diraient, plus largement, idéologique) sans lequel aucune société ne peut perdurer.
Max Weber ou le dénominateur commun
des sciences sociales empiriques
Dans le courant du XIXe siècle, l’intérêt croissant pour l’homme et la société conduit à la multiplication des disciplines empiriques. L’économie est la seule à développer un corpus théorique, puisqu’elle considère que les décisions prises par les agents économiques sont rationnelles. La géographie cesse d’être une science de cabinet au service de la cartographie et de l’histoire et fait du paysage son objet principal et son document central. L’histoire ne se borne plus à reconstituer l’existence des souverains et de leurs capitaines ; elle se focalise sur le devenir des peuples, des classes et des civilisations. L’ethnographie et les études folkloriques s’attachent aux peuples premiers et aux milieux populaires des sociétés traditionnelles. Les sciences politiques se dessinent aux alentours de 1900.
Chaque discipline met au point des approches adaptées aux sources documentaires dont elle dispose. Celles qui travaillent sur le monde contemporain multiplient les enquêtes, à la façon de celles qu’imagine Frédéric Le Play (1879 ; Kalaora et Savoye, 1989) ; pour connaître les conditions de vie des ouvriers européens, il s’appuie sur des questionnaires qui font concrètement connaître leur habitat, leurs modes de vie et leur travail dans des régions sélectionnées d’un bout à l’autre du continent. Pour comprendre leur sort, il faut en effet connaître le lieu où ils vivent, ce qu’ils sont et leurs activités – place, folk and work, traduit Patrick Geddes, qui reprend à son compte la méthode en Grande-Bretagne.
Dans les États qui se modernisent, l’administration recueille de plus en plus de données sur les populations, les activités productives, les équipements de transports et la circulation, la santé, la vie religieuse et les loisirs. La statistique offre ainsi des milliers d’informations sur les faits sociaux. Les techniques mises en œuvre pour les interpréter et pour les représenter (celles de la cartographie thématique en particulier – Palsky, 1996) progressent rapidement. Aux enquêtes directes s’ajoutent les informations que recueillent et publient les États modernes. Grâce aux outils fournis par la statistique mathématique, Adolphe Quételet (1835) apprend à en tirer la connaissance de l’homme moyen et propose, sur cette base, la construction d’une physique sociale.
Une certaine théorisation des sciences sociales empiriques est possible, comme l’enseigne Max Weber. Très différente de celle de Durkheim, sa démarche part de l’activité des individus lorsque celle-ci les lie aux autres et prend en compte leur comportement. Il la définit ainsi :
« Nous appelons sociologie une science qui se propose de comprendre par interprétation l’activité sociale et par là d’expliquer causalement son déroulement et ses effets. Nous entendons par ‘activité’, un comportement humain quand et pour autant que l’agent ou les agents lui communiquent un sens subjectif. Et, par activité ‘sociale’, l’activité qui, d’après son sens visé par l’agent ou les agents, se rapporte au comportement d’autrui par rapport auquel s’oriente son déroulement » (Weber, 1971, p. 4).
Tous les termes sont pesés. L’activité ? Il s’agit des comportements qui revêtent, pour leurs agents, un sens subjectif. L’activité sociale ? C’est celle qui vise autrui. Dans les faits, ce sens n’est pas toujours explicité par ceux qui agissent, ce qui ne veut pas dire qu’il soit absent. Si l’agent se conduit rationnellement, l’observateur peut reconstituer son raisonnement implicite dès qu’il connaît son objectif. Dans les autres cas, il y parvient par un effort d’empathie et d’interprétation.
Observation et interprétation révèlent ainsi le sens visé par un agent ou une pluralité d’agents dans des situations concrètes ; la sociologie regroupe dans un même type les agents dont l’analyse compréhensive montre qu’ils partagent les mêmes visées et sont à l’origine des mêmes formes d’organisation collective ; elle élabore ainsi des idéaux-types, dont chacun éclaire un pan de la réalité empirique. Max Weber commente :
« [Le sens ainsi analysé] n’est donc pas un sens quelconque objectivement ‘juste’ ni un sens ‘vrai’ élaboré métaphysiquement. C’est en cela que consiste la différence entre les sciences empiriques de l’activité, comme la sociologie et l’histoire, et toutes les sciences dogmatiques, telles que la juristique, la logique, l’éthique et l’esthétique qui cherchent à explorer le sens ‘juste’ et ‘valable’ de leurs objets » (ibid., p. 4).
La démarche fait appel à la fois à l’induction (on part de cas concrets) et à la construction de typologies grâce à l’analyse compréhensive.
La sociologie est ainsi définie comme une science bâtie sur des données empiriques dont on dégage la signification en reconstituant leur logique et en mettant en évidence le type auquel elles se rapportent. Elle interprète la réalité en mettant en évidence les idéaux-types vers lesquels tendent les interactions analysées.
Max Weber structure une forme de connaissance sociale dont les bases sont empiriques et qui débouche sur des explications générales tout en évitant le caractère dogmatique du système durkheimien. Il propose ainsi une voie pour élaborer la métathéorie à laquelle aspirent les sciences sociales empiriques, mais qu’elles ont de la peine à systématiser.
L’isolement des sciences sociales de l’inconscient
L’apparition des sciences sociales de l’inconscient s’échelonne sur trois quarts de siècle – des années 1840 aux années 1910. Leurs domaines sont très différents : l’économie, la part la moins intellectualisée des comportements humains, le jeu des mécanismes qui modèlent les langues sans que leurs locuteurs en prennent conscience.
Les deux premières de ces interprétations sont nées dans le monde germanophone (Allemagne et Autriche), la troisième en Suisse romande. Il n’existe aucun rapport entre elles jusqu’au lendemain de la première guerre mondiale. Les remises en cause que subit la métaphysique kantienne sous l’influence de Schopenhauer puis de Nietzsche élargissent cependant leur audience. D’abord limité au monde de langue allemande, les nouvelles attitudes gagnent le reste du monde occidental entre les deux guerres mondiales. Les courants radicaux se réclament déjà de Marx et de Freud. Il faut attendre les années 1950 pour mesurer ce que peut apporter à la connaissance des sociétés et des cultures l’exploration de l’inconscient linguistique.
Trois familles de sciences sociales se sont mises en place aux alentours de 1800, au moment où les Lumières s’effacent, où l’on découvre la complexité et la profondeur du social, où Kant donne une nouvelle portée à la métaphysique, et où Comte décide d’appliquer une démarche scientifique pour répondre au problème devenu central pour la philosophie depuis la Renaissance et La Boétie : celui de la conciliation entre liberté et vie collective, entre ordre et progrès. La confrontation de ces trois démarches ne se produit finalement qu’à partir du milieu du XXe siècle.
La neutralité morale de l’anthropologue et ses conséquences
Le rôle de Franz Boas (Lévy Zumwalt, 2019) dans l’épanouissement de l’anthropologie culturelle américaine me fascine. Cet Allemand a appris la géographie sous la direction de Friedrich Ratzel ; émigré aux États-Unis, il devient anthropologue ; il se distingue par l’attention qu’il porte aux enquêtes de terrain et aux attitudes que doit prendre le chercheur qui les mène. Pour comprendre des sociétés profondément différentes de la sienne, celui-ci doit se départir de ses attitudes habituelles et de leurs présupposés plus ou moins implicites. Il lui faut renoncer à porter des jugements moraux sur ceux qu’il observe et s’abstenir d’analyser les groupes sociaux en termes d’éthique. Cela devient la règle première de l’anthropologie culturelle américaine.
Conseil de bon sens, apparemment : en analysant une société, les chercheurs ne doivent pas plus se soucier de leurs propres valeurs que de celles des populations étudiées. Mais en agissant ainsi et sans en être conscients, ils font subir aux groupes sur lesquels ils travaillent une transformation essentielle : ils les dépouillent de ce qui fait leur humanité. Ils les « déconstruisent », et pour en fournir une interprétation, ils les reconstruisent alors. Ils n’ont pas le droit de le faire en mobilisant les valeurs qui sont au fondement de la société occidentale ou celles que professent les groupes qu’ils analysent : ils interprètent donc ce qu’ils observent en mobilisant ce qui, en dehors des
règles de la morale dominante, fait comprendre les mœurs de la société à laquelle ils appartiennent. Ils s’inspirent très largement de la psychanalyse alors à la mode. C’est ainsi que Margaret Mead (1928) lit dans la fréquence des relations sexuelles avant mariage aux îles Samoa la marque d’une culture qui ne souffre pas des prohibitions liées au christianisme – et l’offre en exemple aux jeunes occidentaux.
Je tire de ces lectures une leçon : la prise en compte de la culture est indispensable pour comprendre les autres sociétés, mais on a beau dresser un inventaire minutieux des environnements qu’elles modèlent ou des techniques qu’elles emploient, on les déshumanise si on ignore leur dimension morale. Au bout d’un demi-siècle, l’anthropologie culturelle américaine prend conscience de ces effets pervers. La pratique recommandée par Clifford Geertz de la deep description, de la description fouillée, fait saisir les motivations profondes des actions observées et les valeurs sur lesquelles elles reposent. Geertz se réclame de l’anthropologie symbolique pour laquelle « la culture est un système hérité de conceptions exprimées en termes symboliques et par lesquels les hommes communiquent, se perpétuent et développent leurs connaissances et leurs attitudes relatives à la vie » (Geertz, 1973, p. 89). La réaction contre les dangers du premier culturalisme se précise avec James Clifford (1988), qui souligne, entre autres, la place que tient l’analyse des systèmes de valeurs chez des ethnographes français comme Maurice Leenhardt ou Marcel Griaule.
Lorsque la fin de l’impérialisme ramène les anthropologues occidentaux dans leurs pays d’origine, certains appliquent à leurs sociétés d’origine la règle de la neutralité face aux valeurs qu’ils ont apprises outre-mer : après avoir déshumanisé les sociétés dominées, ils en font autant des sociétés longtemps dominantes. Bruno Latour ne cache pas que c’est son séjour à Abidjan et l’expérience qu’il a alors de l’anthropologie coloniale qui l’amènent à inventer la théorie de l’acteur-réseau. Pierre Bourdieu se souvient de son expérience kabyle lorsqu’il pose les fondements de ses méthodes d’enquête.
Si l’on veut éviter cette déshumanisation, il faut prendre en compte les représentations de ceux que l’on étudie, celles en particulier qui pèsent sur leurs décisions et sur leurs modes de vie.
Acte II. La remise en cause de la modernité
Des signes avant-coureurs des changements de perspective dans la manière de concevoir les sciences de l’homme et de la société, et la géographie humaine en particulier, sont sensibles dès les années 1950 et 1960. Ils se multiplient aux alentours de 1970. Il faut néanmoins attendre les années 1980 pour que le tournant soit pris.
La fin des interdits dans les sciences sociales
Les interdits étaient particulièrement sensibles en géographie culturelle. Un exemple : Pierre Deffontaines précise en 1966 le point de vue qui était le sien lorsqu’il rédigeait, avant toute remise en cause, la Géographie des religions parue en 1948 :
« Le géographe est alors appelé à conserver à l’égard des faits religieux une attitude de pur observateur, ne cherchant pas à étudier le fondement, l’origine ou l’évolution des systèmes religieux et la valeur respective de ceux-ci. Il se borne à noter les répercussions géographiques des faits de religion sur le paysage, il réduit ainsi le point de vue religieux à des éléments extérieurs et physionomiques, laissant délibérément de côté le domaine majeur de la vie intérieure. Les actes religieux ou de piété seront donc envisagés ici comme des facteurs de paysage, au même titre que des agents climatiques ou d’érosion » (Deffontaines, 1977, p. 1718).
C’est, exposé avec la plus grande fermeté, le point de vue jusque-là communément partagé par les spécialistes de géographie culturelle.
Au sein des sciences sociales en général et de la géographie humaine en particulier, la curiosité conduit alors les chercheurs à remettre en cause le tabou qui leur interdisait d’analyser directement la pensée humaine – mais cela se fait encore en ordre dispersé.
Xavier de Planhol (1958 ; 1968) se montre déjà plus hardi dans son analyse du monde islamique ; la pensée religieuse y valorise inégalement les genres de vie : les citadins sont les mieux placés pour remplir les obligations assignées par le Coran aux croyants ; il manque aux ruraux la possibilité de participer à la grande prière du vendredi au milieu d’une foule de coreligionnaires ; les conditions sont moins favorables encore pour les nomades et les marins. Cela a un impact très fort sur la géographie des pays musulmans et sur leur dynamisme économique.
Une autre étape est franchie en 1967 dans l’étude que publie David Sopher sur Geography of Religions (Sopher, 1967) ; il y conçoit la religion comme un des facteurs essentiels du fonctionnement des groupes : les croyances en constituent un élément-clé. Les savoirs, les références et les comportements partagés donnent à ceux qui pratiquent les mêmes cultes un fort sentiment d’appartenance. L’encadrement religieux des sociétés épaule le pouvoir politique ou s’oppose à lui. Les barrières sur lesquelles butait la géographie religieuse tombent : les représentations religieuses sont pleinement prises en compte.
On constate des évolutions analogues dans d’autres disciplines. En France, l’École des Annales entraîne, chez les historiens d’après 1930, une remise en cause de la primauté de l’histoire politique et des récits nationaux. Mais dans un premier temps, c’est du modèle économique de la modernisation des modes de production (Labrousse, 1944) ou du modèle géographique d’analyse des rythmes lents d’évolution (Braudel, 1958) que s’inspirent la plupart de ceux que séduit le nouveau paradigme. La situation change à partir de 1950 : à la suite de Philippe Ariès (1960), la place faite à l’histoire des mentalités ne cesse de croître ; l’histoire grecque se renouvelle en empruntant à l’anthropologie son approche de la diversité des systèmes de pensée.
Le monde anglophone, où le marxisme n’est pas intellectuellement stérilisé par de puissants partis communistes, réserve un bon accueil à l’analyse que propose Gramsci (2011/1948-1951) du rôle des idéologies dans le monde moderne : l’historien E. P. Thompson (1968) et le spécialiste de la littérature Raymond Williams (1958 ; 1981) analysent les représentations que développent le monde ouvrier britannique et soulignent leur poids dans les dynamiques sociales. Le Parti Communiste freine, en France, l’adoption de ces thèmes, mais le pas est franchi avec Maurice Godelier lorsqu’il publie en 1984 Le Matériel et l’idéel.
Ce qui s’impose ainsi à partir de 1970, c’est la prise en compte par les sciences sociales empiriques en général, et par la géographie humaine en particulier, d’un changement de perspective qui focalise l’attention sur des aspects jusque-là négligés des comportements : (i) la forme des mouvements revendicatifs pour les théoriciens du passage de la modernité à la postmodernité, et (ii) la prise en compte de la totalité de la culture pour ceux qui sont soucieux de bâtir des disciplines vraiment humaines. Pour désigner ces mutations, on parle de tournants : tournant de la postmodernité et du poststructuralisme pour l’ensemble des sciences sociales, tournant linguistique de l’histoire, tournant spatial de la sociologie, tournant culturel pour la géographie.
La critique des philosophies de l’histoire
À l’impatience croissante des chercheurs vis-à-vis d’interdits qu’ils ne comprennent plus s’ajoute un mouvement beaucoup plus large : les philosophies du progrès font l’objet de critiques de plus en plus virulentes. Leurs racines, anciennes, sont philosophiques. Les conflits mondiaux auxquelles mènent l’exaspération des passions nationalistes et l’impérialisme occidental élargissent le nombre de ceux qui constatent que le progrès technique peut générer le pire. Un double pas est franchi dans les années 1950 et 1960 : la critique de la pensée occidentale devient systématique avec la vogue nouvelle de la déconstruction ; une idée se répand de plus en plus largement dans les milieux éduqués, dans l’opinion publique des pays occidentaux puis dans celle de l’ensemble du monde : l’ère de la modernité se clôt ; les conceptions de la science qu’elle avait mises à la mode, le structuralisme en particulier, disparaissent en même temps. On entre dans la postmodernité, une période où les sciences sociales s’affirment poststructuralistes.
Comment en est-on arrivé là ?
La remise en cause de la pensée occidentale est surtout dirigée contre la forme qu’elle a prise à la fin du XVIIIe siècle, avec Kant. Elle débute en Allemagne au XIXe siècle et y revêt deux formes.
Les philosophies de l’absolu de la volonté et du Gai Savoir
La postérité kantienne subit une profonde inflexion avec Schopenhauer : ce qui fait la grandeur de l’homme, ce qui lui donne accès à l’absolu, ce n’est plus la raison, c’est la volonté. La mutation devient totale avec Nietzsche : l’homme n’est plus fondamentalement un être social ; ce qui l’anime, c’est sa volonté de puissance, exprimant des pulsions profondes qui n’ont que faire des règles morales que la collectivité cherche à imposer ; l’homme véritable est un surhomme qui échappe au lot commun. La dimension qui l’affranchit du terre-à-terre quotidien n’est plus transcendantale et liée à l’exercice de la raison ; elle est immanente et enracinée dans l’inconscient des forces dionysiaques de la vie.
Au côté du rationalisme qui domine toujours la philosophie occidentale naît ainsi un courant qui sape ses fondements en mettant l’accent sur l’irrationnel et l’instinct vital. Les forces dont les vertus sont ainsi soulignées échappent au contrôle conscient : de ce point de vue, la philosophie nietzschéenne finit par converger avec les courants issus de l’économie marxiste, de Freud et de la linguistique.
La phénoménologie
La seconde inflexion de la postérité kantienne intervient avec la phénoménologie. Pour celle-ci, l’appréhension du réel ne passe pas nécessairement par la reconstruction sanctionnée par l’expérience que réalise la raison. Elle peut être atteinte directement ; on y parvient en dépouillant les objets que nous percevons de toutes les constructions intellectuelles qui les entourent. Avec Husserl et avec Heidegger, une autre façon de philosopher s’affirme ainsi.
La pensée de la modernité avait trouvé sa première forme dans l’idéalisme rationaliste de Kant. À partir des années 1880, deux autres interprétations, celles imaginées par Nietzsche et Husserl, apparaissent. Cela explique que l’atmosphère intellectuelle du XXe siècle soit plus complexe que celle du XIXe.
Les formes diverses de l’aventure du XXe siècle
Les nouvelles orientations trahissent le souci d’éviter les difficultés soulevées par la « révolution copernicienne » de Kant. Elles apparaissent dans le monde germanophone, mais gagnent rapidement l’ensemble de l’Occident.
L’atmosphère générale change avec la première guerre mondiale. Les nationalismes exacerbés et l’impérialisme conduisent à des affrontements à l’échelle du Globe ; les progrès de l’armement les rendent de plus en plus sanglants. L’utilisation de l’arme nucléaire à la fin de la seconde guerre mondiale rend irréversible les dommages infligés à l’ennemi. En cas d’attaque nucléaire massive d’un pays, les ogives embarquées dans les sous-marins nucléaires de celui-ci infligeront à l’agresseur des dommages aussi irrémédiables que ceux subis par la nation agressée.
Dans sa biographie d’Henri Lefebvre, Rémi Hess (1988) souligne ce que le sociologue tire du sentiment qu’éprouvent alors les intellectuels de vivre « l’aventure du siècle », faite d’inquiétude, de fuite en avant dans l’avant-gardisme et d’exploration de la face sombre de la conscience humaine. Cette aventure prend des formes différentes selon les pays. En Autriche et en Allemagne, la libération freudienne des mœurs va de pair avec un vif intérêt pour les implications techniques de la modernité et avec l’immense succès du thème de la volonté de puissance nietzschéenne ; cela favorise le développement d’une culture de la violence, composante majeure du nazisme. En Amérique du Nord, c’est par la remise en cause du puritanisme que se manifestent les idées nouvelles. Elles introduisent aussi une dimension déconstructrice dans l’anthropologie culturelle américaine.
La situation de la France est particulière. Au lendemain de la première guerre mondiale, l’opinion condamne unanimement la violence – pas question de revoir l’horreur des tranchées : on a vécu « la der des ders » ! Le freudisme pénètre dans les milieux intellectuels, mais n’aboutit pas à une libération massive des mœurs. Le mouvement a la particularité d’être dans une large mesure littéraire et artistique, comme le montre l’audience du surréalisme. L’inconscient ? L’écriture automatique contribue à le révéler. L’œuvre de Sade fascine toute une génération d’écrivains et d’artistes. Elle met à la mode les formes extrêmes du sexe et du sadomasochisme. Avec Georges Bataille ou Antonin Arthaud, érotisme, violence et marginalité sont exaltés. Le mouvement est subversif, comme en témoigne, avant-guerre, sa proximité avec le parti communiste.
Les sciences sociales se développent en France dans un climat différent de celui qu’elles connaissent à l’étranger. À travers Michel Leiris ou Roger Caillois, l’ethnologie participe au mouvement surréaliste, comme le rappelle James Clifford (1986).
L’atmosphère de l’entre-deux-guerres est agitée : les opinions se déchaînent à droite comme à gauche. L’ambiance est différente après-guerre : l’extrême-droite et la droite ont disparu ou se taisent. Soutenu par le Parti communiste et une partie des socialistes, le marxisme a le vent en poupe. Les philosophies allemandes n’ont jamais rencontré une telle audience : c’est vrai de l’hégélianisme illustré par Hyppolite, de la phénoménologie développée par Maurice Merleau-Ponty et de l’œuvre de Heidegger reprise par toute une génération. Associé au mouvement de libération de la jeunesse qui commence à secouer la France, l’existentialisme de Sartre est furieusement à la mode. Enfant de l’Assistance publique, homosexuel, voleur, longtemps balloté de maison de correction en prison, soutenu par Cocteau et par Sartre après-guerre, Jean Genêt apparaît comme le prototype du génie marginal et insoumis.
Du structurationnisme au poststructuralisme
L’engouement qu’a connu le structuralisme en linguistique, en anthropologie et dans certains courants du marxisme gagne alors l’ensemble des disciplines de l’homme, mais se trouve aussi violemment contesté : sa logique le rend aveugle au changement et à la dynamique des évolutions. Le passage de l’idée de structure à celle de système, aux alentours de 1970, corrige mal ce défaut.
La scène intellectuelle évolue très vite durant les années 1970 et le début des années 1980. On qualifie à l’époque de structurationnistes (le terme n’est plus usité aujourd’hui) les efforts effectués pour concilier apport du structuralisme et dynamiques du monde social. En Grande-Bretagne, cette phase est symbolisée par Anthony Giddens (1987) [1984] : les équilibres de forces responsables de la genèse des structures sont remis en cause par l’initiative humaine ; en soulignant que la transmission de la culture n’est jamais exactement la même et varie en particulier selon les localités, la time geography montre, pour Giddens, que les processus de transmission n’enferment jamais la totalité d’un groupe dans le même moule. Élaborée au même moment en France, la théorie de la régulation (Aglietta, 1997 ; Boyer, R., 1986) illustre cette forme de compromis : pour elle, la pensée libérale rend correctement compte des périodes de science normale, celles où règne un même paradigme ; pour expliquer les mutations qui font passer de l’une de ces plages à la suivante, il faut en revanche recourir à la théorie marxiste. C’est ainsi qu’est interprété le passage du capitalisme fordiste, celui des grandes entreprises tournées vers la production de masse qui caractérise les deux premiers tiers du XXe siècle, au capitalisme flexible de l’époque contemporaine.
Un pas est franchi lorsque François Lyotard (1979) et Fredric Jameson (1984 ; 1991) se mettent à opposer la modernité, dont l’essor se poursuit depuis le début du XIXe siècle, à la postmodernité en train de naître. Les mouvements sociaux changent de nature : la classe ouvrière se disloque. Ce n’est plus pour l’augmentation de leurs salaires et de leurs retraites que se battent tous les salariés. Certains désirent réduire la durée du travail pour mieux jouir de la vie. D’autres s’insurgent contre la pollution croissante qui menace à terme la civilisation et la vie sociale. Les luttes concernent les groupes jusqu’alors oubliés : les femmes, les handicapés, les marginaux, les étrangers. On se mobilise pour des problèmes sociétaux : l’avortement, afin de rendre les femmes pleinement maîtresses de leurs corps, la reconnaissance de droits égaux aux homosexuels et aux transsexuels…
Le passage des formes classiques de la lutte des classes à des revendications variées et d’essence socio-culturelle plus qu’économique est le signe de la transition de la modernité à la postmodernité. Dans le domaine épistémologique, les démarches fonctionnelles deviennent soudain obsolètes parce qu’à la logique de l’économie pure se substitue celle de sociétés où les valeurs sont diverses.
C’est pour cela que le marxisme revu et modernisé à la manière de David Harvey est attaqué de toute part à partir de 1985 : il ne s’est pas dégagé du fonctionnalisme qui dominait l’époque précédente et qui liait structures sociales et mécaniques économiques : dans le domaine épistémologique, le monde postmoderne se révèle poststructuraliste.