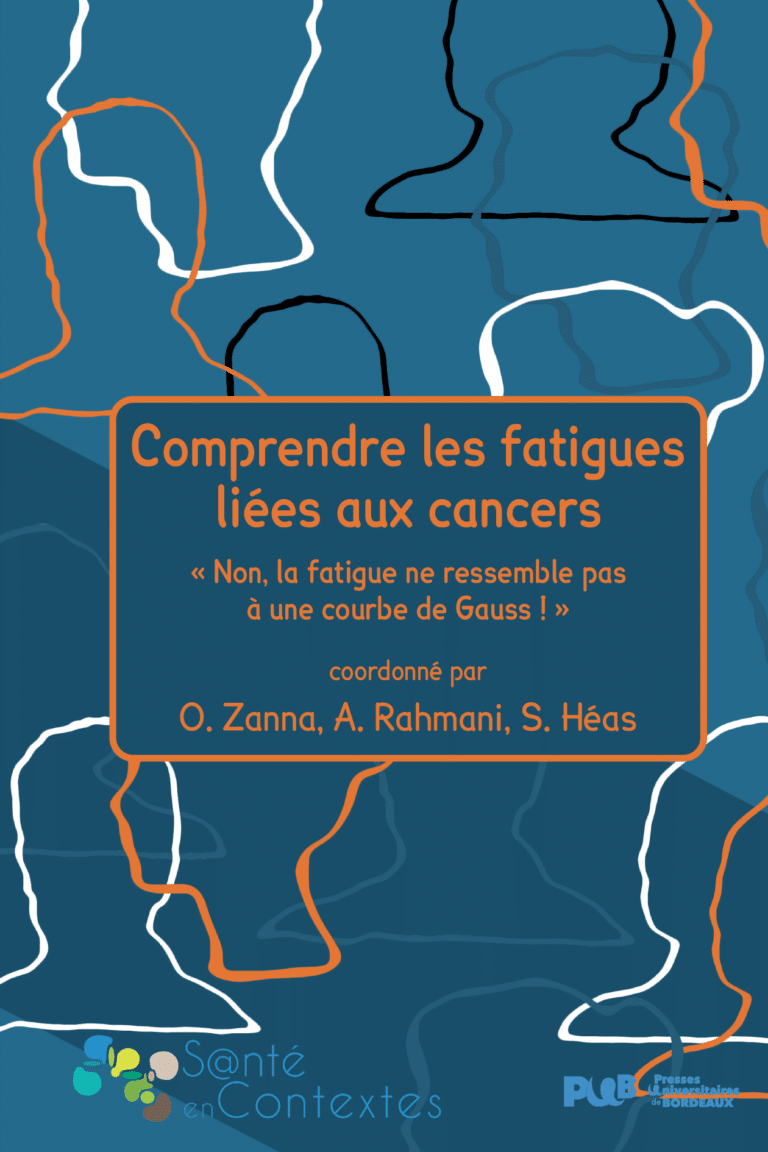Interlude N° 5
Florian (33 ans) est suivi pour un cancer des testicules depuis quatre mois. Entretien réalisé le 06 avril 2022, lors de sa séance de chimiothérapie.
F : Ouais, vraiment de rester à la maison et… puis, comme je vous ai dit, on est vite fatigué, donc même si on… Voilà, j’ai une maison, j’ai des choses à faire à la maison, mais… Je ne peux pas. Je n’ai pas la motivation, ou je suis vite fatigué quoi donc… Ouais c’est vraiment… ça c’est chiant. Ne pas pouvoir travailler ou faire plein de trucs quoi : prendre la voiture, aller se promener… Ça, des fois c’est chiant. Fatiguant quoi. (…) F : J’étais, enfin, je suis toujours un pompier volontaire, dans ma commune. Ça bah déjà ça me manque beaucoup donc… Et puis voilà, je sens que la reprise, ça va être dur (rires). Mais ouais du coup, forcément, ça me manque beaucoup et… Bah ouais, j’ai perdu en forme physique quoi.
V : Vous vous sentez affaibli ?
F : Ah oui oui. Si je force un peu trop, si je monte un peu trop vite l’escalier, je suis… je suis mort. Je suis essoufflé. Alors qu’avant, j’avais vingt kilos dans le dos et puis je montais les escaliers… Ouais, non, après voilà, le médecin m’a dit « c’est normal, ça agresse votre corps, que ce soit le cancer et puis après les traitements ».
Introduction
L’activité physique (AP) est aujourd’hui reconnue comme une stratégie thérapeutique non médicamenteuse efficace en oncologie (INCa, 2017 ; INSERM, 2019). Elle engendre des bénéfices chez les patients atteints d’un cancer en améliorant, entre autres, la tolérance aux traitements, en diminuant la durée d’hospitalisation et les complications post-opératoires, en limitant la sarcopénie et en améliorant la capacité cardio-respiratoire. Toutefois, l’enquête Vie après un cancer débutée en 2012 et menée sur les conditions de vie de personnes atteintes de cancer a montré que dès le diagnostic et cinq ans après le diagnostic, les patients atteints de cancer n’atteignent pas les niveaux de recommandation en termes d’AP. Un patient sur deux déclare faire moins d’AP ou avoir cessé complètement toute activité tandis que seuls 10 % indiquent en pratiquer davantage. Trois patients sur cinq ayant réduit leur quantité d’AP présentent un état de fatigue avéré (Rapport VICAN5, 2018). L’absence d’AP ou le faible niveau de pratique des patients est multifactoriel et parmi les facteurs les plus cités, la fatigue constitue un frein majeur (e.g., Blaney et al., 2013). Dans les deux cas, la fatigue perdure et le patient entre dans un cercle vicieux de déconditionnement.
Ce constat semble indiquer que les programmes d’AP ne permettent pas aux patients atteints de cancer et souffrant de fatigue chronique de s’engager suffisamment dans la pratique. Les raisons sont diverses mais nous retiendrons essentiellement que l’adhésion, c’est-à-dire l’engagement conscient et volontaire dans une AP régulière, repose, en partie, sur la décision du patient de s’investir pleinement dans les séances afin de bénéficier des effets aigus et chroniques de l’AP (INSERM, 2008 ; Audiffren et André, 2015). Généralement, les formations initiées au sein de l’éducation thérapeutique (ETP) des patients insistent sur les bénéfices à long terme, souvent associés aux effets chroniques, mais qui requièrent du temps. C’est ce temps long qui est source de démotivation des patients et à l’origine du taux d’abandon aux programmes d’AP. Les effets aigus de l’AP1 sont, quant à eux, peu perceptibles par les patients et ne constituent pas des sources de motivation en tant que telles.
Ainsi, pour que l’engagement dans une AP s’inscrive dans le temps et afin que le patient y adhère, celui-ci doit pouvoir s’investir pleinement dans chaque séance. Ceci implique qu’agir sur les déterminants psychologiques tels que les attitudes, les normes sociales ou le contrôle comportemental ne suffit pas pour engager le patient (André et al., 2018). Il est également important d’agir sur les déterminants des prises de décision basées sur l’effort, et particulièrement sur les bénéfices immédiats perceptibles de l’effort. Après avoir précisé et défini les termes principaux du débat, nous montrerons que les interventions en AP chez les patients atteints de cancer, selon leurs modalités, sont insuffisantes pour diminuer la fatigue sur le long terme. Ce constat nous conduira à analyser les déterminants de l’adhésion sous le regard croisé de deux modèles théoriques. Nous identifierons ensuite les facteurs de risque de désengagement lorsque la fatigue se chronicise. Enfin, nous proposerons des interventions visant les bénéfices immédiats et destinées à aider les patients à maintenir leur engagement dans l’AP au cours du temps.
Définitions
Fatigue liée au cancer. La fatigue liée au cancer (FLC) n’est pas définie dans la littérature mais plutôt décrite comme « un sentiment pénible, persistant et subjectif de fatigue ou d’épuisement physique, émotionnel et/ou cognitif lié au cancer ou au traitement du cancer qui n’est pas proportionnel à l’activité récente et qui interfère avec le fonctionnement » (National Comprehensive Cancer Network, 2019). La FLC est une fatigue chronique (Bootsma et al., 2020), et peut être caractérisée comme une incapacité à initier et/ou à maintenir des tâches attentionnelles (fatigue mentale) et des activités physiques (fatigue physique) nécessitant une motivation personnelle (par opposition à une stimulation externe) en l’absence de toute faiblesse motrice ou démence cliniquement détectable (Chaudhuri & Behan, 2000). Ces causes sont multiples, telles que l’anémie, l’inflammation, la dénutrition, l’inactivité physique, la charge psychologique et émotionnelle (anxiété, dépression, pensées négatives) et les perturbations du sommeil.
Décisions basées sur l’effort. S’engager dans la pratique d’une AP régulière nécessite de prendre des décisions basées sur l’effort. Selon Treadway et Zald (2011), ces prises de décision impliquent de décider si un résultat donné (généralement une récompense) vaut l’effort mental ou physique requis pour l’obtenir. Bénéficier des effets aigus et chroniques de l’AP demande un engagement de la part du patient dans une AP une fois par jour ou plusieurs fois par semaine de façon régulière. L’effort est donc à la fois associé à l’engagement physique (la pratique elle-même) mais également à l’engagement mental (maintenir l’engagement pendant la pratique mais également au cours du temps). Pour les patients atteints de cancer, le coût de la fatigue vient s’ajouter au coût de l’effort et les bénéfices de l’AP en termes de santé (principalement à long terme) peuvent ne pas compenser les efforts fournis.
Bénéfices immédiats. Les bénéfices immédiats réfèrent aux conséquences positives contiguës à la pratique d’une AP. Ils permettent d’apporter des informations utiles aux patients afin de développer un sentiment de satisfaction lié à la réalisation d’une tâche. Il peut s’agir de l’effet de l’AP sur l’humeur ou du sentiment de progresser, ou encore des bienfaits des interactions sociales. Nous pouvons penser que les bénéfices immédiats sont concomitants aux effets positifs aigus. Les bénéfices immédiats liés à l’AP peuvent être transitoires, c’est-à-dire qu’ils apparaissent peu de temps après le début de l’exercice et s’interrompent quelques secondes ou quelques minutes après l’arrêt de l’AP. Par exemple, les bénéfices immédiats peuvent être associés à des sensations physiques de chaleur, de détente, de progrès qui peuvent devenir des motifs à l’action.
L’AP : stratégie thérapeutique dans la gestion de la fatigue
Il est maintenant admis que l’AP est sans danger, faisable et n’induit pas d’augmentation de FLC, soulignant l’importance de l’intégrer dans le continuum de soins du patient (Kelley et Kelley, 2017 ; Turner et al., 2018). Depuis une décennie, environ quarante revues systématiques et méta-analyses ont rapporté les bénéfices de l’AP sur la fatigue des patients atteints de cancer (taille d’effet faible à modérée). Des amplitudes d’effets différentes ont été rapportées en fonction des types de cancer étudiés, des modalités d’exercice pratiquées, de la durée du traitement, du type de groupes témoins et enfin des questionnaires utilisés (e.g. Medeiros Torres et al., 2022).
Afin de déterminer si les programmes d’AP permettent de diminuer sur le long terme le niveau de fatigue des patients atteints de cancer, une analyse des études utilisant l’Inventaire Multidimensionnel de la Fatigue2 (Multidimensional Fatigue Inventory, MFI ; Smets et al., 1995) dans des essais contrôlés randomisés a été effectuée. Le tableau 1 résume les résultats de neuf études publiées entre 2015 et 2020, impliquant 1 217 participants touchés par des cancers différents3 (Zhou et al., 2018 ; Hu et Zhao, 2020 ; Stan et al., 2016 ; Zhang et al., 2016 ; Travier et al., 2015 ; Witlox et al., 2018 ; Kampshoff et al., 2015 ; van Waart et al., 2015 ; Jong et al., 2018).
Les interventions en AP comprenaient le Tai Chi, le yoga, des exercices de renforcement musculaire, des exercices d’endurance, des entraînements intermittents à moyenne ou haute intensité. Les séances variaient généralement de 60 à 88 minutes avec une fréquence allant de deux fois par semaine à une fois par jour. Les interventions ont duré de douze mois à quatre ans et étaient proposées pendant le traitement avec un suivi jusqu’à quatre ans pour l’étude de Witlox et al. (2018). Quatre études étaient exclusivement supervisées et deux se déroulaient seulement à domicile. Cinq ont utilisé les soins courants comme groupe témoin et les autres études ont choisi la relaxation, des exercices de renforcement musculaire, ou encore des exercices à faible impact. Toutes ces études ont considéré la perception de la fatigue générale comme critère de jugement principal.
| Étude | Type de cancer (stade) / Population | Moment de l’intervention – Durée de l’intervention | Programme AP | Groupe contrôle | Lieu de l’intervention | Résultats |
| Zhou et al. (2018) | Carcinome du nasopharynx (III et IV) / 114 (83 hommes et 31 femmes) | 1er cycle de CRT – N/A | Tai Chi (endurance plus méditation, respiration et conscience du corps) 5 séances / sem. 60 min / séance | Soins courants (pas d’information sur le contenu des soins courants) 5 séances / semaine | En milieu hospitalier ou à domicile, en fonction de la disponibilité du patient, mais sous surveillance. | Niveau de fatigue à T0 : 7,15 FG et 7,77 FC À T1 : Augmentation de la fatigue générale et cognitive pour les deux groupes (par rapport à T0) en raison de la CRT. Différence significative uniquement pour la fatigue générale dans le groupe Tai Chi par rapport au groupe témoin. Attrition : 26,31 % pour le tai-chi et 28,07 % pour les soins courants. |
| Hu & Zhao (2020) | Carcinome du nasopharynx (II, III et IV)/ 132 (89 hommes et 43 femmes) | 1er cycle de CRT – 12 sem. | Renforcement musculaire (pas d’exercices d’endurance) 8 séries d’exercices de résistance progressive sur machine 2 séances / sem. 60 min par séance | Exercices de relaxation musculaire progressive (pas d’exercices d’endurance ou de renforcement musculaire) 2 séances / sem. 60 min par séance | Centre hospitalier de réadaptation | Niveau de fatigue à T0 : 14,6 FG et 13,8 FC À 12 semaines : Réduction de la fatigue cognitive et générale pour les deux groupes mais avec une différence significative pour le groupe renforcement par rapport au groupe relaxation. Attrition : N/A |
| Stan et al. (2016) | Stade précoce de cancer du sein (0, I and II) / 34 femmes | À partir du diagnostic – 12 sem. | Yoga (respiration, échauffement, yoga doux, salutation au soleil assise, yoga debout, étirements sur chaise et relaxation guidée) 3 à 5 séances / sem. 88 min / séance | Exercices de renforcement 5 exercices supérieurs et 5 exercices inférieurs (10 min chacun) avec une résistance fournie par des bandes élastiques (recrutement isométrique des muscles centraux pendant tous les exercices). 3 à 5 séances / sem. 26 min par séance | À domicile | Niveau de fatigue à T0 : 9,8 FG et 5,1 FC Après 12 semaines : Les deux groupes ont réduit de manière significative la fatigue cognitive et la fatigue générale. 3 mois après l’intervention : La réduction de la fatigue cognitive et générale reste stable. Ces différences ne sont obtenues que dans le groupe Yoga Attrition : 22,22% pour le yoga et 43,75% pour les exercices de renforcement musculaire. |
| Zhang et al. (2016) | Cancer du poumon (I, II, III, IV) / 91 (68 hommes et 23 femmes) | 1er cycle de CT – 2 mois et 24 jours | Tai Chi 5 à 10 min d’échauffement, suivies de TC (les participants ont prêté attention à la coordination des mouvements et à la régulation de la respiration) N/A 60 min / séance | Exercices à faible impact (cercles des bras, du cou et des jambes, suivis d’étirements pour les groupes musculaires du haut et du bas du corps et d’une respiration abdominale profonde). N/A 60 min / séance | Intervention à domicile ou communautaire | Niveau de fatigue à T0 : 15,40 FG et 14,95 FC Augmentation de la fatigue générale et cognitive entre T0 et T1 À T1 (6 semaines après le traitement) : Score plus faible sur l’échelle de fatigue générale pour le tai-chi par rapport à un faible niveau d’exercice. Pas de différence de fatigue cognitive entre les deux groupes. À T2 (12 semaines après le traitement) : Les mêmes différences subsistent Attrition : 20,83 % pour le tai-chi et 25 % pour le faible niveau d’exercice. |
| Travier et al. (2015) | Cancer du sein diagnostiqué cancer (0) / 128 femmes | Entre le diagnostic et 18 sem. – 18 sem. | Endurance (entraînement par intervalles d’intensité alternée effectué avec une FC au seuil ventilatoire) et entraînement de la force musculaire (bras, jambes, épaules et tronc : 2 × 10 répétitions (65 % 1-RM) et augmentation progressive pour atteindre 1 × 10 répétitions (75 % 1-RM) et 1 × 20 répétitions (45 % 1-RM) à la fin du programme). en plus des soins courants 2 séances/sem. 60 min / séance | Soins courants (maintien de l’activité physique habituelle jusqu’à la semaine 18) | Centre de réadaptation hospitalier | Niveau de fatigue à T0 : 10,35 FG et 10,02 FC Après 18 semaines : Réduction de la fatigue générale dans le groupe endurance par rapport au groupe de soins courants. Pas de différence pour la fatigue cognitive. À 36 semaines : pas de différence avec le niveau de base Attrition : 14,71 % pour l’entraînement en endurance et 24,51 % pour les soins courants. |
| Witlox et al. (2018) | Cancer du sein et du colon nouvellement diagnostiqués / 11 hommes et 117 femmes | Entre le diagnostic et 18 sem. – 18 sem. | Aérobie (entraînement par intervalles d’intensité alternée effectué avec une FC au seuil ventilatoire) et entraînement de la force musculaire (bras, jambes, épaules et tronc : 2 × 10 répétitions (65 % 1-RM) et augmentation progressive pour atteindre 1 × 10 répétitions (75 % 1-RM) et 1 × 20 répétitions (45 % 1-RM) à la fin du programme en plus des soins habituels 2 séances/sem. 60 min / séance | Soins courants (maintien de l’activité physique habituelle jusqu’à la semaine 18) | Centre de réadaptation hospitalier | Niveau de fatigue à T0 : 10,45 FG et 9,86 FC 4 ans après le début de l’étude : pas de différence avec le début de l’étude dans le groupe d’intervention. Attrition : 41,17 % pour l’entraînement en endurance et 50,85 % pour les soins courants |
| Kampshoff et al. (2015) | Cancer du sein, du colon, des ovaires, du col de l’utérus ou des testicules, ou lymphomes sans indication de maladie récurrente ou progressive (stades I, II, III et IV) / 277 (60 hommes et 55 femmes) | Après un traitement primaire du cancer – 12 sem. | Programme d’exercices d’endurance et de renforcement à haute intensité (HI) ou à intensité faible à modérée (LMI) Les programmes HI et LMI comprenaient 6 exercices de résistance (fréquence de 2 séries de 10 répétitions). Charge de travail : Les exercices de résistance HI commençaient à 70 % de 1-RM et augmentaient progressivement jusqu’à 85 % de 1-RM au cours de la semaine 12 ; les exercices de résistance LMI commençaient à 40 % de 1-RM et augmentaient progressivement jusqu’à 55 % de 1-RM. + Deux types d’exercices d’endurance par intervalles 2 séances / sem. | Soins courants | Supervisé | Niveau de fatigue à T0 : 12,76 FG et 10,90 FC Après 12 semaines : HI a montré une réduction significative de la fatigue cognitive par rapport aux soins courants. HI et LMI ont montré une réduction significative de la fatigue générale par rapport aux soins courants. Attrition : N/A |
| Van Waart et al. (2015) | Cancer du sein (I, II and III) / 230 femmes | 1er cycle de CT – Les interventions ont commencé avec le premier cycle de tomodensitométrie et se sont poursuivies jusqu’à 3 sem. après le dernier cycle de tomodensitométrie. | Programme d’activité physique à domicile de faible intensité (Onco- Move) vs programme d’exercices d’endurance et de renforcement musculaire supervisés d’intensité modérée à élevée (OnTrack) N/A | Soins courants | Programmes à domicile ou supervisés | Niveau de fatigue à T0 : 10,96 FG et 9,93 FC À T1 (après chimiothérapie) : effet de On-track sur la fatigue générale par rapport aux soins courants Pas d’effet sur la fatigue cognitive À T2 (6 mois de suivi) : Plus d’effet sur la fatigue générale. Pas d’effet sur la fatigue cognitive Attrition : 13,15 % en cours de traitement, 38,96 % Onco-move et 31,16 % soins courants. |
| Jong et al. (2018) | Cancer du sein (I, II and III) / 83 femmes | 1 à 2 sem. avant le début de la chimiothérapie – 12 sem. | Yoga (Dru Yoga : conscience de la respiration ; libération des blocages d’énergie ; conscience du corps ; relaxation) 1 séance / sem. 75min / séance + séance quotidienne de relaxation et de respiration (5-20 min / séance) | Soins courants | Encadré (yoga) et à domicile (respiration) | Niveau de fatigue à T0 : 12,50 FG et 11,25 FC Pas d’effet de l’intervention sur la fatigue générale et cognitive Attrition : 14,89 % pour le yoga et 25 % pour le traitement standard |
Globalement, les moyennes de fatigues générale et cognitive perçues par les patients sont très proches (respectivement 9,93 vs. 9,05). À l’exception du yoga proposé dans l’étude de Jong et al. (2018), toutes les interventions testées permettent de réduire la fatigue générale à douze semaines. Concernant la fatigue cognitive, seules trois études montrent des effets positifs de l’AP à douze semaines (Hu & Zhao, 2020 ; Stan et al., 2016 ; Kampshoff et al., 2015). Chacune d’entre elles propose des exercices de renforcement musculaire (parfois associés à des exercices d’endurance). Le programme est supervisé à l’hôpital (Hu & Zhao, 2020) ou à domicile (Stan et al., 2016 ; Kampshoff et al., 2015). Dans les études réalisant un suivi des patients sur le long terme, les effets bénéfiques des différentes interventions n’augmentent pas avec le temps. D’une manière générale, ils restent stables, voire diminuent et le niveau de fatigue générale revient à la ligne de base (avant traitement) (van Waart et al., 2015 ; Travier et al., 2015 ; Witlox et al., 2018). Aucune information n’est disponible pour la fatigue cognitive au cours du temps.
Ces études suggèrent que les fatigues générale et cognitive diffèrent et remettent en question l’efficacité de certaines interventions telles que le Tai Chi, les exercices d’endurance ou les exercices à intensité modérée à élevée pour réduire la fatigue cognitive. En revanche, le renforcement musculaire est la seule intervention montrant des effets positifs à la fois sur les fatigues générale et cognitive. À cet égard, le renforcement musculaire est recommandé par l’American College of Sports Medicine et l’American Cancer Society. Il est inclus dans les lignes directrices des Plans Cancer d’autres pays (Cormie et al., 2018 ; Nadler et al., 2017). Néanmoins, sur les trois études montrant des effets bénéfiques sur la fatigue cognitive, une étude rapporte un niveau d’attrition de 43,75 % pour les exercices de renforcement musculaire (Stan et al., 2016). Ces résultats peuvent expliquer pourquoi malgré les bénéfices de l’exercice sur la fatigue générale, les survivants du cancer sont réticents à s’engager dans des exercices durables en raison d’une fatigue cognitive persistante (Sheill et al., 2019 ; van Vulpen et al., 2020 ; Turner et al., 2018 ; Ormel et al., 2017).
Cette revue de la littérature montre que si l’AP réduit la perception générale de fatigue ainsi que la fatigue cognitive, les effets ne sont pas pérennes. Cela s’expliquerait par le fait que les programmes ne permettent pas aux patients d’adhérer à l’AP. La résurgence de la fatigue peut être associée à une diminution ou à l’arrêt prématuré de l’AP. Il est possible alors de considérer que le programme n’ait pas permis au patient de bénéficier des effets chroniques de l’AP et que l’adhésion n’était pas consolidée.
L’adhésion à l’AP : Regards croisés de deux modèles théoriques
Permettre aux patients atteints de cancer et souffrant de fatigue chronique d’adhérer à une pratique régulière d’AP nécessite de prendre en considération les déterminants de l’adhésion. La FLC est un symptôme qui rend complexe la décision de s’engager dans une AP. En effet, le désengagement découle d’un certain nombre de facteurs directement liés à la fatigue telles que les croyances sur les risques de l’AP, les barrières liées à la fatigue ou encore les symptômes dépressifs et anxieux. Deux modèles théoriques vont permettre d’identifier les leviers de l’adhésion : le modèle exercice-cognition de l’adhésion (Audiffren & André, 2015) et le modèle exercice-émotion-adhésion (Lee et al., 2016).
Le modèle développé par Audiffren et André (2015) propose que les effets chroniques de l’AP soient une condition à l’adhésion dans des comportements de santé. Selon le modèle exercice-cognition de l’adhésion, les fonctions exécutives (FE) et le contrôle volontaire (l’effort) jouent un rôle central dans la relation bidirectionnelle liant l’AP et la santé mentale. Plus particulièrement, la pratique régulière d’une AP (avec effort) initie un cercle vertueux unissant le comportement aux fonctions exécutives de manière bidirectionnelle. D’une part, l’exercice chronique conduit à une amélioration du contrôle par l’effort en partie sous-tendue par les fonctions exécutives. D’autre part, l’amélioration des fonctions exécutives (et du contrôle par l’effort) conduirait à une facilitation du maintien de l’AP au fil du temps. À ce propos, Martin Ginis et Bray (2010) ont souligné que l’adhésion à l’AP nécessite des compétences d’autorégulation telles que l’anticipation et l’élaboration de plans pour surmonter les obstacles à l’AP, la création de plans et d’horaires d’AP et la gestion de la douleur et de l’inconfort liés à l’AP. Toutes ces compétences d’autorégulation sont directement liées aux FE. Par exemple, l’initiation et le maintien d’un comportement tel que pratiquer l’AP plusieurs fois par semaine nécessitent l’inhibition intentionnelle pour résister au désir d’arrêter l’AP lorsque la sensation d’inconfort ou de fatigue est trop élevée. Pratiquer régulièrement des AP nécessite également de planifier les séances au cours de la semaine à venir (c’est-à-dire l’établissement d’objectifs), de se rappeler quand faire de l’AP à l’heure prévue (c’est-à-dire la mémoire prospective) et d’accepter que les effets positifs de l’AP se produisent à long terme (c’est-à-dire accepter le délai de gratification), qui sont trois fonctions cognitives supérieures directement liées aux FE (Lezak et al., 2012 ; Schnitzspahn et al., 2013 ; Lee & Carlson, 2015). Ces compétences d’autorégulation se développent sous l’effet de l’AP chronique et ne semblent pas être efficaces lorsqu’il s’agit d’initier le comportement (Finne et al., 2018). Ce modèle rend compte de l’importance de s’engager dans des activités qui demandent de l’effort pour améliorer le fonctionnement exécutif qui est un déterminant de l’adhésion dans la pratique d’AP.
Selon le modèle exercice-émotion-adhésion proposé par Lee et al. (2016), le faible taux d’AP dans la population générale est en grande partie dépendant de la tendance humaine à éviter les efforts physiques inutiles. Cette tendance a évolué parce qu’elle a permis à nos ancêtres de conserver de l’énergie pour des activités physiques qui avaient une utilité adaptative immédiate, comme poursuivre des proies, échapper à des prédateurs et s’engager dans des comportements sociaux et reproducteurs. La réponse affective négative couramment observée à l’effort, et qui peut expliquer la réticence à s’engager dans une AP, est un mécanisme psychologique par lequel les humains évitent les dépenses énergétiques inutiles. Selon les auteurs, engager durablement les individus dans l’AP régulière requiert d’identifier des objectifs immédiats pour contrer les effets à long terme qui sont souvent source de démotivation. Par exemple, des progrès, des sensations physiques, des émotions agréables, des moments de sociabilité, et des pensées positives attachées à ces actions peuvent devenir des objectifs immédiats. Ce modèle pointe les aspects liés à l’engagement dans des activités qui demandent de l’effort et insiste sur l’intérêt des objectifs immédiats pour faciliter la motivation à faire afin de bénéficier des effets chroniques.
Ces deux modèles offrent une vision plus globale des problèmes d’adhésion dans l’AP que peuvent rencontrer des patients atteints de cancer et souffrant de fatigue chronique. Ces deux modèles permettent de prendre en considération d’une part la nécessité pour le patient d’entrer dans un cercle vertueux pour bénéficier des effets chroniques de l’AP afin de favoriser l’adhésion et, d’autre part, de faire valoir les bénéfices (ou objectifs) immédiats pour augmenter la motivation et l’engagement au cours des séances. Ce deuxième aspect est une condition pour bénéficier des effets chroniques de l’AP.
La fatigue chronique : trois facteurs de risque de désengagement de l’AP
La fatigue dans le cancer peut s’installer très tôt et de façon insidieuse. D’après la littérature sur la FLC (e.g., Bower, 2014 ; Thong et al., 2020 ; O’Higgins et al., 2018) et l’épuisement chronique (André & Baumeister, 2023), au moins trois phénomènes peuvent provoquer une fatigue chronique chez les patients atteints de cancer :
- Le cancer et son traitement ;
- La charge psychologique liée au diagnostic et au bouleversement de la vie ;
- Le sommeil et l’alimentation.
Dans cette perspective, il est important de développer des campagnes de prévention destinées à sensibiliser les gens à la nécessité d’être actif tout au long de la vie. Toutefois, lorsque le cancer est diagnostiqué, il est important d’intervenir rapidement avant que la fatigue ne se chronicise. En effet, le désir de reporter la décision de s’engager dans une AP en cas de fatigue est largement observé dans la littérature (Clark et al., 2008 ; Courneya et al., 2005, Rogers et al., 2007) et le report de ces décisions mène à une récurrence de la fatigue. Trois grands facteurs de risque de désengagement peuvent être identifiés.
En premier lieu, la fatigue récurrente conduit à un déconditionnement secondaire à la maladie qui constitue un premier facteur de risque. En effet, le patient atteint de cancer doit faire face à différents symptômes (altération de la condition physique, modifications de la composition corporelle, fatigue, douleurs, etc.), à des facteurs psychologiques (syndrome dépressif, altération de l’estime de soi et de son image corporelle avec une perte de confiance en ses capacités physiques, voire une kinésiophobie) et à des facteurs sociaux (représentations sociales négatives de la maladie). Ce déconditionnement secondaire à la maladie dégrade encore plus la condition physique, aggrave la fatigue et altère la qualité de vie. Le risque ici pour le patient est d’entrer dans un cercle vicieux de déconditionnement qui réduit de fait la pratique d’AP. Ainsi, si le symptôme est le même pour les patients atteints de cancer, c’est-à-dire la perception de fatigue, en revanche, la cause peut varier d’un individu à l’autre. Il paraît donc nécessaire de prendre en considération ces différences interindividuelles afin d’adapter le traitement.
Ensuite, une fatigue récurrente peut conduire à des apprentissages conditionnés qui peuvent développer une réticence à s’engager dans des activités qui demandent de l’effort. À ce propos, Lenaert et al. (2018) ont proposé que la fatigue puisse être associée à des propriétés aversives (stimulus inconditionné) et qu’en retour, ces propriétés aversives de la fatigue puissent alimenter le développement de la peur et de l’évitement (stimulus conditionné). Par exemple, un patient souffrant de fatigue persistante peut avoir développé la croyance que la fatigue est nocive pour le corps et qu’il vaut mieux éviter l’AP. D’un autre côté, l’apprentissage de la fatigue peut être lié aux précurseurs intéroceptifs – par exemple, de légères sensations somatiques – de la fatigue ou aux conséquences redoutées de la fatigue (par exemple, l’aggravation de la maladie). Ces précurseurs intéroceptifs appris peuvent susciter un comportement d’anticipation similaire, tel que l’évitement de l’activité ; fonctionnant ainsi efficacement comme des stimuli conditionnés (CS). Ces deux formes d’apprentissage de la fatigue – en tant que stimuli inconditionné et conditionné – trouvent un soutien dans un large éventail de preuves quantitatives et qualitatives. Ces apprentissages peuvent faciliter le développement d’une réticence à l’effort qu’il sera alors difficile de dépasser.
Enfin, la fatigue récurrente conduit à une modification durable de la connectivité qui rend les décisions basées sur l’effort plus difficiles à prendre. Ceci constitue un troisième facteur de risque de désengagement de l’AP. Plus précisément, la connectivité cérébrale subit des changements durables qui mettent en évidence des patterns d’activation spécifiques à la fatigue (André, Gastinger & Rébillard, 2021). Deux grands patterns d’activation de différentes régions cérébrales au cours de tâches cognitives chez des patients atteints de cancer et souffrant de fatigue chronique ont été identifiés. D’une part, des mécanismes de compensation s’observent, témoignant d’un engagement en effort plus important que chez des patients sans fatigue. D’autre part, des perturbations des processus d’attention et d’engagement peuvent être identifiées, témoignant d’une diminution de la motivation envers les tâches sollicitant l’effort. Ainsi, une fois engagés dans une tâche sollicitant de l’effort, comme l’AP, les patients devront développer un effort compensatoire pour maintenir le comportement. Cet effort compensatoire nécessite de déployer plus d’effort pour une même tâche et risque d’amener le patient à se désengager plus tôt de la tâche et donc à réduire les effets chroniques de l’AP.
En somme, la fatigue produit des comportements destinés à conserver l’énergie (e.g., la passivité, l’inactivité, le repos) et cette réticence à engager de l’effort favorise le déconditionnement. Ces comportements typiques peuvent provenir d’une altération de l’image de soi, du développement de croyances sur les risques possibles liés à la maladie, du développement de sensations négatives associées à la fatigue, ou encore d’une perte de motivation pour les activités sollicitant l’effort. Les trois processus décrits peuvent être concomitants et mener à des décisions dans lesquelles les coûts surpasseront les bénéfices (distaux). Ainsi, agir sur les bénéfices immédiats lors de la pratique d’une AP devrait permettre d’augmenter la motivation et l’engagement des patients au sein des séances afin qu’ils puissent bénéficier des effets chroniques de l’AP.
Les bénéfices immédiats : facilitateurs de l’engagement dans l’AP
Afin de faciliter la décision des patients atteints de cancer et souffrant de fatigue chronique de s’engager dans des activités exigeantes telles que l’AP et bénéficier ainsi des effets chroniques de l’AP, les interventions devraient s’orienter vers la valorisation des bénéfices immédiats et éventuellement la réduction des coûts. Cette perspective interventionnelle permettrait aux patients de s’engager pleinement au cours des séances elles-mêmes. À ce propos, Finne et al. (2018) ont réalisé une revue de la littérature destinée à identifier les techniques de changement de comportement (Behavioral Change Techniques, BCT) les plus efficaces pour augmenter l’engagement dans l’AP chez des patients atteints de cancer. Les auteurs ont mis en évidence des techniques de changement de comportement basées sur les récompenses (non spécifiques et sociales), les incitations et les tâches à niveaux de difficulté graduels, comme exprimant les effets les plus élevés sur l’engagement. Nous allons détailler ces différentes techniques et nous proposerons d’autres pistes possibles.
Les techniques de changement de comportement
Développées par Michie et al. (2008, 2013), les BCT sont définies comme des composants observables et reproductibles conçus pour modifier le comportement. Le modèle propose une taxonomie des techniques destinées à faciliter le changement de comportement. Une description des techniques identifiées comme efficaces dans le cancer permettra de mieux en comprendre l’intérêt.
Les récompenses (non spécifiques et sociales) considèrent les conséquences à valeur contingente – c’est-à-dire si et seulement si le comportement est exécuté – comme l’approbation sociale, les encouragements (pour les aspects sociaux), ou une sortie au cinéma comme récompense à l’atteinte d’un résultat (pour les aspects non spécifiques). Il est important de signaler que les récompenses sont à utiliser si et seulement si des efforts et/ou des progrès ont été observés dans l’exécution du comportement. Par exemple, des récompenses telles que des messages automatisés positifs pour les participants qui ont atteint leur objectif personnel d’exercice (Lee et al., 2013) ou qui ont réalisé des progrès (Denmark-Wahnefried et al., 2007) ont été utilisées avec succès. La récompense possède des qualités motivationnelles en incitant les personnes à rechercher le but associé à l’obtention de la récompense (Williams et al., 2011 ; French et al., 2014).
Les incitations font référence aux stimuli qui suscitent un comportement. Elles ont pour fonction de déclencher le comportement à un moment précis et pour l’atteinte d’un but. Pour cela, il est possible d’utiliser de la musique pour cadencer les différentes séquences de la séance, ou encore d’encourager les patients à associer un comportement à une sensation (chaleur, odeur, bruit, vision). Les nudges, par exemple, sont des incitations (discrètes) à réaliser des comportements plutôt que d’autres. Par exemple, quelques auteurs ont montré que les nudges pouvaient faciliter le comportement actif (Nocom et al., 2010) par l’incitation à prendre les escaliers plutôt que les escalators (Landais et al., 2020).
La technique de changement de comportement basée sur les tâches à niveaux de difficulté graduels propose de définir des tâches faciles à exécuter, en les rendant de plus en plus difficiles, mais réalisables, jusqu’à ce que le comportement soit exécuté. Par exemple, dans le cadre d’un programme de marche, proposer de commencer par marcher 100 mètres par jour pendant la première semaine, puis 500 mètres par jour, puis 1 kilomètre par jour jusqu’à l’atteinte des recommandations.
Le soutien social
La littérature montre que l’AP a des effets positifs sur le fonctionnement social en renforçant le besoin d’appartenance et en favorisant le partage d’expériences améliorant ainsi l’estime de soi (Lantheaume et al., 2017). Le soutien social peut être instrumental (ou opérationnel), c’est-à-dire centré sur la tâche. Par exemple, l’entraide, les conseils, la résolution de problème dans la réalisation des tâches en font partie. Le soutien social peut également être émotionnel lorsqu’il consiste à exprimer à une personne les affects positifs ressentis à son égard (confiance, amitié), et qu’il apporte à celle-ci des sentiments de réassurance, de protection ou de réconfort. Par exemple, les autres (enseignants d’APA ou patients du groupe) écoutent, font preuve d’empathie et donnent une rétroaction positive générale (Fischer et al., 2020). À ce propos, une revue récente de McDonough et al. (2021) a montré que les comportements de soutien social permettaient d’améliorer l’engagement dans l’AP chez les patients atteints de cancer.
Les motivations inconscientes
Les motivations inconscientes peuvent également être considérées comme des moyens d’agir sur les bénéfices immédiats. Les pensées, les comportements et les sentiments des individus ne sont pas uniquement guidés par un système conscient, réfléchi et basé sur des règles mais également par un système inconscient, impulsif et associatif (Sheeran et al., 2013). Par exemple, la contagion sociale peut constituer un levier d’engagement. Elle est définie comme : « la propagation de l’affect, de l’attitude ou du comportement de la personne A (l’initiateur) à la personne B (le bénéficiaire), où le destinataire ne perçoit pas une tentative d’influence intentionnelle de la part de l’initiateur » (Levy & Nail, 1993, 266). Les processus de motivation sont clairement englobés par cette définition, car l’émotion, l’attitude et le comportement sont des aspects significatifs de la construction de la motivation. Ainsi, la contagion sociale est souvent liée à la motivation des individus impliqués (Aarts et al., 2004). Cette perspective nécessite de développer des relations interindividuelles positives entre les intervenants, par exemple l’enseignant en activités physiques adaptées et les patients, ou entre les patients eux-mêmes dans le cadre de séances en groupe (Ng et al., 2012 ; Boss & Kleinert, 2021). Par exemple, une tâche réalisée par un modèle intrinsèquement motivé (i.e., motivation qui permette de réaliser une activité dans le but d’obtenir une satisfaction personnelle) suscitera plus d’intérêt qu’une tâche réalisée par un modèle extrinsèquement motivé (Wild et al., 1997). À ce propos, la comparaison sociale (technique identifiée au sein des BCT par Finne et collaborateurs comme étant efficace dans le cadre du cancer) doit pouvoir fournir des opportunités de contagion motivationnelle.
Les outils numériques
Les outils numériques représentent une solution intéressante pour apporter des informations de différentes natures aux patients pendant la réalisation d’une AP. Il peut s’agir de paramètres physiques (nombre de pas réalisé), physiologiques (fréquence cardiaque, dépense énergétique) ou d’informations associées à la réalisation de l’AP en cours (atteinte des objectifs, proposition de nouvelles tâches).
Dans la littérature scientifique, deux grandes tendances se dessinent. La première solution se présente généralement sous la forme d’une montre connectée disposant d’un écran pour visualiser des informations en temps réel comme le nombre de pas réalisés, le nombre de calories consommées, la fréquence cardiaque instantanée (Delrieu et al., 2022 ; Philipps et al., 2021). À titre d’exemple, le modèle de montre Withings Steel HR dispose d’une aiguille graduée de 0 à 100 % (Delrieu et al., 2022). Cette aiguille progresse quotidiennement en relation avec l’activité de marche du sujet. Celle-ci atteint la valeur de 100 % lorsque l’objectif de marche quotidien est atteint (exemple d’objectif d’un patient : 3000 pas/jour). Le patient peut ainsi suivre son activité de marche à chaque instant de la journée et il sera informé par une vibration de la montre lorsque l’objectif de marche sera atteint. Ce type de dispositif permet d’apporter un sentiment de satisfaction au patient et permet de renforcer sa motivation pour atteindre des objectifs quotidiens d’AP. Cette utilisation des outils numériques fait intervenir le circuit des récompenses identifié précédemment dans les études de Lee et al. (2013) et Denmark-Wahnefried et al. (2007).
La deuxième solution envisagée est l’association d’une montre connectée avec une intelligence artificielle permettant de guider le patient dans sa pratique d’AP au quotidien (Hassoon et al., 2021). Cette étude propose de comparer deux solutions différentes : une association de la montre Fitbit Charge HR2 avec un haut-parleur intelligent et une association de cette même montre avec un générateur de message texte intelligent. Globalement, les deux solutions apportent des résultats satisfaisants pour augmenter la quantité d’AP chez des patients atteints du cancer. De plus, l’association de la montre avec le haut-parleur intelligent semble apporter les meilleures progressions en termes d’AP. De nouvelles études sont encore à envisager pour tester cette méthode sur des populations plus larges de patients atteints de cancer. Néanmoins, les montres connectées associées à une intelligence artificielle sont capables d’identifier, de communiquer et de valider des objectifs à atteindre par les patients. L’intelligence artificielle peut également être force de proposition pour identifier des nouveaux types d’exercices, des nouvelles séances d’AP ou varier la complexité des tâches à réaliser (intensité, durée ou fréquence des exercices). Cette solution basée sur de l’intelligence artificielle peut donc être associée aux techniques de changement de comportement faisant intervenir les incitations et les tâches à niveaux de difficulté graduels.
Conclusion
L’AP est incontournable dans la prise en charge du cancer car elle engendre de multiples bienfaits physiques et psychologiques chez les patients. Toutefois, les programmes d’AP couramment proposés ne semblent pas réduire durablement la fatigue cognitive liée à la maladie. La persistance de cette fatigue contribue à diminuer la motivation des patients et constitue un frein majeur à leur engagement dans la pratique, notamment à travers une modification durable de la connectivité cérébrale, le développement d’une réticence à l’effort et un déconditionnement. Notre regard croisé sur deux modèles théoriques a souligné l’importance du recours aux bénéfices immédiats pour favoriser l’adhésion à l’AP des patients atteints de cancer et souffrant de fatigue chronique. À ce propos, la combinaison de plusieurs formes d’intervention associant les outils numériques avec les techniques de changement de comportement semble prometteuse et constitue des pistes de réflexion à explorer dans de futures études. Ils permettront aux patients atteints de cancer de maintenir une AP sur le long terme et ainsi de bénéficier des effets chroniques de la pratique.
Bibliographie
Aarts, H., Gollwitzer, P. M., & Hassin, R. R. (2004). Goal contagion: Perceiving is for pursuing. Journal of Personality and Social Psychology, 87(1), 23-37. [en ligne] https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0022-3514.87.1.23.
André, N., Gastinger, S., & Rébillard, A. (2021). Chronic fatigue in cancer, brain connectivity and reluctance to engage in physical activity: A mini-review. Frontiers in Oncology, 11, 774347. [en ligne] https://doi.org/10.3389/fonc.2021.774347.
André, N., Pillaud, M., Davoust, A., & Laurencelle, L. (2018). Barriers identification as intervention to engage breast cancer survivors in physical activity. Psychosocial Intervention, 27(1), 35-43. [en ligne] https://doi.org/10.5093/pi2018a9.
André, N., & Baumeister, R. F. (2023). Three pathways into chronic lack of energy as a mental health complaint. European Journal of Health Psychology, 30(2), 87-101. [en ligne] https://psycnet.apa.org/doi/10.1027/2512-8442/a000123.
Audiffren, M., & André, N. (2015). The strength model of self-control revisited: linking acute and chronic effects of exercise on executive functions. Journal of Sport and Health Science, 4(1), 30-46. [en ligne] https://doi.org/10.1016/j.jshs.2014.09.002.
Blaney, J. M., Lowe, S. A., Rankin, W. J., Campbell, A., & Gracey, J. H. (2013). Cancer survivors’ exercise barriers, facilitators and preferences in the context of fatigue, quality of life and physical activity participation: A questionnaire–survey. Psycho-Oncology, 22(1), 186-194. [en ligne] https://doi.org/10.1002/pon.2072.
Bootsma, T. I., Schellekens, M. P. J., van Woezik, R. A. M., van der Lee, M. L., & Slatman, J. (2020). Experiencing and responding to chronic cancer-related fatigue: A meta-ethnography of qualitative research. Psycho-Oncology, 29(2), 1-10. [en ligne] https://doi.org/10.1002/pon.5213.
Boss, M., & Kleinert, J. (2021). Motivational contagion during exercise and the role of interpersonal relationships: An experimental study. PsyCh Journal, 10(1), 128-140. [en ligne] https://doi.org/10.1002/pchj.398.
Bower J. E. (2014). Cancer-related fatigue–mechanisms, risk factors, and treatments. Nature reviews. Clinical oncology, 11(10), 597-609. [en ligne] https://doi.org/10.1038/nrclinonc.2014.127.
Chaudhuri, A., & Behan, P. O. (2000). Fatigue and basal ganglia. Journal of Neurological Science, 179(S 1-2), 34-42. [en ligne] https://doi.org/10.1016/s0022-510x(00)00411-1.
Clark, M. M., Novotny, P. J., Patten, C. A., Rausch, S. M., Garces, Y. I., Jatoi, A., Sloan, J. A., & Yang, P. (2008). Motivational readiness for physical activity and quality of life in long-term lung cancer survivors. Lung cancer (Amsterdam, Netherlands), 61(1), 117-122. [en ligne] https://doi.org/10.1016/j.lungcan.2007.12.012.
Cormie, P., Atkinson, M., Bucci, L., Cust, A., Eakin, E., Hayes, S., McCarthy, S., Murnane, A., Patchell, S., & Adams, D. (2018). Clinical Oncology Society of Australia position statement on exercise in cancer care. Medical Journal of Australia, 209(4), 184-187. [en ligne] https://doi.org/10.5694/mja18.00199.
Courneya, K. S., Friedenreich, C. M., Quinney, H. A., Fields, A. L., Jones, L. W., Vallance, J. K., & Fairey, A. S. (2005). A longitudinal study of exercise barriers in colorectal cancer survivors participating in a randomized controlled trial. Annals of Behavioral Medicine: a publication of the Society of Behavioral Medicine, 29(2), 147-153. [En ligne ] https://doi.org/10.1207/s15324796abm2902_9.
Delrieu, L., Hamy, A.-S., Coussy, F., Kassara, A., Asselain, B., Antero, J., et al. (2022). Digital phenotyping in young breast cancer patients treated with neoadjuvant chemotherapy (the NeoFit Trial): Protocol for a national, multicenter single-arm trial. BMC Cancer, 22(1), 493. [en ligne] https://doi.org/10.1186/s12885-022-09608-y.
Demark-Wahnefried, W., Clipp, E. C., McBride, C., Lobach, D. F., Lipkus, I., Peterson, B., et al. (2003). Design of FRESH START: a randomized trial of exercise and diet among cancer survivors. Medicine and Science in Sports and Exercise, 35(3), 415-424. [En ligne ] https://doi.org/10.1249/01.MSS.0000053704.28156.0F.
Finne, E., Glausch, M., Exner, A.-K., Sauzet, O., Stölzel, F., & Seidel, N. (2018). Behavior change techniques for increasing physical activity in cancer survivors: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Cancer Management and Research, 10, 5125-5143. [en ligne] https://doi.org/10.2147/CMAR.S170064.
Fischer, G., Tarquinio, C., & Dodeler, V. (2020). Soutien social, santé et maladie, dans G. Fischer, C. Tarquinio & V. Dodeler (dir.), Les bases de la psychologie de la santé. Concepts, applications et perspectives (p. 173-200). Dunod. [en ligne] https://doi.org/10.3917/dunod.fisch.2020.02.0173.
French, D. P., Olander, E. K., Chisholm, A., & Mc Sharry, J. (2014). Which behaviour change techniques are most effective at increasing older adults’ self-efficacy and physical activity behaviour? A systematic review. Annals of Behavioral Medicine, 48(2), 225-234. [en ligne] https://doi.org/10.1007/s12160-014-9593-z.
Hassoon, A., Baig, Y., Naiman, D. Q., Celentano, D. D., Lansey, D., Stearns, V., et al. (2021). Randomized trial of two artificial intelligence coaching interventions to increase physical activity in cancer survivors. NPJ Digital Medicine, 4(1), 168. [en ligne] https://doi.org/10.1038/s41746-021-00539-9.
Hu, Q., & Zhao, D. (2020). Effects of resistance exercise on complications, cancer-related fatigue and quality of life in nasopharyngeal carcinoma patients undergoing chemoradiotherapy: A randomised controlled trial. European Journal of Cancer Care, 30(1), e13355. [en ligne] https://doi.org/10.1111/ecc.13355.
Inserm (dir.). (2008). Activité physique Activité physique : contextes et effets sur la santé. Collection Expertise collective. Paris : Les éditions Inserm, XII-811 p. [en ligne] http://hdl.handle.net/10608/97.
Inserm (dir.). (2019). Activité physique : Prévention et traitement des maladies chroniques. Collection Expertise collective. Montrouge : EDP Sciences, XVI-805 p. [en ligne] http://hdl.handle.net/10608/9690.
Bénéfices de l’activité physique pendant et après cancer. Des connaissances scientifiques aux repères pratiques. Synthèse, collection Etat des lieux et des connaissances, INCa, Mars 2017.
Jong, M. C., Boers, I., Schouten van der Velden, A. P., van der Meij, S., Göker, E. Timmer-Bonte, A. N. J. H., et al. (2018). A randomized study of yoga for fatigue and quality of life in women with breast cancer undergoing (Neo) adjuvant chemotherapy. The Journal of Alternative and Complementary Medicine (New York, N.Y.), 24(9-10), 942-953. [en ligne] https://doi.org/10.1089/acm.2018.0191.
Kampshoff, C. S., Chinapaw, M. J. M., Brug, J., Twisk, J. W. R., Schep, G., Nijziel, M. R., van Mechelen, W., & Buffart, L. M. (2015). Randomized controlled trial of the effects of high intensity and low-to-moderate intensity exercise on physical fitness and fatigue in cancer survivors: Results of the resistance and endurance exercise after chemoTherapy (REACT) study. BMC Medicine, 13, 275. [en ligne] https://doi.org/10.1186/s12916-015-0513-2.
Kelley, G. A., & Kelley, K. S. (2017). Exercise and cancer-related fatigue in adults: a systematic review of previous systematic reviews with meta-analyses. BMC Cancer, 17(1), 693. [en ligne] https://doi.org/10.1186/s12885-017-3687-5.
Landais, L.L., Damman, O. C., Schoonmade, L. J., Timmermans, D. R. M., Verhagen, E. A. L. M., & Jelsma, J. G. M. (2020). Choice architecture interventions to change physical activity and sedentary behavior: a systematic review of effects on intention, behavior and health outcomes during and after intervention. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 17(1), 47. [en ligne] https://doi.org/10.1186/s12966-020-00942-7.
Lantheaume, S., Fabre, F., Fisch, C., Motak, L., Massol, P., Lantheaume, S. et al. (2017). Cancer du sein, activité physique adaptée et qualité de vie. Annales médico-psychologiques, 175, 841-848. [en ligne] http://dx.doi.org/10.1016/j.amp.2016.03.016.
Lee, M. K., Park, H.-A., Yun, Y. H., & Chang, Y. J. (2013). Development and Formative evaluation of a web-based self-management exercise and diet intervention program with tailored motivation and action planning for cancer survivors. JMIR Research Protocols, 2(1), e11. [en ligne] https://doi.org/10.2196/resprot.2331.
Lee, W. S., & Carlson, S. M. (2015). Knowing when to be “rational”: flexible economic decision making and executive function in preschool children. Child Development, 86(5), 1434-1448.
Lee, H. H., Emerson, J. A., & Williams, D. M. (2016). The exercise–affect–adherence pathway: An evolutionary perspective. Frontiers in Psychology, 7, 1285. [en ligne] https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.01285.
Lenaert, B., Boddez, Y., Vlaeyen, J. W. S., & van Heugten, C. M. (2018). Learning to feel tired: A learning trajectory towards chronic fatigue. Behaviour Research and Therapy, 100, 54-66. [en ligne] https://doi.org/10.1016/j.brat.2017.11.004.
Levy, D. A., & Nail, P. R. (1993). Contagion: A theoretical and empirical review and reconceptualization. Genetic, Social, and General Psychology Monographs, 119(2), 233-284.
Deutsch Lezak, M., Howieson, D. B., Bigler, E. D., & Tranel, D. (2012). Neuropsychological assessment. New York: Oxford University Press.
Martin Ginis, K. A., & Bray, S. R. (2010). Application of the limited strength model of self-regulation to understanding exercise effort, planning and adherence. Psychology & Health, 25(10), 1147-1160. [en ligne] https://doi.org/10.1080/08870440903111696.
McDonough, M. H. L., Beselt, J., Kronlund, L. J., Albinati, N. K., Daun, J. T., Trudeau, M. S., et al. (2021). Social support and physical activity for cancer survivors: a qualitative review and meta-study. Journal of Cancer Survivorship, 15(5), 713-728. [en ligne] https://doi.org/10.1007/s11764-020-00963-y.
Michie, S., Richardson, M., Johnston, M., Abraham, C., Francis, J., Hardeman, W., et al. (2013). The behavior change technique taxonomy (v1) of 93 hierarchically clustered techniques: Building an international consensus for the reporting of behavior change interventions. Annals of Behavioral Medicine: a publication of the Society of Behavioral Medicine, 46(1), 81-95. [en ligne] https://doi.org/10.1007/s12160-013-9486-6.
Michie, S., Johnston, M., Francis, J., Hardeman, W., & Eccles, M. (2008). From theory to intervention: Mapping theoretically derived behavioural determinants to behaviour change techniques. Applied Psychology: An International Review, 57(4), 660-680. [en ligne] https://doi: 10.1111/j.1464-0597.2008.00341.x.
Nadler, M., Bainbridge, D., Tomasone, J., Cheifetz, O., Juergens, R. A., & Sussman, J. (2017). Oncology care provider perspectives on exercise promotion in people with cancer: an examination of knowledge, practices, barriers, and facilitators. Support Care Cancer: official journal of the Multinational Association of Supportive Care in Cancer, 25(7), 2297-2304. [en ligne] https://doi.org/10.1007/s00520-017-3640-9.
National Comprehensive Cancer Network. Clinical Practice Guidelines in Oncology. In: Cancer-Related Fatigue Version 2 Plymouth Meeting, PA 19462. (2019). [en ligne] www.nccn.org.
Ng, J. Y. Y., Thøgersen-Ntoumani, C., & Ntoumanis, N. (2012). Motivation contagion when instructing obese individuals: A test in exercise settings. Journal of Sport & Exercise Psychology, 34(4), 525-538. https://doi.org/10.1123/jsep.34.4.525.
Nocon, M., Müller- Riemenschneider, F., Nitzschke, K., & Willich, S. N. (2010). Increasing physical activity with point-of- choice prompts—a systematic review. Scandinavian Journal of Public Health, 38(6), 633-638. https://doi.org/10.1177/1403494810375865.
O’Higgins, C. M., Brady, B., O’Connor, B., Walsh, D., & Reilly, R. B. (2018). The pathophysiology of cancer-related fatigue: current controversies. Supportive Care in Cancer, 26(10), 3353–3364. [en ligne] https://doi.org/10.1007/s00520-018-4318-7.
Ormel, H. L., van der Schoot, G. G. F., Sluiter, W. J., Jalving, M., Gietema, J. A., & Walenkamp, A. M. E. (2018). Predictors of adherence to exercise interventions during and after cancer treatment: A systematic review. Psycho-Oncology, 27(3), 713-724. [en ligne] https://doi.org/10.1002/pon.4612.
Phillips, S., Solk, P., Welch, W., Auster-Gussman, L., Lu, M., Cullather, E., et al. (2021). A technology-based physical activity intervention for patients with metastatic breast cancer (Fit2ThriveMB): Protocol for a randomized controlled trial. JMIR Research Protocols, 10(4), e24254. [en ligne] https://doi.org/10.2196/24254.
Rogers, L. Q., Courneya, K. S., Shah, P., Dunnington, G., & Hopkins-price, P. (2007). Exercise stage of change, barriers, expectations, values and preferences among breast cancer patients during treatment: A pilot study. European Journal of Cancer Care, 16(1), 55-66. [en ligne] https://doi.org/10.1111/j.1365-2354.2006.00705.x.
Schnitzspahn, K. M., Stahl, C., Zeintl, M., Kaller, C. P., & Kliegel, M. (2013). The role of shifting, updating, and inhibition in prospective memory performance in young and older adults. Developmental Psychology, 49(8), 1544-1553. [en ligne] https://doi.org/10.1037/a0030579.
Sheill, G., Guinan, E., Brady, L., Hevey, D., Hussey, J. (2019). Exercise interventions for patients with advanced cancer: A systematic review of recruitment, attrition, and exercise adherence rates. Palliative & Supportive Care, 17(6), 686-696. [en ligne] https://doi.org/10.1017/S1478951519000312.
Sheeran, P., Gollwitzer, P. M., & Bargh, J. A. (2013). Nonconscious processes and health. Health Psychology: official journal of the Division of Health Psychology, American Psychological Association, 32(5), 460-473. [en ligne] https://doi.org/10.1037/a0029203.
Smets, E. M., Visser, M. R., Willems-Groot, A. F., Garssen, B., Schuster-Uitterhoeve, A. L., & de Haes, J. C. (1998). Fatigue and radiotherapy: (B) experience in patients 9 months following treatment. British Journal of Cancer, 78(7), 907-912. [en ligne] https://doi.org/10.1038/bjc.1998.600.
Stan, D. L., Croghan, K. A., Croghan, I. T., Jenkins, S. M., Sutherland, S. J., Cheville, A. L., & Pruthi, S. (2016). Randomized pilot trial of yoga versus strengthening exercises in breast cancer survivors with cancer-related fatigue. Supportive Care in Cancer: official journal of the Multinational Association of Supportive Care in Cancer, 24(9), 4005-4015. [en ligne] https://doi.org/10.1007/s00520-016-3233-z.
Thong, M., van Noorden, C. J. F., Steindorf, K., & Arndt, V. (2020). Cancer-related fatigue: Causes and current treatment options. Current Treatment Options in Oncology, 21(2), 17. [en ligne] https://doi.org/10.1007/s11864-020-0707-5.
Torres, D. M., Jorge Koifman, R., & da Silva Santos, S. (2022). Impact on fatigue of different types of physical exercise during adjuvant chemotherapy and radiotherapy in breast cancer: systematic review and meta-analysis. Supportive Care in Cancer: official journal of the Multinational Association of Supportive Care in Cancer, 30(6), 4651-4662. [en ligne] https://doi.org/10.1007/s00520-022-06809-w.
Travier, N., Velthuis, M. J., Steins Bisschop, C. N., van den Buijs, B., Monninkhof, E. M., Backx, F., et al. (2015). Effects of an 18-week exercise programme started early during breast cancer treatment: A randomised controlled trial. BMC Medicine, 13, 121. [en ligne] https://doi.org/10.1186/s12916-015-0362-z.
Treadway, M. T., & Zald, D. H. (2011). Reconsidering anhedonia in depression: lessons from translational neuroscience. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 35(3), 537-555. [en ligne] https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2010.06.006.
Turner, R. R., Steed, L., Quirk, H., Greasley, R. U., Saxton, J. M., Taylor, S. J., et al. (2018). Interventions for promoting habitual exercise in people living with and beyond cancer. The Cochrane Database of Systematic Reviews, 9(9), CD010192. [en ligne] https://doi.org/10.1002/14651858.CD010192.pub3.
Van Vulpen, J. K., Sweegers, M. G., Peeters, P. H. M., Courneya, K. S., Newton, R. U., Aaronson, N. K., et al. (2020). Moderators of exercise effects on cancer-related fatigue: A meta-analysis of individual patient data. Medicine and Science in Sports Exercise, 52(2), 303-314. [en ligne] https://doi.org/10.1249/MSS.0000000000002154.
Van Waart, H., Stuiver, M. M., van Harten, W. H., Geleijn, E., Kieffer, J. M., Buffart, L. M., et al. (2015). Effect of low intensity physical activity and moderate- to high intensity physical exercise during adjuvant chemotherapy on physical fitness, fatigue, and chemotherapy completion rates: Results of the paces randomized clinical trial. Journal of Clinical Oncology: official journal of the American Society of Clinical Oncology, 33(17), 1918-1927. [en ligne] https://doi.org/10.1200/JCO.2014.59.1081.
Wild, C. T., Enzle, M. E., Nix, G., & Deci, E. L. (1997). Perceiving others as intrinsically or extrinsically motivated: Effects on expectancy formation and task engagement. Personality and Social Psychology Bulletin, 23(8), 837-848. [en ligne] https://doi.org/10.1177/0146167297238005.
Williams, S., & French, D. (2011). What are the most effective intervention techniques for changing physical activity self-efficacy and physical activity behaviour–and are they the same? Health Education Research, 26(2), 308-322. [en ligne] https://doi.org/10.1093/her/cyr005.
Witlox, L., Hiensch, A. E., Velthuis, M. J., Steins Bisschop, C. N., Los, M., Erdkamp, F. L. G., et al. (2018). Four-year effects of exercise on fatigue and physical activity in patients with cancer. BMC Medicine, 16(1), 86. [en ligne] https://doi.org/10.1186/s12916-018-1075-x.
Zhang, L.-L., Wang, S.-Z., Chen, H.-L., & Yuan, A.-Z. (2016). Tai chi exercise for cancer-related fatigue in patients with lung cancer undergoing chemotherapy: a randomized controlled trial. Journal of Pain and Symptom Management, 51(3), 504-511. [en ligne] https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2015.11.020.
Zhou, W., Wan, Y.-H., Chen, Q., Qiu, Y.-R., & Luo, X.-M. (2018). Effects of tai chi exercise on cancer-related fatigue in patients with nasopharyngeal carcinoma undergoing chemoradiotherapy: a randomized controlled trial. Journal of Pain and Symptom Management, 55(3), 737-744. [en ligne] https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2017.10.021.
La vie cinq ans après un diagnostic de cancer – Rapport VICAN5 – Ref : ETUDVIEK518. [en ligne]https://www.e-cancer.fr/Expertises-et-publications/Catalogue-des-publications/La-vie-cinq-ans-apres-un-diagnostic-de-cancer-Rapport.
Notes
- Il s’agit, par exemple, de la stimulation du transport du glucose, de l’augmentation du calibre vasculaire, de l’augmentation de la dopamine cérébrale, de la libération de myokines ou encore de l’amélioration de l’humeur.
- L’inventaire multidimensionnel de la fatigue est le questionnaire le plus utilisé dans la recherche liant le cancer, l’AP et la fatigue.
- Carcinome nasopharyngé, cancer du sein, cancer du poumon, cancer du côlon, cancer de l’ovaire, cancer des testicules, les lymphomes.