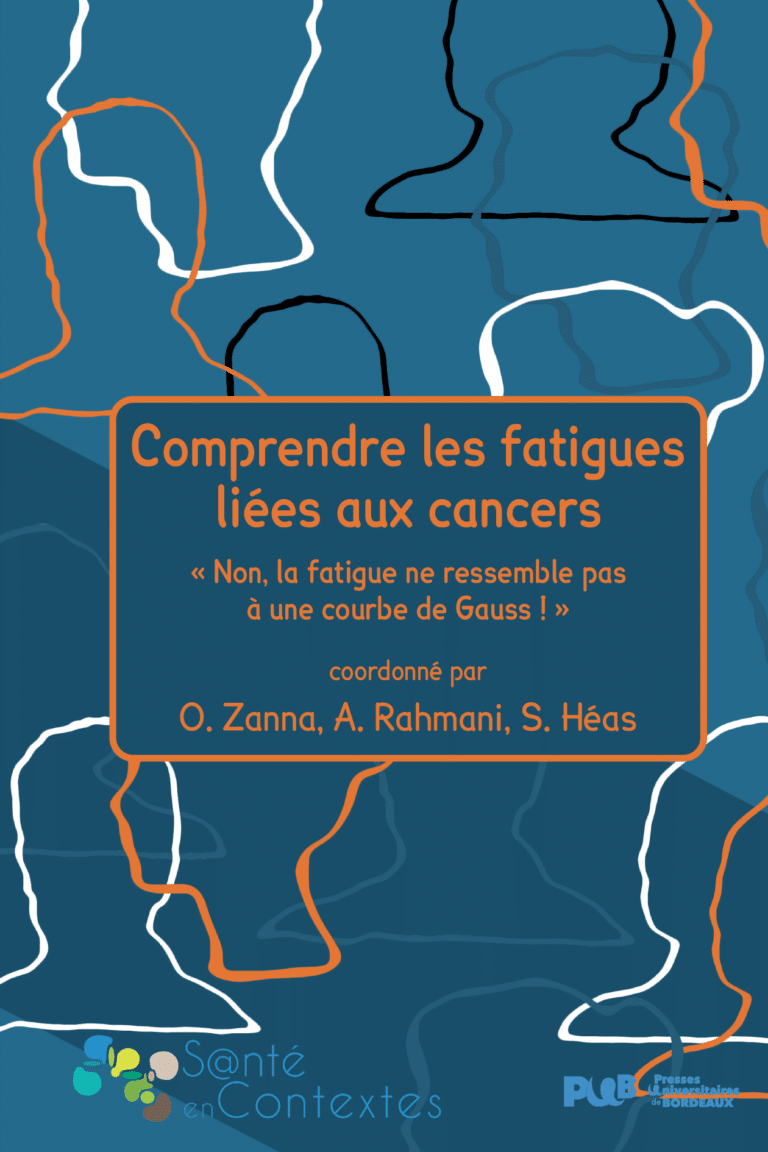Interlude N° 2
Sylviane (64 ans) est suivie pour un cancer du sein depuis six mois. Entretien réalisé le 10 avril 2019 à la Maison du Patient
S : Oui je m’impose des choses. Parce que c’est nécessaire, sinon on a tendance à trop penser à la maladie, et puis la fatigue, ce n’est pas une fatigue qui est forcément habituelle, ce n’est pas une fa- tigue qui donne envie de dormir, c’est une espèce de relâchement du corps, qu’on ne maîtrise pas. C’est une espèce de… C’est assez débilitant comme sentiment, je pense, enfin moi j’étais quelqu’un de très dynamique, qui faisait beaucoup de choses, et cette fatigue-là elle est… Comment dire… Humiliante un peu, quand on avait l’habitude d’être tout le temps debout, d’être quelqu’un de fort, donc il faut se forcer en fait. Il faut s’obliger. Il y a une bonne part de dimension psychique, il faut être clair dans sa tête, mais il faut s’imposer ces choses-là, pour rester debout, pour ne pas aussi imposer à son conjoint d’être toujours complètement raplapla… J’ai des petits fils qui vivent en Afrique, je les vois tous les jours par internet, voilà, il faut qu’ils voient leur grand-mère active, comme ils me connaissent quoi. C’est très très important ça aussi, pour ce que l’on montre aux autres.
La fatigue liée au cancer (FLC) est par définition une sensation de fatigue inhabituelle aux conséquences importantes sur la vie des individus, jusqu’à en altérer significativement la qualité de vie. (Barsevick et al., 2010). D’après le National Comprehensive Cancer Network, la FLC ressort comme l’un des effets secondaires les plus répandus et les plus éprouvants associés au cancer et à ses traitements (Berger et al., 2015). Sa prévalence est fortement variable, oscillant entre 25 % et 99 % des patients en traitement ou en rémission. Elle dépend de différents paramètres tels que les caractéristiques individuelles du patient, le type de cancer, ou encore le traitement spécifique appliqué (Spichiger et al., 2012 ; Weis, 2011). De manière préoccupante, il est à noter que la FLC persiste chez environ un tiers des patients, même après plusieurs mois, voire des années de rémission (Mitchell, 2010). Cette persistance a de profondes répercussions sur leur qualité de vie et peut également influer négativement leurs chances de survie (Bower, 2014). Si les effets de la FLC sont aussi déterminants pour le patient, pourquoi sont-ils alors aussi souvent sous-estimés par les patients eux-mêmes et insuffisamment pris en compte par les professionnels de santé ? Il nous semble que ce manque de prise en charge est, en partie, lié à son aspect multifactoriel, c’est-à-dire que ses déterminants peuvent être variés et nombreux (Saligan et al., 2015) mais également différents entre les individus.
C’est donc pour éclairer cette complexité et à dessein mettre à jour l’intérêt de prendre en considération la FLC dans tous les parcours de soin que nous avons rédigé ce texte. Pour ce faire, dans ce chapitre, nous aborderons dans une première partie les différents déterminants possibles de la FLC. Seront respectivement abordés les déterminants physiques, cognitifs, émotionnels, mais également ceux liées au sommeil, à la biologie ou bien encore aux caractéristiques sociologiques des patients. La perspective est alors d’améliorer la qualité de vie des patients par l’entremise d’une prise en charge adaptée et, autant que faire se peut, efficiente. Afin d’adapter une prise en charge au plus près des besoins et attentes des patients, la seconde partie abordera l’hétérogénéité, la variabilité intra- et inter-individuelle de la FLC.
Les déterminants de la fatigue liée au cancer
La FLC est une problématique complexe et multidimensionnelle qui affecte significativement la qualité de vie des patients. Bien au-delà de la simple sensation de fatigue physique, elle est influencée par une multitude de facteurs interconnectés, incluant les aspects physiologiques, psychologiques, sociaux et environnementaux. Comprendre ces déterminants multidimensionnels est essentiel pour développer des approches de prise en charge complémentaires et efficaces, visant à atténuer cette fatigue débilitante et à améliorer le bien-être des patients atteints de cancer.
Les déterminants physiques de la FLC
Les signes physiques de la FLC sont généralement caractérisés par une baisse notable de l’énergie, un ralentissement des rythmes habituels, une sensation globale de fatigue, ainsi qu’un désir accru de sommeil ou de repos (Curt et al., 2000). Comme nous allons le voir, plusieurs déterminants physiques sont souvent associés à l’émergence de la FLC et à son évolution.
La première porte sur l’indice de masse corporelle (IMC). Celui-ci permet d’estimer la corpulence d’une personne à partir de sa masse et de sa taille (masse [kg] / taille [cm²]). Son augmentation constitue un des prédicteurs de la FLC. En effet, des recherches ont établi une corrélation entre l’obésité et la FLC (Andrykowski et al., 2010 ; Bower, 2014 ; Donovan et al., 2007 ; Inglis et al., 2021). Une étude multicentrique récente souligne même le rôle prédictif d’un IMC élevé dans l’apparition et la persistance de la FLC (Di Meglio et al., 2022) dès le diagnostic du cancer. Ce lien a également été observé chez des patientes en rémission suite à un cancer du sein ; lien qui a tendance à persister longtemps après les traitements (Andrykowski et al., 2010 ; Reinertsen et al., 2010).
Le deuxième déterminant correspond à la cachexie cancéreuse caractérisée par une perte de poids involontaire, accompagnée d’une fonte musculaire et d’une altération de la fonction physique. Elle est également corrélée à la FLC (Fearon et al., 2011). En diminuant la fonction musculaire et les performances physiques, la sarcopénie, qui se réfère à une perte de masse musculaire et de force associée au cancer, représente une phase avancée de cette dégradation physique et a des effets sur la FLC (Cohen et al., 2015 ; Kim & Choi, 2013). C’est la raison pour laquelle la sarcopénie doit être prise en compte dans le processus de prise en charge de la FLC (Wang et al., 2020).
Les phénomènes d’inflammations, liés au cancer et à ses traitements, et de cachexie cancéreuse (Argilés et al., 2009 ; Roberts et al., 2013), entraînent une diminution significative de la capacité à produire une force maximale ou à maintenir un niveau de force au cours d’un exercice. Ainsi, la fatigabilité neuromusculaire est augmentée par ce phénomène. Une plus grande fatigabilité entraine une augmentation des niveaux et des fréquences de fatigue neuromusculaire au cours des efforts quotidiens et pourrait expliquer le lien que la fatigabilité aiguë entretient avec la sensation de fatigue chronique. De ces constats, des recherches ont été réalisées afin de mieux appréhender les liens entre la fatigabilité neuromusculaire au cours de l’exercice et la FLC. Yavuzsen et al. (2009) ont, par exemple, comparé les origines de la fatigabilité neuromusculaire des patients atteints d’un cancer avancé après les traitements souffrant de FLC à des individus en bonne santé, en utilisant la technique de stimulation surimposée à une contraction maximale volontaire (CMV) et de stimulation d’un muscle relâché. L’exercice de fatigabilité consistait à maintenir une flexion du coude à 30 % de leur CMV jusqu’à l’épuisement. Leurs résultats ont montré des temps de maintien chez les patients en moyenne 3,5 min plus courts que pour les participants en bonne santé. De plus, juste avant l’arrêt de l’exercice, les patients fatigués avaient une capacité réduite à recruter volontairement les unités motrices permettant de soutenir l’exercice (celle-ci est représentée par la stimulation surimposée à une CMV). Cela témoigne d’une plus grande fatigue centrale chez les patients. Autrement dit, à l’épuisement, la baisse de la capacité de production de force provenait plus d’une incapacité du système nerveux central à recruter les unités motrices qu’à conduire le signal électrique jusqu’au muscle. Le dysfonctionnement de la jonction neuromusculaire (JNM) pourrait également partiellement expliquer les différences de fatigue musculaire entre les deux groupes de cette étude en ce sens que les signaux centraux seraient inefficacement transmis à travers la JNM. Une diminution de la conduction de la JNM a également été rapportée chez les patients atteints de cancer de la prostate souffrant de FLC pendant la radiothérapie (Monga et al., 1997). Dans une autre étude, les patients souffrant de FLC avaient, cette fois-ci, du mal à maintenir une force de préhension maximale au fil du temps (Feng et al., 2019). Cependant, cette deuxième étude a montré une force de préhension maximale similaire avant un exercice fatigant entre des patients fatigués et non fatigués. Il semblerait donc que la diminution de la perte de capacité maximale puisse être plutôt liée à la pathologie et à ses traitements, alors que la FLC pourrait jouer un rôle sur l’endurance du patient. Une autre étude a évalué la fatigabilité neuromusculaire des fléchisseurs du coude chez des patients FLC lors de contraction isométrique mais cette fois-ci avec un exercice fatigant intermittent qui consistait à répéter des contractions à 40 % de CMV (5 secondes de contraction, 2 secondes de repos) jusqu’à épuisement (Cai et al., 2014). Les auteurs ont rapporté un nombre d’essais moins important chez les patients ressentant une FLC que chez leurs homologues en bonne santé (Cai et al., 2014). Comme dans le cas des études précédentes, la FLC semble jouer un rôle sur l’endurance du patient, qui se fatigue plus rapidement. Tous ces résultats suggèrent que les patients atteints de FLC rencontrent davantage de difficultés et de plus grands défis dans l’exécution de tâches quotidiennes, comme transporter des sacs de courses, monter des escaliers, faire le ménage, préparer des repas… Cela souligne l’importance d’atténuer la FLC par une prise en charge adaptée, notamment en activités physiques (Cai et al., 2014). À noter qu’une faible capacité de maintien des efforts pourrait conduire les patients à réduire l’intensité de leurs activités physiques spontanées pour ne pas dépasser un seuil induisant une sensation d’inconfort les entrainant ainsi dans la spirale du déconditionnement neuromusculaire (Jones et al., 2009).
Il est également reconnu que le cancer et/ou ses traitements provoquent une dérégulation de certains systèmes physiologiques et biochimiques telle qu’une augmentation des taux de sérotonine dans le cerveau (Andrews & Hickok, 2004). Des études rapportent une réponse réduite au cortisol chez les survivants du cancer présentant une FLC persistante (Bower et al., 2005 ; Bower et al., 2002). Ces résultats peuvent, en partie, expliquer pourquoi les patients atteints de FLC présentent une fatigabilité plus centrale (altération progressive de la capacité du système nerveux central à activer de manière volontaire le muscle sollicité lors d’une tâche ou à conduire la commande motrice) que périphérique (altération de la transmission neuromusculaire, de la propagation du potentiel d’action musculaire, et du couplage excitation-contraction et des mécanismes contractiles associés ) (Kisiel-Sajewicz et al., 2012 ; Yavuzsen et al., 2009).
Cependant, il est également plausible que la relation de cause à effet puisse être inverse. Par exemple, le catastrophisme (réaction psychologique intense et négative où le patient perçoit le diagnostic comme une catastrophe imminente) associé à la FLC peut induire un comportement inactif ou sédentaire, qui, à son tour, entraînerait un déconditionnement cardiorespiratoire et neuromusculaire et conduirait ainsi à une plus grande fatigabilité neuromusculaire (Jacobsen et al, 2004). Une étude réalisée sur la population américaine a révélé que 70 % des patients atteints de cancer étaient en dessous des recommandations nationales en matière d’exercices (Blanchard et al., 2008). Le déconditionnement physique rend les tâches ménagères, les distances de marche, les activités sociales plus ardues (Curt et al., 2000), contribuant ainsi potentiellement au développement et à la persistance de la FLC. De nombreuses études longitudinales ont ainsi montré qu’un niveau d’activité physique plus faible après la fin du traitement prédisaient une FLC persistante chez les survivantes du cancer du sein. Il est toutefois à noter qu’une FLC élevée avant et pendant les traitements ait possiblement pu entraîner une réduction considérable des activités physiques (Bower, 2014). Ainsi, la réduction de l’activité physique liée au cancer et à ses traitements persiste parfois longtemps après la rémission. Dans de tels cas, cela peut considérablement modifier la perception de la fatigue à mesure qu’elle devient chronique. Finalement, les patients s’habituent à la FLC et s’en accommodent. C’est pourquoi, au fur à et mesure, des mois après l’arrêt des traitements, les patientes se plaignent de moins en moins de FLC, car la fatigue est devenue une habitude qui est ressentie comme une expérience normale (Dimeo et al., 1997).
En résumé, cette partie met en évidence les déterminants physiques intervenant dans la FLC, notamment l’IMC élevé, la masse musculaire réduite, la fatigabilité neuromusculaire et les comportements de sédentarité. Comprendre ces éléments est essentiel pour accompagner au mieux la FLC des patients atteints de cancer. Si les déterminants physiques entrent en ligne de compte dans l’expérience de la FLC, les aspects cognitifs jouent également un rôle crucial en ce sens où lorsqu’ils sont associés, ils influencent la sévérité et la persistance de la FLC.
Les déterminants cognitifs de la FLC
Après un diagnostic de cancer, la capacité à faire face au stress peut être affectée en raison des nombreuses exigences auxquelles les patients doivent faire face, entraînant une surutilisation de la capacité d’attention directe, nécessaire pour résoudre les problèmes, effectuer les tâches de la vie quotidienne et gérer la fatigue. Lorsqu’une personne est confrontée à des demandes physiques et psychologiques intenses, elle répond par des stratégies comportementales et cognitives appelées coping en anglais. On peut traduire cela, en français, par : « la capacité à faire face ou s’adapter » (Nicchi & Le Scanff, 2005).
Pour évaluer la relation entre la FLC et les stratégies de coping, les chercheurs utilisent régulièrement le Brief COPE. Il s’agit là d’un questionnaire (Carver, 1997) qui comporte 28 items cotés par une échelle de type Likert (appelée aussi « échelle de satisfaction ») à quatre degrés allant de 1 (pas du tout) à 4 (toujours) (Muller & Spitz, 2003). Ce questionnaire a l’avantage d’être un bref inventaire permettant d’appréhender de nombreuses stratégies de coping subdivisées en 14 sous-échelles distinctes :
- Le coping actif, processus par lequel l’individu essaie de supprimer le stresseur ou de minimiser ses effets ;
- La planification, qui est le fait de réfléchir à l’organisation d’un plan, aux étapes à suivre et à la meilleure manière de gérer le problème ;
- La recherche de soutien social instrumental, correspondant à la recherche de conseil, d’assistance ou/et d’informations ;
- La recherche de soutien social émotionnel, qui s’appuie sur le soutien moral, la sympathie ou encore la compréhension ;
- L’expression des sentiments, définie comme la tendance à se centrer sur sa détresse émotionnelle et à évacuer ses sentiments ;
- Le désengagement comportemental, soit la réduction des efforts d’une personne pour faire face au stresseur, à l’abandon de toute tentative d’atteindre les buts sur lesquels celui-ci interfère ;
- La distraction, qui détourne la personne des pensées se rapportant à la situation de stress ou au but avec lequel le stresseur interfère ;
- Le blâme, au cours duquel la personne se fait des reproches ;
- La réinterprétation positive qui incite l’individu à gérer sa détresse émotionnelle plutôt que de combattre le stresseur ;
- L’humour, qui permet de ne pas prendre au sérieux la situation afin d’éviter d’être submergé par les émotions ;
- Le déni ou le refus de croire que le stresseur existe ou comme la tentative d’agir en pensant que le stresseur n’est pas réel ;
- L’acceptation d’une situation stressante, la capacité à s’engager dans une lutte contre celle-ci;
- La tendance à se tourner vers la religion dans les périodes de stress ;
- L’utilisation de substances permettant à la personne de s’évader, d’échapper à la réalité, d’éviter d’être confrontée à la situation (consommation d’alcool, de médicaments ou de drogue).
Kangas et al. (2002) ont passé en revue 13 études après la rémission d’un cancer. Ils ont ainsi pu rapporter que 5 à 19 % des patients répondaient à tous les critères du trouble de stress post-traumatique (TSPT) (Kangas et al., 2002). Des associations entre les TSPT et les symptômes de FLC ont déjà été observées chez les survivants du cancer (Shim et al., 2022). Il semblerait alors que des stratégies de coping centrées sur la résolution du problème telles que le coping actif, la planification, l’acceptation, la réinterprétation positive et l’humour pourraient réduire le TSPT et agir sur la diminution de la FLC. A contrario, les stratégies de coping comme le désengagement comportemental, le blâme, le déni, la religion, l’utilisation de substances, la recherche de soutien instrumental et émotionnel augmenteraient le niveau de stress chez les patients et donc favoriseraient une augmentation de la FLC. Il nous semble alors nécessaire de travailler avec les patients sur les stratégies de coping mises en place, que ce soit dès l’annonce du diagnostic ou au cours du parcours de soins pour agir sur tous les niveaux de TSPT et de FLC.
En outre, le stress que peut provoquer l’annonce d’un cancer chez une personne, d’autres perturbations cognitives sont à considérer. La diminution des capacités cognitives liée au cancer est un problème important et répandu chez les patients atteints d’un cancer colorectal, du sein, ou de la prostate. Il induit des problèmes de mémoire de travail, de perturbations des fonctions exécutives, d’attention, de vitesse de traitement des informations complexes et d’efficacité d’apprentissage (Ahles et al., 2010 ; Feng et al., 2018 ; Janelsins et al., 2014 ; Vardy et al., 2014). Les évaluations cognitives avant la chimiothérapie suggèrent que la chirurgie et le développement du cancer lui-même peuvent également contribuer à la déficience cognitive liée au cancer. En comparant les performances des patients pendant ces moments-là à des personnes non malades et/ou à des données normatives, ces études ont révélé que jusqu’à 33 % des patients présentaient des déficits cognitifs avant la chimiothérapie. Ceux-ci intégraient des déficits dans les domaines de l’apprentissage verbal et de la mémoire, du temps de réaction (Ahles et al., 2008 ; Wefel et al., 2004), ainsi que de la fonction cognitive globale (Jansen et al., 2011). De nombreux patients éprouvent des difficultés à exercer ou à maintenir un effort mental dans des tâches qui nécessitent une attention dirigée (Cimprich, 1995). Un dysfonctionnement du cortex préfrontal et une altération de la fonction exécutive ont été observés chez des patients atteints de cancer (McDonald et al., 2013). Les capacités cognitives sont alors plus faibles avec une augmentation de la demande de ressources cognitives pour effectuer une tâche, déclenchant une fatigabilité cognitive et une fatigue cognitive (DeLuca, 2007 ; Feng et al., 2019 ; Holtzer et al., 2010).
La plupart des patients éprouvant une FLC présentent des troubles de la mémoire à court terme ou un manque de concentration suffisamment importants pour entraîner une réduction substantielle des niveaux antérieurs d’activités professionnelles, éducatives, sociales et/ou personnelles (Fukuda et al., 1994 ; Smith et al., 1993). Dans une étude évaluant la fatigabilité cognitive à l’aide d’un test de STROOP (évaluant la capacité d’inhibition), le temps de réaction aux interférences cognitives de patients atteints d’un cancer de la prostate était significativement augmenté chez les patients présentant une FLC par rapport aux patients non-fatigués. Cependant, la précision des performances n’était pas différente en fonction des deux groupes (Feng et al., 2019). Les patients atteints de FLC réussissaient la tâche mais en prenant plus de temps que la normale.
Tout bien considéré, la FLC peut être influencée par la surutilisation des capacités cognitives pour faire face au stress et aux exigences du traitement. Les symptômes de TSPT jouent un rôle dans son développement et les stratégies de coping peuvent aggraver ou diminuer les symptômes de FLC. Les patients atteints de FLC éprouvent également des déficits des fonctions cognitives tels que des troubles de la mémoire et de l’attention, qui impactent leur fonctionnement quotidien. A fortiori, la FLC aura également un impact sur leurs émotions.
Les déterminants émotionnels de la FLC
En plus des déterminants physiques et cognitifs, il est tout aussi crucial d’examiner les déterminants émotionnels. Les émotions, telles que le stress, la peur, la tristesse, l’irritabilité et la frustration, ont un impact significatif sur la perception de la FLC et sur la manière dont les patients la gèrent. En effet, beaucoup ont signalé un besoin de se pousser à faire des choses (77 %), une diminution de leur motivation ou de leur intérêt (62 %) et des sentiments de tristesse, de frustration ou d’irritabilité (53 %) au cours de leurs expériences de FLC (Curt et al., 2000). Les facteurs émotionnels semblent jouer un rôle étiologique important dans l’apparition et la persistance de la FLC chez les patientes atteintes de cancer du sein et chez les survivantes du cancer (Dhruva et al., 2010 ; Geinitz et al., 2004 ; Miaskowski et al., 2008 ; Reinertsen et al., 2010 ; Stone et al., 2001). En effet, des études ont pu relier la FLC à la dépression, à l’anxiété, à la détresse émotionnelle.
Le facteur émotionnel le plus souvent relié à la FLC reste les symptômes dépressifs (Jacobsen et al., 2003). La dépression est un trouble psychiatrique caractérisé par des sentiments persistants de tristesse, de perte d’intérêt et/ou de plaisir dans les activités, ainsi que d’autres symptômes associés (par exemple, des changements de l’appétit ou du poids, des troubles du sommeil) qui altèrent considérablement le fonctionnement quotidien (American Psychiatric Association, 2013). La dépression est un syndrome comorbide et invalidant qui touche environ 15 à 25 % des patients atteints de cancer (Henriksson et al., 1995 ; Lloyd-Williams & Friedman, 2001). Le taux de cas de dépression (score ≥ 8 à l’HADS) augmente de manière significative entre l’inclusion (8 semaines après la chirurgie : 18,5 %) et quatre mois après (21,5 %), puis diminue à 15,3 % après douze mois (Saboonchi et al., 2014). La relation entre la dépression et la FLC semble même plus importante que celle entre la FLC et l’activité de la maladie, mesurée par des marqueurs tels que l’état nutritionnel ou la gravité de la tumeur (Armes et al., 2004). De nombreuses études ont montré une association entre la FLC et la dépression dans un groupe de patients atteints de cancer et soumis à une radiothérapie ou à une chimiothérapie (Brown & Kroenke, 2009).
L’association entre ces deux symptômes est complexe. La FLC est un symptôme de la dépression, mais peut également précipiter une humeur dépressive en raison d’une interférence avec les activités sociales, professionnelles et de loisirs. Jacobsen et Weitzner (2004) ont établi trois relations causales possibles entre ces deux paramètres : i) la fatigue rend le patient atteint de cancer déprimé ; ii) les patients atteints de cancer peuvent devenir fatigués parce qu’ils sont déprimés ; iii) le cancer peut provoquer à la fois la dépression et la fatigue (Armes et al., 2004). Toutefois, nous ignorons s’il existe d’autres relations causales possibles et dans quelles mesures ces relations s’appliquent dans différents contextes.
Des antécédents de trouble dépressif majeur avant le diagnostic de cancer ont également prédit la FLC post-traitement dans plusieurs études avec des effets observés jusqu’à quarante-deux mois après la fin du traitement (Bower et al., 2014). Ainsi, les patients ayant des antécédents de maladie mentale et ceux souffrant de détresse élevée au stade aigu du diagnostic de cancer et du début du traitement semblent présenter un risque de FLC persistante après le traitement (Bower, 2014). L’anxiété est un état émotionnel caractérisé par des sentiments d’appréhension, de malaise ou de peur, souvent accompagnés de réponses physiologiques, telles qu’une accélération du rythme cardiaque, une respiration rapide et une tension musculaire (Grupe & Nitschke, 2013). Elle peut contribuer à l’apparition de la FLC en provoquant une dérégulation de l’axe hypothalamo-hypophyse-surrénalien (HPA), augmentant alors la production de cytokines, et donc générer de la fatigue (Bower, 2019 ; Bower et al., 2002 ; Morris et al., 2017). Une étude a comparé l’anxiété et la FLC de 580 patientes présentant un cancer du sein avant la chimiothérapie, puis six mois après l’arrêt du traitement (Williams et al., 2021). Pour tous les temps de mesures, les patientes atteintes d’un cancer du sein présentaient une FLC et une anxiété significativement plus importante que les témoins non malades (p < 0,001). L’anxiété chez les patientes atteintes d’un cancer du sein semblait plus élevée au moment du diagnostic, avec une diminution au cours du temps, même si elle restait tout de même plus élevée que pour le groupe témoin (p < 0,001). Williams et al. (2021) indiquent également une diminution significative des proportions de cas d’anxiété (score ≥ 8 à la sous-échelle d’anxiété de l’HADS) chez des patientes atteintes d’un cancer du sein entre le début de l’étude (37,7 %, 8 semaines après la chirurgie) et quatre mois après l’inclusion (26,7 %), mais aucun changement significatif entre quatre et douze mois après l’inclusion (Saboonchi et al., 2014). On remarque donc de très hauts niveaux d’anxiété avant le début des traitements, bien que celle-ci ait diminué ensuite (restant toujours plus élevée que celle d’une population en bonne santé). On peut supposer que l’anxiété se manifesterait comme un état d’humeur orienté vers l’avenir. Elles associent des réponses cognitives, affectives, physiologiques et comportementales couplées à une anticipation des événements ou des circonstances perçues comme menaçantes (Chand & Marwaha, 2023).
Plusieurs études longitudinales ont associé la dépression et l’anxiété. La présence de ces deux déterminants émotionnels avant le traitement est un prédicteur de la FLC avant, pendant et après le traitement (Dhruva et al., 2010 ; Geinitz et al., 2004 ; Miaskowski et al., 2008 ; Reinertsen et al., 2010 ; Stone et al., 2001). L’ensemble des études n’a jamais contrôlé la présence de la FLC avant le traitement. La contribution seule de la dépression à la fatigue préexistante n’est donc pas tout à fait claire. Renna et al. (2022) se sont intéressés à l’effet distinct de la dépression et de l’anxiété sur la FLC chez des patients ayant reçu un diagnostic de cancer colorectal avant le début des traitements adjuvants (c’est-à-dire radiothérapie, chimiothérapie ou immunothérapie). L’ajout de la dépression dans le modèle proposé par ces auteurs, intégrant l’âge, le sexe, l’IMC, le stade du cancer, les comorbidités et la dépression, explique 69 % de la variance de la FLC, avec un écart de 45 % en moins si la dépression est inconsidérée. Lorsque la dépression laisse sa place à l’anxiété, le modèle explique 66 % de la variance de la FLC (Renna et al., 2022). Ces résultats montrent donc bien que la dépression et l’anxiété permettent de rendre compte d’une grande partie de la variance de la FLC (45 et 42 %, respectivement) dans un modèle comprenant des déterminants émotionnels et cliniques. Il est par ailleurs intéressant de noter que la dépression et l’anxiété peuvent également impacter les sous-dimensions de la FLC, notamment la dimension physique. En effet, les patients déprimés et anxieux sont plus susceptibles de réduire leur activité de plein air et de revenir à un mode de vie passif. Cela peut alors entraîner un déconditionnement musculaire et une perte de performance physique (Dimeo et al., 1997).
Tout comme la dépression et l’anxiété, la détresse émotionnelle est un déterminant de la FLC. Elle peut être définie comme un état émotionnel caractérisé par des émotions négatives intenses. Elle est généralement temporaire et peut être une réponse normale à des situations difficiles. Elle résulte de facteurs tels que les préoccupations concernant les changements d’aspect et les cicatrices, l’anesthésie et les procédures chirurgicales (par exemple, douleur pendant la procédure, effets secondaires postopératoires) et le diagnostic et le pronostic. Les préoccupations les plus fréquentes de patientes traitées pour un cancer du sein à un stade précoce étaient la peur de la récidive du cancer, de la douleur, de la mort, des méfaits du traitement adjuvant et des factures médicales (Holland, 1998). Quelle que soit sa source, la détresse émotionnelle préopératoire est liée aux expériences ultérieures d’effets secondaires postopératoires de patients. Par exemple, la détresse préopératoire prédit la douleur postopératoire, les nausées postopératoires et la fatigue postopératoire dans un large éventail de chirurgies (Montgomery et al., 2010).
En somme, les déterminants émotionnels, notamment la dépression, l’anxiété et la détresse émotionnelle, jouent un rôle crucial dans l’apparition et la persistance de la FLC quel que soit le moment de la prise en charge. Ces remarques soulignent l’importance d’une prise en charge globale pour améliorer la qualité de vie des patients. À noter que les troubles émotionnels peuvent non seulement aggraver la FLC chez les patients atteints de cancer, mais aussi influencer leur sommeil.
Les déterminants de la FLC liés au sommeil
Les troubles du sommeil ressentis par les patients atteints de cancer ou mesurés objectivement (de manière impartiale, sans influence de biais personnels), par divers dispositifs standards et vérifiables sont désormais reconnus et examinés par les équipes médicales (Otte et al., 2015). Bien que les études sur la prévalence de l’insomnie varient en termes de conception, de types de cancer évalués, de type et de phase de traitement, il est clair que 20 à 60 % des patients atteints de cancer souffrent d’insomnie et de troubles du sommeil. Cette proportion à l’insomnie est plus élevée dans la population atteinte de cancer que dans une population générale pour laquelle environ 6 % des adultes vivant dans les pays industrialisés souffrent d’insomnie chronique en tant que trouble (Ohayon, 2002). Les patients souffrant d’insomnie ont tendance à adopter des comportements compensatoires comme faire une sieste, se coucher plus tôt, participer à moins d’activités la journée (Mormont et al., 2000 ; Parker et al., 2008). De tels comportements sont adoptés par les patients afin d’essayer de « récupérer ce qui a été perdu », mais conduisent à un décalage entre l’opportunité de dormir et la capacité à dormir. Sur cent patients, une majorité (72 %) a signalé une grande variété de troubles du sommeil après le diagnostic du cancer (Sela, Watanabe et Nekolaichuk, 2005). Les trois symptômes élevés les plus fréquents étaient :
- Le manque de repos le matin (72 %),
- La difficulté à rester endormi (63 %),
- Les difficultés à s’endormir (40 %).
Des rythmes circadiens, c’est à dire un cycle biologique d’environ 24 heures en lien avec l’alternance jour/nuit, synchronisés et robustes sont importants pour assurer la santé et le bien-être des personnes (Berger et al., 2010). Cependant, chez une personne présentant un cancer, un dysfonctionnement et une inflammation de l’axe HPA sont associés à une perturbation des rythmes circadiens (Rich et al., 2005). La perturbation de ces rythmes entraîne alors des symptômes tels que la fatigue, des troubles du sommeil et la dépression (Dzaja et al., 2005).
De nombreux chercheurs ont émis l’hypothèse que les problèmes de sommeil pourraient contribuer aux sensations de fatigue diurne. En effet, des études menées auprès de patients atteints de cancer du sein et de la prostate ont montré que les troubles du sommeil avant traitement par radiothérapie étaient associés à des niveaux de fatigue plus élevés avant, pendant et jusqu’à six mois après la fin du traitement. La FLC est corrélée aux troubles du sommeil chez les patientes présentant un cancer bien que les liens de causalité entre ces symptômes n’aient pas été déterminés (Bower, 2008). Les perturbations du sommeil pourraient donc bien être un facteur de risque de FLC (Bower, 2014). Concernant la relation entre la FLC et les troubles du sommeil perçus avant le début de la chimiothérapie, un plus grand nombre de perturbations signalées au PSQI était significativement corrélé à une fatigue plus importante quelles que soient les sous-échelles de fatigue du MFSI-SF (Ancoli-Israel et al., 2006). Le score total du niveau du sommeil subjectif évalué à l’aide du questionnaire PSQI, avant la chimiothérapie était supérieur à la limite supérieure du sommeil normal mais inférieur au seuil proposé pour les patients atteints de cancer (Berger et al., 2007). Enfin, les scores totaux de fatigue plus élevés étaient faiblement corrélés à des scores totaux de sommeil également plus élevés (Berger et al., 2007).
Des études antérieures menées auprès de patientes atteintes d’un cancer du sein fournissent des informations limitées sur la relation entre la FLC et le sommeil avant la chimiothérapie. Ancoli-Israël et al. (2006) ont constaté que les femmes (n = 85) présentaient une fatigue modérée et des troubles du sommeil au cours des 72 heures précédant la chimiothérapie (Ancoli-Israel et al., 2006). La durée totale de sommeil au lit la nuit était de 6 heures et 76 % du temps passé au lit la nuit était consacré au sommeil, deux valeurs inférieures à la normale (Berger et al., 2005). Le temps d’éveil après le début du sommeil était de 1,8 h / nuit. Ce temps est beaucoup plus long que les 30 minutes considérées comme normales (Berger et al., 2007). Au niveau du sommeil objectif, Martin et al. (2021) ont observé, chez des survivantes du cancer, un temps de réveil après l’endormissement significativement plus élevé que les patientes du groupe non-fatigué. De plus, le score de FLC en continu, en réponse au questionnaire FACIT-F, était significativement corrélé au temps de réveil après l’endormissement, à l’efficacité du sommeil et à la latence d’endormissement.
Tous ces résultats fournissent des preuves indiquant que les troubles du sommeil sont associés à la FLC, tant au niveau du sommeil subjectif qu’objectif, à tous les moments du traitement. Ces perturbations du sommeil peuvent souvent résulter de déséquilibres biologiques induits par la maladie elle-même ou par ses traitements.
Les déterminants biologiques de la FLC
Les résultats des études menées auprès de patients atteints de cancer et des survivants corroborent l’hypothèse selon laquelle les processus inflammatoires contribuent à la FLC, en particulier pendant et après le traitement. Cette association entre inflammation et FLC a été constatée chez les survivants du cancer du sein, des ovaires et des testicules. Il semblerait que les facteurs confondants potentiels d’ordre biocomportemental, tels que l’âge et l’IMC, n’ont pas d’influence sur les liens entre inflammation et FLC. Soulignons cependant que les résultats ne sont pas uniformes dans tous les groupes de patients (Dimeo et al., 2004), pour tous les aspects de la fatigue (de Raaf et al., 2012) ou pour tous les marqueurs inflammatoires (Bower et al., 2011). Cette disparité peut découler de plusieurs différences, notamment la définition et l’évaluation de la FLC, les caractéristiques liées à la maladie et au traitement, ainsi que les méthodes et la qualité des évaluations immunologiques. De plus, différentes composantes du réseau de cytokines pro-inflammatoires peuvent être associées à différents aspects de la fatigue, au sein de groupes de patients divers et à différents stades de la trajectoire du cancer. C’est pourquoi il est nécessaire d’évaluer les composants clés du réseau de cytokines ainsi que les sous-dimensions de la FLC en utilisant des mesures valides et fiables. Il convient de noter qu’un des résultats les plus fréquents dans la littérature scientifique porte sur le lien entre la protéine C-réactive (CRP) et la FLC après le traitement, peut-être en raison de la mesure de routine de la CRP dans les laboratoires cliniques. Bien que cela garantisse une évaluation plus fiable que d’autres marqueurs inflammatoires moins analysés (Bower, 2014), cela ne peut représenter toute la complexité des processus inflammatoires.
Par ailleurs, des études ont également mis en évidence des associations entre la FLC et des altérations des systèmes immunitaire et neuroendocrinien. Des altérations de l’axe HPA ont été avancées comme un mécanisme sous-jacent de la FLC, que ce soit en agissant directement ou en influençant les processus inflammatoires. Cet axe joue un rôle essentiel dans la régulation de la production de cytokines et exerce des effets anti-inflammatoires significatifs (McEwen et al., 1997). Ceux-ci peuvent se manifester par des altérations dans la production de glucocorticoïdes, y compris des profils circadiens perturbés, ainsi que par une diminution de la sensibilité du récepteur des glucocorticoïdes à la liaison hormonale (Raison & Miller, 2003). Des indications préliminaires suggèrent que des altérations au niveau de deux de ces voies sont observées chez les patients souffrant de FLC. En ce qui concerne la production de cortisol, les survivantes du cancer du sein éprouvant une fatigue persistante présentent des altérations de la pente diurne du cortisol, avec des niveaux élevés de cortisol le soir par rapport aux témoins non fatigués (Bower et al., 2005). En plus de l’altération de l’axe HPA, nous observons des modifications au niveau des sous-populations de leucocytes, de la réactivation de virus latents (herpès), ainsi que des altérations du système nerveux autonome (Bower, 2014). Ces systèmes sont intrinsèquement liés à l’inflammation et peuvent influencer la FLC en initiant ou en maintenant une inflammation élevée. À noter également que les modifications de ces systèmes peuvent avoir un impact direct sur la FLC. Cependant, le rôle causal de ces altérations reste incertain dans le développement et la persistance de la FLC, car leur activité a généralement été mesurée en parallèle de la fatigue.
En un mot, il est possible de dire que les processus inflammatoires sont associés à la FLC, bien que cette association avec la fatigue varie selon les populations, les marqueurs inflammatoires et les dimensions de la fatigue étudiées. Aussi, une évaluation rigoureuse des composants inflammatoires et des sous-dimensions de la fatigue pour mieux comprendre cette relation complexe s’impose. Si les données biologiques rendent compte d’une partie de la FCL, la prise en compte des variables sociodémographiques est également à considérer pour avoir une vision large, et finalement plus réaliste, de ce que la FLC veut dire.
Les déterminants sociodémographiques de la FLC
Chez une cohorte de femmes diagnostiquées d’un cancer du sein, Puigpinós-Riera et al. (2020) ont établi un lien entre le groupe social et la sévérité de la FLC. Ils montrent ainsi que la proportion de femmes souffrant de FLC intense est plus élevée parmi les patientes d’origine modeste que chez celles issues des couches sociales supérieures. Le deuxième déterminant mis en évidence concernait la composition familiale au domicile. Les personnes vivant seules éprouvaient une FLC plus importante. Une revue de littérature (Ruiz-Casado et al., 2021) a mis en évidence que les femmes plus jeunes étaient plus susceptibles de ressentir une FLC accrue (Bower et al., 2000 ; Meeske et al., 2007). Au niveau des origines ethniques, il semblerait que les populations latines ont des prévalences plus élevées de FLC (Eversley et al., 2005 ; Fu et al., 2009). La prévalence est d’autant plus forte lorsque celles-ci ont de faibles revenus et un accès limité aux services de soins. De manière générale et peu importe l’origine ethnique, une situation économique moins favorable est associée à la FLC (Bower et al., 2006). Par ailleurs, les études sur la relation entre l’éducation et la FLC ont donné des résultats variés. La plupart d’entre elles révèle une association négative (Schmidt et al., 2015), à l’exception des patients recevant des inhibiteurs de l’aromatase, chez lesquels une éducation accrue était corrélée à une fatigue accrue (Mao et al., 2018). L’adversité vécue pendant l’enfance, telle que les mauvais traitements, la négligence, les conflits familiaux et la désorganisation durant l’enfance, a également été identifiée comme un facteur de risque de FLC persistante (Bower et al., 2018 ; Fagundes et al., 2012).
La FLC est également influencée par les relations sociales. En effet, de nombreux patients rapportent que, pour être capables d’assister et de participer à des activités familiales ou sociales, ils sont obligés de planifier des périodes de repos dans la journée (Holley, 2000). D’autres, au contraire, se désengagent de ce type d’activités à cause de la FLC. Pour certains patients, il devient même compliqué de répondre au téléphone, car ils estiment que cela leur demande trop d’énergie, les fatigue trop (Holley, 2000). Cependant, le soutien familial reste un facteur crucial qui les aide à traverser le parcours du cancer et de la FLC (Williams & Jeanetta, 2016).
Comme on peut le voir, les déterminants sociodémographiques et notamment l’origine sociale, la composition familiale, l’âge, l’ethnie, l’éducation et les expériences d’adversité pendant l’enfance jouent un rôle important dans le développement et la gestion de la FLC, influençant sa sévérité ainsi que la capacité des patients à maintenir des relations sociales et à tenter de renouer avec la vie d’avant la maladie. Mais, comme nous allons le voir la FLC et les dimensions qui vont la définir varient d’un patient à un autre.
Variabilité et hétérogénéité de la FLC et implications pour la prise en charge des soins de support adaptés
Des études qualitatives ont montré que les caractéristiques cliniques sont très individuelles (Holley, 2000 ; Scott et al., 2011). La nature multidimensionnelle, tant dans ses causes que dans ses conséquences, de la FLC avec les contributions des déterminants physiques, cognitifs, émotionnels, liés au sommeil, biologiques et sociodémographiques, contribue à son hétérogénéité individuelle. En effet, le type et le stade de la tumeur, les modalités de traitement et la réponse inflammatoire du corps contribuent à l’expérience individuelle de la FLC (Bower, 2014 ; Wang et al., 2014). Au niveau des facteurs émotionnels, des conditions psychologiques préexistantes telles que la dépression et l’anxiété sont associées à des expériences de fatigue accrue pendant le traitement du cancer (Janelsins et al., 2017). Les facteurs cognitifs jouent également un rôle dans l’hétérogénéité de la fatigue. Les stratégies d’adaptation, telles que la résolution de problèmes et la recherche d’un soutien social, jouent un rôle central dans l’atténuation de l’impact de la FLC. Les facteurs physiques, y compris l’activité physique contribuent à la variabilité des expériences de FLC. Les patients qui pratiquent une activité physique régulière signalent souvent des niveaux de fatigue inférieurs, probablement en raison d’une amélioration de leur forme cardiovasculaire et de leur bien-être psychologique (Curt et al., 2000). La FLC est le résultat d’une interaction systémique entre plusieurs déterminants d’ordre physique, cognitif, émotionnel, biologique et social. Ces facteurs n’agissent pas de manière isolée, mais plutôt en interrelation, formant un réseau intriqué qui influence l’expérience de la FLC.
Relations systémiques entre les différents déterminants de la FLC
Les interactions systémiques entre divers déterminants jouent un rôle crucial dans la compréhension de la FLC et dans le développement de stratégies de gestion adaptées. Ainsi, nous pouvons noter que les patients déprimés et anxieux sont plus susceptibles de réduire leur activité de plein air et de s’astreindre à un mode de vie passif. Cela peut alors entraîner un déconditionnement musculaire et une diminution de la performance physique (Dimeo et al., 1997). A contrario, l’activité physique permet d’atténuer les effets du traitement sur la fatigabilité cognitive et la dépression (Lawson et al., 2016). De nombreuses études ont analysé l’impact de la dépression sur d’autres déterminants. Ils ont constaté une diminution des fonctions cognitives (Bedillion et al., 2019 ; Vardy et al., 2014), de l’efficacité des traitements (Somerset et al., 2004) ainsi qu’une augmentation de l’anxiété (Vardy et al., 2014) lorsque les patients étaient déprimés. De la même manière, les troubles du sommeil, l’anxiété et la dépression affectent la qualité de vie (Kim et al., 2019).
D’un point de vue biologique, il semblerait que les cytokines jouent un rôle dans l’apparition de la dépression. En effet, les patients souffrant de dépression clinique sévère ont des concentrations sanguines accrues de biomarqueurs inflammatoires (Dantzer et al., 2008). Les déterminants biologiques semblent donc avoir une influence dans l’apparition des troubles cognitifs avec des mécanismes possibles comprenant la libération de cytokines, les changements hormonaux, la coagulation du sang dans les petits vaisseaux cérébraux et les effets neurotoxiques de la chimiothérapie (Ahles & Saykin, 2007). Ces exemples non exhaustifs démontrent les interactions multiples et complexes qui existent entre les différents déterminants de la FLC.
En somme, les causes de la FLC peuvent être multiples et interagissent de manière complexe les unes avec les autres, mais un point important émerge de ces constats : toutes les causes ne sont pas présentes chez chaque individu, ce qui entraîne des parcours individuels variés de FLC. Il existe autant de profils de FLC différents que de patientes, c’est pour cela que la variabilité et l’hétérogénéité de la FLC doivent être prises en compte.
Variabilité et hétérogénéité interindividuelle de la FLC
Une grande variabilité interindividuelle a été démontrée dans les trajectoires de fatigue du soir et du matin dans une étude analysant les trajectoires de fatigue nocturne (évaluée le soir) et diurne (évaluée le matin) (Miaskowski et al., 2008). Dans cette étude, l’âge et les troubles du sommeil prédisaient des niveaux plus élevés de fatigue nocturne et diurne. Les résultats de cette étude suggéraient également que les hommes plus jeunes présentant un niveau de fatigue plus élevé avant la radiothérapie couraient un risque accru de niveaux plus élevés de fatigue le soir et le matin au cours de la radiothérapie. De plus, le niveau de fatigue diurne au cours de la radiothérapie semble dépendre du niveau de dépression du patient avant le début des traitements. La variance des paramètres dans les changements individuels suggère qu’il existe des différences interindividuelles substantielles dans les trajectoires de fatigue du soir et du matin.
La figure 1 illustre par exemple les trajectoires de fatigues nocturne et diurne chez 73 femmes atteintes d’un cancer du sein avant, pendant et après la radiothérapie. Avant le traitement, la fatigue nocturne est affectée négativement par la présence d’enfants à la maison ainsi que par la dépression, avec une détérioration plus prononcée de la fatigue nocturne, au cours du traitement, chez les femmes exerçant une activité professionnelle. Quant à la fatigue diurne avant le début des traitements, elle est plutôt influencée par des facteurs tels qu’un jeune âge, un indice de masse corporelle plus bas, des troubles du sommeil et de l’anxiété, avec des trajectoires de fatigue diurne, au cours du traitement, plus sévères chez les patientes avec un stade de maladie plus avancé et présentant davantage de comorbidités médicales (Dhruva et al., 2010).
À une échelle temporelle plus grande, il existe plusieurs trajectoires de FLC possibles au cours des traitements. Bower et al. (2021) en ont identifié cinq (fig. 2) chez des femmes présentant un cancer du sein de stade 0-IIIA interrogées plusieurs fois avant et après les traitements (Bower et al., 2021). Les deux premières trajectoires que nous remarquons concernent les patientes qui présentent une FLC stable au cours des traitements, que celle-ci soit élevée (17 ± 3.1) ou basse (5.6 ± 4.0) dès le départ. Ensuite, nous notons deux autres trajectoires inverses l’une par rapport à l’autre : les patientes avec une FLC basse au début des traitements et qui augmente au fur et à mesure (4.9 ± 3.3 au départ et tend vers ≈ 15 après dix-huit mois post-traitement), et inversement, les patientes avec une FLC haute au début des traitements et qui diminue progressivement (17.2 ± 4.0 vers ≈ 5 après dix-huit mois post-traitement). Et la dernière trajectoire, que les auteurs de cette étude ont nommée « réactive », et que nous pourrions également appeler fatigue « passagère ». Dans ce cas, la FLC augmente progressivement entre le diagnostic et six mois après l’arrêt des traitements puis redescend à des valeurs initiales dix-huit mois après l’arrêt des traitements. À titre de référence, dans l’étude de validation du MFSI, le score moyen sur la sous-échelle générale était de 5,1 chez les témoins non atteints de cancer et de 7,3 dans un groupe combiné de patientes atteintes d’un cancer du sein sous traitement et de survivantes ayant terminé le traitement (Stein et al., 1998).
Bower et ses collaborateurs (2021) ont également cherché à déterminer des prédicteurs potentiels en fonction des différents groupes de trajectoire de FLC (fig. 2). Par exemple, les prédicteurs du groupe « fatigue stable élevée » semblaient être des niveaux élevés de détresse psychologique et de troubles du sommeil cliniquement significatifs ainsi que des antécédents de trouble dépressif majeur avant leur diagnostic de cancer du sein. Les prédicteurs du groupe « fatigue décroissante » semblaient plutôt être à des niveaux élevés de détresse spécifique au cancer au diagnostic, sans antécédents de dépression avant le diagnostic.

Chartogne et al. (2021) ont établi un modèle offrant l’opportunité de comprendre les mécanismes prédominants de la FLC au niveau individuel. Ainsi, deux patients avec un même niveau de FLC cliniquement significatif (c’est-à-dire un score au questionnaire FA12 de 56) présentaient des étiologies différentes de FLC, avec une influence différente des symptômes d’anxiété/dépression, des troubles du sommeil et de la fatigabilité neuromusculaire sur leur FLC. Cet exemple démontre une hétérogénéité des étiologies de la FLC pour deux patients ayant un même niveau de FLC. Cependant, une variabilité intra-individuelle existe également.
Variabilité intra-individuelle de la FLC
La littérature révèle que la fatigue d’un patient atteint de cancer varie d’un moment à un autre de la journée. En effet, Miaskowski et al. (2008) ont rapporté que les patients déclaraient des fatigues plus importantes le soir que le matin (entre 2,2 et 5,1 le soir vs entre 0,55 et 3,55 le matin) avant le début de la radiothérapie. Au-delà de ces variations journalières, les niveaux de fatigue perçue semblent également varier considérablement d’une semaine à l’autre. Dhruva et al. (2010) ont également constaté ce phénomène, c’est-à-dire une fatigue déclarée plus importante le soir que le matin et des niveaux de fatigue variant d’une semaine à l’autre très fortement en fonction des patients (fig. 1).
La (re)connaissance de la variabilité et de l’hétérogénéité individuelle de la FLC est nécessaire pour les implications cliniques. En effet, une grande partie des interventions proposées aujourd’hui est unidimensionnelle, à savoir qu’un seul type d’intervention pour un seul déterminant ciblé. Ces interventions ont alors un effet pour certains patients mais pas pour tous. Une des hypothèses à cet effet pourrait concerner l’adaptation de la prise en charge au type de fatigue de certains patients mais pas à l’ensemble. En d’autres termes, il n’existe pas un type de fatigue identique pour tous, mais une prise en charge adaptée à un patient. Il semble assez évident que chaque patient doit être pris en charge de façon individualisée et que ce n’est pas au patient de s’adapter à la prise en charge. Pour pallier cette limite de l’intervention unique, il est important que les interventions prennent en compte la combinaison de facteurs biologiques, psychologiques, sociaux et environnementaux d’un individu afin d’offrir une approche pertinente qui lui permette de gérer efficacement la FLC qui le concerne. Les interventions personnalisées pourraient englober une combinaison d’agents pharmacologiques ciblant l’inflammation, des interventions psychosociales traitant la détresse émotionnelle et des modifications du mode de vie axées sur l’activité physique et l’hygiène du sommeil (fig. 3). La FLC étant une entité multidimensionnelle, un seul mode de traitement, identique pour tous les patients, est insuffisant (Foucaut et al., 2020 ; Narayanan & Koshy, 2009).
Conclusion
La FLC est une sensation de fatigue perçue par le patient qui s’avère être bien différente de la fatigue dite normale. Elle résulte d’un phénomène complexe et multidimensionnel qui impacte profondément la qualité de vie des patients. Elle peut poursuivre son impact même après la rémission des patients. Cette fatigue ne peut pas être réduite à une seule cause ou un facteur isolé. Elle est le résultat d’une interaction complexe entre de multiples déterminants biologiques, psychologiques, sociaux et environnementaux. Ces facteurs ne fonctionnent pas de manière indépendante, mais sont interconnectés, créant un réseau de relations complexes. La difficulté est d’autant plus grande que tous ces facteurs ne sont pas présents chez chaque individu. Des parcours individuels variés de la FLC existent, impliquant une hétérogénéité des étiologies de la FLC. Cette dernière est également caractérisée par de grandes variabilités inter- et intra-individuelle, synonyme d’une prise en charge qui nécessite l’individualisation des patients en ayant toujours en tête ce que la FLC peut vouloir dire au niveau biologique, psychologique, social. C’est l’ambition qu’a le projet BIOCARE FActory qui se propose de créer un modèle biopsychosocial de la fatigue liée au cancer.
Bibliographie
Ahles, T. A. et Saykin, A. J.,Candidate mechanisms for chemotherapy-induced cognitive changes. Nature Reviews Cancer, 7(3), 192–201. [en ligne] https://doi.org/10.1038/nrc2073.
Ahles, T. A., Saykin, A. J., McDonald, B. C., Furstenberg, C. T., Cole, B. F., Hanscom, B. S., … Kaufman, P. A. (2008). « Cognitive function in breast cancer patients prior to adjuvant treatment Breast Cancer Research and Treatment, 110(1), 143–152. [en ligne] https://doi.org/10.1007/s10549-007-9686-5.
Ahles, T. A., Saykin, A. J., McDonald, B. C., Li, Y., Furstenberg, C. T., Hanscom, B. S., … Kaufman, P. A. (2010). Longitudinal Assessment of Cognitive Changes Associated With Adjuvant Treatment for Breast Cancer: Impact of Age and Cognitive Reserve. Journal of Clinical Oncology, 28(29), 4434-4440. [en ligne] https://doi.org/10.1200/JCO.2009.27.0827.
American Psychiatric Association et Association, A. P. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4th ed.). [en ligne] https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425596.
Ancoli-Israel, S., Liu, L., Marler, M. R., Parker, B. A., Jones, V., Sadler, G. R., … Fiorentino, L. (2006). Fatigue, sleep, and circadian rhythms prior to chemotherapy for breast cancer. Supportive Care in Cancer, 14(3), 201-209. [en ligne] https://doi.org/10.1007/s00520-005-0861-0.
Andrews, P. L. et Hickok, J. T. (2004). Mechanisms and models of fatigue associated with cancer and its treatment: Evidence of pre-clinical and clinical studies. In J. Armes, M. Krishnasamy et I. Higginson (Eds.), Fatigue in Cancer (pp. 51-87). Oxford University Press.
Andrykowski, M. A., Donovan, K. A., Laronga, C. et Jacobsen, P. B. (2010). Prevalence, predictors, and characteristics of off-treatment fatigue in breast cancer survivors. Cancer, 116(24), 5740-5748. [en ligne] https://doi.org/10.1002/cncr.25294.
Argilés, J. M., Busquets, S., Toledo, M. et López-Soriano, F. J. (2009). The role of cytokines in cancer cachexia. Current Opinion in Supportive & Palliative Care, 3(4), 263–268. [en ligne] https://doi.org/10.1097/SPC.0b013e3283311d09.
Armes, J., Krishnasamy, M. et Higginson, I. (2004). Fatigue in cancer (OUP Oxford, Ed.).
Barsevick, A. M., Cleeland, C. S., Manning, D. C., O’Mara, A. M., Reeve, B. B., Scott, J. A. et Sloan, J. A. (2010). ASCPRO Recommendations for the Assessment of Fatigue as an Outcome in Clinical Trials. Journal of Pain and Symptom Management, 39(6), 1086-1099. [en ligne] https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2010.02.006.
Bedillion, M. F., Ansell, E. B. et Thomas, G. A. (2019). Cancer treatment effects on cognition and depression: The moderating role of physical activity. The Breast, 44, 73-80. [en ligne] https://doi.org/10.1016/j.breast.2019.01.004.
Berger, A. M., Abernethy, A. P., Atkinson, A., Barsevick, A. M., Breitbart, W. S., Cella, D., Wagner, L. I. (2010). Cancer-Related Fatigue. Journal of the National Comprehensive Cancer Network, 8(8), 904-931. [en ligne] https://doi.org/10.6004/jnccn.2010.0067.
Berger, A. M., Farr, L. A., Kuhn, B. R., Fischer, P. et Agrawal, S. (2007). Values of Sleep/Wake, Activity/Rest, Circadian Rhythms, and Fatigue Prior to Adjuvant Breast Cancer Chemotherapy. Journal of Pain and Symptom Management, 33(4), 398-409. [en ligne] https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2006.09.022.
Berger, A. M., Mooney, K., Alvarez-Perez, A., Breitbart, W. S., Carpenter, K. M., Cella, D., … Smith, C. (2015). Cancer-related fatigue, version 2.2015. JNCCN Journal of the National Comprehensive Cancer Network, 13(8), 1012-1039. [en ligne] https://doi.org/10.6004/jnccn.2015.0122.
Berger, A. M., Parker, K. P., Young-McCaughan, S., Mallory, G. A., Barsevick, A. M., Beck, S. L., … Hall, M. (2005). Sleep/Wake Disturbances in People With Cancer and Their Caregivers: State of the Science. Oncology Nursing Forum, 32(6), E98-E126. [en ligne] https://doi.org/10.1188/05.ONF.E98-E126.
Blanchard, C. M., Courneya, K. S. et Stein, K. (2008). Cancer survivors’ adherence to lifestyle behavior recommendations and associations with health-related quality of life: Results from the American Cancer Society’s SCS-II. Journal of Clinical Oncology, 26(13), 2198-2204. [en ligne] https://doi.org/10.1200/JCO.2007.14.6217.
Bower, Julienne E. Ganz, Patricia A. Desmond, Katherine A. Rowland, Julia H. Meyerowitz, Beth E. Belin, T. R. (2000). Fatigue in Breast Cancer Survivors: Occurrence, Correlates, and Impact on Quality of Life. Journal of Clinical Oncology, 18(4), 743-753. [en ligne] https://doi.org/10.1200/JCO.2000.18.4.743.
Bower, J.E. (2008). Behavioral symptoms in breast cancer patients and survivors: Fatigue, insomnia, depression, and cognitive disturbance Julienne. Journal of Clinical Oncology, 26(5), 768-777. [en ligne] https://doi.org/10.1200/JCO.2007.14.3248.Behavioral.
Bower, J E, Ganz, P. A. et Desmond, K. A. (2006). Fatigue in long-term breast carcinoma survivors: A longitudinal investigation. Cancer, 106(4), 751-758. [en ligne] https://doi.org/10.1002/cncr.21671.
Bower, Julienne E. (2014). Cancer-related fatigue—mechanisms, risk factors, and treatments. Nature Reviews Clinical Oncology, 11(10), 597-609. [en ligne] https://doi.org/10.1038/nrclinonc.2014.127.
Bower, Julienne E. (2019). The role of neuro immune interactions in cancer related fatigue: Biobehavioral risk factors and mechanisms. Cancer, 125(3), 353-364. [en ligne] https://doi.org/10.1002/cncr.31790.
Bower, Julienne E., Crosswell, A. D. et Slavich, G. M. (2014). Childhood adversity and cumulative life stress: Risk factors for cancer-related fatigue. Clinical Psychological Science, 2(1), 108-115. [en ligne] https://doi.org/10.1177/2167702613496243.
Bower, Julienne E., Ganz, P. A. et Aziz, N. (2005). Altered Cortisol Response to Psychologic Stress in Breast Cancer Survivors With Persistent Fatigue. Psychosomatic Medicine, 67(2), 277-280. [en ligne] https://doi.org/10.1097/01.psy.0000155666.55034.c6.
Bower, Julienne E., Ganz, P. A., Aziz, N. et Fahey, J. L. (2002). Fatigue and Proinflammatory Cytokine Activity in Breast Cancer Survivors. Psychosomatic Medicine, 64(4), 604-611. [en ligne] https://doi.org/10.1097/00006842-200207000-00010.
Bower, Julienne E., Ganz, P. A., Dickerson, S. S., Petersen, L., Aziz, N. et Fahey, J. L. (2005). Diurnal cortisol rhythm and fatigue in breast cancer survivors. Psychoneuroendocrinology, 30(1), 92-100. [en ligne] https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2004.06.003.
Bower, Julienne E., Ganz, P. A., Irwin, M. R., Cole, S. W., Garet, D., Petersen, L., … Crespi, C. M. (2021). Do all patients with cancer experience fatigue? A longitudinal study of fatigue trajectories in women with breast cancer. Cancer, 127(8), 1334-1344. [en ligne] https://doi.org/10.1002/cncr.33327.
Bower, Julienne E., Ganz, P. A., Irwin, M. R., Kwan, L., Breen, E. C. et Cole, S. W. (2011). Inflammation and behavioral symptoms after breast cancer treatment: Do fatigue, depression, and sleep disturbance share a common underlying mechanism? J Clin Oncol, 29(26), 3517-3522. [en ligne] https://doi.org/10.1200/JCO.2011.36.1154.
Bower, Julienne E., Wiley, J., Petersen, L., Irwin, M. R., Cole, S. W. et Ganz, P. A. (2018). Fatigue after breast cancer treatment: Biobehavioral predictors of fatigue trajectories. Health Psychology, 37(11), 1025-1034. [en ligne] https://doi.org/10.1037/hea0000652.
Brown, L. F. et Kroenke, K. (2009). Cancer-Related Fatigue and Its Associations With Depression and Anxiety: A Systematic Review. Psychosomatics, 50(5), 440-447. [en ligne] https://doi.org/10.1176/appi.psy.50.5.440.
Cai, B., Allexandre, D., Rajagopalan, V., Jiang, Z., Siemionow, V., Ranganathan, V. K., … Paul, F. (2014). Evidence of significant central fatigue in patients with cancer-related fatigue during repetitive elbow flexions till perceived exhaustion. PLoS ONE, 9(12), 1-15. [en ligne] https://doi.org/10.1371/journal.pone.0115370.
Carver, C. S. (1997). You want to measure coping but your protocol’ too long: Consider the brief cope. International Journal of Behavioral Medicine, 4(1), 92-100. [en ligne] https://doi.org/10.1207/s15327558ijbm0401_6.
Chand, S. P. et Marwaha, R. (2023). Anxiety. In StatPearls. Retrieved from [en ligne] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30450216
Cimprich, B. (1995). Symptom management: Loss of concentration. Seminars in Oncology Nursing, 11(4), 279–288. [en ligne] https://doi.org/10.1016/S0749-2081(05)80009-9.
Cohen, S., Nathan, J. A. et Goldberg, A. L. (2015). Muscle wasting in disease: molecular mechanisms and promising therapies. Nature Reviews Drug Discovery, 14(1), 58-74. [en ligne] https://doi.org/10.1038/nrd4467.
Curt, G. A., Breitbart, W., Cella, D., Groopman, J. E., Horning, S. J., Itri, L. M., Vogelzang, N. J. (2000). Impact of cancer-related fatigue on the lives of patients: new findings from the Fatigue Coalition. Oncologist, 5(5), 353-360. [en ligne] https://doi.org/10.1634/theoncologist.5-5-353.
Dantzer, R., O’Connor, J. C., Freund, G. G., Johnson, R. W. et Kelley, K. W. (2008). From inflammation to sickness and depression: when the immune system subjugates the brain. Nature Reviews Neuroscience, 9(1), 46-56. [en ligne] https://doi.org/10.1038/nrn2297.
de Raaf, P. J., Sleijfer, S., Lamers, C. H. J., Jager, A., Gratama, J. W. et van der Rijt, C. C. D. (2012). Inflammation and fatigue dimensions in advanced cancer patients and cancer survivors. Cancer, 118(23), 6005-6011. [en ligne] https://doi.org/10.1002/cncr.27613.
Dhruva, A., Dodd, M., Paul, S. M., Cooper, B. A., Lee, K., West, C., … Miaskowski, C. (2010). Trajectories of Fatigue in Patients With Breast Cancer Before, During, and After Radiation Therapy. Cancer Nursing, 33(3), 201-212. [en ligne] https://doi.org/10.1097/NCC.0b013e3181c75f2a.
Di Meglio, A., Havas, J., Soldato, D., Presti, D., Martin, E., Pistilli, B., … Vaz-Luis, I. (2022). Development and Validation of a Predictive Model of Severe Fatigue After Breast Cancer Diagnosis: Toward a Personalized Framework in Survivorship Care. Journal of Clinical Oncology, 40(10), 1111-1123. [en ligne] https://doi.org/10.1200/JCO.21.01252.
Dimeo, F., Schmittel, A., Fietz, T., Schwartz, S., Köhler, P., Böning, D. et Thiel, E. (2004). Physical performance, depression, immune status and fatigue in patients with hematological malignancies after treatment. Annals of Oncology, 15(8), 1237–1242. [en ligne] https://doi.org/10.1093/annonc/mdh314.
Dimeo, F., Stieglitz, R.-D., Novelli-Fisher, U., Fetscher, S., Mertelsmann, R. et Keul, J. (1997). Correlation between physical performance and fatigue in cancer patients. Annals of Oncology, 1251–1255. [en ligne] https://doi.org/10.1023/A.
Donovan, K. A., Small, B. J., Andrykowski, M. A., Munster, P. et Jacobsen, P. B. (2007). Utility of a cognitive-behavioral model to predict fatigue following breast cancer treatment. Health Psychology, 26(4), 464-472. [en ligne] https://doi.org/10.1037/0278-6133.26.4.464.
Dzaja, A., Arber, S., Hislop, J., Kerkhofs, M., Kopp, C., Pollmächer, T.,… Porkka-Heiskanen, T. (2005). Women’s sleep in health and disease. Journal of Psychiatric Research, 39(1), 55-76. [en ligne] https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2004.05.008.
Eversley, R., Estrin, D., Dibble, S., Wardlaw, L., Pedrosa, M. et Favila-Penney, W. (2005). Post-Treatment Symptoms Among Ethnic Minority Breast Cancer Survivors. Oncology Nursing Forum, 32(2), 250-256. [en ligne] https://doi.org/10.1188/05.ONF.250-256.
Fagundes, C. P., Lindgren, M. E., Shapiro, C. L. et Kiecolt-Glaser, J. K. (2012). Child maltreatment and breast cancer survivors: Social support makes a difference for quality of life, fatigue and cancer stress. European Journal of Cancer, 48(5), 728-736. [en ligne] https://doi.org/10.1016/j.ejca.2011.06.022.
Fearon, K., Strasser, F., Anker, S. D., Bosaeus, I., Bruera, E., Fainsinger, R. L., … Baracos, V. E. (2011). Definition and classification of cancer cachexia: an international consensus. The Lancet Oncology, 12(5), 489-495. [en ligne] https://doi.org/10.1016/S1470-2045(10)70218-7.
Feng, L. R., Espina, A. et Saligan, L. N. (2018). Association of Fatigue Intensification with Cognitive Impairment during Radiation Therapy for Prostate Cancer. Oncology, 94(6), 363–372. https://doi.org/10.1159/000487081.
Feng, L. R., Regan, J., Shrader, J. A., Liwang, J., Ross, A., Kumar, S. et Saligan, L. N. (2019). Cognitive and motor aspects of cancer related fatigue. Cancer Medicine, 8(13), 5840-5849. [en ligne] https://doi.org/10.1002/cam4.2490.
Foucaut, A., Neuzillet, C., Anota, A., Farsi, F., Labrosse, H., Beerblock, K., … Vanlemmens, L. (2020). Fatigue et cancer. AFSOS, Référentiels En Soins Oncologiques de Support. Retrieved from [en ligne] https://www.afsos.org/wp-content/uploads/2018/12/Fatigue-et-Cancer_AFSOS.pdf.
.Fu, O. S., Crew, K. D., Jacobson, J. S., Greenlee, H., Yu, G., Campbell, J., … Hershman, D. L. (2009). Ethnicity and persistent symptom burden in breast cancer survivors. Journal of Cancer Survivorship, 3(4), 241-250. [en ligne] https://doi.org/10.1007/s11764-009-0100-7.
Fukuda, K., Straus, S. E., Hickie, I., Sharpe, M. C., Dobbins, J. G. et Komaroff, A. (1994). The chronic fatigue syndrome: A comprehensive approach to its definition and study. Ann Intern Med, 121, 953-959.
Geinitz, H., Zimmermann, F. B., Thamm, R., Keller, M., Busch, R. et Molls, M. (2004). Fatigue in patients with adjuvant radiation therapy for breast cancer: Long-term follow-up. Journal of Cancer Research and Clinical Oncology, 130(6), 327-333. [en ligne] https://doi.org/10.1007/s00432-003-0540-9.
Gerber, L. H. (2017). Cancer-Related Fatigue: Persistent, Pervasive, and Problematic. Phys Med Rehabil Clin N Am, 28(1), 65-88. [en ligne] https://doi.org/10.1016/j.pmr.2016.08.004.
Grupe, D. W. et Nitschke, J. B. (2013). Uncertainty and anticipation in anxiety: An integrated neurobiological and psychological perspective. Nature Reviews Neuroscience, 14(7), 488–501. [en ligne] https://doi.org/10.1038/nrn3524.
Henriksson, M. M., Isometsä, E. T., Hietanen, P. S., Aro, H. M. et Lönnqvist, J. K. (1995). Mental disorders in cancer suicides. Journal of Affective Disorders, 36(1-2), 11-20. [en ligne] https://doi.org/10.1016/0165-0327(95)00047-X.
Holland, J. (1998). Psycho-oncology (O. U. Press, Ed.).
Holley, S. (2000). Cancer-Related Fatigue. Suffering a Different Fatigue. Cancer Practice, 8(2), 87-95. [en ligne] https://doi.org/10.1046/j.1523-5394.2000.82007.x.
Inglis, J. E., Kleckner, A. S., Lin, P.-J., Gilmore, N. J., Culakova, E., VanderWoude, A. C., Peppone, L. J. (2021). Excess Body Weight and Cancer-Related Fatigue, Systemic Inflammation, and Serum Lipids in Breast Cancer Survivors. Nutrition and Cancer, 73(9), 1676-1686. [en ligne] https://doi.org/10.1080/01635581.2020.1807574.
Jacobsen, P. B., Andrykowski, M. A. et Thors, C. L. (2004). Relationship of Catastrophizing to Fatigue Among Women Receiving Treatment for Breast Cancer. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 72(2), 355-361. [en ligne] https://doi.org/10.1037/0022-006X.72.2.355.
Jacobsen, P. B., Donovan, K. A. et Weitzner, M. A. (2003). Distinguishing Fatigue and Depression in Patients with Cancer. Seminars in Clinical Neuropsychiatry, Vol. 8, 229-240. [en ligne] https://doi.org/10.1016/S1084-3612(03)00049-2.
Janelsins, M. C., Heckler, C. E., Peppone, L. J., Kamen, C., Mustian, K. M., Mohile, S. G., Morrow, G. R. (2017). Cognitive complaints in survivors of breast cancer after chemotherapy compared With Age-Matched Controls: An analysis from a nationwide, multicenter, prospective longitudinal study. Journal of Clinical Oncology, 35(5), 506-514. [en ligne] https://doi.org/10.1200/JCO.2016.68.5826.
Janelsins, M. C., Kesler, S. R., Ahles, T. A. et Morrow, G. R. (2014). Prevalence, mechanisms, and management of cancer-related cognitive impairment. International Review of Psychiatry, 26(1), 102-113. [en ligne] https://doi.org/10.3109/09540261.2013.864260.
Jansen, C. E., Cooper, B. A., Dodd, M. J. et Miaskowski, C. A. (2011). A prospective longitudinal study of chemotherapy-induced cognitive changes in breast cancer patients. Supportive Care in Cancer, 19(10), 1647–1656. [en ligne] https://doi.org/10.1007/s00520-010-0997-4.
Jones, L. W., Eves, N. D., Haykowsky, M., Freedland, S. J. et Mackey, J. R. (2009). Exercise intolerance in cancer and the role of exercise therapy to reverse dysfunction. The Lancet Oncology, 10(6), 598-605. [en ligne] https://doi.org/10.1016/S1470-2045(09)70031-2.
Kangas, M., Henry, J. L. et Bryant, R. A. (2002). Posttraumatic stress disorder following cancer: A conceptual and empirical review. Clinical Psychology Review, 22(4), 499–524. [en ligne] https://doi.org/10.1016/S0272-7358(01)00118-0.
Kim, J. H., Paik, H.-J., Jung, Y. J., Kim, D., Jo, H. J., Lee, S. et Kim, H. Y. (2019). A Prospective Longitudinal Study about Change of Sleep, Anxiety, Depression, and Quality of Life in Each Step of Breast Cancer Patients. Oncology, 97(4), 245-253. [en ligne] https://doi.org/10.1159/000500724.
Kim, T. N. et Choi, K. M. (2013). Sarcopenia: Definition, Epidemiology, and Pathophysiology. Journal of Bone Metabolism, 20(1), 1. [en ligne] https://doi.org/10.11005/jbm.2013.20.1.1.
Kisiel-Sajewicz, K., Davis, M. P., Siemionow, V., Seyidova-Khoshknabi, D., Wyant, A., Walsh, D., Yue, G. H. (2012). Lack of muscle contractile property changes at the time of perceived physical exhaustion suggests central mechanisms contributing to early motor task failure in patients with cancer-related fatigue. J Pain Symptom Manage, 44(3), 351-361. [en ligne] https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2011.08.007.
Lawson, R. A., Yarnall, A. J., Duncan, G. W., Breen, D. P., Khoo, T. K., Williams-Gray, C. H., Burn, D. J. (2016). Cognitive decline and quality of life in incident Parkinson’s disease: The role of attention. Parkinsonism & Related Disorders, 27, 47-53. [en ligne] https://doi.org/10.1016/j.parkreldis.2016.04.009.
Lloyd-Williams, M. et Friedman, T. (2001). Depression in palliative care patients – a prospective study. European Journal of Cancer Care, 10(4), 270–274. [en ligne] https://doi.org/10.1046/j.1365-2354.2001.00290.x.
Mao, H., Bao, T., Shen, X., Li, Q., Seluzicki, C., Im, E.-O. et Mao, J. J. (2018). Prevalence and risk factors for fatigue among breast cancer survivors on aromatase inhibitors. European Journal of Cancer, 101, 47–54. [en ligne] https://doi.org/10.1016/j.ejca.2018.06.009.
Martin, T., Twomey, R., Medysky, M. E., Temesi, J., Culos-Reed, S. N. et Millet, G. Y. (2021). The Relationship between Fatigue and Actigraphy-Derived Sleep and Rest–Activity Patterns in Cancer Survivors. Current Oncology, 28(2), 1170-1182. [en ligne] https://doi.org/10.3390/curroncol28020113.
McEwen, B. S., Biron, C. A., Brunson, K. W., Bulloch, K., Chambers, W. H., Dhabhar, F. S., Weiss, J. M. (1997). The role of adrenocorticoids as modulators of immune function in health and disease: neural, endocrine and immune interactions. Brain Research Reviews, 23(1–2), 79-133. [en ligne] https://doi.org/10.1016/S0165-0173(96)00012-4.
Meeske, K., Smith, A. W., Alfano, C. M., McGregor, B. A., McTiernan, A., Baumgartner, K. B., Bernstein, L. (2007). Fatigue in breast cancer survivors two to five years post diagnosis: a HEAL Study report. Quality of Life Research, 16(6), 947-960. [en ligne] https://doi.org/10.1007/s11136-007-9215-3.
Miaskowski, C., Paul, S. M., Cooper, B. A., Lee, K., Dodd, M., West, C., Wara, W. (2008). Trajectories of Fatigue in Men with Prostate Cancer Before, During, and After Radiation Therapy. Journal of Pain and Symptom Management, 35(6), 632-643. https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2007.07.007.
Mitchell, S. A. (2010). Cancer-Related Fatigue: State of the Science. Cancer Symptom Manag, 2014(5), 364–383. https://doi.org/10.1016/j.pmrj.2010.03.024.
Monga, U., Jaweed, M., Kerrigan, A. J., Lawhon, L., Johnson, J., Vallbona, C. et Monga, T. N. (1997). Neuromuscular fatigue in prostate cancer patients undergoing radiation therapy. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 78(9), 961-966. [en ligne] https://doi.org/10.1016/S0003-9993(97)90058-7.
Montgomery, G. H., Schnur, J. B., Erblich, J., Diefenbach, M. A. et Bovbjerg, D. H. (2010). Presurgery Psychological Factors Predict Pain, Nausea, and Fatigue One Week After Breast Cancer Surgery. Journal of Pain and Symptom Management, 39(6), 1043-1052. [en ligne] https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2009.11.318.
Mormont, M. C., Waterhouse, J., Bleuzen, P., Giacchetti, S., Jami, A., Bogdan, A., Lévi, F. (2000). Marked 24-h rest/activity rhythms are associated with better quality of life, better response, and longer survival in patients with metastatic colorectal cancer and good performance status. Clinical Cancer Research : An Official Journal of the American Association for Cancer Research, 6(8), 3038-3045. [en ligne] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10955782.
Morris, G., Anderson, G. et Maes, M. (2017). Hypothalamic-Pituitary-Adrenal Hypofunction in Myalgic Encephalomyelitis (ME)/Chronic Fatigue Syndrome (CFS) as a Consequence of Activated Immune-Inflammatory and Oxidative and Nitrosative Pathways. Molecular Neurobiology, 54(9), 6806-6819. [en ligne] https://doi.org/10.1007/s12035-016-0170-2.
Muller, L. et Spitz, E. (2003). Évaluation multidimensionnelle du coping: Validation du Brief COPE sur une population française. Encephale, 29(6 I), 507-518.
Narayanan, V. et Koshy, C. (2009). Fatigue in cancer: A review of literature. Indian Journal of Palliative Care, 15(1), 19-25. [en ligne] https://doi.org/10.4103/0973-1075.53507.
Nicchi, S. et Le Scanff, C. (2005). Les stratégies de faire face. Bulletin de Psychologie, Numéro 475(1), 97-100. [en ligne] https://doi.org/10.3917/bupsy.475.0097.
Ohayon, M. M. (2002). Epidemiology of insomnia: what we know and what we still need to learn. Sleep Medicine Reviews, 6(2), 97-111. [en ligne] https://doi.org/10.1053/smrv.2002.0186.
Otte, J. L., Carpenter, J. S., Manchanda, S., Rand, K. L., Skaar, T. C., Weaver, M., Landis, C. (2015). Systematic review of sleep disorders in cancer patients: can the prevalence of sleep disorders be ascertained? Cancer Medicine, 4(2), 183-200. [en ligne] https://doi.org/10.1002/cam4.356.
Parker, K. P., Bliwise, D. L., Ribeiro, M., Jain, S. R., Vena, C. I., Kohles-Baker, M. K., Harris, W. B. (2008). Sleep/Wake Patterns of Individuals With Advanced Cancer Measured by Ambulatory Polysomnography. Journal of Clinical Oncology, 26(15), 2464-2472. [en ligne] https://doi.org/10.1200/JCO.2007.12.2135.
Puigpinós-Riera, R., Serral, G., Sala, M., Bargalló, X., Quintana, M. J., Espinosa, M., Vidal, E. (2020). Cancer-related fatigue and its determinants in a cohort of women with breast cancer: the DAMA Cohort. Supportive Care in Cancer, 28(11), 5213-5221. [en ligne] https://doi.org/10.1007/s00520-020-05337-9.
Raison, C. L. et Miller, A. H. (2003). When Not Enough Is Too Much: The Role of Insufficient Glucocorticoid Signaling in the Pathophysiology of Stress-Related Disorders. American Journal of Psychiatry, 160(9), 1554-1565. [en ligne] https://doi.org/10.1176/appi.ajp.160.9.1554.
Reinertsen, K. V., Cvancarova, M., Loge, J. H., Edvardsen, H., Wist, E. et Fosså, S. D. (2010). Predictors and course of chronic fatigue in long-term breast cancer survivors. J Cancer Surviv, 4(4), 405-414. [en ligne] https://doi.org/10.1007/s11764-010-0145-7.
Renna, M. E., Shrout, M. R., Madison, A. A., Alfano, C. M., Povoski, S. P., Lipari, A. M., Kiecolt Glaser, J. K. (2022). Depression and anxiety in colorectal cancer patients: Ties to pain, fatigue, and inflammation. Psycho-Oncology, 31(9), 1536-1544. [en ligne] https://doi.org/10.1002/pon.5986.
Rich, T., Innominato, P. F., Boerner, J., Mormont, M. C., Iacobelli, S., Baron, B., Lévi, F. (2005). Elevated serum cytokines correlated with altered behavior, serum cortisol rhythm, and dampened 24-hour rest-activity patterns in patients with metastatic colorectal cancer. Clinical Cancer Research, 11(5), 1757-1764. [en ligne] https://doi.org/10.1158/1078-0432.CCR-04-2000.
Roberts, B. M., Frye, G. S., Ahn, B., Ferreira, L. F. et Judge, A. R. (2013). Cancer cachexia decreases specific force and accelerates fatigue in limb muscle. Biochemical and Biophysical Research Communications, 435(3), 488-492. [en ligne] https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2013.05.018.
Ruiz-Casado, A., Álvarez-Bustos, A., de Pedro, C. G., Méndez-Otero, M. et Romero-Elías, M. (2021). Cancer-related Fatigue in Breast Cancer Survivors: A Review. Clinical Breast Cancer, 21(1), 10-25. [en ligne] https://doi.org/10.1016/j.clbc.2020.07.011.
Saboonchi, F., Petersson, L.-M., Wennman-Larsen, A., Alexanderson, K., Brännström, R. et Vaez, M. (2014). Changes in caseness of anxiety and depression in breast cancer patients during the first year following surgery: Patterns of transiency and severity of the distress response. European Journal of Oncology Nursing, 18(6), 598-604. [en ligne] https://doi.org/10.1016/j.ejon.2014.06.007.
Sadigh, M. R. (2013). Development of the biopsychosocial model of medicine. Virtual Mentor, 15(4), 362–366. [en ligne] https://doi.org/10.1001/virtualmentor.2013.15.4.mhst2-1304.
Saligan, L. N., Olson, K., Filler, K., Larkin, D., Cramp, F., Sriram, Y., Mustian, K. M. (2015). The biology of cancer-related fatigue: a review of the literature. Support Care Cancer, 23(8), 2461–2478. [en ligne] https://doi.org/10.1007/s00520-015-2763-0.
Schmidt, M. E., Chang-Claude, J., Seibold, P., Vrieling, A., Heinz, J., Flesch-Janys, D. et Steindorf, K. (2015). Determinants of long-term fatigue in breast cancer survivors: results of a prospective patient cohort study. Psycho-Oncology, 24(1), 40-46. [en ligne] https://doi.org/10.1002/pon.3581.
Scott, J. A., Lasch, K. E., Barsevick, A. M. et Piault-Louis, E. (2011). Patients’ experiences with cancer-related fatigue: A review and Synthesis of qualitative research. Oncology Nursing Forum, 38(3), 191-203. [en ligne] https://doi.org/10.1188/11.ONF.E191-E203.
Sela, R., Watanabe, S. et Nekolaichuk, C. (2005). Sleep disturbances in palliative cancer patients attending a pain and symptom control clinic. Palliative and Supportive Care, 3(1), 23–31. [en ligne] https://doi.org/10.1017/S1478951505050042.
Seo, Y. M., Oh, H. S., Seo, W. S. et Kim, H. S. (2006). Comprehensive Predictors of Fatigue for Cancer Patients. Journal of Korean Academy of Nursing, 36(7), 1224. [en ligne] https://doi.org/10.4040/jkan.2006.36.7.1224.
Shim, E., Jeong, D., Jung, D., Kim, T., Lee, K., Im, S. et Hahm, B. (2022). Do posttraumatic stress symptoms predict trajectories of sleep disturbance and fatigue in patients with breast cancer? A parallel process latent growth model. Psycho-Oncology, 31(8), 1286-1293. [en ligne] https://doi.org/10.1002/pon.5923.
Smith, A. P., Behan, P. O., Bell, W., Millar, K. et Bakheit, M. (1993). Behavioural problems associated with the chronic fatigue syndrome. British Journal of Psychology, 84(3), 411-423. [en ligne] https://doi.org/10.1111/j.2044-8295.1993.tb02492.x.
Somerset, W., Stout, S. C., Miller, A. H. et Musselman, D. (2004). Breast cancer and depression. Oncology (Williston Park, N.Y.), 18(8), 1021–1034 ; discussion 1035-6, 1047-1048. Retrieved from [en ligne] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15328896.
Spichiger, E., Rieder, E., Müller-Fröhlich, C. et Kesselring, A. (2012). Fatigue in patients undergoing chemotherapy, their self-care and the role of health professionals: A qualitative study. Eur J, 16(2), 165–171. [en ligne] https://doi.org/10.1016/j.ejon.2011.05.002.
Stein, K. D., Martin, S. C., Hann, D. M. et Jacobsen, P. B. (1998). A Multidimensional Measure of Fatigue for Use with Cancer Patients. Cancer Practice, 6(3), 143-152. [en ligne] https://doi.org/10.1046/j.1523-5394.1998.006003143.x.
Stone, P., Richards, M., A’Hern, R. et Hardy, J. (2001). Fatigue in patients with cancers of the breast or prostate undergoing radical radiotherapy. Journal of Pain and Symptom Management, 22(6), 1007-1015. [en ligne] https://doi.org/10.1016/S0885-3924(01)00361-X.
Vardy, J., Dhillon, H. M., Pond, G. R., Rourke, S. B., Xu, W., Dodd, A., Tannock, I. F. (2014). Cognitive function and fatigue after diagnosis of colorectal cancer. Annals of Oncology, 25(12), 2404–2412. [en ligne] https://doi.org/10.1093/annonc/mdu448.
Wang, B., Thapa, S., Zhou, T., Liu, H., Li, L., Peng, G. et Yu, S. (2020). Cancer-related fatigue and biochemical parameters among cancer patients with different stages of sarcopenia. Supportive Care in Cancer, 28(2), 581-588. [en ligne] https://doi.org/10.1007/s00520-019-04717-0.
Wang, X. S., Zhao, F., Fisch, M. J., O’Mara, A. M., Cella, D., Mendoza, T. R. et Cleeland, C. S. (2014). Prevalence and characteristics of moderate to severe fatigue: A multicenter study in cancer patients and survivors. Cancer, 120(3), 425-432. [en ligne] https://doi.org/10.1002/cncr.28434.
Wefel, J. S., Lenzi, R., Theriault, R., Buzdar, A. U., Cruickshank, S. et Meyers, C. A. (2004). “Chemobrain” in breast carcinoma? A prologue. Cancer, 101(3), 466-475. [en ligne] https://doi.org/10.1002/cncr.20393.
Weis, J. (2011). Cancer-related fatigue: prevalence, assessment and treatment strategies. Expert Rev Pharmacoeconomics Outcomes, 11(4), 441-446. [en ligne] https://doi.org/10.1586/erp.11.44.
Williams, A. M., Khan, C. P., Heckler, C. E., Barton, D. L., Ontko, M., Geer, J., Janelsins, M. C. (2021). Fatigue, anxiety, and quality of life in breast cancer patients compared to non-cancer controls: a nationwide longitudinal analysis. Breast Cancer Research and Treatment, 187(1), 275-285. [en ligne] https://doi.org/10.1007/s10549-020-06067-6.
Williams, F. et Jeanetta, S. C. (2016). Lived experiences of breast cancer survivors after diagnosis, treatment and beyond: qualitative study. Health Expectations, 19(3), 631-642. [en ligne] https://doi.org/10.1111/hex.12372.
Yavuzsen, T., Davis, M. P., Ranganathan, V. K., Walsh, D., Siemionow, V., Kirkova, J., Yue, G. H. (2009). Cancer-Related Fatigue: Central or Peripheral? J Pain Symptom Manage, 38(4), 587-596. [en ligne] https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2008.12.003.