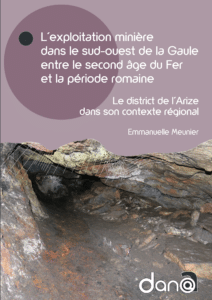UN@ est une plateforme d'édition de livres numériques pour les presses universitaires de Nouvelle-Aquitaine
Lieu d'édition : Pessac
Pour ne pas multiplier les codes, nous avons rassemblé dans un même tableau ces trois documents dont la tradition passe en grande partie par des copies dues à Jean-Raoul Marboutin et Jean Dubois.
Pour ne pas multiplier les codes, nous avons rassemblé dans un même tableau ces trois documents dont la tradition passe en grande partie par des copies dues à Jean-Raoul Marboutin et Jean Dubois.
Pour ne pas multiplier les codes, nous avons rassemblé dans un même tableau ces trois documents dont la tradition passe en grande partie par des copies dues à Jean-Raoul Marboutin et Jean Dubois.
Au terme de cette présentation, nous espérons que d’autres chercheurs sauront mettre en perspective le document que nous éditons et qui fait parcourir plusieurs étapes.
Cette section analyse les documents de façon à la fois typologique et chronologique.
Le volume où se trouve le bullaire de Valier porte l’ex-libris de Pierre-Jules Bourrousse de Laffore (1811-1890). Né à Paris pendant les études de droit de son père, mais d’une famille de Laplume, cet érudit fut d’abord médecin, membre correspondant de l’Académie de médecine
Les analyses du bullaire de Valier sont presque toutes basées sur le même schéma : tel laïc a cédé « la dîme ou une partie de la dîme de l’église de M/ Saint-N. », ou assez souvent « de la paroisse (de l’église de Saint- N.) », ou parfois « simplement la dîme de M. », en référence à un cadre institutionnel bien clair au XIIIe siècle.
Malgré la présentation qu’en a fait l’abbé Barrère, le responsable du bullaire est mal connu. Certes, Johannes Valerii se définit lui-même au début du bullaire comme clerc, notaire, originaire d’Ivrée et Piémontais, procureur et vicaire de Marc-Antoine de la Rovère, évêque et comte d’Agen pour lever tous les revenus de l’évêché.
par Stéphane Capot
Notre gratitude va à tous ceux qui ont entouré l’élaboration de cet ouvrage. D’abord Jean-Bernard Marquette qui n’en a hélas pu voir l’aboutissement.
Vers 1520, Jean Valier, un Piémontais au service de l’évêque d’Agen a compilé 158 bulles pontificales, principalement celles qu’un précédent évêque avait obtenues en 1309 de son neveu le pape Clément V. Elles vidiment et confirment 878 actes originaux (essentiellement des cessions de dîmes par des laïcs vers 1240-1290). À en juger par les quelques originaux et copies modernes conservés Valier en donne une analyse fidèle.