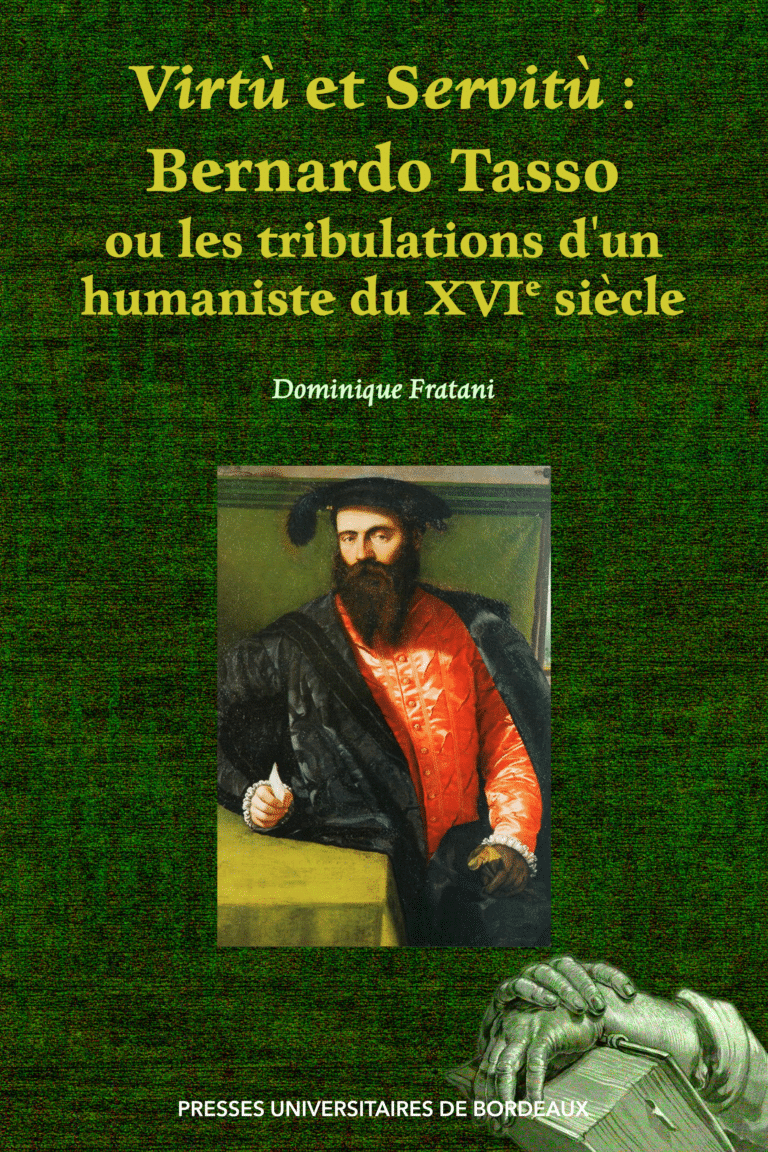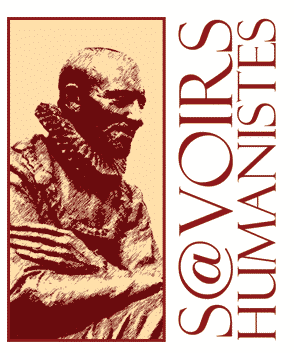La construction d’un modèle d’humaniste
La lecture des deux recueils de lettres de Bernardo Tasso met en avant des contenus parfois très différents liés à un contexte personnel et historique qui a changé pendant les onze ans qui séparent les publications. Dans les deux cas cependant, même si les modalités divergent, il s’est efforcé de soigner son image publique. En dépit de ce souci constant, sa réputation s’est modifiée au cours des années ainsi que cela ressort de l’analyse des volumes et de la comparaison d’une même démarche à des moments bien distincts de son existence.
On se souvient que, dans son premier ouvrage épistolaire, le secrétaire mettait l’accent sur sa stature de mentor d’un prince par un didactisme et un moralisme très prononcés étayés par une habileté technique raffinée dans la construction de ses épîtres. Il n’hésitait pas à prodiguer conseils et reproches autour de lui que ce soit à sa famille, à ses connaissances ou encore au seigneur qu’il servait ; sa lettre concernant l’éducation de Cornelia représentant un peu le point d’orgue de cette tendance. Dans l’ensemble, il fondait son livre sur une veine moralisatrice qui se manifestait par l’émergence de la notion de « virtù », terme dont la polysémie allait bien au-delà du sens moral dans lequel on pourrait l’entendre de prime abord et qu’il convenait d’interpréter comme un ensemble de valeurs humaines et de compétences professionnelles nécessaires à forger et à consolider une réputation en société. Le mot, qui représentait en quelque sorte une marque de fabrique de la plupart des hommes de lettres, se retrouvait aussi sous la plume de l’Arétin qui, pourtant plus libre que la plupart de ses semblables à partir de son installation à Venise, tentait, dans ses recueils épistolaires, de tracer de lui-même l’autoportrait d’un « virtuoso »1. Cette qualité fut fréquemment revendiquée par son rival en littérature épistolaire qui insistait sur des valeurs d’amitié, de fidélité et d’honnêteté. Tout en servant à louer quelque interlocuteur2, notamment le seigneur qui lui prêtait ou aurait dû lui prêter l’oreille, dans bien des cas, ce vocable témoignait plutôt d’un sentiment sous-jacent de supériorité intellectuelle et morale, était synonyme de moralisme didactique et imprégnait nombre de lettres, pour variées qu’elles fussent. Cette « virtù » au sens moral, humain et professionnel du terme valorisait son travail et sous-entendait un devoir d’éclaircissement rationnel de l’action du prince.
Les exemples sont très nombreux3, mais quelques citations suffisent à démontrer brièvement l’importance de cette notion. La lettre XXI se distingue par une forte tonalité sentencieuse et le moralisme du texte se développe jusqu’à couvrir presque deux pages entières où les conseils se succèdent :
Ricordatevi che forti e magnanimi quelli sono da giudicare, non che fanno l’ingiuria, ma che gli uomini dalle ingiurie difendono. Se maggiore gloria a far così v’è paruto da acquistare, voi v’ingannate, e chi questo consiglio v’ha dato è stato più malizioso che prudente […]. Non sapete voi, carissimo Signor mio, che la magnanimità, che ama più l’essere che il parere, nelle operazioni consiste e non nella gloria? e che (come dicono gli Stoici) la fortezza de l’animo è virtù, che per la giustizia ad ogni ora combatte e per la equità?4
Le passage est prolongé par une accumulation paratactique d’interrogations rhétoriques et de conseils destinés à instruire le condottiere et, en s’éloignant du caractère plutôt guerrier et diplomatique du début de l’ouvrage, semble bien fonctionner comme un véritable speculum principis :
Non vi lasciate da cotesti vostri desideri d’onore, de’ quali è pieno l’altissimo animo vostro, sforzare a far cosa che giusta e onesta non sia, né vaglia in voi più lo sciocco appetito d’una falsa gloria che il ragionevole desiderio de la vera […]. Ritiratevi da questa impresa e in altra parte e con altri mezi che questi non sono cercate di trovare la vera gloria5.
Si, dans son premier florilège épistolaire, le Tasse n’hésitait donc pas à prodiguer conseils et réprimandes à son entourage, à se définir comme un homme vertueux6 et à comparer implicitement sa fonction à celle du courtisan telle qu’elle avait été prônée par Castiglione7, plus tard encore, dans celui qui fut publié en 1560, il persévérait dans son intention de faire fonction de mentor. Vers la fin de sa carrière, dans un contexte historique bien précis, celui de la guerre de Toscane avant le désastre de Marciano8, il s’adressait à son protecteur en insistant sur la nécessité pour un seigneur de pouvoir se fier à des conseils dépourvus de toute adulation :
Signor mio Eccellentissimo, si suol dire che un principe non ha bisogno de cosa alcuna più che di persona che gli dica il vero; e massime in questo così corrotto e infelice secolo; e vo’ che sappiate che il fedele e prudente servidore è quasi colonna saldissima e sostegno de l’onor del Padrone e al contrario l’adulatore machina da ruinare e precipitare la dignità e la gloria sua9.
Avec toutes les précautions oratoires d’usage, il mettait en doute l’opportunité pour le prince de se rendre à Sienne. Pour des raisons qui échappent au lecteur d’aujourd’hui, il semblerait que la réputation de ce dernier était alors en péril et que son secrétaire lui recommandait de faire preuve de prudence.
À travers ces exhortations, ces réprimandes, voire les déplorations adressées plus tardivement au prince de Salerne, le Tasse se dépeignait non seulement comme un scribe, un poète, mais aussi comme un directeur de conscience, jaloux de l’honneur de son protecteur, garant de son image vis-à-vis du public et n’hésitant pas pour cela à jouer un rôle didactique. Sous le couvert de l’humilité, il avait bien l’ambition de mener son seigneur sur le chemin de la vertu et, dans un synthétique miroir des princes qui ouvre le troisième livre du premier volume, il lui rappelait la priorité que constitue la fidélité à Dieu et à sa patrie :
Non credo Illustrissimo Signor mio, che sia alcuna persona di giudizio, che non sappia, che doppo Iddio, niuno obligo è maggior, che quello che abbiamo alla patria […] e l’obligo che le abbiamo è tale, che nelle sue necessità un animo nobile ha da prepor la morte sua alla servitù, al danno e all’infamia della patria sua10.
Nombre d’écrits permettent de constater que, dans son effort pour devenir la conscience du prince, notre auteur se livrait à une activité d’information, voire d’éducation. Le recueil épistolaire se transforme ainsi par moments en un véritable manuel ad usum Delphini tout en dessinant en filigrane l’image que le Tasse se faisait de son office, celle d’un bon secrétaire, soucieux à la fois de son honneur et de celui du puissant personnage aux côtés duquel il se trouve. Un serviteur aimant, sage et prudent, qui ne se confond pas avec la masse de ceux qui ne s’inquiètent que de leur intérêt, allant même jusqu’à se préoccuper de la réputation des proches du prince11. Pour comprendre cette posture, qui relève peut-être de l’ostentation de ses qualités, on peut évoquer son statut, car contrairement à d’autres, à un Trissino par exemple, il passa toute sa vie au service de différents mécènes et, jusqu’à la fin de sa carrière, par conviction ou par intérêt, ou pour les deux raisons à la fois, il mena un combat d’arrière-garde en se présentant comme un courtisan au sens où un Castiglione pouvait encore l’entendre, alors qu’à son époque, il ne pouvait plus être qu’un exécutant. Le déphasage, sans doute plus apparent que réel12 avec son temps, s’exprime à la fois dans l’affirmation de sa fidélité et dans sa quête d’une nouvelle place qui l’aurait sorti de l’état de nécessité qui semble avoir été son lot quotidien très tôt dans sa carrière13.
Quant aux véhémentes protestations ou aux déclarations d’amitié qui parcourent les recueils, elles témoignent peut-être de son dépit d’être ravalé au rang de serviteur. Ces lettres sentencieuses tendent donc à suggérer l’image flatteuse d’un « virtuoso » capable de guider les princes qui l’employaient autant sur le plan politique14 que sur le plan moral en leur inspirant les meilleures décisions à prendre dans leur propre intérêt et parfois pour le bien de tous. Il semblerait que le Bergamasque se soit ici posé en exemple à la fois éthique et littéraire, notamment au moyen de cette propension moralisatrice qui transforme les lettres en catalogue de vertus morales et sociales jusque dans la correspondance familiale dont la publication a contribué sa renommée. Les déboires professionnels et personnels, connus sans doute avant même son exil, pourraient être à l’origine de ce processus propagandiste. Cette tendance à user et à abuser d’intonations moralisatrices, didactiques ou sentencieuses selon les cas et parfois toutes ensemble, fait partie des constantes d’une écriture qui tend à construire une image plus ou moins artificielle dans le dessein que l’on sait15.
Dans un siècle qui subit de plein fouet les traumatismes induits par « i colpi delle oltremontane guerre »16 ainsi que la crise religieuse ouverte conjointement par la perte d’autorité morale de la papauté17, le schisme luthérien et le sac de Rome, le courtisan ne fait rien d’autre que de proposer une figure rassurante. Parfois quelque peu passéiste, parce que globalement inspirée du statut de l’intellectuel humaniste à une époque où le secrétaire n’est plus destiné à instruire le prince mais à le servir18, la conception qu’il se fait de sa charge lui paraît somme toute valorisante auprès d’un public qui ne se limite sans doute pas à l’élite choisie dans ses introductions19. Soucieux d’apparaître tel un parangon de vertus, Bernardo cultive sciemment l’image d’un gentilhomme au sens plein du terme, non seulement lettré reconnu parmi ses pairs mais aussi courtisan, conseiller et bon père de famille. La prudence qu’il affiche contribue à la création d’un modèle éthique autant que les valeurs d’honnêteté, de moralité, de religiosité et de sagesse revendiquées au fil des pages et que les compétences professionnelles mises en évidence dès le début de l’édition de 1549-155920. En se représentant comme un « virtuoso », il met en avant une véritable stratégie d’autovalorisation fondée sur une codification implicite de qualités dont le catalogue semble parfois bien proche d’un véritable plaidoyer pro domo sua21. Sans ignorer les liens de son recueil avec toute la tradition rhétorique, classique, médiévale et humaniste, et sans le limiter à un pur phénomène sociologique, il apparaît à peu près indéniable que ce livre de lettres se présente dès lors comme un véritable manuel de comportement22.
S’appuyant sur la diffusion massive que permettait déjà l’imprimerie en cette moitié de XVIe siècle, ces lettres publiées contribuent donc à la construction d’une autobiographie élogieuse – et sans doute quelque peu mensongère – partie intégrante et conditio sine qua non d’une politique littéraire destinée à transformer l’auteur du florilège en secrétaire reconnu et estimé et par conséquent digne de servir les princes. Ce faisant, le Tasse anticipe sur les nombreux traités qui définissent les fonctions de ce personnel lettré dans les années 1564 à 163023, car il s’agit bien pour lui de proposer à la fois des modèles normatifs de textes formant un véritable manuel de technique épistolaire24 et à la fois une représentation idéale de ce que doit être le personnage d’un point de vue professionnel et humain. En d’autres termes, par rapport à la trattatistica légèrement plus tardive qui scindera la partie rhétorique et technique (le formulaire et les lettres données en exemple) de la partie éthique et culturelle25, le Tasse semble vouloir concilier ces deux aspects et produire un discours qui institue le parfait secrétaire en insistant toutefois, avec ce qui apparaît comme une proposition de normes comportementales, sur une moralité forte.
Les lettres privées : un contre-exemple
À côté de cette indéniable volonté moralisatrice et didactique ostensiblement arborée de manière à réhabiliter une image mise à mal par les tribulations que l’on sait, dans les deux recueils, comparaît également une catégorie de lettres difficilement définissable, car intégrant des textes à mi-chemin entre lettre de négoce et lettre familière et traitant des affaires privées de l’auteur. Ces lettres détonnent même sur les familiares par l’évocation de problèmes matériels et financiers qui, ordinairement, ne sont pas ou ne devraient pas être exposés à la face du monde. Atypiques et d’un niveau stylistique et rhétorique assez différent des exempla examinés plus haut, elles peuvent aider à cerner sa personnalité, rentrer parfois et/ou partiellement dans le cadre d’une littérature de la subjectivité et faire pendant à l’autoportrait fortement valorisant qui se dégage des lettres moralisatrices.
Parcourant l’ensemble de l’œuvre épistolaire, ces écrits s’intègrent parfois sans heurt marqué avec les textes littéraires et/ou formels qui occupent en particulier le premier recueil, dans la mesure où ils accueillent parfois de longues digressions sentencieuses et ampoulées et où l’influence des écrivains latins se ressent dans l’élégance avec laquelle les sujets les plus courants de la vie sont abordés. Ainsi, certains axiomes sont suivis d’une longue comparaison emphatique entre la générosité de la nature et la libéralité nécessaire au genre humain, mais peuvent simplement préluder à une requête d’exportation de vin :
L’uomo, Signor mio, non nasce solo a se medesimo, ma alla patria, a i parenti, a gli amici, a tutti gli uomini; e perciò così come la natura […] larga e liberale con noi comparte tutte le ricchezze sue […], così noi imitatori della sua liberalità, il favore e i beni che o la Fortuna o la nostra propria virtù ci ha acquistati, dovemo alla comune utilità donare […]. Ma perché non sia più lungo il proemio che la narrazione, vi dico ch’io vorrei col favor e auttorità di Vostra Signoria impetrar da Sua Maestà, ch’io potessi ogni anno […] cavar fuori del Regno dugento botti di vino per Roma, o per dove più utile mi tornasse26.
Les notions de débit et de crédit reviennent à plusieurs reprises et des passages évoquent sans pudeur particulière, mais non sans artifices rhétoriques, les problèmes économiques dont leur auteur semblait souffrir :
La mia necessità che non sopporta dilazione […]. Io son senza un danaio, ho alcuni debiti e molte cose mi mancano per lo bisogno della casa mia27.
En dépit de l’ostentation d’un moralisme presque omniprésent, le Bergamasque donne donc l’impression de suivre ses affaires privées et de surveiller au plus près ses intérêts en fustigeant parfois les comportements susceptibles de leur nuire. C’est ainsi que la lettre CVII s’ouvre sur l’éloge de l’honnêteté avant de laisser paraître son objectif, à savoir son refus d’annuler une créance et son exigence de la percevoir au prétexte que :
[I]l donar a voi che ricchissimi sete e liberali a chi ha modo di usar la magnanimità, non a me, che povero sono, si conviene28.
À l’instar de l’Arétin29, bien que de façon beaucoup moins virulente, le protégé de Sanseverino dénonçait ainsi à son tour l’avarice des grands30 en mettant en avant sa pauvreté. Au-delà du topos commun à la plupart des intellectuels de cour, il est vraisemblable que sa position parfois critique soit à l’origine de compromis nécessaires entre une « virtù » affichée et la précarité éventuelle de sa condition, comme en témoigne dès 1542-1544, une lettre au ton familier adressée à son beau-frère :
Questi miei debitori e massimamente quello amorevole amico mio, sono come cavalli che senza sprone non caminano. Però, poiché la mia necessità lo richiede e alla loro tarda natura si conviene, spronateli, e se non basta lo sprone, operate la verga e il bastone […]. Sovra tutto vi raccomando il negozio dell’assessore, acciò che, sì come io mi doglio della sua taccagneria, egli non si goda del danno mio31.
D’autres passages de ce recueil traduisent une situation parfois précaire. On aurait pu croire à une certaine stabilité financière au moins pendant les années 1542 à 1552, avant qu’il ne soit frappé par la condamnation de la justice espagnole, mais plusieurs lettres de négoce dans lesquelles il expose les difficultés qu’il rencontrait dans le recouvrement de ses créances sont imputables précisément à cette période. Ces témoignages détaillés apparaissent plutôt inhabituels par rapport à ce qui était imprimé à l’époque. Dès 1542, des plaintes concernant des embarras pécuniaires s’exhalaient dans des textes adressés à des membres de sa famille. Ainsi après que son innocence avait été reconnue par le prince, il écrivait à son cousin le Cavalier Tasso :
La mia povertà è grandissimo indizio e argomento della mia virtù […] perché non pur mi trovo altra facultà, che quella che è piaciuto al signor principe di donarmi, e la dote di mia moglie; ma questa ancora aggravata d’alcuni debiti32.
La lettre LXXXI scelle la fin du malentendu dont il avait été victime et évoque une somme de deux cents ducats qui auraient dû lui revenir et que le prince aurait eu l’intention de s’approprier, nous fournissant ainsi un éclairage intéressant sur l’état calamiteux des finances de Sanseverino contraint à engager les revenus des charges offertes à ses courtisans pour payer ses propres dettes33. De fait, l’extravagante prodigalité de l’aristocrate napolitain était notoire, ses dépenses excessives mettaient sérieusement en péril ses finances, parfois celle de ses proches, et il ne fallait pas toujours compter sur ses promesses de don34.
Toujours à la même époque, Bernardo réitérait ses besoins et commençait à mentionner sa pauvreté35 :
Son creditore di cento e sedici scudi d’oro […]; la somma è poca, io in bisogno.36
Ho più debiti alle spalle che scudi nella cassa, né altro ho, con che vivere con la mia famiglia, che queste entrate37.
La tonalité de ces textes semble annoncer celle qui caractérise quelques passages du second recueil épistolaire et justifie déjà partiellement l’expression d’« accatonaggio letterario » à laquelle recourt Dionisotti à propos de l’Amadis38. En 1544, lors de la guerre franco-espagnole qui se déroulait dans le Piémont, le Tasse réclama la rançon d’un prisonnier qui lui était due au nom de l’honneur et de ses nécessités. Entre 1547 et 1548, plusieurs missives traitent de ses affaires privées et notamment de ses démêlés avec des débiteurs39. Le premier livre se clôt d’ailleurs sur ses demandes à l’un d’eux de régler une somme modique à sa place et à un ami de payer à pour lui deux ducats à son serviteur40.
Au moment de la préparation et de la publication du premier volume, l’une des raisons de cet état de fait réside peut-être dans les fréquents voyages, apparemment insuffisamment défrayés, qu’il devait effectuer pour le compte du prince :
Né io sono persona, come alcune che voi sapete, che faccia industria e mercatanzia di queste andate; anzi, vi ho io spessissime volte posto del mio, sicché ancor me ne sento; e so che Sua Eccellenza lo sa. Volere dunque andare in Ispagna, non isperando di potere né al mio debito né al suo desiderio soddisfare senza poter fare cosa che le piaccia […] mi potrebbe far men caro a Sua Eccellenza di ciò che io merito di esserle41.
Il est toutefois curieux de rencontrer ce genre de doléances à ce moment-là de son existence, alors qu’il bénéficiait de provisions et de rentes qui le mettaient largement à l’abri du besoin, puisque sa charge de secrétaire lui procurait un salaire annuel qui alla jusqu’à neuf cents ducats et qui dépassait celui des gouverneurs espagnols de province42. En 1559, il fait lui-même le point sur ce qu’il possédait quand il était au service du prince en déclarant qu’il percevait une partie des taxes prélevées sur une activité artisanale située sur un territoire appartenant à la baronnie des Sanseverino, un pourcentage sur les bénéfices de la douane de Salerne, peut-être équivalent à cent ducats par an, et des rentes sur un lac qui était un bien allodial. Si on ajoute qu’il était titulaire de la chancellerie du prince et propriétaire d’une maison, il semblerait pour lors que, au moins pendant la première partie de son existence, jusqu’en 1552, il ait joui d’une situation plutôt enviable43. Cette hypothèse est confortée par une lettre de 1556, qui atteste un certain bien-être matériel passé :
Ella sa che più volte m’ha allegato per un essempio di felicità, dicendo ch’io aveva una bella e virtuosa moglie da la quale ero amato e la quale amava estremamente; ch’io aveva bellissimi figliuoli, assai ben accomodato di facultà, una bellissima casa e ben guarnita così di ornamenti, come d’ogni cosa necessaria44.
Quoi qu’il en soit, si même en ces années fastes, le poète semble avoir connu des moments difficiles, il ne faut guère s’étonner que la dénonciation de son dénuement s’accentue encore dans son deuxième recueil épistolaire, plus autobiographique que le précédent, même si d’autres textes, volontairement écartés de la publication, n’ont été mis au jour que dans l’édition Campori. L’écho de ses malheurs et de ses pertes retentit également dans une de ses odes :
Il pover villan ch’ha sparso il seme
Nel suo campo fecondo,
E già lieto e giocondo,
Scort’a la riva la sua fida speme,
Di nullo tempo rio paventa o teme,
Se poi si vede il già raccolto frutto,
Onde le lunghe brame
De la pallida fame
Saziar sperava de’ figliuoli, tutto
Da nimico furor arso e destrutto,
E scorge da vicin l’orrido verno
Che riversa dal Cielo
Ognor la neve e ‘l gelo,
Non possendo far schermo al duol interno,
A la ragion di sé toglie il governo,
E disperato di poter giamai
Ristorar il suo danno,
Perché i frutti de l’anno
Futuro incerti e son lontani assai,
Assorda il Ciel di dolorosi lai;
Pur con la vista de la casta moglie
E de la famigliuola
Amata si consola,
Ché la presenza sua talor gli toglie
Una gran parte de l’acerbe doglie.
Et io che quasi ardito pellegrino
Solcando varii mari
Con venti ognor contrari,
Malgrado del furor d’empio destino
Era già giunto al fin del mio camino,
E con l’ancore salde e col ritorto
Canape la mia barca
Di ricche merci carca,
Senza temer del mare oltraggio o torto,
Avea legato nel securo porto,
Da non prevista e subita tempesta
Di vento disleale,
Che la vita mortal
Col fiero orgoglio suo turba e molesta,
Disciolto il legno, fui respinto in questa
Onda del mondo misero e fallace.
Così fuor del mio nido,
Mi tolse il flutto infido,
Che non osserva mai tregua né pace,
Le merci e ‘l legno con la man rapace;
E, ciò che più i miei giorni oscuri e neri
Rende, la cara Donna
Ferma e salda colonna
Ov’appoggiar soleva i miei pensieri,
E i pegni del mio amor securi e veri
Vivon sott’altro cielo, ahi dura sorte
Ahi meschino, chi fia
Che ‘n questa pena ria
E più d’ogn’altra cruda mi conforte?
In quest’esiglio mio lungo e gravoso
Il fiero strale scocchi,
Chi chiuderà quest’occhi?
Chi fia del mio morir tanto pietoso
Che ‘l morto viso mesto e sospiroso
Bagni d’amaro e lagrimoso umore?
E chi ne la partita
De la misera vita
Mi darà i baci estremi, e con dolore
Farà le pompe del funereo onore?
Pon omai freno a l’ostinato orgoglio,
Fato crudele e duro,
Ch’io non son saldo muro
Che possa, né sassosa Alpe né scoglio
A l’impeto durar del mio cordoglio45.
Les allusions à un exil et celles à sa femme qui vit sous d’autres cieux permettent de la situer entre mars 1552 et février 1556, c’est-à-dire après son départ pour la France et avant la mort de Porzia. Peut-être se trouvait-il à Rome où, lorsqu’il rentra de sa mission infructueuse à la cour d’Henri II, il s’installa de manière à être près de Naples afin d’obtenir la sortie du Royaume de Porzia et de Cornelia.
Son impécuniosité chronique et l’espoir – par la suite déçu – d’être récompensé d’une manière ou d’une autre, furent en partie à l’origine de sa décision de suivre le prince de Salerne en exil. Vers la fin de son existence en revanche, en une période où ses problèmes financiers se faisaient sentir de façon particulièrement aiguë et où il n’avait plus aucun espoir d’aide de la part de son ancien maître, il protestait de sa fidélité envers lui et mettait en avant des motivations autrement plus nobles, telle que la nécessité de ne pas faire preuve d’ingratitude à son égard46.
Cette situation matérielle et financière est également imputable à la perte de la dot de Porzia, qui avait été retenue par la famille De’ Rossi. Très tôt47, Bernardo intenta un procès pour récupérer trois des cinq mille ducats qui lui étaient dus sans obtenir gain de cause, car même les mille cinq cents ducats de douaire restèrent entre les mains de ses beaux-frères. Cette conjoncture s’aggrava lorsqu’il fut inclus dans la sentence de la justice espagnole en 1552 et que ses biens furent attribués à sa belle-famille. Il n’eut pour lors de cesse d’obtenir au moins la restitution « di cinquemila ducati della dote ed antifato della meschina di mia moglie »48, tout en renonçant presque aussitôt à récupérer ses possessions, car :
Per la più parte, il prencipe mi aveva donate senza assenso dell’imperatore, la qual donazione, non avendo essi figliuoli, viene a esser invalida, e l’altre [facultà] sono state donate e vendute49.
Il faut croire que c’est en pleine connaissance de cause qu’il se résigna à la perte des biens qui lui venaient de son mécène, parce qu’il était bien placé pour connaître la «precarietà sempre più avventurosa delle finanze del principe »50. La fin de son existence fut à l’image de cette précarité et les lettres privées se multiplient donc dans le volume de 156051 en se faisant l’écho de ses conditions de vie. À leur lecture, se pose le problème de l’état de ses finances, non point par curiosité purement matérielle, encore qu’il puisse y avoir quelque intérêt à s’interroger sur l’existence au quotidien des grands hommes de lettres du passé52, mais plus simplement parce que toutes ces données finissent par constituer un filon littéraire, un leit-motiv53.
Le Tasse ne représente pas un cas isolé – nombreuses sont les lamentations des intellectuels sur les problèmes concrets auxquels ils se heurtent – mais, surtout vers la fin de son rapport avec Sanseverino, l’acrimonie avec laquelle il s’exprime est symptomatique d’un contexte de crise grave pour lui qui a tout perdu (ses biens, son épouse, sa santé, sa jeunesse) au service de son protecteur et qui ne parvient pas à se faire dédommager54. Son deuxième livre de lettres comporte ainsi quelques textes qui mentionnent d’abord discrètement, puis, comme en un crescendo soigneusement orchestré, de façon de plus en plus marquée, sa pauvreté dont il rejette toute la responsabilité sur son ancien mécène. Au nombre d’une trentaine, ces écrits rédigés entre 1554 et 155755 – c’est-à-dire les années de bannissement qui suivirent les tumultes de Naples, les plus difficiles, voire les plus dramatiques pour le vieux courtisan – occupent approximativement un tiers du volume et la thématique qui y est développée influe notablement sur l’image que le Tasse veut transmettre. Une analyse du vocabulaire récurrent met en lumière la prédominance d’une tonalité affective, compatissante, in primis pour lui-même. De fait, en dépit de l’amour proclamé pour son épouse, la déploration de sa mort est quantitativement circonscrite à une quinzaine de locutions disséminées dans des lettres de 155656, puis simplement évoquée dans les suppliques qu’il envoie à la cour d’Espagne ou aux plus éminents des courtisans de Philippe II. Le chagrin provoqué par la mort de Porzia, tout comme les lamentations sur sa triste destinée, semblent s’apaiser après que le poète a trouvé refuge auprès de Guidobaldo della Rovere57.
La malédiction du sort qui s’acharne sur lui s’exprime environ une quarantaine de fois58, jointe le plus souvent à la déploration de ses malheurs59. Cette tendance à l’autocommisération se traduit concrètement par des termes comme « miseria », « necessità », ou « estrema necessità » et « ruina» ou encore par des adjectifs tels que « povero » et « misero », parfois rehaussés par des expressions verbales comme « perduta la facultà »60, « perdute le mie comodità »61 ou « mendicando il vivere »62. Le regret des dommages subis lors de l’aventure napolitaine et de ses déplorables conséquences couvre ainsi un vaste champ sémantique et le degré de présence de cette terminologie s’avère plutôt élevé avec environ une cinquantaine d’occurrences63. Çà et là, à partir de 1553, des éléments encore plus matériels, comme l’évocation de sommes précises – qu’il s’agisse d’une partie de la dot perdue, de l’héritage de Porzia, du paiement de la provision que son ancien protecteur lui versait encore, de son montant, ou bien encore de ce qu’il lui restait pour vivre après avoir payé les dettes les plus urgentes64 – émergent de ce relevé lexical et complètent le tableau de la sombre réalité à laquelle il doit se confronter. Ses lettres au prince sont au demeurant sous-tendues d’accents pathétiques qui mentionnent sa pauvreté :
Vedete ora in quanto poco spazio di tempo io sia caduto da questo grado di felicità in una estrema miseria; io ho perduta la facultà tanto onoratamente e con tante fatiche e pericoli miei acquistata […]; ho perdute le mie commodità […] perduta la mia carissima moglie e con essa, fatto perder a’ miei miseri figliuoli la dote de la madre e tutta la speranza che mi restava di potergli sostentare […] ho perduta la grazia vostra, senza avervene data una minima cagione65.
Mais, la plus emblématique de toutes est peut-être la LXII au cours de laquelle, après avoir retracé les événements antérieurs, il résume en quelques mots sa situation :
Son rimasto vecchio, povero, anzi mendico, abbandonato da ogni soccorso umano, in arbitrio de la mia nemica fortuna66.
Entre 1554 et 1556, plusieurs requêtes d’aides, et particulièrement de prêt d’un logement, ponctuent sa correspondance67. Il n’hésite pas à solliciter quelque subside même à la cour de France, auprès de Marguerite de Valois68. Lors de ces années d’errance, il semble aussi avoir été obligé de s’endetter considérablement. Ainsi, dans un petit volume de lettres destinées à son compatriote et ami Marcantonio Tasca, il met en exergue son dénuement. Dans la première, il le prie de l’excuser s’il ne lui paye pas ce qu’il lui doit et, afin de lui faire entendre son état de nécessité, lui détaille les dettes qu’il a déjà contractées en n’hésitant pas à donner des chiffres :
Io vi giuro, Messer Marcantonio […] ch’io per viver, oltre quel ch’io son debitore a dei gentiluomini miei amici, oltre trenta ducati ch’io debbo al Mazzola e a Messer Jacopo Rosso, ho in pegno centodieci ducati di robbe al Giudeo, talmente che questa settimana, per l’ultimo, non essendomi rimasto altro, ho impegnato un paro di lenzuola69.
Il explique ensuite qu’il se trouve réduit à ces extrémités par une absence presque totale de paye des deux années précédentes et par son statut incertain auprès du duc d’Urbin, qui ne lui avait encore assigné aucune provision ni aucune charge spécifique. Ces justifications sont renforcées par des jurements sur la vie ou le sort de ses deux enfants qui contribuent à dramatiser le texte en faisant appel à la compassion du lecteur par le biais d’expressions particulièrement touchantes comme « poveri e innocenti figliuoli », « sfortunati figliuoli » ou « misero figliuolo » ou encore telles que « figliuolino di dodici anni »70 – formulation dans laquelle la charge affective du terme est intensifiée par le recours à un diminutif – mais, contrairement à ce qu’on pourrait croire à une première lecture, elles ne sont pas vraiment plus présentes que les autres termes énumérés précédemment71.
Bernardo évoque également une promesse de don pour l’Amadis, mais démontre que celui-ci ne suffira aucunement et il adjure son destinataire de bien vouloir attendre quatre ou cinq mois que son roman soit imprimé pour rentrer dans son dû :
Non vi aggravi avendo aspettato tanto, aspettare anco quattro o cinque mesi, sin ch’io abbia stampato il poema, col quale solo mi si darà il modo di pagarvi senza punto mancare72.
La date de la lettre n’est pas mentionnée, mais elle appartient à la période où il avait déjà prévu d’imprimer son poème à Venise, toutefois avant que l’Accademia della Fama ne l’approche à la fin de l’année, sinon il ne serait pas préoccupé de vivre à Venise avec deux serviteurs pendant quatre mois. Ses difficultés étaient alors bien réelles si, sur le point de s’installer pour quelques mois dans la cité lagunaire, il se trouva dans l’obligation de demander qu’on lui prête une maison à Murano :
Io verrò fra un mese […] per far stampare il mio poema e perché mi bisognerà trattenermi fra Padova e Venezia almeno cinque mesi e ‘l tener casa qui e costà non si richiede a la qualità del presente stato mio, ho pregato Messer Pompeo Pace, apportator di queste, che procuri d’avere il favor di Vostra Signoria per ottener da li Clarissimo fratelli de la felice memoria de l’Abbate di Carrara, la lor casa di Murano […]. In altro tempo, mi sarei vergognato di dar loro questo fastidio, ma ora mi bisogna accomodar a la qualità de’ tempi e de la mia fortuna73.
Le début de sa lettre à Marcantonio Tasca semble renvoyer à sa prise de service auprès de Guidobaldo della Rovere et, dans tous les cas, après juin 1558, date à laquelle le prince de Salerne aurait cessé de lui faire verser sa pension74. Sachant que Bernardo prit ses nouvelles fonctions en septembre 1558 et qu’il mentionne alors clairement dans sa correspondance une longue maladie de son nouveau protecteur75, on peut légitimement supposer que cette lettre a été rédigée à l’automne 1558, entre la fin du mois d’octobre et celle du mois de décembre. Un autre écrit vient cependant contredire, au moins en apparence, les propos tenus à Marcantonio car, même si dans les premiers temps de son arrivée à Urbin à la fin de l’année 1556, Bernardo n’était effectivement qu’un hôte, de marque certes, mais rien de plus76, le 20 novembre 1557, c’est-à-dire à un moment où ses rapports avec le prince de Salerne étaient tendus et sa pension payée irrégulièrement, voire partiellement, il vante à son ami, Vincenzo Laureo, la magnanimité et la libéralité de Guidobaldo II :
[Sono] in buona opinione e grazia di questo magnanimo principe, il quale ogni giorno con novi segni di liberalità e di grandezza, avanzando il merito mio, m’obliga ad esserli perpetuo servitore77.
Une lettre du 6 juillet 1558, remercie le duc et reconnaît lui être grandement débiteur :
Per tutto dove mi portarà il loco e l’occasione comodità, procurarò di mostrar a Vostra Eccellenza l’osservanza che io le porto e il desiderio che io ho di pagar in parte il molto debito che io mi sento d’averle78.
Des témoignages de l’amélioration de son sort parcourent notamment ses conversations à distance avec Speroni. Ainsi le 7 novembre 1558, il reconnaît qu’il n’a plus la même hâte qu’auparavant de publier son poème, parce que la nécessité ne l’y pousse plus aussi cruellement79 et, à la fin de l’année 1559, alors qu’il réside déjà à Venise, il revient certes sur sa « povera fortuna »80, mais indique aussi à son ami qu’il peut le loger fort décemment et réitère son offre dans sa lettre suivante81. Il semblerait donc qu’à ce moment-là, il ne soit plus dans la misère, d’autant que l’accord signé avec l’Accademia della Fama le 6 janvier 1560 prévoyait un logement, la protection de son fils – quand bien même il ne participerait pas aux travaux de l’Académie vénitienne – et un salaire de deux cents ducats par an. C’est la même somme que celle que la République de Venise versait à ses enseignants82 et il y a fort à parier que ces émoluments déterminèrent son acceptation de la charge de chancelier. Mais déjà au cours de l’année 1559, sa rémunération était supérieure à la somme indiquée83.
Tout cela ne l’empêche pas, dans la quatrième lettre de ce tout petit florilège, qui devrait se situer après la publication de l’Amadis, d’avouer ne pas avoir réglé son dû depuis quatre ans et de s’en justifier par une accumulation de motifs dont certains laissent perplexes. En effet, il y affirme notamment que :
Vi promisi di pagarvi come si stampava l’Amadigi con due speranze, l’una che l’Accademia Veneziana me lo facesse stampare a spese sue, l’altra tenendo per fermo d’aver da’ signori e cavalieri, de’ quali aveva fatto menzione nel poema ed a’quali ho mandato a donar i libri, almeno mille ducati; e l’una e l’altra di queste speranze mi ha ingannato, perché l’Accademia fallite e non mi potè attender la promessa e m’è bisognato far compagnia per cinque anni, non avendo il modo di stamparlo a mie spese, col Giolito, partendo ugualmente la spesa e il guadagno84.
Il est exact qu’en dépit de la générosité du duc Guidobaldo, notre écrivain comptait sur des rentrées d’argent qui n’eurent pas lieu85, mais il ne s’en contredit pas moins par rapport à sa réponse à Girolamo Molino dans laquelle il avait refusé de faire imprimer son poème par la nouvelle académie de la Sérénissime en arguant de différents prétextes et en finissant par reconnaître qu’il souhaitait recueillir les bénéfices de l’opération86. Cela ne fut pas le cas, ou de façon très modique si l’on en croit une autre lettre à Marcantonio Tasca qui détaille l’aspect financier de la première édition du roman et la déception de son auteur face à l’ingratitude des bénéficiaires de ses dons, puis au vu de la quasi absence de bénéfices qu’il retira de l’opération. Le montant exact qui lui revint n’est pas clair et il dut faire parts égales avec Giolito :
Ne facessimo stampar 1200; 154 n’ho mandati a donare la più parte legati; né dal duca d’Urbino in fuori, ho avuto da alcuno altro che lettere laudando il poema e ringraziandomi; di sorte che cavatone 150 ducati del prezzo de’ libri che se ne sarebbe ritratto de li donati, senza la legatura che mi costa da 30 scudi, cavatone 150 ducati che mi costa la mia parte della spesa, cavatone che di 150 i quali, per aver bisogno, diedi al Giolito per cinque lire l’uno, vedrete ciò che m’è rimasto; e di que’ pochi m’ha bisognato pagar molti debiti fatti per viver e per vestir in Venezia87.
Pareille discordance s’explique peut-être par le fait que cette lettre est adressée à un ami qui est aussi son créditeur et pourrait donc contenir des exagérations, voire des contre-vérités. À moins qu’on ne retienne l’hypothèse de Foffano selon lequel le Tasse, qui s’était rendu à Venise en décembre 1558, avait rencontré des oppositions chez certains des académiciens, car la proposition qui lui avait été faite par Girolamo Molino relevait d’une initiative individuelle88. Quant aux revenus qu’il tira de l’impression de l’Amadis, il semble à peu près certain qu’ils ne furent pas à la hauteur de ses attentes. Dans l’ensemble donc, et à l’exception peut-être du calcul de ses gains, sa correspondance avec Marcantonio Tasca contraste avec les textes du recueil de 1560. Si on en juge par ses plaintes réitérées même en des périodes apparemment fastes, comme par le peu de scrupules dont il fit parfois preuve dans le remaniement de faits historiques, et sauf à supposer que la générosité du duc n’allait pas jusqu’à lui permettre de régler ses dettes, la fiabilité de textes rédigés à l’attention d’un créditeur semble pour le moins douteuse. Cela étant, nul doute que la fin de vie du Tasse fut placée à l’enseigne de la nécessité ainsi qu’en témoigne sa quête incessante d’un nouveau protecteur et, entre autres, une lettre envoyée à Benedetto Varchi au sujet d’une place éventuelle auprès du duc Cosme de Médicis en novembre 1562 à un moment où il venait de quitter le service du cardinal Louis d’Este89 :
Io mi contento de le spese per tre bocche et un cavallo e di 150 ducati di provisione, come ho qui dal cardinale, stando però in casa e servendo presso la persona sua. Ma quando sua eccellenza illustrissima si volesse servir di me presso qualche altro principe o in qual si voglia altro loco, dove mi bisognasse tor una fante, pagar pigion di casa e far alcuna altra spesa necessaria, non avendo io altre facultà sarebbe impossibile, con sì poco trattenimento, di potermi sostentare con dignità sua e mia90.
Parvenus à la fin de l’analyse de ce deuxième livre de lettres, il faut rappeler quelques observations déjà formulées, à savoir qu’il diffère profondément du précédent et connut une fortune éditoriale bien plus limitée. Sa dissemblance avec le modus scribendi publié auparavant réside précisément dans l’intégration au sein d’un volume destiné à une publication et à un lectorat comprenant les plus hauts personnages de la Péninsule, voire des cours espagnole et française, de toutes les typologies qui ont été recensées lors de ces deux derniers chapitres91. Or, on sait aujourd’hui que pour cette nouvelle initiative éditoriale, l’auteur bergamasque a procédé à un choix scrupuleux de missives et de réponses, à une véritable opération culturelle dont témoignent les nombreuses lettres renvoyées à l’anonymat des archives, d’où elles furent exhumées grâce aux recherches de Campori et des critiques qui lui emboîtèrent le pas.
Il est donc étonnant que ce lettré parfaitement au fait des usages des cours n’ait pas censuré partiellement ou totalement toutes les lettres traitant de ses affaires privées, de ses problèmes financiers, des pertes qu’il avait subies, de la pauvreté qui en découla, des dettes qu’il dut contracter, de l’obligation où il se trouva de quémander subsides et/ou logement, et ainsi de suite. Bien au contraire, il semblerait que ce soit délibérément qu’il insiste sur cette catégorie de textes en lui accordant une place de choix au sein de son ouvrage. Qui plus est, son dénigrement du prince sur la « scène du monde », son rejet sur lui de la responsabilité des erreurs commises en 1547 et dans les années qui suivirent, la dénonciation de son ingratitude et plus largement de l’avarice des puissants, le chantage implicite auquel il se livre parfois, ses menaces voilées sont autant d’éléments qui contribuent à éloigner très nettement le recueil de 1560 de celui qui le précède et à tracer un autoportrait bien différent de celui qui ressort des lignes moralisatrices et sentencieuses du premier recueil épistolaire.
Le modèle éthiquement et stylistiquement exemplaire auquel il semblait attaché est ici remis en question dans la mesure où sa nouvelle stratégie éditoriale ne peut guère conforter la précédente image d’un homme sage, bon père de famille, conseiller diplomatique, voire politique des princes, et où l’intrusion d’un lexique du quotidien se démarque du langage choisi du premier recueil. L’épistolier se donne ici à voir sous un tout autre jour et brouille l’apparence moralisatrice, volontiers didactique, qu’il avait transmise à son public quelques années auparavant. Ainsi, le Bernardo Tasso du deuxième volume apparaît-il bien différent de l’exemplum de moralité et de savoir-vivre du premier. Le parfait courtisan au cursus honorum exemplaire a cédé la place à un intellectuel pugnace parfaitement conscient du pouvoir de sa plume et qui n’a plus grand-chose à envier au modèle de l’Arétin. Le modus vivendi proposé dans les volumes de l’éditeur Valgrisi se heurte à la réalité humaine d’un courtisan vieillissant, désargenté et seul face à l’adversité, tandis qu’au modus scribendi destiné à illustrer les qualités intellectuelles et culturelles d’un secrétaire idéal succède à maintes reprises un lexique de l’ordinaire et parfois de l’aigreur.
En dépit des divergences macroscopiques qui ont été mises en évidence, il reste peut-être un point commun aux deux volumes qui expliquerait l’évolution de leur écriture et le ressentiment dont témoignent les lettres publiées en 1560. Si on s’en tient à ce qu’il laisse deviner de sa personnalité dans ses écrits, en raison d’un code comportemental plutôt rigide où débit et crédit devaient se compenser, l’écrivain aurait peut-être souffert de ce qu’il ressentait comme une véritable trahison et les reproches qu’il adresse à Sanseverino ne relèveraient pas seulement de la fiction littéraire. Même si, a posteriori, il est manifeste qu’il avait sa part de responsabilité dans le naufrage de son existence, son indigence et le désespoir qui en découlait l’amenèrent à réclamer ce qu’il pensait lui être dû et à menacer implicitement celui qu’il jugeait responsable de sa situation. En l’état actuel de nos connaissances, il faut se limiter à prendre en compte l’aspect formel et humain de ces livres de lettres et à conclure que, malgré la finesse de sentiments qui domine dans une bonne partie d’entre eux, non seulement les typologies épistolaires représentées varient considérablement, mais même la mise en scène du « je » dans le deuxième recueil se révèle surprenante. À moins que l’exhibition d’une rancœur tenace ne laisse deviner une autre facette de l’humanité de ce poète-courtisan. Le public de l’époque ne s’y trompa au demeurant pas, qui plébiscita l’aspect formel du premier recueil mais bouda le deuxième. Dans l’ensemble cependant, grâce surtout à son livre de lettres de 1549-1559, le Tasse s’inscrit de plain-pied dans la catégorie des grands épistoliers du XVIe siècle et compte alors parmi les hommes de lettres les plus connus de la Péninsule. Une étude de sa bibliographie met en évidence l’impact de ses œuvres sur le public et sur la critique aussi bien de son vivant que jusqu’à nos jours.
Notes
- Paul Larivaille, Pietro Aretino…, p. 227-228.
- Lettere, I, CXVI, p. 208-209 ; CXVII, p. 209-210.
- Trop pour qu’on puisse tous les citer. De fait, si l’on exclut les écrits de nature purement informative, une bonne partie des autres sont parcourus de conseils et de suggestions. C’est pratiquement une constante de l’écriture tassienne.
- Lettere, I, XXI, p. 54 : « Rappelez-vous qu’il faut considérer que les hommes forts et magnanimes sont non pas ceux qui offensent, mais ceux qui défendent des offenses. S’il vous a semblé acquérir de la sorte une plus grande gloire, vous vous trompez et celui qui vous a donné ce conseil a été plus malicieux que prudent […]. Ne savez-vous pas, très cher seigneur, que la magnanimité, qui privilégie l’être au paraître, réside dans les actions et non dans la gloire ? Et que (comme disent les Stoïciens) la force d’âme est une vertu qui combat à toute heure pour la justice et pour l’équité ? ».
- Ibid., p. 54-55 : « Ne vous laissez pas entraîner par les désirs d’honneur dont votre âme est emplie à faire chose qui ne soit ni juste ni honnête et ne laissez pas l’emporter en vous le vain appétit d’une fausse gloire sur le désir raisonnable de la vraie […]. Retirez-vous de cette entreprise et essayez de trouver la vraie gloire en d’autres lieux et avec d’autres moyens que ceux-ci ».
- Voir par exemple Lettere, I, LXXXI, p. 143-148.
- Baldassare Castiglione, Il Libro del… , p. 368-369.
- La lettre n’est pas datée, mais les quelques allusions qu’on y rencontre dès les premières lignes à Piero Strozzi, commandant des troupes franco-siennoises, au cardinal Jean du Bellay, chargé par Henri II de négocier une alliance avec Jules III, ainsi qu’à l’ambassadeur, représentant officiel du roi et rival du cardinal, laissent entendre qu’elle est postérieure à l’année 1552, lorsque Sanseverino passa dans le camp français et antérieure à la bataille de Marciano qui eut lieu en août 1554. De fait, au moment où elle fut rédigée, le secrétaire s’interrogeait : « Circa il loco dove [Ferrante Sanseverino] si possa trattenere per servizio del Re e de l’impresa, non volendo il Papa che venga in Roma ». Cf. Lettere, II, XLV, p. 126-131.
- Lettere, II, XLV, p. 126-131 : « Votre Excellence, on a coutume de dire qu’un prince n’a pas de plus grand besoin que celui d’une personne qui lui dise la vérité, et surtout en ce siècle si corrompu et si funeste ; et je veux que vous sachiez qu’un serviteur fidèle et prudent est comme un solide pilier qui soutient l’honneur de son maître, tandis qu’au contraire l’adulateur intrigue pour discréditer et détruire sa dignité et sa gloire ».
- Lettere, I, CCCVII, p. 501-506 : « Je ne crois pas mon très illustre Seigneur que nulle personne sensée ne sache, qu’après Dieu, aucune autre obligation n’est plus grande que celle que nous avons envers notre patrie […] et l’obligation que nous avons envers elle est telle que, dans ses besoins, une âme bien née doit faire passer sa mort avant la servitude, l’outrage et l’infamie de sa patrie ».
- Ainsi que le démontre la lettre I, XXVII, p. 62-67 à Claudio Rangone qu’il tente de dissuader de quitter le service de la Sérénissime pour passer à celui du Roi Très Chrétien.
- Selon les termes de Solerti (Cf. Angelo Solerti, Vita di…, I, p. 53), le Tasse semble avoir une conscience très précise de la fragilité de sa position et se préoccupe de donner à son fils une profession sûre.
- Voir le chapitre consacré aux lettres de négoce privées.
- Voir les dépêches diplomatiques ou de « ragguaglio » lors de la bataille de Pavie et de ses avatars (Lettere, I, II et suiv., p. 22-24), du sac de Rome (Lettere, I, XIV, p. 40-41), de la descente de Lautrec dans le sud de la Péninsule (Lettere, I, XVII et suiv.), de la campagne contre les Français dans le Montferrat (Lettere, I, CXLVI et suiv., p. 46-51) et ainsi de suite.
- Je rejoins en cela les conclusions auxquelles parvient Gianluca Genovese dans son introduction à La lettera oltre il genere, p. XXXV.
- Selon la célèbre formule de Machiavel dans son Art de la guerre,chap. V : « les coups des guerres ultramontaines ».
- Les motifs en sont bien connus et décrits, qu’il s’agisse du luxe de la curie romaine, de la vente des indulgences, de celle des bénéfices ecclésiastiques, de l’imposition de dîmes et autres taxes ou encore de la séparation entre détention du bénéfice temporel et exercice des devoirs spirituels pour lesquels celui-ci avait été institué, d’où, bien souvent, une mauvaise préparation des prêtres chargés de dispenser les sacrements à la place du détenteur de la rente.
- Or, on sait que le Tasse n’était pas dupe de la réalité de sa condition, le deuxième recueil épistolaire publié en 1560 en témoigne abondamment, tout comme les lettres inédites retrouvées par Campori.
- Sur la fortune du genre épistolaire, cf. Amedeo Quondam, Le «carte messaggiere». Retorica e…, p. 14 : « L’ […] ampiezza quantitativa [del libro di lettere] in assoluto rilevante » ; p. 30 : « Più di 130 sono i libri di «autore», ventisette le «raccolte» miscellanee; computando le ristampe, nell’arco cronologico 1538-1627, sono presenti circa 540 volumi di lettere ». Voir aussi Jeanine Basso, Le genre épistolaire…, p. 9.
- Voir Dominique Fratani, « Témoignages historiques et comptes rendus diplomatiques ; l’ouverture du recueil épistolaire de Bernardo Tasso », Studi tassiani, 2005, [i.e. 2008], LIII, p. 7-38.
- Notamment dans une lettre au Cavalier Tasso, I, LXXVII, p. 135-136 : « l’esperienza che avete veduta della mia passata vita e l’integrità che avete conosciuta in me […], la mia innocenza […], la verità […], la mia dignità […], la mia integrità […], la servitù e fede mia da tutto il mondo conosciuta », ou encore, de façon plus diffuse, dans de nombreuses autres dans lesquelles il n’est guère avare d’épithètes ou d’expressions élogieuses à son propre sujet. S’agissant d’une autre des caractéristiques, et non des moindres, de l’écriture tassienne, je me limite à un échantillon extrait des cinquante premières lettres du recueil ; voir donc Lettere, I, XVII, p. 47 : « io, che sono pazientissimo » ; I, XVIII, p. 48 : « uomo di provata prudenza e di candida fede » ; I, XXIV, p. 59 : « io grave e prudente ne sarò giudicato […]. L’ufficio loro è di dire male e il mio d’operar bene » ; I, XXIX, p. 69 : « [il] mio giudizio e […] la mia diligenza » ; XXXVII, p. 79 : « [la] mia fedel servitù » ; I, XXXVIII, p. 79 : « la sincerità dell’animo mio » ; I, XLIII, p. 86 : « avendo io un animo tanto grato » ; I, XLV, p. 89-90 : « la conscienza mia […] mio merito » ; I, LV, p. 100 : « l’onor mio ».
- Nicola Longo, « De epistola condenda… », dans Amedeo Quondam, Le «carte messaggiere». Retorica e …, p. 188.
- Cf. Adelin Charles Fiorato, « Grandeur et servitude du secrétaire : du savoir rhétorique à la collaboration politique », dans Culture et professions en Italie (XVe-XVIIe siècles), Paris, Publications de la Sorbonne, 1989, p. 133.
- Qui comprend aussi bien des variations sur un même thème comme la lettre de recommandation, la lettre amicale, la lettre de condoléances et ainsi de suite, que des prises de position sur des problèmes de rédaction tels que, par exemple, l’usage des formules de courtoisie.
- Cf. Adelin Charles Fiorato, « Grandeur et servitude… », p. 138.
- Lettere, I, CIII, p. 184-187 : « L’homme, Monseigneur, ne vit pas uniquement pour lui, mais pour sa patrie, pour ses parents, pour ses amis, pour tous les hommes ; c’est pourquoi tout comme la nature […] large et généreuse partage avec nous toutes ses richesses […], de même, imitant sa générosité, nous devons donner dans l’intérêt de tous la faveur et les biens que soit la Fortune, soit notre vertu individuelle nous a procurés […]. Mais afin que cet exorde ne soit pas plus long que la narration, je vous dis que je voudrais avec la faveur et l’autorisation de Votre Seigneurie, requérir Sa Majesté de pouvoir chaque année […] faire sortir du Royaume deux cents tonneaux de vin pour Rome, ou pour la destination qui me serait la plus utile ».
- Lettere, I, XCVI, p. 172-173 : « Mon état de nécessité qui ne souffre aucun délai […]. Je suis sans le sou, j’ai quelques dettes et bien des choses manquent aux besoins de ma maisonnée ». Lire aussi : Lettere, I, XCVIII, p. 174-175 : « Mi trovo al presente alquanto in disordine per le molte spese fatte » ; I, CXXVI, p. 227-230 : « L’entrate mie tali non sono, che non pur m’avanzino, ma alle necessità della vita siano bastanti; né io ho tanti danari in cassa, che più debiti non abbia sulle spalle ».
- Lettere, I, CVII, p. 194-195 : « Il vous sied davantage à vous qui êtes fort riches et prodigues ainsi qu’à ceux qui peuvent se montrer magnanimes de donner, bien plus qu’à moi qui suis pauvre ».
- Qui, rémunéré pendant quelques années par Ferrante Sanseverino, ne se priva pas de réclamer haut et fort les cent ducats annuels que le seigneur lui devait. Cf. Laura Cosentini, Una dama napoletana…, p. 52-55.
- Lettere, I, CVII, p. 195 : « State sano e non vogliate essere avaro con meco, dove con altri sete stato liberale ».
- Lettere, I, XCVI, Al signore Onofrio Correale, p. 172 : « Mes débiteurs et en particulier cet ami fort aimant sont comme des chevaux qui, sans éperon, n’avancent pas. Donc, puisque mon besoin l’exige et que cela s’accorde à leur lenteur naturelle, éperonnez-les et si l’éperon ne suffit pas, utilisez les verges et le bâton […]. Par-dessus tout, je vous recommande l’affaire de l’assesseur de sorte que, tout comme je me plains de son avarice, il ne s’enrichisse pas à mes dépens ».
- Lettere, I, LXIX, p. 139-142 : « Ma pauvreté atteste grandement ma vertu et témoigne en sa faveur […] car je ne dispose d’aucune autre faculté que de celle qu’il a plu à Monseigneur le prince de me donner, à l’exception de la dot de mon épouse ; mais celle-ci est grevée de quelques dettes ».
- Lettere, I, LXXXI, p. 143-148. Cf. Raffaele Colapietra, I Sanseverino di Salerno…, p. 179-180 ; Laura Cosentini, Una dama napoletana…, p. 52.
- Cf. Laura Cosentini, Una dama napoletana …, p. 70-71 : « La sua prodigalità lo metteva troppo spesso a mal partito […]. E di questo suo continuo bisogno di denaro e de gli strani mezzi di cui si serviva per procacciarsene, troviamo frequente ricordo ne le cronache del tempo » ; p. 85-86 : « prodigalità sconsigliata e abituale che impoveriva rapidamente l’erario del Principe […]. E non danaro soltanto, ma più spesso a compenso di servizi resi od in segno di benevolenza concedeva o donava terre e castelli come i re soltanto usano fare […] i più avevano terre e case; ma ad alcuni eran concesse gabelle, censi, mastrodattie, castellanie, ecc. ».
- Lettere, I, CVII, p. 194-195 : « Povera mia fortuna […] povero sono » ; I, CIX, p. 196-197 : « Duolmi che la mia fortuna è più tosto povera che mediocre per molti rispetti » ; I, CXVIII, p. 210-211 : « Se la necessità, Magnifico, Messer Angelo mio, più che il dovere mi fa importuno, iscusatemi, che il poverel digiuno viene ad atto talora che, in miglior stato, averebbe in altrui biasimato ».
- Lettere, I, XCVII, p. 173-174 : « Je suis créditeur de cent seize écus d’or […] ; la somme est minime, moi je suis dans le besoin ».
- Lettere, I, XCVIII, p. 174-175. « J’ai plus de dettes sur le dos que d’écus dans ma caisse et je n’ai rien d’autre pour vivre avec ma famille que ces revenus ».
- Carlo Dionisotti, « Amadigi e Rinaldo a Venezia… », p. 23.
- Lettere, I, CCXI, p. 384-385 ; CCXIV, p. 387-388.
- Lettere, I, CCXV, p. 388-389 : « Bartolomeo se ne ritorna non pure stanco dalle incommodità di questa corte, ma sazio di questi fastidi. Se pur tardasse a trovar padrone, affine che non si dolga della mia gratitudine, come io non mi posso doler del suo servizio, vi piacerà di accomodarlo di due ducati, che al mio ritorno ve li farò buoni. D’Augusta, il XV di gennaio del XLVIII ».
- Lettere, I, CXXVII, p. 230-234 : « Je ne suis pas quelqu’un qui, comme certains que vous connaissez, fait commerce et tire profit de ces voyages ; au contraire, j’en ai très souvent été de ma poche, de telle sorte que je m’en ressens encore et je sais que Son Excellence le sait. Vouloir donc aller en Espagne, sans espoir de pouvoir ne satisfaire ni à mon devoir ni à son désir […] sans pouvoir faire chose qui lui plaise […] pourrait me faire moins apprécier par Son Excellence que ce que je mérite ».
- Voir Laura Cosentini, Una dama napoletana…, p. 50, qui observe que, pendant ses années de service auprès du prince de Salerne, le salaire du Tasse avait augmenté au point d’égaler, voire de dépasser, les provisions versées à des gouverneurs ou des vice-rois de provinces espagnoles en Italie. Voir aussi Angelo Solerti, Vita di Torquato Tasso…,p. 5 : « Aveva allora Bernardo, oltre alla buona provvigione consueta, più di mille altri ducati all’anno di rendita, fortuna agiata per quei tempi ».
- Lettere, II, CLXVI, p. 575 : « A la donazione fattami dal fu Principe di Salerno, di dugento scudi sovra la gabella de la tinta di Sanseverino, né a li cento sovra la dogana di Salerno, non avea potuto ottener l’assenso di Sua Maestà cesarea, né parlo della cancellaria, ch’egli m’avea donata in vita mia e d’un mio figliuolo, che valeva quattrocento scudi l’anno; dimando solo in cambio de li ducento ducati annui ch’io aveva sovra il lago picciolo in Burgensatico e per lo valor de la mia casa venduta da la regia corte in Salerno, trecento scudi d’entrata perpetua nel ducato di Milano, perché nel regno di Napoli, per molti ragionevoli rispetti, ho deliberato non tornar mai più; e che siano posti i miei innocenti e poveri figliuoli in possessione de l’eredità materna ».
- Lettere, II, LX, p. 163-164 : « Vous savez qu’à plusieurs reprises vous m’avez désigné comme étant un exemple de bonheur, en disant que j’avais une épouse belle et vertueuse dont j’étais aimé et que j’aimais extrêmement, que j’avais de très beaux enfants, que je disposais de quelques facultés et d’une très belle maison bien décorée et fournie de tout le nécessaire ». Voir aussi Lettere, II, CXC, p. 613-616 : « Dopo aver perduto ottocento scudi d’entrata, una casa tale quale forse pochi gentiluomini miei pari avevano ».
- Rime, vol. II, XXVII, p. 321-324 : « Le pauvre paysan qui a semé son grain/ dans son champ fertile/ Et qui déjà content et joyeux,/ Apercevant son espérance qui parvient à bon port,/ Ne craint ni ne redoute plus aucun mauvais temps,/ S’il voit ensuite le fruit de sa récolte,/ Dont il espérait rassasier la pauvre faim/ Et le grand besoin de ses enfants,/ Complètement brûlé et détruit par une fureur ennemie,/ Puis aperçoit de près l’horrible hiver/ Qui déverse du ciel/ La neige et le gel à toute heure/ Ne peut parer à la douleur qu’il éprouve/ Et cesse de gouverner son esprit./ Désespérant de jamais pouvoir/ Remédier à sa détresse,/ Car les fruits de l’année/ À venir sont incertains et bien lointains,/ Il assourdit le Ciel de douloureuses plaintes./ Mais la vue de sa chaste épouse/ Et de sa petite famille/ Qu’il chérit le console,/ Car leur présence lui ôte parfois/ Bonne part de son amère affliction./ Et moi qui, tel un intrépide pèlerin,/ Sillonnant différentes mers/ Par des vents toujours contraires,/ En dépit de la fureur de mon perfide destin/ Était déjà parvenu à la fin de ma route,/ Et par de solides ancres et des cordes tressées/ Avait amarré ma barque/ Chargée de riches marchandises/ En un port abrité,/ Et ne craignait plus de tort ou d’outrage de la mer,/ Par une tempête imprévue et soudaine/ De vent déloyal/ Qui trouble et moleste par sa cruelle arrogance/ Nos vies de mortels,/ Je fus repoussé dans cette onde du monde miséreux et perfide/ par ma barque à la dérive./ Ainsi, hors de mon nid,/ De sa main rapace, le flot trompeur,/ Qui ne respecte jamais ni trêve ni paix,/ Me déroba mes marchandises et mon embarcation./ Et ce qui rend mes jours encore plus sombres et noirs,/ Ma chère femme,/ Solide et ferme colonne/ Sur laquelle reposaient mes pensées,/ Et les gages fondés et sincères de mon amour/ Vivent sous d’autres cieux, las misérable sort !/ Las, pauvre de moi, / Qui en ce dur malheur/ Plus que nul autre amer, me réconfortera ?/ Si en ce long et pesant exil/ La cruelle flèche m’est décochée,/ Qui fermera mes yeux ?/ Qui aura suffisamment pitié de ma mort/ Pour, triste et chagrin, baigner de larmes amères/ Mon visage mort ?/ Et qui, lors de mon départ/ De ma pauvre vie,/ Me donnera les derniers baisers et, affligé,/ Ordonnera les cérémonies des honneurs funèbres ?/ Mets désormais un frein à ton orgueil acharné/ Oh destin dur et cruel,/ Car je ne suis ni un robuste mur/ Ni une montagne rocailleuse, ni même un récif, / Pour résister à l’assaut de mon affliction ».
- Lettere, II, CLIV, p. 499 : « Signor mio, io non poteva senza grandissimo biasimo e senza giustissima nota d’ingratitudine, avendolo servito per ventitre anni ne la prospera fortuna e trovandomi beneficiato da lui, abandonarlo ne l’adversa […]. Onde per non mancar a l’onor mio, volsi perder tanta facultà, abbandonar la moglie da me sovra tutte le cose del mondo amata, i figliuoli piccioli, tant’altre cose ch’io m’aveva con sì lunghe e onorate fatiche de la mia giovinezza acquistate ».
- Avant même les années 1542-1544 auxquelles appartient la lettre I, CXXVII, p. 230-234 : « Sua Eccellenza sa che io ho mossa lite a’ miei cognati dei tre mila ducati; la quale importa tutto lo stato mio e de’ miei figliuoli ».
- Lett. Com. 3, 36, p. 132-134 : « de cinq mille ducats de la dot et du douaire de ma pauvre épouse ». Et on sait que Torquato s’évertua ensuite lui aussi pour récupérer l’apport de Porzia, mais sans succès.
- Lett. Com. 3, 36, p. 132-134 : « Pour la plupart, le prince me les avait données sans l’assentiment de l’empereur, et comme il n’a pas d’enfants, cette donation est caduque et mes autres [biens] ont été donnés et vendus ».
- Raffaele Colapietra, I Sanseverino di Salerno…, p. 179-180 : « la précarité, toujours plus incertaine, des finances du prince ».
- Ainsi que dans les recueils d’inédits qui ont été édités aux XVIIIe et XIXe siècles. Voir surtout Lett. MTasca, mais aussiLett. Com. 3 etLett. Camp.
- D’autant que la question avait déjà été indirectement posée par Dionisotti lorsqu’il affirmait polémiquement au sujet des écrivains italiens au cours des siècles : « Come quegli scrittori campassero, di che e per che, oltre che per scrivere, donde venissero e dove andassero, non pare sia il caso di discutere ». Cf. Carlo Dionisotti, « Chierici e laici », p. 56.
- Le premier recueil inclut déjà environ une douzaine de lettres de négoce qui traitent des affaires financières du poète-courtisan. Parmi celles-ci, les plus explicites sont les lettres I, XCVI, p. 172-173 ; XCVII, p. 173-174 ; XCVIII, p. 174-175 ; CVII, p. 194-195 ; CXVI, p. 208-209 ; CXVII, p. 209-210 ; CXVIII, p. 210-211 ; CLVI, p. 289-291 ; CCXI, p. 284-285 ; CCXIV, p. 387-388 ; CCXV, p. 388-389.
- Son ressentiment envers le prince prend parfois un ton de dénonciation, comme en témoigne une lettre restée inédite sans doute parce qu’autocensurée. Voir dans Lett. Camp., la XV qui est adressée au prince de Salerne, p. 100-101 : « Corpo di Dio, come non volete ch’io sia disperato vedendomi in tanta povertà che mi bisogni star nel letto per acconciarmi le calze, ché se non fossero i ferri vecchi che mi portai da casa, non avrei di che nascondermi le carni, e gli altri che vengono da quelle parti tutti carichi d’oro e di seta risplendono a guisa di raggio di sole. Insegnatemi, signor mio, di rimediare alla necessità con belle parole, ch’io sarò più modesto; altrimenti io dirò; il poverel digiuno viene ad atto talor che in miglior stato, avria in altrui biasimato ».
- Les plus explicites à ce propos sont les Lettere, II, XXXVI, p. 104-107 ; II, XLV, p. 126-131 ; XXXVII, p. 108-113 ; XL, p. 118-120 ; XLIII, p. 122-123 ; XLIV, p. 124-125 ; XLIX, p. 137-140 ; LI, p. 142-144 ; LIX, p. 159-162 ; LX, p. 163-165 ; LXI, p. 165-167 ; LXII, p. 168-172 ; LXIII, p. 172-173 ; LXIV, p. 174-176 ; LXV, p. 177-180 ; LXVI, p. 180-186 ; LXVIII, p. 196-199 ; LXIX, p. 200-204 ; LXX, p. 204-207 ; LXXIII, p. 220-223 ; LXXIV, p. 223-225 ; LXXVII, p. 241-243 ; CLXII, p. 519-521 ; CLXXIV, p. 558-567 ; CLXXV, p. 567-576 ; CXLVIII, p. 481-484 ; CL, p. 486-490 ; CLIV, p. 498-504 ; CLVII, p. 508-510 ; CLXXIX, p. 583-587 ; CXC, p. 613-617 ; CXCII, p. 619-621.
- La douleur du poète s’exprime essentiellement dans les lettres écrites entre février 1556 et juillet de la même année. J’exclue deux formulations qui, dans leur contexte, semblent se rapporter davantage aux pertes subies en général qu’à l’affliction éprouvée pour le décès d’une épouse aimée : « perduta la mia carissima moglie » (Lettere, II, LX, p. 163-165) : « perduta la moglie » (II, CLIV, p. 498-504 et II, CXC, p. 613-617).
- Même si la douloureuse séparation du prince de Salerne se produisit en 1558, plusieurs lettres attestent une amélioration de ses conditions de vie dès le début de l’année 1557. Voir Lettere, II, LXXXVIII, p. 269-271 ; XC, p. 274-276 ; XCII, p. 277-281.
- Les expressions qu’on rencontre le plus fréquemment sont : « maligna fortuna » ou ses variantes : « maligno destino », « malignità della mia fortuna », « adversa fortuna », « nemica fortuna » et apparaissent entre la lettre XXXVI du 1er août 1553 et la CXCIV du 10 juillet 1560.
- Dans ce cas également, entre la lettre XXXVII du 6 septembre 1553 et la CXC du 7 novembre 1559, des vocables tels que « miserie » (Lettere, II, XXXVII, p. 108-113) : « disgrazie » (II, LIX, p. 159-162) : « calamità » (II, LX, p. 163-165) : « adversità » (II, LXII, p. 168-172) ; ou « fastidi » (II, LXXXIV, p. 263-265) et d’autres encore reviennent plus de vingt-cinq fois.
- Lettere, II, LX, p. 163-164 : « j’ai perdu les richesses ».
- Lettere, II, LX, p. 163-164 : « j’ai perdu tout ce qui contribuait à mon bien-être » ; ou encore : « perdita ch’io ho fatta », Lettere, II, CLVII, p. 508-510.
- Lettere, II, CXLVIII, p. 481-484 : « mendier pour vivre ».
- Qui incluent également des vocables comme : « spese » (Lettere, II, LIX, p. 159-162) ; « ruina » (II, LX, p. 163-165) ; « elimosina » (II, CI, p. 303-306) ; « fame » (II, CLVII, p. 508-510) ; ainsi que des expressions telles que « consumarmi negli interessi e nelle usure » (II, CL, p. 486-490) ; « morir di fame » (II, CLIV, p. 498-504) ; et de nombreuses autres du même genre.
- Plus d’une trentaine d’allusions à ses difficultés financières parcourent ce corpus : « mille e cinquecento ducati » (Lettere, II, LVI, p. 180-186) ; « cinque milla scudi » (II, LXXVII, p. 241-243) ; « il pagamento della mia provisione » (II, CX, p. 325-326) ; « settantacinque scudi d’oro » (II, CXXXVI, p. 444) ; « quattordici scudi » (II, CXLVIII, p. 481-484) et ainsi de suite.
- Lettere, II, LX p. 163-164 : « Voyez à présent comment en peu de temps je suis tombé de ce degré de bonheur en une extrême misère ; j’ai perdu les richesses que j’avais acquises si honorablement par mon dur labeur et par les dangers affrontés […] ; j’ai perdu tout ce qui contribuait à mon bien-être […], perdu ma très chère épouse et, avec elle, fait perdre à mes pauvres enfants la dot de leur mère et tout l’espoir qui me restait de pouvoir les élever […] ; j’ai perdu votre grâce, sans vous en avoir donné la moindre raison ».
- Lettere, II, LXII, p. 168-172 : « Je me retrouve vieux, pauvre, voire miséreux, abandonné de tout secours humain, à la merci de ma fortune ennemie ».
- Lettere, II, XLIII, p. 122-123 ; XLIV, p. 124-125 ; LVI, p. 165-167.
- Lettere, II, LXIII, p. 172-173.
- Lett. MTasca, I,p. 9 : « Je vous jure, Messire Marcantonio, […] que, pour vivre, outre ce dont je suis débiteur envers quelques gentilshommes de mes amis, outre trente ducats que je dois à Mazzola et à Messire Jacopo Rosso, j’ai mis en gage pour cent dix ducats d’effets personnels auprès d’un Juif, si bien que cette semaine, en dernier recours, comme il ne me restait rien d’autre, j’ai engagé une paire de draps ».
- « pauvres enfants innocents » (Lettere, II, CLXV, p. 525-527, CLXXV, p. 567-574) ; « malheureux enfants » ; « infortuné enfant » (II, CXLVIII, p. 481-484) ; « petit garçon de douze ans » (II, LXXII, p. 220-223).
- On ne dénombre pas plus d’une trentaine de formules de commisération relatives à ses enfants, par rapport à une quinzaine concernant la mort de Porzia et plus d’une cinquantaine uniquement pour la déploration des pertes qu’il a subies lors de sa condamnation.
- Lett. MTasca, I, p. 11 : « Si cela ne vous pèse pas, puisque vous avez déjà tant attendu, veuillez attendre encore quatre ou cinq mois, jusqu’à ce que j’aie imprimé mon poème, car il me donnera seul le moyen de vous payer sans faute ».
- Lettere, II, CLXII, p. 519-521 : « Je viendrai dans un mois […] pour faire imprimer mon poème et comme il me faudra demeurer entre Padoue et Venise pendant au moins cinq mois et qu’il ne sied pas à mon état présent d’avoir une maison ici et là-bas, j’ai prié Messire Pompeo Pace, qui est porteur de ces lettres, qu’il gagne la faveur de Votre Seigneurie pour obtenir des Clarissimo, frères de l’abbé de Carrare d’illustre mémoire, leur maison de Murano […]. En d’autres temps, j’aurais eu honte de les ennuyer, mais à présent il me faut m’adapter à la qualité du moment et de ma situation ».
- Cf. Edward Williamson, op. cit., p. 36.
- Lett. MTasca, p. 10 : « Quando fui richiesto per nome di questo Illustrissimo Principe, mi fu dato intenzione, che Sua Eccellenza mi darebbe la medesima provisione che mi dava il Pricipe, né perancora sì perché il signor duca è stato nel letto invisibile da giugno sino a mezzo ottobre, sì perché sin a pochi giorni […] non mi è stata specificata, né assignata provisione alcuna, né risoluto in che officio l’abbia da servire ».
- Antonio Brancati, « Bernardo e Torquato Tasso… », p. 63-75.
- Lettere, II, CXXVII, p. 419-421 : « [J’ai] la faveur et je suis dans les bonnes grâces de ce prince magnanime qui, chaque jour par de nouvelles marques de libéralité et de grandeur qui vont au-delà de mon mérite, me contraint à être perpétuellement son serviteur ».
- Lettere, II, CLII, p. 493-494 : « Partout où je me trouverai et où l’occasion se présentera à moi, je tâcherai de montrer à Votre Excellence le respect que je vous porte et le désir que j’ai de payer en partie la dette considérable que je pense avoir envers vous ».
- Lett. Com. 3, 36, p. 132-134.
- Lett. Com. 3, 42, p. 142-143.
- Lett. Com. 3, 43, p. 143-147 et 44, p. 147-148.
- Lina Bolzoni, « L’Accademia veneziana: splendore e decadenza di una utopia enciclopedica », Università, Accademie e Società scientifiche in Italia e in Germania dal Cinquecento al Settecento, a cura di Letizia Boehm e Ezio Raimondi, Bologna, il Mulino, 1981, p. 117-168, voir en particulier p. 124, n. 26.
- Pietro Pagan, « Sulla Accademia “Venetiana” o “della Fama” », Atti dell’Istituto veneto di scienze, lettere e arti, 1973-1974, t. CXXXII, p. 359-392, voir p. 379.
- Lett. MTasca, IV, p. 16 : « J’ai promis de vous payer lorsqu’on imprimerait l’Amadis en me fondant sur deux espoirs, l’un que l’Académie Vénitienne le ferait imprimer à ses frais, comme cela m’avait été promis, et l’autre parce que je comptais fermement obtenir des seigneurs et des chevaliers que j’ai mentionnés dans mon poème et à qui j’ai envoyé des livres en don, au moins mille ducats. L’un et l’autre de ces espoirs ont été déçus parce que l’Académie a fait faillite et n’a pas tenu la promesse qui m’avait été faite et parce que, n’ayant pas les moyens de l’imprimer à mes frais, il m’a fallu me mettre en société pendant cinq ans avec Giolito en partageant également les frais et les gains ».
- Lettere, CXLVIII, 14 avril 1558, a Angelo Papio, p. 481-484.
- Lettere, II, CXLI, p. 456-461.
- Lett. MTasca, p. 16 : « Nous en fîmes imprimer mille deux cents ; j’en ai envoyé en don cent cinquante-quatre, pour la plupart reliés, et à l’exception du duc d’Urbin, je n’ai rien reçu d’autre que des lettres qui tressaient les louanges de mon poème et me remerciaient. Tant et si bien que si on retire cent cinquante ducats du prix des livres qu’on aurait pu obtenir de ceux qui ont été donnés, sans la reliure qui me coûte environ trente écus, si on retire cent cinquante ducats de ma participation aux frais, si on retire les cent cinquante livres que j’ai donnés à Giolito pour cinq lires chacun, parce que j’en avais besoin, voyez ce qui m’est resté et sur ce peu d’argent, il m’a fallu régler de nombreuses dettes contractées pour vivre et me vêtir à Venise ».
- Francesco Foffano, « L’Amadigi di Gaula di Bernardo Tasso », p. 249-310, voir en particulier la p. 267 et n. 2.
- D’après la correspondance publiée dans Lettere a Benedetto Varchi…, p. 403-404, le Tasse aurait pris congé du cardinal un peu avant de solliciter un emploi auprès du duc Cosme de Médicis par l’intermédiaire de l’homme de lettres florentin et par celui de Sallustio Piccolomini, représentant des Médicis à Ferrare.
- Lettere a Benedetto Varchi…, p. 404 : « Je me contente des frais de bouche pour trois personnes et un cheval et de 150 ducats de gages, comme ce que j’ai ici auprès du cardinal, à condition de demeurer dans sa maison et de servir auprès de sa personne. Mais si son excellence illustrissime voulait se servir de moi auprès de quelque autre prince ou en n’importe quel autre lieu, où il me faudrait prendre une servante, payer le loyer d’une maison et faire quelques autres dépenses nécessaires, comme je n’ai pas d’autres facultés, il me serait impossible, avec si peu d’émoluments, de pouvoir subvenir à mes besoins dans le respect de sa dignité et de la mienne ».
- C’est volontairement, parce qu’elles relèvent d’une autre intention, que les lettres de préparation de l’Amadis sont exclues de ce propos.