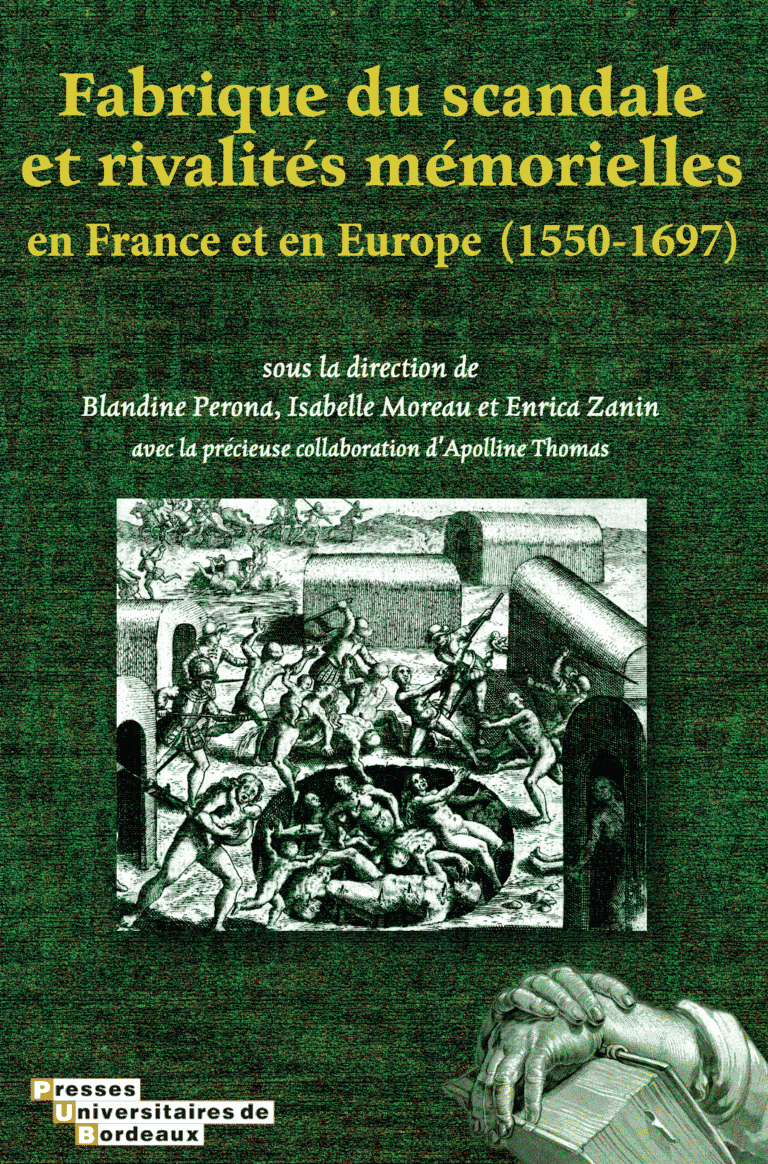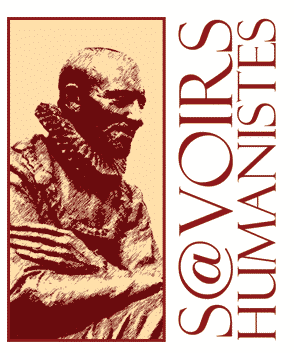« Quelle liberté y a-t-il en ce monde qui n’ait avec elle ses abus ?
C’est à nous, qui voulons être libres, à savoir les subir,
et c’est aux tribunaux, quand ils sont témoins de ces scandales,
qu’il appartient de les réprimer »
(Faustin Hélie, Traité de l’instruction criminelle, 1869)
Lier mémoire et scandale semble une évidence pour le juriste contemporain, plus encore depuis la fin du XXe siècle, lorsque la loi Gayssot a établi un délit d’opinion face à une vérité d’État, donnant naissance à un empilement de lois sur des sujets aussi divers et controversés – mais tout aussi scandaleux – que l’esclavage, l’homophobie, le colonialisme ou divers génocides, accompagné d’une prolifération de journées mémorielles. À tel point que certains auteurs évoquent un risque de « mémoricide » pour tous les événements douloureux de notre histoire non reconnus par la loi, tandis que d’autres s’inquiètent du développement de la « justice mémorielle ». Pourtant, cette même société hypermnésique réclame dans le même temps un « droit à l’oubli » au profit des individus qui la composent : il conviendrait de protéger la vie privée contre les effets néfastes du voyeurisme numérique, en particulier à propos de procès médiatisés. C’est toute la question de l’anonymisation des procédures, qui préoccupe l’ensemble des juridictions françaises et européennes. Il est vrai que les peines infamantes du droit pénal d’Ancien Régime paraissent bien douces, comparées à la flétrissure en ligne qui ne connaît pas de prescription. Les juristes sont conscients du danger qu’il y aurait à jouer de façon inconsidérée avec ce précieux bien commun qu’est la mémoire judiciaire, même si le procès, destiné à mettre fin au scandale causé par un crime, peut faire naître un nouveau scandale pour les parties qui y sont mêlées.
Il est aisé de discuter des risques issus des manipulations de la mémoire scandaleuse à l’époque contemporaine. La question est autrement plus complexe en période de guerre civile, au cœur des violences extrêmes que la France a connues au XVIe siècle. La réponse du roi Henri IV peut surprendre : par l’édit de Nantes, il ordonne à ses sujets un « éternel oubli » au nom de la nécessaire réconciliation entre protestants et catholiques. Nul ne peut imaginer raisonnablement que le souverain croyait en son pouvoir d’organiser une amnésie collective par la magie d’un discours législatif. En revanche, en vertu du droit de grâce traditionnel des rois de France, il lui était possible de jeter un voile d’oubli sur les crimes passés, d’exiger que ses sujets fassent de même, et d’interdire à l’avenir toute évocation d’une mémoire douloureuse. Dans le cadre de cette stratégie, le droit utilise plusieurs termes pour désigner les manifestations populaires rendues illégales par l’édit de tolérance : le trouble, le tumulte, la sédition, l’offense publique, la commotion populaire et bien évidemment, l’escland(r)e ou scandale, hérité des débats théologiques du Moyen Âge. Le scandale, présent dans l’Ancien Testament, notamment dans le Lévitique1, apparaît dans les écrits des premiers chrétiens à partir du IIIe siècle, et s’avère le contraire de l’exemplum, il est :
[…] l’occasion qui pousse à mal faire ou à errer dans la foi […] l’obstacle que le chrétien trouve sur la voie de son salut, […] ce n’est pas le péché mais le mauvais exemple qu’il donne, qui trouble la conscience de chaque chrétien ou menace la paix de la société chrétienne toute entière2.
Il n’y a pas lieu de revenir sur les enjeux théologiques, développés, dans cet ouvrage, par Anne-Pascale Pouey-Mounou, ni sur le scandale en droit canonique déjà bien étudié3. Il s’agit plutôt ici de cerner le sens que les juristes lui ont donné à partir de la Renaissance, ainsi que l’interprétation qui en a été faite, dans le cadre de la lente édification d’une monarchie absolue de droit divin. Peut-être même sera-t-il possible d’en retrouver quelques lointaines résonances dans un droit contemporain largement sécularisé.
La première difficulté, pour la période considérée (1550-1697), vient du fait qu’il existe très peu de dictionnaires juridiques, au sens où on l’entendra à partir du XVIIIe siècle, et que ceux-ci ne comportent pas, sauf de rares exceptions, de vedette « scandale ». On peut citer L’Introduction à la pratique, publiée en 1679 par l’avocat Claude de Ferrière4, puis en 1734 sous la forme d’une édition posthume et remaniée par son fils Claude-Joseph et dotée d’un titre qui se veut plus moderne : le Dictionnaire de droit et de pratique5. Aucune des deux versions destinées aux praticiens – peut-être pour cette raison même – ne juge utile de définir le scandale. Quelques années plus tard, le Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, de Joseph-Nicolas Guyot6, est tout aussi silencieux. Le même constat s’impose avec d’autres ouvrages similaires tels que les Questions de droit, de jurisprudence et d’usage de Simon Mallebay de La Mothe (dans ses diverses éditions, de 1766 à 1787)7 ou le Dictionnaire de jurisprudence, de Prost de Royer (nouvelle édition du Dictionnaire de Brillon), alors que les deux auteurs se caractérisent pourtant par une recherche de définitions des principes juridiques, en vue de simplifier et unifier le droit français. En revanche, le Dictionnaire de la police de La Poix de Fréminville (1758)8 comporte une notice sur le scandale9, mais la curiosité du lecteur est vite déçue : il s’agit d’un bref résumé d’une affaire judiciaire – un catéchisme interrompu par des insultes – sans le moindre commentaire et sans que rien ne vienne expliquer les raisons d’un tel choix, alors que le mot figure dans de nombreuses autres notices, comme nous le verrons plus tard. Ainsi, ce n’est pas parce qu’un terme figure dans le discours des juristes qu’il en devient pour autant une notion juridique analysée par la doctrine et utilisable par les praticiens, en particulier à l’occasion d’un contentieux.
Dans le fond, le droit français demeure, tout au moins jusqu’à la Révolution, une matière essentiellement casuistique, appréhendée de façon inductive, en partant de la pratique pour tenter d’en dégager des principes. C’est pourquoi il peut être judicieux de commencer l’étude du scandale à travers la procédure judiciaire. Le procès, à tout le moins celui le plus sujet à scandale, c’est-à-dire le procès pénal, tente de respecter un délicat équilibre entre plusieurs intérêts : celui de la victime (ou de sa famille) qui réclame justice, celui de l’accusé qui a droit à une défense équitable et celui de l’État qui entend protéger l’ordre et la paix sociale troublés par le crime. En choisissant d’imposer la présomption d’innocence au cours du Moyen Âge classique, la justice royale a décidé de protéger au premier chef l’accusé car les juges sont conscients du fait que de toute procédure peut naître un scandale. Aussi, alors que, dans le vocabulaire processuel, la notion de scandale est rare, l’esprit de la procédure en est imprégné.
Au cours de l’époque moderne, la doctrine ajoute couramment le qualificatif de « public » au mot « scandale ». La redondance surprend dans une langue juridique d’ordinaire rigoureuse et concise : le sens religieux originel du scandale implique déjà une forme de publicité, puisqu’il s’agit d’un fait commis à la vue de tous, dans l’espace public, avec le risque de faire chuter autrui par un mauvais exemple. Mais la redondance n’est qu’apparente. Il a fallu des siècles à la monarchie capétienne pour dégager des principes de droit public à partir des règles de droit commun, instaurant la summa divisio droit public/droit privé qui a caractérisé le droit français jusqu’à la fin du XXe siècle et justifié la dualité de nos juridictions. Pour le scandale, l’intérêt est certain d’ajouter le qualificatif de « public » : celui de procurer à l’État la maîtrise d’un domaine jusqu’alors réservé à l’Église, en invoquant le motif de l’intérêt public, de la Res publica. Et en effet, au cours du XVIIe siècle, le scandale va devenir une affaire d’État, voire de l’État, au nom d’un pouvoir qui ne cessera de se développer : le pouvoir de police administrative. Les auteurs modernes définissent celui-ci comme un ensemble de moyens permettant de maintenir l’ordre dans la cité, empêcher la corruption des mœurs et conserver les personnes ainsi que les biens. Son évolution est notable à travers les différentes éditions du Dictionnaire de droit de Claude de Ferrière : la première, en 1679, ne comporte pas d’article à ce mot ; il faut attendre les éditions du XVIIIe siècle, refondues par son fils, pour trouver une notice qui ne cesse de s’allonger jusqu’à celle de 1769. Les devoirs qui en découlent pour les officiers municipaux s’alourdissent en conséquence : assurer la propreté et la sûreté, l’abondance des denrées, l’observation des statuts des marchands et des artisans, lutter contre les abus des commerçants, contre le luxe et la débauche et « empêcher le scandale public ». Ainsi, jurisprudence et doctrine vont aider la monarchie à transformer une notion théologique en un outil de maîtrise de l’ordre public.
Une notion rarement explicite et pourtant essentielle
dans la procédure judiciaire
Dans le vocabulaire juridique, une seule expression a employé la notion qui nous intéresse : il s’agit de « l’amener (ou amené) sans scandale ». Les lecteurs de Racine ont eu l’occasion de la rencontrer au détour d’un passage des Plaideurs (II, 14), lorsque Léandre veut faire appréhender le chien (Citron), accusé d’avoir volé et mangé un chapon10. Or, Racine connaît les débats juridiques de son temps et estime que son public en est tout autant informé. Parce que le scandale constitue un mauvais exemple pour les fidèles et peut les entraîner à tomber dans le péché, le droit canon a toujours cherché à éviter les actes susceptibles de troubler la paix publique. C’est la raison pour laquelle les officialités ont créé la procédure de l’amené sans scandale, qui a subsisté en droit français jusqu’en 1670. Il s’agit d’une ordonnance rendue par un juge pour qu’un accusé soit conduit devant lui par l’huissier, mais celui-ci doit exécuter sa mission « sans bruit, sans éclat et avec certains égards11 ». La procédure a ses limites : elle n’est possible que s’il n’y a pas de charges graves12. Les juges savent combien une réputation peut demeurer entachée par une procédure judiciaire, quelle que soit son issue. Ainsi, la logique de la présomption d’innocence est préservée.
Pourtant, l’ordonnance criminelle de 1670 (t. X, art. 17) supprime cet héritage du droit canonique médiéval. Les motifs ne sont pas très clairs chez les arrêtistes qui l’évoquent, d’ailleurs, toujours brièvement : l’argument principal consiste à affirmer que les abus des officialités facilitaient les évasions13, aussi le Parlement de Paris aurait, à plusieurs reprises, défendu aux juges ecclésiastiques d’user de cette procédure14. D’autres sources retournent l’institution contre elle-même, comme le Dictionnaire universel de Trévoux, rédigé par des Jésuites : une autre forme d’abus aurait consisté à constituer « un homme prisonnier avec la même indignité que s’il y eût decret contre lui15 ». La discrétion voulue par les officialités aurait disparu avec son utilisation par les justices séculières. Pourtant, au XVIIIe siècle, une partie de la doctrine persiste à défendre la mémoire de cette institution disparue : pour Prost de Royer, par exemple, les juges ecclésiastiques, « plus doux par principe », privilégiaient cette forme de prise de corps pour « les jeunes gens qu’ils voulaient condamner à épouser les filles enceintes16 ». Le Parlement de Paris n’aurait pas mis en cause la procédure mais bien au contraire la façon brutale et scandaleuse dont certains huissiers exécutaient les décrets de prise de corps. L’argument du scandale est ici retourné : l’origine serait à rechercher dans le comportement des agents au service de la justice royale. Ainsi, le Parlement aurait reconnu, au profit des accusés, une forme de droit à éviter le scandale.
Derrière les débats doctrinaux mettant en exergue des jurisprudences opposées avec un laconisme qui ne permet pas toujours de se faire une idée claire des circonstances réelles, on perçoit sans surprise une lutte de compétence entre Parlement et officialités. Par exemple, dans l’affaire Jean Gay qui concerne des promesses verbales de mariage, le Parlement de Paris affirme qu’il a « perpétuellement réprouvé les amenés sans scandale, qui est toujours un scandale et un mal public17 ». Mais ce n’est qu’un élément au cœur d’une argumentation destinée à réduire strictement la compétence des officialités en matière matrimoniale. Il y a ensuite des enjeux de procédure : le secret peut être perçu, non comme un juste moyen de protéger la fama des familles ou des individus contre le scandale, mais comme une preuve de faiblesse de la justice. Or, l’État moderne tient à démontrer sa capacité à réprimer le crime, quitte à accentuer pour cela certains aspects de justice-spectacle. Les peines infamantes et les différentes formes d’exécution publique en sont les illustrations les plus évidentes, mais l’interdiction de l’amener sans scandale en fait également partie. Dans la continuité de cette politique pénale, après que la Révolution a imposé le principe d’une justice rendue de façon publique, les audiences à huis clos, c’est-à-dire les portes fermées, seront, elles aussi, strictement limitées à quelques cas en matière civile (art. 87 du Code de procédure civile de 1806) et en matière criminelle (art. 64 de la charte de 1814). Le scandale servant à l’édification de tous, il devient une mesure prophylactique. Il sert aussi d’arme entre les mains de l’État – monarchie de droit divin ou République laïque – soucieux de démontrer qu’il lutte avec la plus grande fermeté contre le mal, sans craindre le regard des citoyens. La « vengeance publique », en affichant son action, espère peut-être éviter le recours à la « vengeance privée ».
À l’inverse, dans quelques cas graves, un bien supérieur peut justifier, aux yeux de l’Église, le risque de révéler un scandale au peuple : c’est le cas du monitoire. Sous forme d’appel à témoins, il s’adresse à tous et enjoint de révéler certains faits, dans le cadre d’une procédure en cours. Des Lettres du juge d’Église sont publiées au prône de la messe paroissiale, puis affichées à la porte des églises et sur les places publiques. Les curés et vicaires sont ensuite invités à recueillir les éventuels témoignages et à envoyer les révélations qu’ils ont reçues au greffe de la juridiction devant laquelle le procès est pendant. Les témoins qui s’abstiendraient de se manifester risquent l’excommunication : ainsi, par une sorte d’inversion, le scandale, c’est la
non-dénonciation.
Cet élément de procédure, né de l’initiative des officialités, devient à l’époque moderne une réelle pierre d’achoppement dans les relations entre Église et État, quand les cours souveraines multiplient les empiètements sur la juridiction ecclésiastique. L’État a évidemment compris tout le parti que pouvait en tirer la justice séculière lorsque les preuves étaient insuffisantes, mais il s’en est aussi servi pour réduire les libertés ecclésiastiques, parfois avec l’appui même d’une partie du clergé, comme le montre par exemple le Traité des monitoires (1740) de Laurent Rouault. C’est tout l’enjeu, également, de la célèbre controverse qui oppose les Vindiciae adversus C. Fevreti du canoniste Antoine Dadin d’Auteserre au Traité de l’abus (1654) de Charles Févret, rédigé en soutien au gallicanisme parlementaire18. Aussi, les ordonnances royales se sont succédé, précisant les conditions dans lesquelles les monitoires devaient être fulminés. L’ordonnance d’Orléans de janvier 1560 (art. 18) exige un « crime et scandale public ». L’édit d’avril 1695 (art. 26) précise que les crimes doivent être « graves » et que le monitoire ne doit être utilisé qu’en dernier recours, « lorsque l’on ne pourrait avoir autrement la preuve ». Quant à l’ordonnance criminelle de 1670, elle accroît les exigences en matière de respect du secret de l’instruction : nul ne doit être désigné ou nommé, sauf en termes vagues et généraux, afin de ne pas porter atteinte à l’honneur ou la réputation d’un innocent (t. VII, art. 4).
La littérature juridique sur le monitoire est immense mais, pour la question précise qui nous intéresse, on notera qu’il n’est pas simple de définir le « scandale public », ni le degré de gravité justifiant une révélation au public, susceptible à son tour d’engendrer un scandale. L’étude de la pratique montre en effet une utilisation détournée de ses origines car de nombreux monitoires sont publiés pour des délits mineurs et non en cas de véritable scandale19. Comme le fait remarquer un arrêtiste bourguignon, François Perrier, les monitoires devraient être utilisés « pour la preuve des faits graves et atroces ». Or leur objet concerne des coupes de bois et de petits larcins. Il conclut avec raison : « N’est-ce pas une dérision de lancer des foudres pour de petits sujets ? Dieu n’en use point ainsi avec les hommes20. » Un autre arrêtiste bourguignon, le protestant Job Bouvot développe d’intéressantes distinctions à propos des abus de monitoires portant sur de simples faits d’injures verbales : « Le scandale public doit s’entendre d’un acte qui regarde et concerne l’État […], qui ne concerne que la chose publique, sans avoir égard au particulier […]21 ». Le monitoire n’a pas à être utilisé en cas d’« injures générales, non spécifiées » et « ambigües » mais uniquement lorsque l’injure verbale est aggravée d’« excès et outrages » ou « battures », et plus encore lorsqu’elle s’adresse « à une personne publique, comme à un magistrat en faisant sa charge ». Le scandale que risque d’engendrer le monitoire ne se justifie donc que par un crime lui aussi particulièrement scandaleux, du fait des circonstances ou de la qualité des personnes atteintes. Ainsi, une procédure d’origine canonique est devenue un outil précieux au service de la justice séculière.
La Révolution l’a certes supprimée, en même temps que les justices ecclésiastiques. Cependant, il n’est guère étonnant de voir l’État autoritaire mis en place par Napoléon retrouver un intérêt à cette procédure : en effet, en 1806, le monitoire est rétabli afin de lutter contre la forte criminalité qui sévissait dans les campagnes22. Le dialogue ayant été renoué entre le gouvernement français et Rome grâce au concordat de 1801, les Jacobins au pouvoir ont recherché la collaboration du clergé catholique pour réprimer les crimes quand les voies ordinaires de la justice échouaient. En pratique, l’expérience a été de courte durée. Comme la non-révélation des crimes n’est pas incriminée dans le Code pénal de 1810, ce mode d’instruction est tombé en désuétude au cours de la Restauration.
Enfin, et de façon plus générale, le scandale permet de distinguer, en droit pénal, l’action publique de l’action privée. En effet, à la différence du droit romain, le droit français exige que l’accusateur ait un intérêt légitime. Un particulier doit avoir souffert d’un crime, directement ou indirectement dans la personne d’un de ses proches, pour pouvoir engager une action privée. Quant à la partie publique, elle a pour mission principale de défendre la société et donc de « poursuivre la vindicte publique, c’est-à-dire de faire réparer par des peines publiques, le trouble et le scandale que le crime a pu causer à la société23 ». Le terme de vindicte rappelle que depuis la fin du Moyen Âge, l’État s’efforce d’éteindre le droit de vengeance privée (sauf cas de légitime défense) au profit d’une vengeance publique, censée être mieux maîtrisée grâce à un juge professionnel impartial et une procédure équitable. La parole et l’acte scandaleux sont qualifiés de « crimes publics » car ils bouleversent l’ordre de la société et exigent donc une vengeance publique qui se manifeste par la peine. Le peuple, dépossédé du droit de rendre lui-même la justice, doit se satisfaire des réparations publiques mises en scène par l’autorité publique, de préférence sur les lieux mêmes du crime. La peine la plus courante est l’amende honorable, que le juge prononce « contre celui qui a causé un scandale public, soit en marquant du mépris pour Dieu, pour l’autorité du Roi ou de la justice, soit en excitant le peuple à la sédition, ou en profanant les choses sacrées24 ». Elle consiste en un aveu public du crime commis et n’est souvent que l’accessoire d’une peine plus grave. Mais le scandale sert aussi à justifier la peine de mort contre l’esclavage perpétuel qui a la préférence de quelques auteurs au XVIIIe siècle : l’esclavage n’empêcherait nullement le criminel de nuire à la société, ne serait-ce que par « le scandale que donnerait sa présence et le souvenir de son crime25 ». Si l’on en croit l’adage populaire, « la vie a une fin, la vengeance n’en a pas » ; il s’agit de la vengeance privée, désormais illégale. La vertu première de la vengeance publique est de mettre fin au scandale causé par le crime public et l’exécution du coupable a donc le mérite de faire disparaître jusqu’au souvenir de ce scandale.
Le « scandale public », un outil efficace dans la maîtrise
de l’espace public par la monarchie de droit divin
Les actes de la chancellerie désignent le roi de France par la formule « rex Francie Dei gratia », rappelant ainsi que, par le sacre, il tient sa souveraineté de Dieu dont il est le « lieutenant ». La monarchie à l’époque moderne ne peut donc oublier qu’elle doit assurer la tuitio regni et ecclesiarum, la protection de ces intérêts intimement liés que sont ceux du royaume et de l’Église. Pour cette dernière, cela implique une défense sur le plan matériel (la protection de son patrimoine, de ses privilèges et libertés contre toute attaque et usurpation) tout autant que spirituel (la foi, le dogme et la morale chrétienne), sans omettre le respect des compétences de la justice ecclésiastique.
Il n’est donc pas surprenant de constater que les ouvrages juridiques de l’époque moderne – arrêtistes et traités de droit criminel – usent couramment de la notion de scandale à propos d’affaires concernant la religion et le clergé. C’est le cas, par exemple du Recueil d’arrêts notables (1556), compilation effectuée par le lieutenant général du bailliage du Forez, Jean Papon, qui a participé activement à la lutte contre le parti protestant26. L’acception est large, du sacrilège au conflit de compétence. Le scandale naît d’un hérétique qui a donné des coups de dague contre un crucifix, « de cœur malin27 » ; ou encore de paroles proférées contre des prêtres passant en procession28 ; mais aussi d’une justice séculière qui ne respecte pas la compétence des officialités29. On notera que l’usage du terme se multiplie dans la réédition faite par Jean Chenu en 1621 : par exemple, le scandale ne permet pas de justifier qu’un criminel ne puisse être arrêté dans une église, le droit d’asile ayant été aboli en 153930 ; alors que l’édition originale de 1556 préfère user du terme juridique de « franchise31 ». Contemporaine, La pratique judiciaire de Jean Imbert (1563), fait, elle aussi, de nombreuses références au scandale : lorsqu’un prêtre est accusé « de tenir une femme mal famée », ou, là encore, pour de nombreux cas de répartition de compétence entre justices laïque et ecclésiastique32. Néanmoins, les rééditions postérieures qui comportent une table des matières n’ont pas jugé utile de créer une entrée pour le scandale. Le mot figure couramment dans les différents sens connus mais ne semble pas mériter que les juristes le haussent au niveau d’un véritable concept juridique, contrairement à d’autres notions auxquelles le scandale est pourtant associé, comme le monitoire ou le rapt.
Au-delà de ces emplois qui ne répondent pas toujours à une logique très rigoureuse, le scandale constitue un critère de distinction pour caractériser le comportement des ecclésiastiques : par exemple, l’Église autorise la chasse pour les clercs, mais uniquement la chasse « privée et tranquille, où l’on trouve une récréation utile et souvent nécessaire à la santé », opposée à la chasse « périlleuse ou du moins si bruyante qu’elle produit scandale », i.e. la chasse aux bêtes fauves nécessitant une meute et se pratiquant en société ou chasse à courre. Il est vrai que son droit de passage cristallise de nombreuses réprobations33.
Mais de façon plus essentielle, il constitue surtout un critère pour distinguer, d’une part les cas réservés au pape de ceux que l’évêque peut absoudre, et d’autre part les « cas privilégiés » ou « cas royaux » de ceux que l’État concède à la justice d’Église. En ce domaine, l’ordonnance du 19 novembre 1549 « sur la recherche et la punition du crime d’hérésie » mérite une attention particulière. Henri II commence par restituer au juge ecclésiastique la connaissance des crimes « d’erreur ou hérésie simple, procédant plus d’ignorance, erreur, infirmité et fragilité humaine, légèreté et lubricité de la langue de l’accusé » ; puis il crée des commissions paritaires pour juger du crime d’hérésie aggravé de « scandale public, commotion populaire, sédition ou autre crime emportant offense publique et par conséquent cas privilégié », susceptible d’appel auprès du Parlement. Par ce moyen, la justice royale peut reprendre à son compte une notion d’origine canonique, et ce dès les premières années des guerres de Religion : ainsi, Sylvie Daubresse a dénombré 49 actes du Parlement de Paris, sur les 390 étudiés entre 1555 et 1558, qui utilisent le mot scandale34.
Durant un siècle, la monarchie ne cesse de développer les crimes justifiant la seule intervention du juge royal. Le résultat est patent lorsque l’ordonnance criminelle de 1670 (tit. I, art. 11) énumère les cas royaux : le « sacrilège avec effraction », « la police pour le port des armes », les cas de « sédition », « émotions populaires », « crime d’hérésie », « trouble public fait au service divin », « rapt et enlèvement des personnes par force et violence ». La liste n’est pas limitative. Le texte est complété par l’art. 30 de l’édit promulgué en avril 1695, dix ans après la révocation de l’édit de Nantes : la connaissance et le jugement de la doctrine catholique appartiennent aux archevêques et aux évêques ; les juges de l’ordre séculier se réservent le droit de pourvoir « à la réparation du scandale et trouble de l’ordre et tranquillité publique et contravention aux ordonnances, que la publication de ladite doctrine aura pu causer ». La distinction entre les deux ordres, « concilie le Sacerdoce avec l’Empire, et établit par ce moyen l’ordre qui conserve les droits respectifs des deux puissances », pour reprendre les mots du très gallican Durand de Maillane35.
Parfois, il est possible de constater que la compétence d’un juge séculier impartial est susceptible de favoriser l’apaisement des troubles religieux. Un exemple nous est donné à l’occasion de provocations causées par des protestants, lors de processions du Saint-Sacrement, pour ridiculiser la transsubstantiation. Un arrêt du Conseil du Roi du 23 octobre 1640 insiste sur la volonté du Roi de « conserver la paix et l’union entre ses Sujets ». Le seul moyen consiste dans « l’observation exacte de ses édits de pacification », lesquels interdisent « très expressément de commettre aucun acte ou contenance qui puisse tourner à mépris et de scandale à l’assistance ». Au Moyen Âge, le droit canonique privilégiait le devoir de charité par rapport à la liberté, ce qui imposait au chrétien de réduire sa liberté afin de ne pas scandaliser ; à l’époque moderne, le principe subsiste, afin de garantir l’ordre public. Un arrêt du Parlement de Bordeaux (18 septembre 1646) en fait cependant une application particulière : constatant la violence des provocations, il rappelle que les lois ordonnent aux protestants de faire preuve de respect ou de « se retirer dans les maisons prochaines sans scandale » afin de ne pas « donner envie au peuple de courre sus ». Dans ce cas précis, il ne s’agit pas de priver les protestants du droit de manifester leur foi dans l’espace public ni moins encore de les obliger à honorer le Saint-Sacrement, mais seulement de les empêcher de troubler l’exercice du culte catholique. Donc, en matière de scandale, l’excuse de provocation est déniée. Pourtant, l’édit de Nantes implique une tolérance réciproque et les autorités doivent être particulièrement vigilantes face à toute manifestation susceptible de remettre en cause un équilibre précaire. Mais le juge ecclésiastique, confronté à de telles provocations, n’aurait peut-être pas fait preuve d’autant de sérénité.
En revanche, un commentaire de ces faits par Jean Filleau en donne une toute autre lecture36. Avocat du roi au présidial de Poitiers et membre de la Compagnie du Saint-Sacrement, constituée autour de l’intendant Voyer d’Argenson, ce polémiste catholique, favorable aux théories modernes de l’absolutisme, ne reconnaît aux protestants que la seule liberté de conscience. En effet, il juge que ces derniers ne sont pas dispensés « d’honorer au moins extérieurement et politiquement » le Saint-Sacrement. En outre, son légalisme est notable et prend sous sa plume des caractères qui annoncent la monarchie absolue de droit divin : le « Mystère » est « reconnu et déclaré tel par la Loy Royale ». C’est principalement pour ce motif qu’il faut l’honorer, en vertu de l’adage Quod Principi placuit, legis habet vigorem37. Le sens du scandale est donc modifié : il est défini, non pas de façon active par des actes de provocations mais, de façon passive, par le simple fait de s’abstenir de manifester extérieurement du respect. Il s’agirait bien de faire disparaître les protestants de l’espace public, fiction que tentera d’opérer l’édit de Fontainebleau.
Dans d’autres cas, l’utilisation du scandale comme critère pour déterminer l’existence d’un cas privilégié tourne à l’avantage de l’Église. En constitue un exemple presque paradigmatique l’affaire impliquant un prêtre, privé de sa cure pour « indécences, impuretés, prédications scandaleuses, port d’armes ». Condamné par l’official de Laon, il a interjeté appel comme d’abus, au motif, entre autres, qu’il s’agit d’un cas privilégié puisque les faits dont on l’accuse sont « tous crimes qui intéressaient la société ». Or toute l’argumentation du Parlement de Paris38 – après exposé des conclusions du gallican Joly de Fleury – consiste à rejeter sa compétence en requalifiant les faits. Les « libertés prises avec des personnes du sexe » ne constituent pas un rapt. Les violences n’ont été que verbales. Toutes les « indignités » ou « déclamations injurieuses » contenues dans les prêches sont contraires aux mœurs et donc entrent dans le ressort naturel du juge ecclésiastique ; elles peuvent d’ailleurs très bien être réparées par une peine canonique. Donc, le service religieux n’ayant pas été interrompu et aucune partie civile n’ayant déposé plainte, « la sûreté publique, l’ordre de la société n’ont point été compromis » ; l’official était bien compétent. On notera que l’argumentation s’est appuyée entre autres auteurs, sur Charles Fevret et son Traité de l’abus déjà évoqué ; peut-être n’aurait-il pas imaginé – et apprécié ? – un tel usage à l’appui d’une telle conclusion.
Néanmoins, le juge royal montre le plus souvent une volonté de défendre avec fermeté cette distinction entre le Sacerdoce et l’Empire évoquée par Durand de Maillane. Une affaire jugée devant le Parlement de Dijon en 1677 en constitue un bon exemple. Un paysan avait été autorisé par son curé à rentrer la récolte un dimanche et donc dispensé d’assister à la messe. Assigné à requête par le Procureur du roi, il est condamné à l’amende pour n’avoir pas demandé la permission au juge. La question suscite visiblement des controverses au sein même de la justice, puisque le baillage le décharge du paiement de l’amende et cette décision fait l’objet d’un appel auprès du Parlement de Dijon. L’argumentation de l’accusé insiste sur la nécessaire distinction des compétences entre juges ecclésiastique et séculier : « le travail des jours de Fêtes ne cause du scandale qu’en ce que c’était un péché, et un mépris pour la Religion » ; l’affaire serait ainsi de la seule compétence ecclésiastique et le scandale aurait disparu avec la dispense du curé. L’accusation, qui convaincra finalement les juges du Parlement, rappelle tout d’abord que l’observation des fêtes, exigée par le droit canonique, l’est également par les ordonnances royales. Et l’argument du scandale est retourné en faveur du juge séculier au moyen d’une distinction dans laquelle le scandale occupe la première place : la dispense empêche le péché mais ne fait pas disparaître le scandale que « le juge seul pouvait […] empêcher », parce qu’il s’agit d’un « fait de police ».
Une autre affaire utilise pareillement le scandale pour justifier l’intervention des juges royaux au détriment de l’Église, sur une question particulièrement polémique, le mariage, mélangeant le sacrement et l’institution publique. L’arrêtiste François Perrier cite plusieurs arrêts du Parlement de Paris ordonnant à des parties dont le mariage a été déclaré nul de réitérer leurs vœux. Or, selon cet auteur, aucun juge ne peut forcer des sujets libres à se marier et se prétendre compétent en matière de sacrement. « C’est donc uniquement par rapport au scandale » qu’il est possible d’exiger un nouveau mariage solennel et légitime, au nom de l’intérêt public. Là encore, c’est parce que « le scandale est du ressort de la Police extérieure », qu’il appartient au seul magistrat séculier de le réprimer39.
Dans ces deux procès, la notion de police est mise en avant. Elle est tout aussi omniprésente dans la doctrine. L’exemple le plus évident nous est fourni par le Dictionnaire de la police de Fréminville (1758)40, abondamment réédité car il constitue un véritable « code des communes avant la lettre41 ». Parmi les très nombreuses allusions faites au scandale, beaucoup concernent directement les atteintes à la religion. Ainsi, le catéchisme ne doit pas être perturbé car c’est dans ce cadre que la doctrine catholique est transmise ; c’est certainement pour cette raison que cet exemple illustre l’article « scandale ». L’ordre et la marche dans les processions entrent aussi dans les missions de police : la « vanité » des litiges pourrait inciter à les traiter légèrement et pourtant, réunissant « l’irrévérence, le scandale et la voie de fait », ils sont susceptibles d’entrainer des troubles importants que les autorités ne peuvent ignorer du fait de l’importance des rangs dans une société d’honneur42. Le pouvoir politique s’autorise à sanctionner les prédicateurs mais seulement lorsque ceux-ci usent de « paroles scandaleuses tendantes à exciter le public à l’émotion, désobéissance et la contravention des ordonnances du Roi ». Dans les campagnes, il convient de veiller tout particulièrement à la décence dans les églises car les femmes y amènent leurs enfants qui « crient, font beaucoup de bruit, interrompent le prêtre et les assistants, ce qui est un vrai scandale », tandis que d’autres, « entrent à l’église avec leurs poulets [qui] crient et font des bruits scandaleux » ; sans oublier celles qui ont « l’habitude du scandale » et vont dans les églises « en robe abattue sans ceinture43 ». Bien évidemment, les « femmes de mauvaise vie » et « hommes de toutes espèces » exerçant un « commerce scandaleux » doivent vider les lieux proches des églises44. Les autorités municipales ont ensuite l’obligation de sanctionner les violations de prescriptions religieuses, au motif que toute « licence scandaleuse » peut avoir des conséquences dangereuses pour la paix publique. C’est le cas des cafés et cabarets qui doivent être fermés la nuit mais aussi aux heures des messes45. L’activité des aubergistes est surveillée durant le Carême pour empêcher qu’ils ne donnent à manger gras, sauf permission expresse du curé ; et les bénéficiaires de cette exception sont alors contraints de « manger séparément dans leurs chambres sans scandale46 ». Quant à l’interdiction de travailler le dimanche et les jours de fêtes prescrits par l’Église, des sentences de police doivent en imposer le respect, sous peine de « grand scandale du
public47 ». Le scandale est donc devenu d’un usage courant et dans le même temps, son sens a été sécularisé, puisqu’il est devenu synonyme de tout ce qui peut être contraire aux bonnes mœurs ou à la tranquillité publique. Ainsi, des propriétaires sont sanctionnés pour avoir loué leur maison à des femmes qui s’adonnent à un « libertinage scandaleux » avec des « soldats aux Gardes françaises et Suisses, et gens suspects et sans aveu, qui y commettent des scandales et des désordres tant de jour que de nuit ». Les pauvres ou les vagabonds qui « mendient avec insolence et scandale, plutôt par libertinage que par une véritable nécessité […] au lieu de s’occuper à des métiers et à des professions utiles », méritent d’être enfermés ou envoyés aux colonies ; mais les autorités sont rappelées à leur devoir de favoriser les aumônes et de leur trouver des moyens de
subsistance48. Quant aux femmes, « vendantes et étalantes dans les halles et marchés », elles méritent une surveillance particulière car chacun sait qu’elles ont pour habitude de causer du scandale « par les cris et jurements affreux qu’elles profèrent, tant contre les autres femmes […] que contre les bourgeois49 ».
Néanmoins, on est en droit de se demander si le sens du scandale n’est pas en train de se diluer et donc de s’affaiblir, alors même que son usage se répand couramment dans le vocabulaire juridique. En trois siècles, il est finalement passé du sacrilège au trouble anormal de voisinage. Ainsi, à la veille de la Révolution, il n’est pas rare de rencontrer sous la plume des juristes l’idée qu’il ne constitue pas un crime en soi : le scandale laïcisé est rétrocédé au rang de simple circonstance aggravante d’un délit qualifié de « public », permettant au juge séculier de se dire compétent alors que le délit est purement ecclésiastique50.
Ce sentiment est accru après la rupture juridique instaurée par la Révolution française, en particulier en droit pénal. Le scandale disparaît de la codification séculière, qu’il s’agisse de la loi des 16-29 septembre 1791, du Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV, du Code d’instruction criminelle de 1808, probablement en raison de sa coloration religieuse dans un droit qui se veut résolument laïc. Quant au Code pénal de 1810, il décline à l’infini les outils placés entre les mains du puissant État contemporain pour sanctionner un trouble à l’ordre public : crime et délit contre la chose publique, contre la sûreté de l’État, contre la paix publique ; attentat à la liberté, complot, provocation dirigée contre l’autorité publique, résistance, désobéissance, outrage et violence envers un dépositaire de l’autorité publique. Mais le scandale est absent. Une exception demeurera, sans surprise, à l’époque contemporaine, en droit canonique jusqu’au dernier Code de 1983, qui comporte encore près d’une trentaine d’occurrences.
En revanche, le scandale ressurgit naturellement dans la doctrine et la jurisprudence avec des sens similaires à ceux observés à la fin de l’Ancien Régime. Un débat doctrinal est particulièrement éclairant sur l’évolution que connaît la notion au cours du XIXe siècle : la volonté de sévir du Ministère public peut-elle s’effacer au nom de considérations d’ordre supérieur ? Le pénaliste Alphonse Bérenger répond en posant une distinction entre les crimes et délits qui « attentent directement à l’ordre social et à l’humanité » et ceux qui « attentent à la morale publique et privée d’une manière moins ouverte ». Les premiers « ne méritent point de grâce ». En revanche, pour ce qui est des seconds :
[…] on ne peut se dispenser de les poursuivre lorsqu’ils sont devenus publics : mais lorsqu’ils demeurent ignorés, c’est au magistrat à examiner si le scandale qu’occasionnerait un éclat imprudent ne serait pas plus pernicieux que le mal en lui-même51.
À l’occasion des débats de la codification, M. Defermon avait même proposé que le ministère public ne punisse pas le délit, « en paraissant ne l’avoir pas connu52 ». Le scandale refait ainsi son apparition autour des controverses sur le nouveau droit pénal. Et il faut souligner que de telles affirmations sont courantes pour les infractions aux mœurs. Les raisons sont multiples : souvent par crainte de ne pas parvenir à réunir suffisamment de preuves, du fait de ce huis clos que constitue la cellule familiale, mais aussi par respect pour le domicile, l’intimité ou l’autorité du bon père de famille. P. Rossi, poussant la logique jusque dans ses extrémités, ira jusqu’à affirmer que « punir l’inceste commis sans violence ni scandale, c’est peut-être dépasser les exigences de l’ordre public53 ». Mais après tout, Jeremy Bentham ne considérait-il pas que « les délits d’incontinence ne deviennent nuisibles qu’en devenant publics54 » ? Pour des motifs similaires, le législateur français a renoncé à condamner la bestialité, contrairement à de nombreux autres codes européens, au motif que « la punition peut devenir plus funeste pour le peuple, à qui elle découvre des sources de plaisirs inconnus55 ». Au XXe siècle, l’utilitarisme n’a pas seulement gangréné le droit pénal, il atteint le droit administratif. Dans l’espace public, le trouble à l’ordre public vient avantageusement remplacer le scandale devant les juridictions administratives soucieuses de contrôler l’espace public ou privé. Les plus optimistes pourront voir dans cet utilitarisme une survivance de la pierre de scandale. Les autres pourront imaginer que la France des notables puis des notabilités a choisi de faire sienne l’affirmation de Tartuffe56 : « Le scandale du monde est ce qui fait l’offense/Et ce n’est pas pécher que pécher en silence. »
ANNEXES
Textes juridiques sélectionnés
• Édit portant règlement pour la juridiction ecclésiastique, avril 1695 (Recueil général des anciennes lois françaises, depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution de 1789, Paris, Belin-Leprieur, 1830, t. 20, p. 252).
« Art. 26 : Les archevêques ou évêques et leurs officiaux ne pourront décerner des monitoires que pour des crimes graves et scandales publics, et nos juges n’en ordonneront la publication que dans les mêmes cas, et lorsque l’on ne pourroit avoir autrement la preuve. »
« Art. 30 : La connoissance et le jugement de la doctrine concernant la religion appartiendra aux archevêques et évêques : enjoignons à nos cours de parlemens et à tous nos autres juges de la renvoyer auxdits prélats, de leur donner l’aide dont ils auront besoin pour l’exécution des censures qu’ils en pourront faire, et de procéder à la punition des coupables, sans préjudice à nosdites cours et juges de pourvoir par les autres voies qu’ils estimeront convenables à la réparation du scandale, et trouble de l’ordre et tranquillité publique, et contravention aux ordonnances, que la publication de ladite doctrine aura pu causer. »
• Lettre circulaire du parlement de Franche-Comté aux juges de son ressort, 11 mars 1689.
« Encore que les actions d’injures puissent être civilement intentées, de même que criminellement, néanmoins pour éviter les vexations et donner plus de moyens aux Défendeurs de se servir du bénéfice de l’Ordonnance ancienne, il est nécessaire de faire quelque distinction en matière d’injures, en laissant à l’Acteur la liberté de les traiter criminellement à l’égard des réelles et des verbales qui causent un scandale de conséquence, ou qui emportent un Délit qui exige la vengeance publique : mais hors de ces deux cas, toutes injures verbales ne doivent être traitées que civilement, et non extraordinairement par informations et autres procédures criminelles ».
• Commentaire par Muyart de Vouglans (Les lois criminelles de France dans leur ordre naturel, Paris, Merigot, 1780).
« L’Injure est dite qualifiée par ses circonstances, lorsque ces circonstances sont tellement graves, qu’elles la font dégénérer dans un Crime public, à cause du trouble et du scandale qu’elles causent dans la société. Ces circonstances se tirent ou du motif, comme lorsque l’Injure est dite avec préméditation, et par l’effet d’un ressentiment injuste ; ou de la manière dont elle est proférée, comme lorsqu’elle est dite avec des gestes indécents ou des cris séditieux ; ou bien de la qualité des Parties,
c’est-à-dire, tant de l’injuriant que de la personne injuriée, comme si elle est commise par un inférieur envers son supérieur […] ou bien si elle est commise envers des personnes du sexe, par des propos tendans à les corrompre et à blesser leur pudeur […] Dans tous ces cas où l’injure est de nature à produire des effets durables et scandaleux, il est certain que de simples réparations d’honneur, ou des peines de prison et d’abstention des lieux, ne pourraient suffire, et qu’il y aurait lieu à des peines corporelles, afflictives, ou au moins infamantes, avec des réparations civiles plus ou moins considérables. »
• Parlement de Dijon, 26 janvier 1677 (cité par Perrier, Arrests notables du Parlement de Dijon, T. I, 1738, p. 526).
« Un paysan de Minot ayant été prendre quelques gerbes un Dimanche matin ensuite de la permission que le Curé lui avoit accordée, fut assigné à requête du Procureur du Roi, pour être condamné à l’amende, et pour n’avoir pas demandé la permission au Seigneur, ou au Juge des lieux : ayant été condamné, la Sentence fut réformée au Balliage de la Montagne, et le Paysan déchargé, donc Appel.
Grusot, pour le Seigneur de Minot, disoit que l’observation des Fêtes n’étoit pas seulement commandée par les Canons, mais encore par les Ordonnances, que c’étoit au Juge séculier à tenir la main à ce qu’elles fussent exécutées, et à punir ceux qui violoient la Sainteté du Dimanche ; que la permission du Curé ne servoit qu’à empêcher le péché, mais que le scandale demeuroit, et que le Juge seul pouvoit l’empêcher : que le Curé n’ayant aucune Juridiction ne pouvoir punir les violateurs, ni les dispenser et mettre à couvert de la punition ; qu’en un mot s’agissant d’un fait de Police, il faloit necessairement se munir d’une permission du Juge.
Blanche, pour l’Intimé, disoit que la nécessité n’avoit point de loi, que sa Partie auroit perdu ses gerbes sans la permission qui lui avoit été donnée, de les aller querir ; qu’il s’etoit adressé au Curé comme à celui qui avoit coutume de donner ces sortes de permissions ; que le travail des jours de Fêtes ne cause du scandale qu’en ce que c’étoit un péché, et un mépris pour la Religion, et que ce scandale cessoit par la dispense du Curé qui etoit seul capable de juger s’il y avoit du mal ou non ; qu’on ne s’adressoit point au Juge des lieux pour faire les choses défenduës par l’Eglise, comme de manger de la chair en Carême, etc., que l’Intimé, pauvre Paysan, etoit dans la bonne foi, et ne devoit pas être condamné à l’amende.
Parise, pour le Curé, disoit que l’assignation qui lui avoit été donnée étoit une vexation, qu’il avoit eu sujet de croire qu’il avoit le pouvoir de donner la permission dont il s’agit, puisque tous les Curez étoient dans cette possession.
La Cour a mis l’apellation, ordonne que ce dont apel sera executé, dépens compensez, a renvoyé la Partie de Parise de l’assignation à lui donnée, avec dépens ; faisans droit sur les plus amples conclusions du Procureur General, a fait défenses à toute personne de travailler les jours de Fêtes sans la dispense du Curé, et de la permission du Juge des lieux, et de l’amende arbitraire ».
• Arrêt du Parlement de Bordeaux, 18 septembre 1646.
« […] ceux de la R.P.R. de la présente Ville, se rendent tellement irrespectueux et insolens contre le S. Sacrement de l’Autel, que se trouvans dans les ruës au rencontre des Curez revestis d’Estolle et de Surpelis, portans le S. Sacrement de l’Autel sous le Poisle aux malades, ils ne daignent pas salüer le S. Sacrement, ny fléchir le genoüil, ny se retirer dans leurs maisons, comme ils sont tenus et obligez par les Edits du Roy et Arrests de la Cour. Au contraire ils sont si hardis et si scandaleux, que souvent ils passent et repassent par lesdites ruës ayans le chapeau sur leur teste, et vont par un mépris intolérable le chapeau sur la teste aborder lesdits Curez, les regardans fixement, et passans prés du Poisle, heurtent du coude à écient les Prestres qui le portent, avec des irreverences et impietez si abominables, qu’elles font fremir et herisser les cheveux a ceux qui les voyent : Et lors que lesdits Curez tenans le S. Sacrement en main, leur veulent remontrer leur devoir, et leur commander de se découvrir et fléchir le genoüil comme font les Catholiques, ou se retirer de bon-heure dans leurs maisons sans scandale, ils les regardent tous couverts avec des yeux hagarts et un maintien plein de mépris, les uns donnans du nez sans dire mot, et les autres d’entr’eux se mocquent et montrent au doigt le S. Sacrement, disans à haute voix qu’ils ne se soucient dezsdits Curez ny de leurs Sacremens […] Et ces mépris, impietez et irreverences commises par telles personnes impies et scandaleuses, ont cuidé causer de l’émotion, et donné envie au peuple de courre sus à telles personnes impies et scandaleuses. Pour à quoy obvier, et afin qu’il n’y arrive du mal à telles gens à l’advenir, ledit Procureur general a fait informer d’authorité de la Cour contre telles personnes impies et scandaleuses, et a presenté ladite information à la Cour, pour la decreter de prise de corps contre les dénommez en icelle : Et neanmoins afin que telles impietez et irreverences n’arrivent plus, et ne causent point de scandale et d’émotion à l’advenir, a requis estre ordonné et enjoint à tous les Habitans de la presente Ville et Estrangers residans en icelle de quelque qualité qu’ils soyent, faisans procession de ladite R.P.R. lors qu’ils se rencontreront dans les ruës, et que les Curez ou leurs Vicaires porteront le S. Sacrement aux malades, ou lors que le Clergé le portera Processionnellement […] de se découvrir et mettre le chapeau à la main, et fléchir le genoüil devant le S. Sacrement de l’Autel, si mieux lesdits de la R.P.R. n’ayment se retirer dans les maisons prochaines sans scandale […] »
• Arrêt du Conseil Privé du Roy, 23 octobre 1640.
« Sur ce qui a esté representé au Roy en son Conseil, que le Substitut du Procureur de sa Majesté en la Chambre my-partie établie à Castres, auroit fait plainte en ladite Chambre qu’aucuns particuliers faisant profession de la R.P.R. avoient commis des irreverences et mépris à la rencontre du S. Sacrement […] Surquoy et sur ce ladite Chambre ayant deliberé, […] requis les Predisents et Conseillers d’icelle presents à la deliberation, se seroient trouvez partis en opinions, et que par ce moyen l’affaire demeuroit indecise, sans qu’on y pût apporter de remede convenable ny empescher la continuation de tels desordres […] Le Roy en son Conseil sans s’arrester audit partage, a evoqué et évoque à soy la matiere, et voulant conserver la paix et l’union entre ses Sujets, de prévenir toute occasion de tumulte par l’observation exacte de ses Edits de pacification, a fait inhibitions et deffenses à toutes personnes, mesmement à ceux qui font profession de ladite R.P.R. de commettre aucun scandale contre les Sacremens et Ceremonies de l’Eglise Catholique, Apostolique et Romaine, à peine d’estre punis comme infracteurs des Edits et perturbateurs du repos public […] leur deffend tres-expressément de commettre aucun acte ou contenance qui puisse tourner à mépris et de scandale à l’assistance sur peine de punition [suit l’énoncé des peines avec aggravation jusqu’à deux récidives] […] sans préjudice de plus grande peine s’il y échoit, et en cas que la qualité du scandale meritast un châtiment plus rigoureux et exemplaire ».
• Commentaire de Jean Filleau (Decisions catholiques, ou Recueil general des arrests rendus en toutes les cours souveraines de France, Poitiers, Jean Fleuriau, 1668, p. 116).
Le Roy Henry III, par son Edit du mois d’Octobre de l’an 1585, ayant pourveu aux desordres qui estoient lors dans son Royaume, fit dresser des Articles […] Or par cette Profession de Foy dressée par le commandement du Roy, il paroist évidemment que par la seule consideration des Loix civiles et Politiques, l’on peut convaincre ceux de la R.P.R. qu’ils sont obligez d’honorer au moins exterieurement et Politiquement le Tressainct Sacrement de l’Autel […] comme Sujets estant soumis, ils doivent au moins par la voye d’une obeïssance Politique rendre les respects exterieurs à ce Mystere reconnu et declaré tel par la Loy Royale, de laquelle ils n’ont aucun droict de se dispenser, Quod Principi placuit, legis habet vigorem. Et bien qu’ils ne soyent en ce temps obligez de faire cette protestation de Foy, la liberté de conscience leur ayant esté accordée, ils ne sont pas pourtant dispensez d’honorer par voye exterieure, ce Mystere adorable, dans lequel les Roys reconnoissent la Souveraineté de celuy qui les a honorez du glorieux Tiltre de Roys de France, et Roys Tres Chrestiens […] Et si la Clemence de nos Princes a toleré pour un temps la R.P.R. qu’elle n’a pas dispensé pour cela ceux qui la professent, de venerer et respecter au moins exterieurement, cette divine Majesté devant laquelle nos Roys se prosternent avec tant d’humilité, et à laquelle ils font hommage de leurs Sceptres et de leurs Couronnes. Ils ont beau dire secrettement dans leurs cœurs, que Dieu n’est pas au Tressainct Sacrement, Dixit impius in corde suo non est Deus, s’ils ne veulent pas croire, leur mécreance ne sera pas punie, elle sera tolerée, mais il ne leur sera jamais permis en public et au scandale des Sujets du Roy, de mépriser la Divinité qui est adorée par leur Prince, qui ne les a jamais dispensé de luy rendre le respect au moins exterieur.
• Amboise, mars 1559 : Édit d’abolition en faveur des gens qui ont été trouvés en armes aux environs de la ville d’Amboise (dans Recueil général des anciennes lois françaises, depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution de 1789, Paris, Belin-Leprieur, 1829, t. 14, p. 24).
« […] Nous avons puis n’aguères […] fait pardon, rémission et abolition générale à tous nos subjets de quelque qualité ou condition qu’ils soient, pour tout le passé des crimes et cas concernans le fait de la foy et religion, ordonnant que pour raison desdits cas et crimes […] ne sera faite cy après par nos juges pour le regard du passé aucune question à nosdits subjets, en jugement ne hors jugement. Et défendons très expressément à tous de ne se reprocher aucune chose passée, quant au fait de la religion, souz peine d’en estre punis selon l’exigence du cas. […] Toutefois nous sommes deüement informez que plusieurs de nos subjets, ou pour ignorer nostre susdicte grace et abolition, ou pour être séduits par aucuns malins et séditieux esprits, qui taschent souz le voile de la religion à saccager toutes les riches villes et maisons de nostre royaume, se sont mis en chemin pour venir devers nous, en plusieurs et diverses troupes : la plupart d’entr’eux garnis d’armes et pistolets, soubs couleur de nous vouloir (comme ils disent) présenter certaine confession de leur foy, qui est voye scandaleuse, et contre tout droit divin et humain. Et combien que telle damnable entreprise mérite griefve et exemplaire punition : toutesfois ayant veu et cogneu la grande simplicité et ignorance d’aucuns d’entr’eux prins d’entre lesdites troupes, que nous avons fait interroger en notre présence : désirant conserver ceux qui recognoistront leur faute et délaisseront une si damnable voye et par là espargnant le sang de nostre peuple : et aussi de chastier ceux qui obstinément demeureront en telles méchantes et scandaleuses entreprinses, et les punis selon la rigueur et sévérité de la loy, de manière que l’exemple en demeure à tousjours.
Nous avons […] statué et ordonné que par les carrefours et lieux publics […] sera faict commandement à cry public et son de trompe, à toutes personnes de quelque qualité qu’ils soient […] que […] ils ayent à rebrousser chemin, et à eux retirer en leurs maisons paisiblement et pacifiquement […] Et à ceux qui par la manière devant dicte se retireront dedans ledict temps, nous avons par compassion et miséricorde donné impunité du faict et cas dessudit. Et défendons à tous nos juges de leur en faire à jamais question. Et quant à ceux qui demeureront obstinez en cette scandaleuse et damnable entreprise, nous avons statué et ordonné que ledit temps passé, en quelque part qu’ils soient trouvez ou appréhendez, ils seront pendus et étranglez
sur-le-champ, de quelque qualité qu’ils soient, sans autre forme et figure de procez, nonobstant toutes appellations […] ».
• Saint-Germain-en-Laye, juillet 1561 : Édit sur la religion, sur le moyen de tenir le peuple en paix, et sur la répression des séditieux (ibid., p. 109).
« […] pour donner remède et pourvoir aux troubles et esmotions qu’on voit pulluler et multiplier de jour en jour en ce royaume, à cause de la diversité des opinions, concernans le fait de la religion […]
(2) […] défendons […] à toutes personnes ne faire aucuns enroollemens, signatures, ou autres choses tendans à injures, ou provoquans à factions, conspirations, ou partialitez. Et pareillement à tous prescheurs de n’user en leurs sermons ou ailleurs de paroles scandaleuses ou tendantes à exciter le peuple à esmotion […]
(9) […] prohibons et défendons à toutes personnes de quelque qualité ou condition qu’ils soient, sur peine de la hart, toutes voyes de fait et port d’armes. Defendant pareillement sur la mesme peine, le port des harquebuzes et pistolets, fors et excepté aux archers de nos gardes, et ceux de nos ordonnances, allans et venans en leurs garnisons, les prévosts des mareschaux, leurs lieutenans et archers, les ministres de la justice, au temps qu’il sera requis pour l’exercice d’icelle, les conducteurs de nos deniers pour la seureté d’iceux seulement : ensemble aux gardes des forests et des buissons auxquels permettons porter pistolets.
(10) Défendons aussi à toutes personnes, autres que les cy dessus exceptez, les gentils-hommes, les serviteurs des princes, seigneurs et gentils-hommes, et lors qu’ils seront à leur suitte tant seulement, de porter aux villes et bourgades espées, dagues, grands cousteaux, et autres armes offensives, si ce n’est en allant par pays, pour la seureté et défense de leurs personnes […] ».
• Saint-Germain-en-Laye, 17 janvier 1561 : Déclaration sur la répression des troubles nés à l’occasion de la religion réformée (ibid., p. 124).
« […] disons et ordonnons ce qui s’ensuit.
(1) […] que tous ceux de la nouvelle religion, ou autres qui se sont emparez des temples, seront tenus […] d’en vuider et s’en départir […] inhibons et défendons […] d’abattre et desmolir croix, images, et faire autres actes scandaleux et séditieux sur peine de la vie, et sans aucune espérance de grace ou rémission.
(5) Enjoignons de nouveau […] à tous nosdits subjets, de quelque religion, estat, qualité ou condition qu’ils soient, qu’ils n’ayent à faire aucunes assemblées à port d’armes, et à ne s’entre-injurier, reprocher, ne provoquer pour le fait de la religion, ne faire esmouvoir, procurer ou favoriser aucune sédition, mais vivent et se comportent les uns avec les autres doucement et gracieusement, sans porter aucunes pistoles, pistolets, harquebuzes, n’autres armes prohibées et défenduës, soit qu’ils voisent ausdites assemblées ou ailleurs : si ce n’est aux gentils-hommes, pour les dagues et espées, qui sont les armes qu’ils portent ordinairement. »
• Rouen, 16 août 1563 : Édit de confirmation de l’édit de pacification du 19 mars 1562, et défense du port d’armes (ibid., p. 142).
« […] (3) Et afin que la tranquillité soit par tout le plat pays aussi bien que par lesdites villes, pour éviter aussi que les peuples armez ne feissent aucun scandale n’entreprinse, entendons semblablement que les armes, dont nos subjects dudit plat pays sont saisis et garnis, soyent par eux apportées et consignées par inventaire és plus prochains chasteaux et maisons à nous appartenans : et qu’à ce faire ils soient contraincts par nosdits lieutenans généraux […] pour là estre gardées jusques à nostre bon plaisir […] N’entendons toutesfois en ce comprendre les princes, seigneurs, gentils-hommes et noblesse de notredit royaume, qui pourront avoir en leurs maisons les armes y nécessaires, pour la seureté et défense d’icelles, sans en abuser.
(4) Davantage, considérant que les meurtres, voleries, assassinats, et autres entreprinses, qui troublent le commun repos de nosdits sujects, s’exercent plus par les armes à feu, que nuls autres : défendons tres estroictement sur mesmes peines à toutes personnes de quelque estat, dignité et qualité qu’ils soient porter ne faire porter leurs gens et serviteurs dedans les villes, ne pars les champs, aucune hacquebute, pistole ne pistolet, ne d’icelles tirer sinon qu’ils fussent gens de nos ordonnances, ayans et portans le saye de gendarme ou archer, selon leur qualité, gentilhommes de nostre maison, ayant certificat signé de leur capitaine, archers de nos gardes, ceux du prevost de nostre hostel, prevost des connestable et mareschaux de France, portans le hoqueton, ou certificat de leurs capitaines ; et les gens de guerre, soldats estants à nostre solde en leurs garnisons, et allans pour nostre service par nostre commandement, ou des connestable et mareschaux de France, d’un lieu à un autre, et non autrement.
(5) Et en retirant les anciennes ordonnances de nous et de nos prédécesseurs, défendons aussi à toutes personnes, toutes assemblées en armes, et port d’armes pour quelque cause que ce soit, sur peine d’estre punis comme séditieux et perturbateurs du repos public. »
Notes
- Pour plus de précisions, voir Olivier Got, « Histoire du mot scandale », Sigila, 33, 2014 : « Le scandale », p. 13-21.
- Bernard Guénée, Un meurtre, une société. L’assassinat du duc d’Orléans, 23 novembre 1405, Paris, Gallimard, 1992, p. 236.
- Voir notamment d’Arnaud Fossier, « “Propter vitandum scandalum” : histoire d’une catégorie juridique
(XIIe-XVe siècle) », Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge, 121, 2, 2009, p. 317-348 et « Scandale, vérité et gouvernement de l’Église (XIIe-XIVe siècle) », dans Jean-Philippe Genet (dir.), La Vérité. Vérité et crédibilité : construire la vérité dans le système de communication de l’Occident (XIIIe-XVIIe siècle), Paris/Rome, Publications de la Sorbonne/École française de Rome, 2015, p. 365‑377. - Claude de Ferrière, Introduction à la pratique, contenant l’explication des principaux termes de pratique, & de coûtume, Paris, J. Cochart, 1679.
- Le titre exact est : Nouvelle introduction à la pratique ou Dictionnaire des termes de pratique, de droit, d’ordonnances, et de coutumes. Avec les jurisdictions de France, Paris, Claude Prudhomme, 1734.
- Publié en 64 volumes, entre 1775 et 1783, [En ligne] https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4261656?rk=21459;2 [consulté le 25/10/2021].
- La première édition s’intitule Sommaire alphabétique, des principales questions de droit, de jurisprudence et d’usages des provinces du droit écrit du ressort du Parlement de Paris, Paris, 1766. Les éditions suivantes, revues et corrigées, sont parues avec un titre légèrement modifié : Questions de droit, de jurisprudence et d’usage des provinces de droit écrit du ressort du Parlement de Paris. Pour la dernière, de 1787, voir : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96064453.r=mallebay%20de%20la%20mothe?rk=64378;0 [consulté le 16/12/2021].
- Edme de la Poix de Fréminville, Dictionnaire ou Traité de la police générale des villes, bourgs, paroisses et seigneuries de la campagne, Paris, Gissey, 1758.
- Ibid., p. 537.
- « Petit Jean : Tout est perdu… Citron…/Vostre Chien … vient là-bas de manger un Chapon./Rien n’est seûr devant luy. Ce qu’il trouve, il l’emporte. Léandre : Bon, voila pour mon pere une cause./Main forte. Qu’on se mette apres lui. Courez tous. Dandin : Point de bruit ; Tout doux. Un Amené sans scandale suffit. » (Les Plaideurs, Paris, Claude Barbin, 1669, p. 66).
- Antoine-François Prost de Royer, Dictionnaire de jurisprudence et des arrêts, Lyon, Aimé de la Roche, 1781-84, t. IV, « Amener sans scandale », p. 535.
- Voir, par ex., Claude-Joseph de Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique, Toulouse, Jean Dupleix, 1779, p. 86.
- Pierre-François Muyart de Vouglans, Instruction criminelle, Paris, Desaint et Saillant, 1762, art. XVII, p. 222. Voir également les exemples jurisprudentiels cités par Encyclopédie de jurisprudence, Bruxelles, J.-L. de Boubers, 1779, t. V, p. 305-306.
- Ibid., t. V, v° « Amende honorable », p. 299.
- Dictionnaire universel françois et latin, op. cit., p. 1548.
- Prost de Royer, Dictionnaire de jurisprudence et des arrêts, op. cit.
- Arrêt du Parlement de Paris du 10 avril 1636, cité dans Recueil d’arrêts du Parlement de Paris, pris des mémoires de feu M. Pierre Bardet, Avignon, Pierre-Joseph Roberty, 1773, t. II, p. 232-233.
- Voir sur ce sujet Cyrille Dounot, L’Œuvre canonique d’Antoine Dadine d’Auteserre (1602-1682), Toulouse, Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, 2013.
- Voir les exemples donnés par Eric Wenzel, Le Monitoire à fin de révélations sous l’Ancien Régime, Villeneuve-d’Asq, Presses universitaires du Septentrion, 2001. Du même auteur, on peut lire : « Forcer les témoignages : le délicat recours au monitoire sous l’Ancien Régime » dans Benoît Garnot (dir.), Les Témoins devant la justice. Une histoire des statuts et des comportements, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2003, p. 83-90.
- Arrêts notables du Parlement de Dijon. Recueillis par François Perrier. Avec des observations sur chaque question, par Guillaume Raviot, Dijon, A.J.B. Augé, 1738, t. I, p. 110.
- Job Bouvot, Nouveau Recueil des arrests de Bourgogne, où sont contenues diverses notables questions de droit, Genève, P. et J. Chouet, 1623-28, t. II, p. 41, q. XLI et p. 701.
- Le monitoire, réintroduit par un texte du 10 septembre 1806, ne pouvait être ordonné que sur décision du ministre de la justice, seulement pour la répression de grands crimes. Voir Charles Berriat-Saint-Prix, Des Tribunaux et de la procédure du grand criminel au XVIIIe s. jusqu’en 1789, Paris, Auguste Aubry, 1859, p. 50 ; ou encore Jean-Marie-Emmanuel Le Graverend, Traité de la législation criminelle en France, Paris, Jean-Baptiste Duvergier, 1830, p. 215.
- Pierre-François Muyart de Vouglans, Les Lois criminelles de France dans leur ordre naturel, Paris, Merigot le jeune/Crapart/Morin, 1780, p. 580.
- Encyclopédie de jurisprudence, op. cit, p. 299.
- Pierre-François Muyart de Vouglans, Les Lois criminelles, op. cit., « Réfutation du Traité des délits et des peines », p. 827.
- Sur cet auteur, voir la notice de Laurent Pfister et les références bibliographiques dans le Dictionnaire historique des juristes français, Jean-Louis Halpérin, Jacques Krynen et Patrick Arabeyre (dir.), Paris, PUF, 2015.
- Jean Papon, Recueil d’arrestz notables, Lyon, Jean de Tournes, 1556, p. 22.
- Ibid., p. 35.
- Ibid., p. 179.
- Jean Papon, Recueil d’arrests notables des courts souveraines de France augmentez de plusieurs arrests, observations & curieuses recherches par Jean Chenu, Paris, Nicolas Buon, 1621, 4e éd., p. 8.
- Jean Papon, Recueil d’arrestz notables, op. cit., éd. 1556, p. 21.
- Jean Imbert, La Practique judiciaire, tant civile que criminelle (1563), Paris, Robert Fouët, 1609.
- Pierre-Toussaint Durand de Maillane, Dictionnaire de droit canonique et de pratique bénéficiale, Paris, Desaint et Saillant, 1776.
- Sylvie Daubresse, Conjurer la dissension religieuse. La justice du roi face à la Réforme (1555-1563), Seyssel, Champ Vallon, 2020, p. 114.
- Pierre-Toussaint Durand de Maillane, Dictionnaire de droit canonique, op. cit., v° « Doctrine », p. 563.
- Dictionnaire historique des juristes français, op. cit. Voir plus particulièrement Daniel Hickey, « Le rôle de l’État dans la réforme catholique : une inspection du diocèse de Poitiers lors des Grands Jours de 1634 », Revue historique, 624, 2002, p. 939.
- Jean Fillau, Décisions catholiques, ou Recueil général des arrests rendus en toutes les cours souveraines de France, Poitiers, Jean Fleuriau, 1668, p. 116.
- Arrêt de la Tournelle, 1er juin 1737, cité par Nicolas-Guy du Rousseaud de La Combe, Arrêts et règlements notables du parlement de Paris et autres cours souveraines, Paris, Paulus-du-Mesnil, 1743, p. 52.
- Arrêts et règlements notables, op. cit., p. 327, arrêts des 22 janvier 1652 et 16 juin 1674.
- Edme de La Poix de Fréminville, Dictionnaire ou Traité de la police générale des villes, op. cit. ; De semblables énumérations se trouvent aussi bien dans le Traité de la police de Nicolas de La Mare (1729) que dans le Dictionnaire universel de police de Nicolas-Toussaint des Essarts (1786).
- Benoît Plessix, L’Utilisation du droit civil dans l’élaboration du droit administratif, thèse de doctorat, dir. Jean-Jacques Bienvenu, soutenue en 2001, université Panthéon-Assas, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 2003, p. 612.
- Dictionnaire historique des juristes français, op. cit., v° « Procession de la Fête-Dieu ». Voir Fanny Cosandey, Le Rang. Préséances et hiérarchies dans la France d’Ancien Régime, Paris, Gallimard, 2016.
- Ibid.., v° « Églises, leur décence ».
- Ibid.., v° « Femmes de mauvaise vie ».
- Ibid.., v° « Cafés ».
- Ibid.., v° « Cabarets ».
- Ibid.., v° « Dimanches et fêtes ».
- Ibid., v° « Subsistance des pauvres ».
- Ibid., v° « Injures ».
- Muyart de Vouglans, Les Lois criminelles, op. cit., p. 758. Semblable affirmation devient courante au XVIIIe siècle. Voir par exemple L’Examen des remontrances du parlement de Normandie du 14 août 1753 (p. 17) : « En effet, qu’est-ce qu’un scandale public dans le langage des Jurisconsultes et des Lois, n’est-ce pas une action illicite qui cause de l’éclat parmi le peuple et qui l’offense ? C’est bien moins une espèce particulière de délit, qu’une circonstance aggravante de quelque délit public ».
- Alphonse Bérenger, De la justice criminelle en France, Paris, C.-F. Patris, 1818, t. I, p. 278.
- Jean-Guillaume Locré, La Législation civile, commerciale et criminelle de la France, Paris, Treuttel/Würtz, 1827-1832, t. XXIV, p. 108.
- Pellegrino Rossi, Traité de droit pénal, Paris, Guillaumin et Cie, 1855, t. I, p. 308.
- Jérémy Bentham, Traité de législation civile et pénale, Bruxelles, 1829, p. 239. Voir aussi son Essai sur la pédérastie (1785), Lille, Questions de genre/GKC, 2003, p. 87 ; comparer avec Cesare Beccaria, Des délits et des peines (1764), Lyon, ENS éditions, 2009, art. 36.
- Jacques-Pierre Brissot, Théorie des lois criminelles, Paris, J.-P. Aillaud, 1836, t. I, p. 251. Sur cette question, on peut voir Solange Ségala, « Quand la chair humaine rencontre la chair animale. Du crime de bestialité aux « sévices de nature sexuelle » commis envers un animal », dans Jean-Paul Andrieu et al. (dir.), La Chair, Mare et Martin, 2018, p. 145-163.
- Molière, Le Tartuffe ou l’imposteur, Paris, Jean Ribou, 1669, acte IV, scène 5, p. 74., v. 1505-1506.