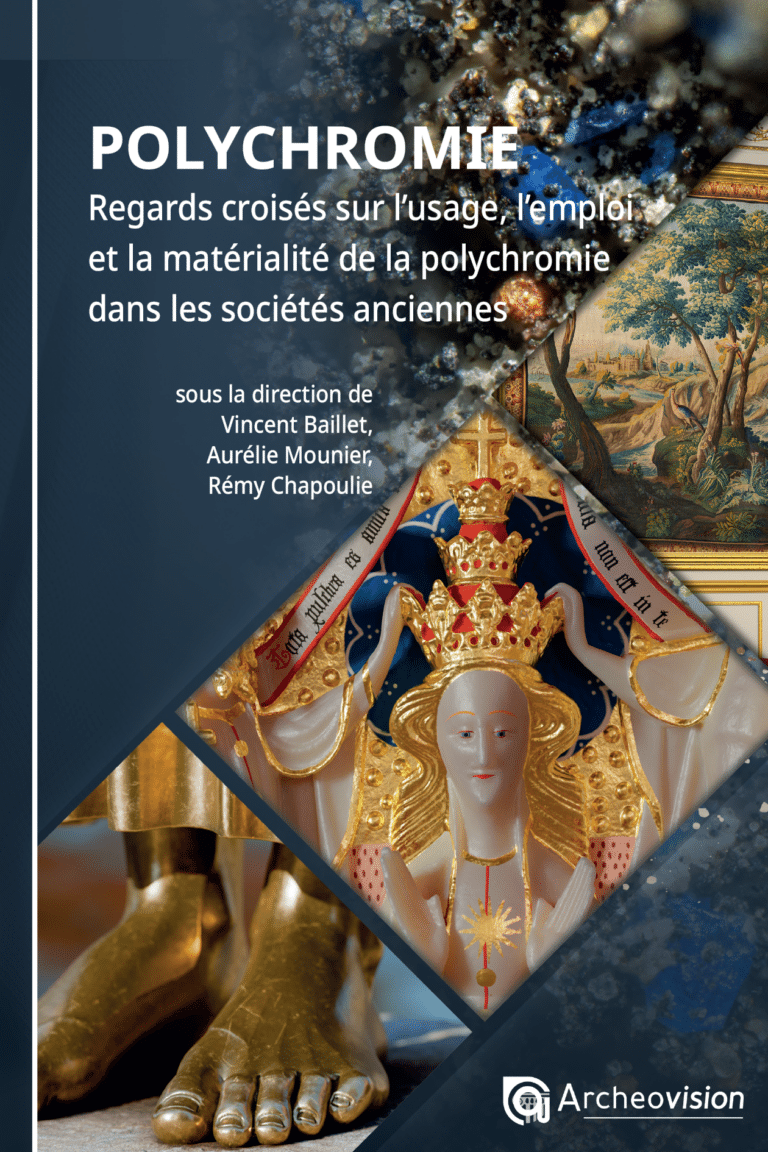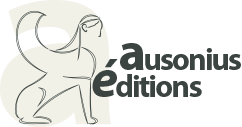Introduction : Un gisant longtemps oublié

Vestiges de tombeaux souvent anonymes et fréquemment perdus ou disparus, les gisants qui se caractérisent par la représentation sculptée d’un personnage défunt sur le couvercle de sa tombe, constituent des pièces archéologiques belles, mais rares.
En 2022, les collections funéraires du musée d’Aquitaine se sont enrichies par l’acquisition d’un gisant de chevalier, retrouvé en 2000 à Sadirac, au château Tustal, dans l’Entre-Deux-Mers. Cette pièce maîtresse, mise en dépôt au musée, est présentée au public depuis 2001 dans son parcours permanent.
Elle a fait l’objet de deux expositions temporaires dont l’une au Canada, mais aussi de diverses conférences et publications1.
Signalé pour la première fois en 1883 par Louis Augier dans le Bulletin de la Société archéologique de Bordeaux2, ce gisant n’a fait l’objet d’aucune étude jusqu’à celle, succincte, de Paul Roudié en 19643 sans aucun effet sur la protection de l’œuvre. Il a fallu attendre l’an 2000 pour que ce gisant retienne enfin l’attention et soit déposé définitivement au musée d’Aquitaine.
Conservé de nombreuses années au cœur d’un nymphée humide, le gisant a nécessité une restauration profonde pour supprimer les petites algues vertes, les lichens et autres micro-organismes qui proliféraient sur lui en raison de l’environnement dans lequel il se trouvait.
Taillé dans un bloc calcaire massif de qualité moyenne provenant de l’Entre-Deux-Mers, cet imposant monument funéraire affiche des dimensions remarquables, même si elles ne sont pas exceptionnelles. Il mesure 2,17 m de long, 0,6 cm de large et 0,42 m de hauteur, pour un poids de 650 kg.
Un chevalier gisant vieux de huit siècles
Ce gisant représente un chevalier revêtu de son équipement complet, ce qui lui confère un intérêt tout particulier. Le défunt repose allongé, la tête posée sur un coussin, les jambes étendues et les pieds droits et parallèles. Ses mains sont jointes à hauteur de la poitrine dans un geste de prière. Au pied du chevalier se trouve un animal acéphale représentant probablement un lion. Le chevalier est vêtu d’une cotte de mailles à capuchon, dont les manches se terminent par des gantelets, ainsi que de chausses de même nature. La cotte d’armes recouvre sur le corps la cotte de maille, tandis que se devine en dessous de cette dernière le gambison. L’armement offensif se résume à une épée large et courte, caractérisée par une longue poignée, terminée par un pommeau rond imposant. L’épée est maintenue par une ceinture lâche rattachée à une ceinture plus serrée. Elle est rangée dans un fourreau comme le suggère la bouterolle de pointe. Le chevalier porte des éperons finement sculptés. Son équipement défensif est complété par un écu de forme pointue au centre duquel figure majestueusement la représentation en relief d’un superbe lion couronné. Ce lion est dit rampant parce qu’il est dressé sur ses pattes postérieures. La gueule est dentée tandis que le cou est recouvert d’une crinière. Deux meubles héraldiques enrichissent la figure avec la présence d’une couronne et de griffes. Aucune trace de polychromie visible à l’œil nu ne subsiste.
La datation de ce gisant ne pose guère de difficultés, même si elle reste approximative. On peut affirmer qu’il s’agit d’une représentation d’un chevalier ayant vécu entre le 2e et le 3e quart du XIIIe siècle. Des arguments stylistiques, techniques, ethnologiques, archéologiques et héraldiques convergent en ce sens.
Cette œuvre constitue ainsi un témoignage fascinant et évocateur des réalités de la chevalerie et du système féodal en Aquitaine.
Un gisant énigmatique
À tort, la tradition populaire a longtemps affirmé que cette sculpture funéraire était celle du Prince Noir qui fut nommé par son père, le roi d’Angleterre, lieutenant de Gascogne en 1355.
La sépulture d’Édouard de Woodstock, prince de Galles, comte de Chester, duc de Cornouailles et Prince d’Aquitaine se trouve dans la cathédrale de Canterbury où il fut inhumé en 1376.
L’origine du calcaire issu d’Entre-deux-Mers témoigne de la provenance locale de cette œuvre qui figure un seigneur du lieu.
Au Moyen Âge, la ferveur religieuse poussait de nombreux fidèles à élire sépulture dans des lieux consacrés afin de favoriser le salut de leur âme. Chacun aspirait aux emplacements les plus favorables, à savoir à proximité du chœur, près d’un autel, dans une chapelle absidiale, les collatéraux ou les murs gouttereaux de l’édifice à l’extérieur.
Frère Etienne Dulaura, moine bordelais appartenant à la congrégation bénédictine de Saint-Maur de l’abbaye de la Sauve Majeure, consigna en 1683 dans son érudite Histoire de l’Abbaye de la Sauve Majeure :
“Je doute qu’il y ait eu aucune famille noble à 3 ou 4 lieues à la ronde, pour ne pas dire davantage, dont quelqu’une n’ait élu sa sépulture en notre église, que tout le monde regarda longtemps comme la plus illustre et la plus sainte du pays.”
Etienne Dulaura atteste l’existence de plusieurs sépultures à l’abbaye où se côtoient des ecclésiastiques, mais aussi des laïcs, tous issus de lignées influentes. Pour ces derniers, il s’agit des familles d’Albret, d’Escoussans, de Lataste, de Pressac et de Curton, qui sont toutes bienfaitrices de l’abbaye. La chronologie de ces sépultures remonte au moins au XIIIe siècle et elles sont donc bien contemporaines du gisant.
En l’absence de documentation, l’identification du gisant au lion couronné repose essentiellement sur l’examen de son blason. C’est évidemment un défi en raison des lacunes héraldiques concernant cette époque reculée. Les premiers armoriaux connus ne remontent qu’au milieu du XVe siècle, soit près de deux siècles après la réalisation de l’œuvre. Toutefois, d’autres sources ou d’autres indices permettent de formuler des hypothèses au sujet des familles identifiées.
On peut immédiatement éliminer la famille d’Albret dont le blason est “de gueule plain” c’est-à-dire tout de rouge sans aucune forme ni motif. Le gisant du chevalier au lion couronné ne peut donc relever de cette dynastie illustre.
En ce qui concerne la famille Lataste, les traces héraldiques demeurent incertaines et mystérieuses d’autant plus que de multiples branches généalogiques existent. Dès lors, tout est envisageable sans l’être en l’absence d’un blasonnement précis connu.
Léo Drouyn découvrit au XIXe siècle dans la grande salle du château de Langoiran, où vécut la famille d’Escoussans, une très riche décoration héraldique ornée de plusieurs animaux, dont un lion. L’absence de couronne sur ce dernier limite cependant la portée de cette hypothèse. La couronne, en effet, est une particularité propre au lion représenté sur l’écu du gisant.
Ce cas de figure se retrouve avec plus d’ambigüités dans le cas de la famille de Pressac. En effet, si l’armorial général de Jean Baptiste Rietstap, qui recense l’ensemble des blasons de la noblesse européenne au XIXe siècle, décrit la présence d’un lion couronné dans les armoiries de ce lignage, leur sceau de 1340 dément l’existence de cette couronne sur la tête de l’animal.
Enfin, l’hypothèse selon laquelle la famille de Curton pourrait être associée au gisant semble également devoir être écartée, en raison de l’existence d’un blason attesté au XIVe siècle, composé uniquement de losanges. Néanmoins, ce blason apparaît contradictoire avec les écrits du moine Etienne Dulaura qui indique que l’abbé “Barrau de Curton, de l’illustre famille des seigneurs de ce nom, dont le château n’est éloigné que d’une lieue et demie de la Sauve” fit graver en 1295 sur les piliers du réfectoire “le lion qui font les armes” de sa maison.
On a ici la preuve que la famille de Curton, voisine immédiate de l’abbaye de la Sauve-Majeure, arbore un lion dans son blason. Une découverte de Léo Drouyn au Château de Curton met également en évidence un lion dans un écartelé héraldique complexe. Cette représentation est particulièrement importante, puisque le lion est peint à cet endroit avec une couronne lui conférant une silhouette similaire à celle sculptée sur le gisant. Cependant, le blason découvert par Léo Drouyn date vraisemblablement de la fin du XVIe siècle et non pas du XIIIe siècle. Cette distorsion chronologique affaiblit le lien hypothétique entre les deux représentations. En effet, au XVIe siècle, ce n’est plus la famille originelle de Curton qui règne sur la seigneurie éponyme, mais la famille de Chabannes, dont l’écartelé aperçu par Léo Drouyn représente les armes. La puissante famille de Curton s’est éteinte au XIVe siècle faute de descendants mâles. La baronnie de Curton fut ensuite octroyée en 1451 par Charles VII à Jacques de Chabannes, chevalier et seigneur de La Palice, de Châlus et de Passy en récompense de ses services loyaux. Or cette famille ne présente aucun lien connu avec la famille de Curton originelle. Toutefois, il est grandement plausible que les Chabannes, devenus à leur tour barons de Curton en lieu et place d’un lignage éteint, aient finalement repris à leur compte les anciennes armoiries dans le but d’asseoir leur nouvelle autorité.
Par conséquent, la multiplication de nombreux faisceaux d’indices en direction du lignage de Curton, permet de penser que le gisant exposé constitue le dernier vestige de leur sépulcre, même s’il est impossible de l’affirmer.
Les nouvelles investigations autour de la polychromie originelle du gisant au lion couronné ont donc pour but de confirmer ou d’infirmer l’ensemble de ces hypothèses émises, d’où leur importance et leur utilité.
Précis méthodologique des analyses mises en œuvre sur le Gisant
Protocole d’acquisition 3D : le relevé micrométrique par photogrammétrie

Identifier et localiser des matières colorantes sur les objets du patrimoine historique reste toujours une tâche ardue. Les traces laissées sur les surfaces conservées sont très souvent extrêmement ténues. La sculpture du gisant présente au musée d’Aquitaine ne déroge pas à cette règle. En témoigne son état de conservation dégradé dû à son dépôt en milieu humide et aussi aux opérations de nettoyage réalisées après sa redécouverte, qui ont largement contribué à l’effacement progressif de sa parure polychromique.
Cette situation nous a amenés à mettre au point un protocole d’investigation qui favorise une localisation à une échelle très réduite, de traces de couleurs invisibles à l’œil nu.
À cet effet, nous avons fondé notre approche sur le protocole d’investigation “Traquer” qui a été mis au point dans le cadre du Grand Programme de Recherche “Human Past” de l’Université de Bordeaux4. Ce dernier a permis de rendre possible l’identification d’un certain nombre de traces de matières colorantes sur le gisant à partir d’une acquisition 3D par photogrammétrie à l’échelle micrométrique.
La photogrammétrie peut être définie comme une technique utilisant la photographie pour déterminer la forme et la position d’un objet dans l’espace. De manière conventionnelle, ce terme désigne une technique reposant sur une modélisation rigoureuse des images pour aboutir à une reproduction tridimensionnelle exacte d’un objet.
Cette technique est mise en œuvre à l’aide d’un appareil photographique. Il est nécessaire d’obtenir une superposition de 75 % entre chaque prise de vue, afin d’assurer une reconstruction complète de l’objet photographié5.
Dans le cadre de cette sculpture médiévale, les photographies ont été menées jusqu’à une échelle micrométrique, qui ont été géoréférencées à l’aide de prises de vue intermédiaires à plus grand champ.
Concrètement, ce relevé numérique se construit autour de plusieurs anneaux photographiques en deux phases. L’agrandissement de plus en plus précis des anneaux photographiques permet de localiser et de géoréférencer directement les traces de matières colorantes sur le modèle 3D généré par photogrammétrie.
La première phase fut réalisée avec un objectif Nikon Z7 35 mm afin d’obtenir un modèle 3D général de la sculpture du gisant. Ce procédé permet une acquisition photogrammétrique tout à fait classique, abondamment documentée dans la littérature scientifique6.
La deuxième phase a été conduite par l’intermédiaire d’un objectif Nikon Z7 100 mm (grossissement 1×) et un pas de 200 μm, afin de scruter attentivement les zones considérées comme les plus propices présentant encore des traces de polychromie préservées.
La mise en œuvre de ce protocole a permis d’obtenir une véritable cartographie des matières colorantes restantes sur la sculpture du gisant. À cet effet, on distingue trois zones d’intérêt :
- Le bouclier du gisant : le bord extérieur droit, ainsi que l’intérieur de la patte gauche du lion ont révélé la présence de trace de matières colorantes jaunes. Par ailleurs, on distingue des traces bleutées à proximité des griffes de la patte supérieure gauche du lion.
- Le socle du gisant : les relevés numériques du lit supérieur du socle ont permis d’identifier l’existence de traces de matières colorantes bleues.
- Le gisant : la dernière zone d’intérêt concerne la statue du gisant sur laquelle de multiples traces ont pu être décelé par le relevé numérique micrométrique. On note la présence de pigments bleus sur le bas de la tunique de la jambe droite. De plus, on constate l’existence de multiples traces de matières colorantes rouges sur les ourlets de la veste ou encore à gauche de la tête et plus précisément sur le camail du chevalier.
Cette prospection à l’échelle micrométrique s’est avérée indispensable à double titre : tout d’abord, elle permet de révéler des traces de matières colorantes qui jusqu’à alors n’ont jamais pu être observées.
Au regard, de la faible taille de ces traces, leurs localisations précises permettent de faciliter également la mise en œuvre des analyses archéométriques par les appareils de mesures destinés à la caractérisation de ces matières colorantes.
Enfin, le caractère ténu de ces traces de polychromies nous invite à multiplier, ainsi qu’à croiser les différentes techniques analytiques, afin de garantir la rigueur des résultats obtenus. À ce titre, il convient de rappeler quelques implications techniques et méthodologiques propres à ces techniques analytiques.
Analyses archéométriques pour la caractérisation des traces de matières colorantes
Microscopie optique (Dino-Lite)
Deux microscopes optiques portables Dino-Lite (AM7915MZT permettant de grossir de 10× à 200× et AM7515MT4A de 400× à 470×) ont été utilisés pour identifier et photographier les traces polychromes relevées par photogrammétrie, tous deux dotés d’une résolution de 5 mégapixels (fig. 3a).
Spectroscopie de réflectance par fibre optique dans le visible et dans le proche infrarouge (FORS-VIS et FORS-NIR)
La spectroscopie de réflectance par fibre optique (FORS) permet de collecter, par des mesures ponctuelles, les spectres de réflectance de zones difficiles d’accès (creux, zones à l’ombre…) grâce à sa fibre optique. Le système est constitué d’une lampe halogène de 20 W (HL2000, Ocean Optics) associée à un spectrophotomètre Thorlabs (CCS200/M-200-1000 nm) pour les études dans le visible (VIS) et un détecteur à photodiode InGaAs (ARCoptix FT-NIR Rocket) dont la gamme de mesure s’étend de 11000 à 3800 cm-1 (900 à 2600 nm) pour l’analyse dans le proche infrarouge (NIR).
Les mesures ont été collectées à l’aide d’un faisceau de fibres optiques (en forme de Y) constitué de sept fibres optiques (400 nm de diamètre – six fibres d’illumination autour d’une fibre de collecte). Le diamètre du faisceau d’analyse est d’environ 3 mm.
La sonde a été positionnée perpendiculairement à la surface pour enregistrer les spectres de réflectance avec une résolution inférieure à 2 nm.
Afin de réduire le signal provenant de la pierre et de permettre l’observation d’une réflexion caractéristique de la couleur, un carton noir avec un trou d’un diamètre de 2 mm a été utilisé comme masque (fig. 3b). L’instrument a été étalonné à l’aide d’une référence Spectralon® blanche.
Imagerie hyperspectrale (HSI)
L’imagerie hyperspectrale permet d’acquérir des données spectrales continues sur l’ensemble d’une image, ce qui permet une caractérisation spectrale complète des matériaux sur une zone étendue. L’analyse a été réalisée à l’aide d’une caméra hyperspectrale Specim ultraportable IQ (SPECIM Spectral Imaging Ltd., Finlande) (fig. 3c). Chaque pixel d’une image hyperspectrale contient une information qui est un spectre de réflectance dans le visible et proche infrarouge (400- 1000 nm). L’exceptionnelle portabilité de la caméra, qui ne pèse que 1,3 kg, et ses dimensions compactes (207×91×126 mm) la rendent particulièrement adaptée à l’analyse in situ. Sa capacité à fonctionner efficacement à courte distance et le contrôle en temps réel de l’acquisition et de la visualisation des données soulignent encore davantage son intérêt. Les traces polychromiques ont été examinées en positionnant la caméra, montée sur un trépied photographique, face à la zone d’intérêt et entre deux lampes halogènes disposées symétriquement à 45 degrés. L’appareil a été positionné le plus près possible du support (environ 170 mm, étant donné que la plage de mise au point est d’au moins 150 mm) afin de maximiser la résolution et d’offrir la possibilité de capturer sélectivement uniquement les pixels représentatifs du pigment. L’instrument a été étalonné à l’aide d’une référence Spectralon® blanche. Les data-cubes (fichiers générés par la caméra hyperspectrale) acquis dans le cadre de cette étude ont été traités à l’aide du logiciel ENVI 5.2 + IDL.
Le logiciel ENVI et le traitement Spectral Hourglass Wizard (ENVI-SHW) a été appliqué au cube de données afin de simplifier le processus d’analyse spectrale en extrayant et en analysant les composants clés de l’image. Ce logiciel a été utilisé pour générer des cartes spectrales illustrant la distribution spatiale des pigments à l’aide d’un algorithme de classification appelé Mixture Tuned Matched Filtering (MTMF).
Cet algorithme permet tout d’abord de discriminer et de classer toutes les signatures spectrales uniques de la zone étudiée (appelées endmembers), ce qui permet ensuite de détecter et surtout de localiser la signature spectrale caractéristique du pigment sur l’ensemble de la zone examinée.
Après avoir déterminé le spectre de réflectance caractéristique des traces colorées, il est possible d’identifier les pigments en comparant les bandes spécifiques des spectres (absorption, points d’inflexion, etc.) avec des spectres de référence.
Ces hypothèses peuvent ensuite être complétées et confirmées par l’aide de méthodes spécifiques telles que la fluorescence de rayons X.
Spectrométrie par fluorescence de rayons X portable (pXRF)
La fluorescence de rayons X portable (pXRF) permet l’étude des éléments chimiques présents dans les pigments. Cette analyse a été réalisée à l’aide de l’analyseur portable Olympus Vanta VCR-CCX-G2 (fig. 3d). Le spot d’interaction a un diamètre de 3 mm avec une caméra intégrée. Le tube à rayons X de 40 kV émet deux faisceaux de différentes énergies pour analyser les éléments : un faisceau à 40 keV pour les éléments lourds et un faisceau à 10 keV pour les éléments légers. Le temps total d’analyse est de 30 secondes. Le traitement des données a été effectué à l’aide du logiciel PyMCA.

Résultats des analyses archéométriques menées sur le gisant
L’étude analytique a permis de mettre en évidence et de caractériser des nombreuses traces de polychromie sur le gisant, notamment des traces de jaune sur le bouclier, de bleu sur la surface où le chevalier est posé et de rouge sur sa veste. Les spectres acquis lors de l’analyse des points FORS dans le visible apparaissent superposés à ceux obtenus avec la caméra hyperspectrale, confirmant la reproductibilité et la précision du signal obtenu. Afin d’éviter les répétitions, on a choisi de ne présenter que les spectres acquis avec la caméra hyperspectrale. Malheureusement, les spectres FORS dans l’infrarouge n’ont pas donné de résultat satisfaisant en raison de la réflexion intense du substrat rocheux, c’est pourquoi ils ne seront pas pris en compte dans ce rapport. En outre, la statue présente de nombreuses taches noires et blanches qui ont été considérées comme des résultats de la dégradation physique et biologique du support rocheux. Dans la présente contribution, seules les traces chromatiques définies comme attribuables à la polychromie d’origine seront traitées.
Traces de couleur jaune sur le bouclier
Des traces de jaune et de bleu ont été identifiées sur le bouclier, près de la couronne du lion, comme l’illustre la figure 3a (carrés en pointillés). La figure 3b montre la position de la photographie IQ, superposée au modèle 3D obtenu à partir de l’étude photogrammétrique. Dans cette zone, de nombreuses traces de pigment jaune ont été identifiées. Dans la figure 3c, la cartographie en fausses couleurs obtenue grâce à l’algorithme MTMF permet d’observer la localisation précise des régions colorées identifiées par la caméra hyperspectrale. Le spectre de réflectance représentatif de la couleur jaune dans la zone étudiée présente un point d’inflexion autour de 510 nm, qui a pu être identifié comme dû à de l’orpiment (As2S3)7. Le spectre observé ainsi que le spectre de référence de l’orpiment sont présentés dans la figure 3d. La couleur observée peut être décrite comme un jaune chaud et brillant (couleur bien visible au microscope optique portable, fig. 3e).
En raison de sa brillance, qui rappelle celle d’un métal précieux, l’orpiment est également connu sous le nom de “pigment du roi” et a souvent été utilisé à la place de l’or pour créer des effets visuels similaires8. Nous avons cherché à confirmer cette interprétation en utilisant la fluorescence X, qui aurait pu identifier les éléments As et S. Malheureusement, les analyses XRF sur les traces jaunes n’ont pas produit de résultats significatifs, car le spectre acquis se superpose exactement au spectre du substrat rocheux. Donc les éléments As et S n’ont pas été détectés, vraisemblablement en raison de la dimension trop réduite de la zone colorée

Il a été particulièrement important d’identifier, après une étude détaillée de la photogrammétrie, une deuxième zone du bouclier où d’autres traces de pigment jaune sont clairement visibles. Elles sont situées près de la partie inférieure de la patte du lion, comme le montre la figure 5. Malgré l’absence de spectre de réflectance relatif, la similitude évidente de la couleur des traces suggère une même origine pigmentaire.
Traces de couleur bleu
Des traces de pigment bleu foncé ont été découvertes sur le socle du gisant, au niveau de son épaule droite (localisation de la zone d’intérêt en figure 5a et superposition de l’image IQ sur la photogrammétrie en figure 5b). Dans la figure 5c, la cartographie en fausses couleurs de l’analyse hyperspectrale montre que les traces identifiées suivent une trajectoire linéaire, ce qui semble indiquer que les opérations de restauration, en particulier le nettoyage effectué dans le sens longitudinal, peuvent être à l’origine de cette dispersion. Le spectre de réflectance (fig. 5d), avec un pic de réflectance à 475 nm et un point d’inflexion à 787 nm, pourrait permettre l’attribution des traces de couleur bleue au bleu outremer (Na7Al6Si6O24S3), potentiellement mélangé au blanc de plomb9.
En outre, la présence d’un pic de réflectance autour de 650 nm semble suggérer un mélange du bleu avec un pigment rouge. Le bleu outremer, dont la couleur est communément identifiée comme un bleu profond et brillant, semblable à celle observée au microscope (fig. 5e-f), est l’un des pigments bleus les plus nobles connus dans le passé. Il était extrait de la pierre précieuse appelée lapis-lazuli, une variété de lazurite, un minéral coûteux composé de sodium, de calcium, d’aluminium et de sulfate.

Dans le contexte des œuvres en pierre et des sculptures, l’utilisation de l’outremer naturel symbolisait généralement l’importance et la signification du sujet représenté10. L’analyse élémentaire par la technique de fluorescence X semble renforcer les résultats de l’imagerie hyperspectrale. Cette analyse a révélé la présence d’oxydes de sodium, d’aluminium et de silicium, tous attribuables au bleu outremer. La présence de fer détectée pourrait en outre s’expliquer par la teneur en fer relativement élevée des matières premières concernées11. Des analyses invasives (prélèvement et analyse en laboratoire) seraient nécessaires pour confirmer cette attribution.
D’autres traces de pigment bleu ont été trouvées à deux endroits différents du gisant : l’une près des griffes de la patte supérieure gauche du lion sur le bouclier (fig. 6a-b) et l’autre sur la tunique du chevalier, près d’une tache rouge (cette dernière sera examinée en détail dans le paragraphe suivant) (fig. 6c-d). Malheureusement, il n’a pas été possible d’extraire les spectres attribuables à la couleur bleue des images IQ obtenues, en raison des limitations de l’instrument et des ombres créées par la surface non plane de la statue. Par conséquent, une comparaison avec les données précédemment décrites n’a pu être réalisée.
Traces de couleur rouge
De multiples traces de pigment rouge ont été détectées dans différentes zones du gisant, notamment sur la veste et le camail (fig. 8 et 9). Sur le camail du chevalier, les traces de pigment rouge s’étendent sur toute la longueur verticale (clairement visibles dans la représentation en fausses couleurs en figure 8b), laissant supposer qu’il était entièrement coloré à l’origine. Le spectre de réflectance de cette zone présente un point d’inflexion à 600 nm, permettant d’attribuer le pigment au cinabre, un pigment précieux utilisé pour créer des nuances rouges intenses12.
Cette attribution semble également confirmée par la couleur rouge vif et intense observée au microscope (fig. 8d). L’association de lapis-lazuli avec le cinabre pouvait évoquer des symboles liés à la royauté, à la spiritualité ou à la richesse, de sorte que sa présence dans les œuvres d’art médiévales contribuait au prestige visuel des objets artistiques.

D’autres traces de pigment rouge ont été identifiées à divers emplacements de la veste (fig. 8). En particulier, sur le bord droit, où l’analyse hyperspectrale (fig. 8a-b) a révélé la présence de plusieurs zones avec des traces rouges longitudinales provenant du même pigment. Des traces attribuables au même pigment ont également été observées sur les ourlets de la veste. Dans la figure 8c, le cadre en pointillés rouges indique l’emplacement des zones d’analyse en hyperspectral IQ_867 et IQ_871. Dans les figures 8e-f-g-h, on peut observer ces images IQ en fausses couleurs et leur superposition dans la reconstruction 3D. Remarquablement, les traces de couleur observées présentent des motifs circulaires, comme si le restaurateur avait effectué un travail de brossage rotatif. Dans les traces analysées, le spectre de réflectance révèle un point d’inflexion à 586 nm, suggérant la possibilité d’un mélange de cinabre et d’ocre rouge (fig. 8d). Une explication plausible réside dans les dimensions importantes de la veste et le coût élevé du cinabre. Il est envisageable qu’afin d’optimiser les coûts et de réduire la quantité de pigment utilisée, la décision ait été prise d’incorporer de l’ocre rouge à la composition. Aussi, le peintre a peut-être fait le choix de mélanger deux pigments rouges pour faire varier les tonalités et hiérarchiser les zones.

Conclusion : un gisant polychrome
Du point de vue des analyses archéométriques, l’utilisation de l’imagerie hyperspectrale a prouvé son efficacité dans l’analyse approfondie des traces de polychromie qui ont été conservées sur la statue du gisant du présumé chevalier de Curton. Cette technique a facilité la localisation, la cartographie et l’identification précise de différentes zones de polychromie, permettant de caractériser les pigments utilisés. En particulier, des pigments bleus ont été détectés dans la zone du support sur lequel repose le chevalier, des traces de pigments jaunes et bleues ont été trouvées sur le bouclier, et des pigments rouges ont été observés dans diverses parties de la veste et du camail. L’association de la microphotogrammétrie à l’imagerie hyperspectrale semble être une nouvelle piste méthodologique à développer dans le cadre des études s’attachant à révéler d’infimes restes de polychromie. Cette combinaison a aussi fait ses preuves dans le cadre de l’étude du temple de Delphes en mai 202313. L’association de ces deux méthodes présente à l’évidence une grande efficacité dans l’étude de la polychromie.
Concernant le cadre historique, les résultats de l’analyse physico-chimique indiquent l’utilisation de pigments de grande valeur, ce qui suggère que la sculpture a probablement été commanditée par des personnes aisées de l’aristocratie. L’analyse physico-chimique renforce donc l’importance artistique et historique de cette sculpture médiévale et soutient l’hypothèse initiale selon laquelle le chevalier pourrait appartenir à la famille de Curton.
Dans une volonté de conforter ces résultats, il serait souhaitable d’effectuer des prélèvements microscopiques sur les traces de matières colorantes. Elles permettraient une caractérisation plus fine des pigments, en utilisant d’autres méthodes de laboratoire telles que la spectroscopie infrarouge à transformer de Fourier (FTIR), la spectroscopie Raman et la microanalyse à rayons X à dispersion d’énergie (MEB-EDX). Ces méthodes offriraient une meilleure résolution pour une compréhension plus approfondie de la composition des pigments et des liants utilisés à la période médiévale.
Ainsi, le Moyen Âge fut une époque particulièrement colorée. L’héraldique médiévale repose sur une codification précise. Le nombre des couleurs employées est volontairement restreint. Surtout, elles se subdivisent en deux catégories, avec les métaux qui sont au nombre de deux et les émaux qui sont au nombre de cinq. Les premiers regroupent l’or et l’argent, représentés par l’emploi respectif du jaune et du blanc. Les seconds comprennent le bleu (azur), le rouge (gueules), le noir (sable), le vert (sinople) et le violet (pourpre). Une règle essentielle de l’héraldique interdit de superposer deux éléments de même nature. Ainsi, un métal ne peut absolument pas recouvrir un autre métal. Il en va de même pour les émaux. Cette contrainte a pour unique finalité d’assurer un fort contraste des couleurs. Il existe d’autres combinaisons à l’origine des fourrures comme l’hermine, qui est un champ d’argent moucheté de sable ou le vair qui alterne à la fois azur et argent.
La qualité des pigments retrouvés sur le gisant témoigne également de la volonté pour ses commanditaires de lui conférer une dimension solennelle et éclatante. Son coût perceptible suggère un lignage aisé dans ses dépenses, mais sans être non plus obligatoirement riche comme le prouve un certain nombre de limites dans l’exécution de l’œuvre ou la diversité qualitative de certains pigments utilisés.
Ainsi, l’étude approfondie de la polychromie, combinée à une analyse comparative des armoiries connues, peut constituer ici une nouvelle clef d’interprétation pour son identification.
Discussions autour des nouvelles hypothèses d’identification
La mise en évidence de traces de polychromie sur l’œuvre ouvre de nouvelles perspectives d’analyse. La découverte de pigments bleus sur le support funéraire du chevalier et de pigments rouges sur son vêtement et son camail confirme l’usage fréquent de ces couleurs dans l’art funéraire et leur popularité comme en témoignent les gisants polychromes d’Aliénor d’Aquitaine et d’Henri II Plantagenet.
Par ailleurs, la présence de pigments jaunes sur l’écu offre une nouvelle piste d’interprétation héraldique. Cependant, cette trace ténue retrouvée sur le blason doit impérativement faire l’objet d’une vérification approfondie afin d’écarter toute coïncidence liée à l’utilisation de peinture jaune sur le support de l’œuvre en 2001 pour sa présentation. Un “accident” de peinture est d’ailleurs visible sur la pierre avec une trace jaune contemporaine au bas de la dalle.
Cette précaution n’est pas vaine puisque la présence d’or sur l’écu-même et non sur la couronne ou les griffes du lion remet en question l’attribution de ce gisant à la famille de Curton.
En effet, le blason des seigneurs de Chabannes, barons de Curton et seigneurs de la Palice, est décrit dans l’armorial de Jean-Baptiste Riestap comme étant “ de gueule au lion d’hermine armé, lampassé et couronné d’or”. La couleur jaune ainsi observée ne saurait donc n’être associée aux armoiries des Curton, du moins pas dans la zone où ces pigments ont été retrouvée, l’écu étant tout de rouge.
Il ne peut également s’agir, dans ces circonstances, non plus d’un seigneur de Pressac dont le blason est “d’argent au lion de gueule armé, lampassé et couronné d’azur”. L’or ne figurant pas dans leur blason, les seigneurs de Pressac sont donc également éliminés. Si la branche des Pressac, Soudan de la Trau, a un blason composé “d’or au lion de gueule armé et lampassé de sable”, l’absence de la couronne ne permet pas cependant non plus d’y rattacher le gisant. Cette absence est bien confirmée par le moulage d’un sceau de 1634 et une plaque d’orfèvrerie fabriquée en 1421 et conservée dans la chapelle Saint-Georges du château de Windsor.
Ainsi, si les sources documentaires et les données archéologiques tendent à privilégier une attribution du gisant aux seigneurs de Curton selon nos hypothèses, suivis de près par leurs voisins, les seigneurs de Pressac, force est de constater que ces deux pistes se fragilisent avec la découverte de pigments jaunes sur l’écu et non pas sur la couronne ou les griffes.
Témoin silencieux, vieux de huit siècles, le chevalier au lion couronné garde encore jalousement ses secrets, conférant à cette œuvre une aura à la fois énigmatique et fascinante, qui continue d’émerveiller les visiteurs du musée d’Aquitaine.
Remerciements
Nous tenons à remercier les équipes du musée d’Aquitaine pour l’accueil qui nous a été réservé à l’occasion des analyses qui ont été menées sur le gisant de Curton en 2023. À cet effet, nous tenons à adresser nos sincères remerciements à Christian Block (Conservateur du Patrimoine des collections médiévales et modernes au musée d’Aquitaine) pour son implication et son expertise tout au long de cette étude. Par ailleurs, cette étude a bénéficié du soutien financier du gouvernement français dans le cadre du programme IdEx “Investissements d’avenir” de l’Université de Bordeaux / GPR “Human Past”.
Bibliographie
Aceto, M., Agostino, A., Fenoglio, G., Idone, A., Gulmini, M., Marcello, P., Ricciardi, P. et Delaney, J.K. (2014) : “Characterisation of colourants on illuminated manuscripts by portable fibre optic UV-visible-NIR reflectance spectrophotometry”, Analytical Methods. [https://doi.org/10.1039/C3AY41904E]
Aicardi, I., Chiabrando, F., Lingua, A. et Noardo, F. (2018) : “Recent trends in cultural heritage 3D survey: The photogrammetric computer vision approach”, Journal of Cultural Heritage, 32, Turin, 257-266. [http://dx.doi.org/10.1016/j.culher.2017.11.006]
Augier, L. (1883) : “Compte rendu de la séance de 1883”, Bulletin de la Société Archéologique de Bordeaux, Bordeaux.
Baillet, V., Chapoulie, R., Dutailly, B., Galluzzi, F., Mora, P. et Mounier, A. (2024) : “A new approach to locate, characterise and restore in 3D polychromy of Apollo’s temple at Delphi (4th century B.C.)”, Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage, 34, Bordeaux. [https://doi.org/10.1016/j.daach.2024.e00345]
Block, C. (2001) : Le gisant du chevalier au lion couronné, Bordeaux.
Burgio, L., Clark, R.J.H., Martin, G., Pantos, E. et Roberts, M. (2003) : “A Multidisciplinary Approach to Pigment Analysis: King’s Yellow and Dragon’s Blood From the Winsor and Newton Pigment Box at the Victoria and Albert Museum”, in : Tsoucaris, G. and Lipkowski, J., eds. : Molecular and Structural Archaeology : Cosmetic and Therapeutic Chemicals, 61-72. [https://doi.org/10.1007/978-94-010-0193-9_6]
Cosentino, A. (2014) : “FORS Spectral Database of Historical Pigments in Different Binders”, e-conservation Journal, 54-65.
Delevoie, C., Dutailly, P., Mora, P. et Vergnieux, R. (2012) : “Un point sur la photogrammétrie”, Archéopages Archéologie & société, 34, 86-89. [https://doi.org/10.4000/archeopages.410]
Le Hô, A.-S. et Pagès-Camagna, S. (2014) : “La polychromie de la sculpture médiévale française, XIIe-XVe siècles. Bilan des examens et analyse entrepris au C2RMF”, Technè, 39, 34-41. [https://doi.org/10.4000/techne.11940]
Méhu, D. (2003) : Gratia Dei. Les chemins du Moyen Âge, Montréal.
Plesters, J. (1966) : “Ultramarine Blue, Natural and Artificial”, Studies in Conservation, 11, 2, 62-91. [https://doi.org/10.2307/1505446]
Roudié, P. (1964) : “Notes sur deux gisants girondins”, Bulletin de la Société Archéologique de Bordeaux, Bordeaux.
Sapirstein, P., (2015) : “Photogrammetry as a Tool for Architectural Analysis: The Digital Architecture Project at Olympia”, in : Papadopoulos, C., Paliou, E., Chrysanthi, A., Kotoula, E. et Sarris, A., eds. : Archaeological Research in the Digital Age, Rethmno, 129-139.
Notes
- Block 2001 ; Méhu 2003.
- Augier 1883.
- Roudié 1964.
- Baillet et al. 2024.
- Delevoie et al. 2012, 86-89.
- Sapirstein 2015, 129-139 ; Aicardi et al. 2018, 257-266.
- Cosentino 2014, 54-65.
- Burgio et al. 2003, 61-72.
- Aceto et al. 2014.
- Le Hô et al. 2014, 34-41.
- Plesters 1966, 62-91.
- Aceto et al. 2014.
- Baillet et al. 2024.