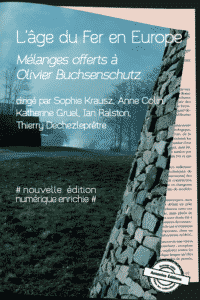UN@ est une plateforme d'édition de livres numériques pour les presses universitaires de Nouvelle-Aquitaine
Lieu d'édition : Pessac
La multiplicité des représentations cartographiques rend aujourd’hui quasi impossible tout inventaire fin et raisonné. Sur quoi se fonder : la qualité de la représentation ou de la facture, le nombre des détails figurés, l’évaluation de la précision, l’échelle… ?
Publié en 1996, le document d’évaluation du patrimoine archéologique de la ville de Bourges constitue une synthèse des éléments de topographie du milieu urbanisé. Ce travail, qui comprend une série de cartes de topographie historique, permet de situer les jalons topographiques par période sur un fond dont les courbes de niveau sont espacées tous les 5 m.
La présence de remparts protohistoriques montrant des signes clairs de vitrification est un fait démontré par les analyses physico-chimiques et les fouilles menées au cours des dernières années, suite à leur repérage à la fin du siècle dernier.
par Jörg Biel
L’étude de l’âge du Fer, principalement celui des débuts de la période, est longtemps restée tributaire de l’archéologie funéraire . La recherche sur les fortifications, en particulier sur les oppida de La Tène finale, constituait une exception. Les habitats de plaine non fortifiés, à fortiori la typologie des bâtiments isolés, étaient largement inconnus.
Comprendre la relation entre habitats de hauteur fortifiés et territoire environnant est un des enjeux majeurs des études micro-régionales. Le statut de l’habitat et les modalités de son emprise sur les terroirs avoisinants sont au cœur des problématiques d’occupation. Habitat d’une élite locale ? Contrôle des passages et/ou contrôle des terres agricoles et des ressources minérales ou surveillance de la côte ?
par Fabien Delrieu
Les habitats protohistoriques de hauteur ont souvent été l’objet d’investigations archéologiques anciennes, parfois même dès le XVIIIe s. Plus récemment, les difficultés d’accès ou l’absence d’aménagement dans leur emprise n’ont pas permis de développer de programmes de recherche structurés avec les moyens de l’archéologie préventive. De ce fait, il existe des centaines de fortifications en France qui ne sont pas ou mal datées. C’est pour répondre à cette lacune, que, dès 2007, un programme de recherche visant à échantillonner ces sites afin de préciser leur attribution chronologique a été lancé en Basse-Normandie.
La multiplicité des représentations cartographiques rend aujourd’hui quasi impossible tout inventaire fin et raisonné. Sur quoi se fonder : la qualité de la représentation ou de la facture, le nombre des détails figurés, l’évaluation de la précision, l’échelle… ?
En 1995, Olivier Buchsenschutz sollicitait quatre chercheurs pour réfléchir avec lui sur le rapport entre l’Histoire et les données archéologiques, dans un article d’Histoire et Mesures, intitulé “Histoire quantitative et archéologie protohistorique”. On y faisait le point sur les outils utilisés pour reconstituer l’évolution économique à long terme des cultures protohistoriques.
L’expression “chaîne opératoire” n’est pas fréquemment utilisée dans l’œuvre scientifique d’Olivier Buchsenschutz. Il a néanmoins exprimé ses vues dès 1987 dans un article intitulé “Archéologie, technologie, culture”, dans lequel il évoque l’importance des “processus techniques”, de la fonction et de la “reconstitution de la chaîne opératoire” dans l’étude de la culture matérielle.
par Sophie Krausz
À quelques kilomètres de Châteauroux, dans un lieu écarté et secret du Berry, se trouve la bonne ville de Levroux, enserrée entre Boischaut et Champagne.
Lorsqu’en 1858 Ferdinand Keller affronte l’épineuse question de la datation des vestiges que l’on venait de mettre au jour à La Tène, l’idée que l’on pouvait se faire de la chronologie des objets, que l’on découvrait au gré des fouilles et du hasard, était loin d’être claire.
Pour les étudiants ou les jeunes chercheurs, ce que pouvait être l’enseignement de l’archéologie à Paris avant 1968 relève sans doute de la préhistoire.